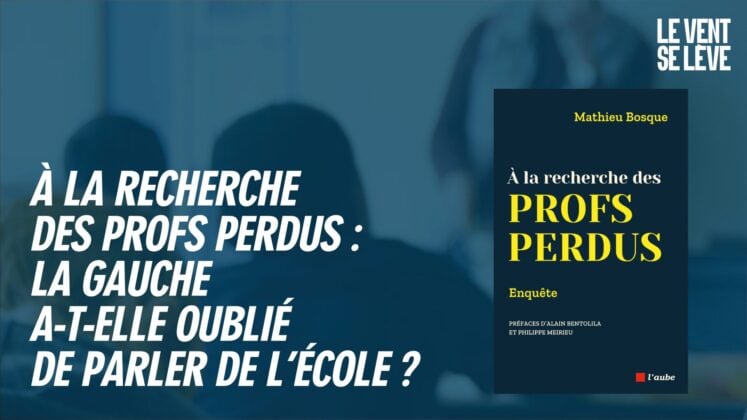Arthur Nesnidal, tout jeune auteur alors âgé de 22 ans à la parution de son premier roman intitulé La Purge dans lequel il met en scène l’expérience d’un personnage en classe préparatoire aux grandes écoles, nous a accordé un entretien sur la place de son roman – et du roman en général – dans la bataille culturelle. Selon lui, La Purge est un pamphlet contre notre société méritocratique dans laquelle règne une compétition acharnée qui transforme le droit de vivre dignement en privilège réservé à certains. Entretien réalisé par Romain Lacroze.
LVSL — Vous avez écrit La Purge, votre premier roman, paru chez Julliard en août 2018 (bientôt en poche). C’est un roman pamphlétaire, assez court, engagé dans la bataille culturelle ouvertement en faveur des opprimés. Ce livre met en scène un narrateur en classe préparatoire qui se montre très critique vis-à-vis de ce système, mais pas seulement… Qu’aviez-vous à dire en écrivant La Purge ? Et pourquoi avoir choisi cette forme du roman pour le dire ?
Arthur Nesnidal — Il me semble que c’est extrêmement clair, ne serait-ce que quand je dédicace mon livre aux résistants, c’est-à-dire à ceux qui restent dignes. Les gens dignes sont ceux qui s’affirment, qui existent par leur résistance à l’oppression. C’est un livre qui dénonce l’oppression et la reproduction des élites. Je me sers des classes préparatoires comme d’un prétexte pour dénoncer un système beaucoup plus vaste, celui de la reproduction des élites, de la confiscation de la culture classique par une élite. En fait, quand je dis « élite », j’entends « oligarchie ». C’est l’oligarchie que j’ai dans le viseur de mon bouquin.
« Je me sers des classes préparatoires comme d’un prétexte pour dénoncer un système beaucoup plus vaste de reproduction des élites, de confiscation de la culture classique par une élite »
D’autre part, il s’agit d’un roman parce que c’est beaucoup plus efficace que n’importe quelle autre forme littéraire pour ce que je veux en faire. Mon objectif est de dénoncer, de susciter l’indignation, la colère et la révolte. Un essai ne me conviendrait pas parce que la forme rigoureuse de la démonstration scientifique, comme on aurait dans un essai sociologique qui s’appuierait sur des statistiques, ne permet pas de susciter l’indignation. L’essai permet plutôt d’avoir une vue suffisamment précise de la situation pour rédiger un texte de loi par exemple. Un essai sociologique s’approche plus du travail du législateur que de l’invitation à l’insurrection populaire. En définitive, le roman incite à taper du poing sur la table. C’est plus puissant, cela a plus d’impact…
Il y a aussi d’autres raisons à ce choix : je ne suis pas sociologue, donc, je ne peux pas, de toute façon, me permettre d’écrire autrement que dans une forme purement littéraire ou artistique pour dénoncer un système violent. D’autant plus que, j’insiste, mon sujet ne traite pas des classes préparatoires, il dénonce un système beaucoup plus vaste de reproduction des élites. Si je rédigeais un essai de sociologie, je serais obligé de cadrer mon sujet et d’étudier en elles-mêmes les classes préparatoires. D’une certaine manière, je serais à côté de ce que je voulais faire. Je serais « hors sujet » car mon but est plutôt de dénoncer le fait que la valeur qui est mise au pinacle de notre société est la compétition. Quand on veut dénoncer cela, il me semble qu’un essai est beaucoup moins approprié car plus réducteur, ou alors, cela demande un travail beaucoup plus ample dont je n’ai absolument pas les moyens.
LVSL — Ce qui est étonnant dans votre livre, c’est la première personne. Pourquoi avoir écrit ce livre à la première personne alors que vous avez toujours dit que ce n’était pas une autobiographie ?
AN — Juste un petit mot sur l’autobiographie : j’estime, à titre personnel, que l’autobiographie n’est pas un genre littéraire. À partir du moment où une biographie a des qualités littéraires, elle est romancée, donc c’est déjà un roman et ce n’est plus factuel. Une biographie n’a en elle-même qu’un intérêt historique. Ceci dit, c’est une opinion purement subjective que je porte sur la littérature en général, et du haut de mes 23 ans d’existence, cela ne pèse pas bien lourd ! Mais, il me semble que la biographie n’est pas vraiment un genre littéraire, dans le sens artistique. D’ailleurs, j’utilise le contrat de lecture pour bien signifier au lecteur qu’il ne s’agit pas d’une biographie. Au premier chapitre de mon livre, l’incipit, j’annonce aux lecteurs qu’on se situe dans un futur post-apocalyptique et que je vais raconter ma jeunesse ; c’est censé causer un déclic chez lui pour qu’il comprenne bien que c’est une fiction et que je ne vais pas raconter ma vie, puisque dans ma vie, il n’y a pas eu d’apocalypse, je ne suis pas vieux et nous ne sommes pas à la fin du XXIème siècle. Je crois que c’est assez clair sur le fait que ce n’est pas une biographie, ni une autobiographie.
Deuxièmement, pourquoi à la première personne ? Parce que je m’étais imposé une contrainte pour renforcer la valeur symbolique de ce que j’écrivais : ne mentionner aucun nom de personnage, les personnages étant tous désignés par leur fonction. À partir du moment où on n’avait que des personnages-fonction, je renforçais l’identification du lecteur et rendais possible la généralisation. Quand on dit « Monsieur le Professeur » ou « Monsieur le Directeur » pris comme des entités presque abstraites, c’est beaucoup plus facile ensuite de s’en référer à ce qu’on a connu soi-même. De plus, cela permet de comprendre que je ne parle pas d’une classe préparatoire en particulier ou des classes préparatoires en général, mais vraiment de la société toute entière. Un problème a émergé avec cette contrainte : que faire du narrateur ? Parce qu’il y a forcément un personnage narrateur qui est là, c’est quasiment obligatoire. Un roman sans narrateur n’aurait strictement aucun sens. Le mettre à la première personne permettait de respecter cette contrainte d’une part, et d’autre part, d’entretenir une confusion entre le personnage narrateur et l’auteur, c’est-à-dire moi, puisque parfois nos avis sont confondus. Parfois non, mais bien souvent, ils sont confondus, et cela fait du narrateur un personnage témoin, qui n’agit pas, qui raconte. Donc c’est drôle parce que ce livre qui est écrit à la première personne met en scène un « je » très absent puisque ce personnage ne fait rien, n’agit pas et se contente d’observer. En réalité, les descriptions et les portraits en sont la toile de fond. J’explique ce que font les autres, ce qui se passe autour de lui. Et la véritable action du personnage, ce qui change véritablement pour lui au cours du livre, c’est le regard qu’il porte sur le monde, sur ce monde-là : au début, il est complètement aliéné, il s’imagine que comme il arrive en classe préparatoire, l’ascenseur social de la République fonctionne et qu’il va y arriver ; mais à la fin du livre, il n’a plus du tout cette vision-là des choses… En fait, on suit l’éveil de sa conscience bien plus que l’agissement d’un personnage héroïque, car ce n’est pas du tout le sujet.
LVSL — Justement, vous parlez d’éveil des consciences. Quel est le public cible ? Est-ce que ce roman peut éveiller d’autres consciences ? Qui est visé en particulier ?
AN — Tout le monde. Je ne suis pas un « marketeux », je n’ai pas de public cible. Absolument tout le monde parce que comme je l’ai dit, ce n’est pas un livre sur les classes préparatoires, donc tout le monde. En fait, de manière générale, l’école concerne absolument toute la société. J’estime, parce que je suis profondément républicain, que tous les sujets politiques concernent toute la société, mais l’école en particulier, c’est-à-dire la façon dont on va former les futurs citoyens, donc, pas seulement ce qu’on leur enseigne en termes factuels, mais aussi ce qu’on leur inculque des valeurs humaines. C’est ça la formation. On ne peut pas dire que la véritable formation d’un étudiant soit le contenu de l’enseignement, qui de toute façon change d’une époque à l’autre selon l’évolution des connaissances. Ce qui est vraiment important, c’est ce qu’il va en retenir et la façon dont il va se construire avec ça.
« L’école concerne absolument toute la société »
De fait, ce que je dis de l’école dit beaucoup de la société : la valeur la plus importante, la valeur cardinale de notre société est la compétition. Dans cette compétition, donc dans une société libérale, dans un marché dérégulé, l’école a pour but de former des employables. On enseigne donc aux élèves des métiers qui vont ensuite leur donner éventuellement une place dans la société. Bon, mais en réalité, l’école n’est pas du tout un ascenseur social : la discrimination se fait aussi à l’école, même de façon inconsciente. Je ne suis pas en train de dire que partout les professeurs montrent du doigt les boursiers mais que structurellement c’est comme ça… Une personne issue d’une famille intellectuelle cultivée dans le sens de la culture universitaire, de la culture classique, a bien plus de chances de réussir à l’école que n’importe quelle autre.
Donc en théorie la ligne de départ est censée être la même pour tout le monde mais en réalité, ce n’est pas du tout le cas. Et quand bien même, l’école forme des employables, inculque un métier et, surtout, ancre l’idée de la nécessité de la compétition. Indubitablement, cette façon-là de former les jeunes ne peut déboucher que sur une société violente. Une société de compétition permanente est une société violente. Je ne dis pas que la classe préparatoire transforme les jeunes en gens violents ; cela n’aurait aucun sens, ce que je dis c’est que tout le système scolaire et toute notre société tendent à être violents parce que cette dernière idolâtre la compétition. Et par « compétition », j’entends « compétition acharnée ». Quand on commence à imaginer une société qui est faite d’entrepreneurs, je crois que tout est dit. On détruit l’État, on encourage la société civile à s’auto-organiser via les marchés, donc via l’économie, et cela ne peut être que violent, cela débouche forcément sur une compétition acharnée.
« Dire que tout le monde a sa chance, c’est dire que tout le monde est à égalité. Mais en réalité, cela signifie qu’il y aura un vainqueur et plein de perdants »
Le mensonge est de dire que tout le monde a sa chance dans l’économie de marché, dans le libéralisme, et donc dans la compétition. Dire que tout le monde a sa chance, c’est dire que tout le monde est à égalité. Mais en réalité, cela signifie qu’il y aura un vainqueur et plein de perdants. Et ce sera violent parce que de toute façon les gens vont se battre pour être vainqueur. Personne n’a envie d’être perdant, parmi les gens qui vont se faire opprimer, qui vont se retrouver sans rien. C’est d’autant plus violent si tout le monde se dit que c’est une bonne idée de vivre en compétition permanente et que ce système est accepté.
LVSL — Justement, dans votre roman, situé dans une époque « post-apocalyptique », vous écrivez en référence à une période antérieure à celle-ci : « Les mots sont importants ; et ils étaient volés. République, pacifisme, progrès, socialisme, internationalisme, les grands noms de Jaurès et de Blum n’avaient plus aucun sens ; on vendait tout au plus offrant. L’ultralibéralisme était si bien ancré dans toutes les cervelles qu’il était devenu quasi totalitaire ». Est-ce que ce roman est aussi une arme contre ce que vous appelez l’ultralibéralisme ?
AN — Bien vu, on ne m’avait pas encore sorti cette citation, ça fait plaisir de la voir sortir une fois. Un mot sur le vocabulaire volé : c’est un scandale. On ne peut plus s’exprimer si les mots sont volés. « République » a un sens, et cela ne peut pas avoir le sens d’être de droite. C’est radicalement opposé à la droite, c’est radicalement opposé au libéralisme. La République est une idée de gauche, qui ne peut être qu’une idée de gauche, et politiquement orientée. Quand on prononce « République », on ne peut pas penser « libéralisme », quand on dit « République », on signifie que l’ensemble des citoyens éduqués se préoccupe collectivement du bien commun représenté par l’État républicain. Donc les mots volés, c’est un scandale ! République a un sens, socialisme a un sens. C’est un scandale que le Parti Socialiste ne soit pas socialiste et qu’il entretienne ainsi une confusion générale. Et cela conduit les gens à dire : « La droite et la gauche, c’est la même chose, les gens sont tous pareils, les politiques sont tous pareils ». Alors que c’est tout à fait faux. Le fait de voler les mots, de les salir, empêche d’expliquer le système. Que nous reste-t-il comme mots à partir du moment où on ne peut plus dire « République », « socialisme » ou « capital » ? Comment fait-on pour décrire le libéralisme ? Comment fait-on pour en faire une critique constructive ? Il est très difficile d’être contre le libéralisme avec des mots qui sont tous salis, volés ou détournés. Comment fait-on pour dire que La République En Marche ! n’est pas républicaine ? Ou que Les Républicains ne sont pas républicains ? Comment peut-on opposer, par exemple, « capitalisme » et « communisme » alors que le communisme est assimilé au stalinisme ? C’est très compliqué et je le dénonce. Je crois que reconquérir les mots est absolument indispensable pour structurer notre pensée. En effet, on ne peut pas penser quelque chose si on n’a pas le mot pour le désigner.
D’autre part, je dis que le libéralisme est devenu quasi totalitaire : il se trouve que c’est vrai parce qu’un régime totalitaire est un régime où le pouvoir dirige et surveille chacun des aspects de la vie d’un citoyen, d’un membre du groupe. De fait, il se préoccupe tellement de chacun des aspects de la vie d’un citoyen qu’il se mêle de ce que l’on a le droit de penser ou de ne pas penser. Les journalistes sont quasi univoques sur à peu près tous les sujets, les gens ont strictement la même opinion et l’opposition est très mal tolérée ; le fait de critiquer est très mal toléré. Donc oui, totalitaire, car à partir du moment où l’on affirme des valeurs comme une évidence en permanence, et que tout le monde les accepte, il n’y a plus de démocratie. La démocratie intervient quand on n’est pas d’accord et qu’on tranche par le vote, par le nombre, par la conviction et par le débat. En général, quand tout le monde est d’accord, c’est le signe d’un régime qui n’est pas démocratique.
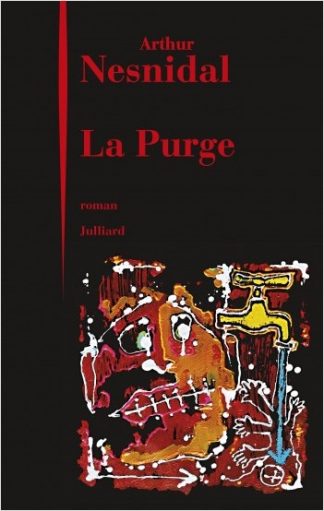
LVSL — En quoi ce roman est-il populaire ?
AN — J’ai surtout dit que je voulais que ce soit un roman populaire. Un roman populaire se détermine d’abord par le fait que ce soit un roman qui est un best-seller (rires). En tout cas, c’est un roman qui se veut populaire parce que, clairement, il prend position pour le camp du peuple ; c’est très clair et sans ambiguïté. Je n’irai pas jusqu’à dire un roman « populiste » qui essaie de décrire avec réalisme la vie du peuple à la façon du roman Les Misérables, parce que ce n’est pas le sujet ici. On est dans un lieu extrêmement clos, tout se passe au même endroit sur une année… Ce roman se veut populaire, parce que, très clairement, il prend position pour le peuple. Alors « pour le peuple » ça veut dire contre l’oligarchie. Mais encore une fois, il y a quelque chose de dramatique dans le fait qu’on ne puisse plus dire que l’on est contre quelque chose parce qu’à partir de ce moment, on voit se répandre des éléments de novlangue absolument insupportables qui sont des non-sens intellectuels du style : « Il faut arrêter d’être contre, il faut être pour ! » Cela sous-entend : « Pour quoi ? Pour nous bien sûr, pour nous, l’oligarchie… » Alors que nous sommes pour des choses aussi belles que le partage, la Sécurité sociale… C’est avec le partage du pouvoir en particulier que va se faire le partage des richesses… Voilà, je ne suis pas seulement contre… Je suis aussi pour d’autres choses. Cela implique que quand on est pour quelque chose et qu’il y a quelque chose d’autre en place radicalement différent, on est contre ce qui est en place. Fatalement, quand je dis que je veux que ce soit un roman populaire, c’est parce que dans mon esprit, le peuple est opposé à l’oligarchie. Les gens qui détiennent le pouvoir à la place de ceux qui le subissent, c’est-à-dire les gens qui détiennent le pouvoir au lieu de représenter le peuple, n’ont pas leur place dans notre société. Cela ne devrait pas fonctionner comme ça.
« Les gens qui détiennent le pouvoir à la place de ceux qui le subissent, […] qui détiennent le pouvoir au lieu de représenter le peuple,
n’ont pas leur place dans notre société »
Bien sûr, il y a aussi les éléments de novlangue qui contribuent à vider les mots de leur sens. On martèle des mots un peu comme des concepts opérants. Quand un préfet parle, il doit dire : « État, sécurité » ; quand un ministre parle, il doit dire « budget économique, essor, relance par l’austérité ». C’est absolument incroyable ! Surtout quand un représentant parle, il va parler de compétitivité, il va parler d’attractivité, c’est-à-dire des concepts qui sont extrêmement orientés en fait, et il va les marteler jusqu’à ce que ça paraisse évident qu’on doive être compétitif, qu’on doive faire de la croissance, produire, être attractif pour les entreprises. Dire que la compétition n’est pas une fin en soi est quelque chose qui n’est pas du tout évident dans notre organisation sociale, surtout dans les représentations culturelles comme à la télévision, dans les journaux, à la radio ; il faut d’abord commencer par faire admettre un vocabulaire qui n’est pas le vocabulaire du libéralisme.
« Dire que la compétition n’est pas une fin en soi est quelque chose
qui n’est pas du tout évident dans notre organisation sociale »
On ne peut pas critiquer le libéralisme avec son vocabulaire. C’est complètement absurde. Si je veux critiquer l’oppression dans l’entreprise, je suis obligé d’utiliser des termes qui signifient l’oppression dans l’entreprise : je vais dire qu’il y a l’oppression de l’entreprise sur des gens qui ne possèdent pas leur outil de travail qu’on va appeler les prolétaires, c’est un vocabulaire extrêmement typé. C’est tout à fait normal, c’est le vocabulaire typique des gens qui sont contre l’oppression dans l’entreprise. En revanche, si je critique le libéralisme en disant que dans la start-up nation, il y a des défavorisés qui n’ont pas eu le mérite de fonder eux-mêmes leur entreprise et de montrer leur valeur sur le marché parce qu’ils n’étaient pas assez attractifs et compétitifs, cela a l’air absurde de critiquer le libéralisme. On en déduit que le libéralisme est quelque chose qui fonctionne très bien et que le seul fautif dans l’histoire, c’est ce pauvre type qui n’a pas eu de chance et, surtout, qui n’a pas eu de mérite. Je ne crois pas au mérite, je ne crois pas que le droit de vivre et d’avoir une vie digne se mérite. Je crois que c’est quelque chose que tout le monde a le droit d’avoir : c’est d’ailleurs ce qu’affirment les Droits de l’Homme. Mais on a bien inculqué aux gens que la place qu’on occupait dans la société devait être indexée sur le mérite.
« Je ne crois pas que le droit de vivre et d’avoir une vie digne se mérite »
À partir du moment où l’on vole le vocabulaire et où l’on martèle ces concepts opérants via les médias et via la culture, il est très difficile de lutter. Modestement, mon travail est d’attaquer ce processus. Parce qu’en tant qu’écrivain, mon boulot est principalement de travailler la langue, de travailler à partir de dictionnaires, de grammaires et de donner une nouvelle connotation aux mots ou de reconquérir le sens des mots, donc de proposer une vision du monde par le langage et de créer ce qui permettra de visionner ce monde-là, tel que je le vois, c’est à dire le monde violent que je dénonce.
LVSL — Est-ce que le prochain livre est un roman ? Quand sortira-t-il ? Quel sera son sujet ?
AN — Si tout va bien, il sortira en août prochain. Le sujet : l’oppression sociale, l’oppression des puissants, la dignité des petits… Mon prochain roman dira beaucoup de l’emprise de la finance sur le pouvoir. C’est une contre-utopie. Il me reste un certain nombre de thèmes à aborder. Ce roman sera toujours aussi travaillé du point de vue de la langue, du point de vue du style et je vais continuer dans la lancée du premier. Je n’ai pas changé et je n’oublie pas d’où je viens.
Au début de l’entretien, la question était de savoir quelle était la place du roman dans la bataille culturelle, eh bien, je rajoute que le roman dans la bataille culturelle a la même place que toutes les autres formes d’art, mais il y a quand même une différence entre les arts car certains arts demandent beaucoup de moyens. Et il est donc plus facile de les censurer : par exemple, il est difficile de monter un film parce qu’un film demande beaucoup de moyens, il est difficile de faire un jeu vidéo pour les mêmes raisons. Je pense que certains arts comme la littérature ou la musique sont davantage accessibles parce qu’on peut les pratiquer même quand on n’a pas les moyens. En effet, concrètement, pour écrire, il faut un stylo et un cahier. Alors que des formes d’art qui demandent beaucoup de moyens nécessitent aussi beaucoup d’investissement financier. À noter que la qualité technique dans le métier d’écrire est tout aussi exigeante que celle des autres formes d’art. Je fais le pari, et ça ne m’étonnerait pas, que le roman sera à l’avenir une forme d’art abondante, subversive. Je précise que je n’écris pas des romans parce que je fais des paris ; je le fais parce que je suis romancier, que c’est mon métier et que c’est ça que je sais faire. Mais je pense que dans les années à venir nous, les romanciers subversifs, révolutionnaires, serons beaucoup plus nombreux à avoir un regard critique sur la société, à proposer de s’indigner contre le monde dans lequel on vit par la littérature. Et dans d’autres formes d’art, peut-être que ce sera plus difficile.
On vient de voir le roman à la croisée des chemins de l’art et de la bataille culturelle. Je suis sûr que l’art dans la bataille culturelle a une importance primordiale. Seul l’art peut sensibiliser autant les gens à qui l’on s’adresse et provoquer des sentiments sains. Je considère que l’indignation et la colère sont saines. Former l’imaginaire collectif par l’art est absolument indispensable pour reconquérir les concepts qui nous permettent de critiquer le monde dans lequel on vit. C’est un travail qui est bien sûr de première importance mais qui n’est pas forcément supérieur au travail conceptuel que font les chercheurs, les sociologues, les scientifiques. C’est un travail complémentaire, il ne sont pas opposables. Simplement, moi, c’est ce que je sais faire, donc c’est ce que je fais.