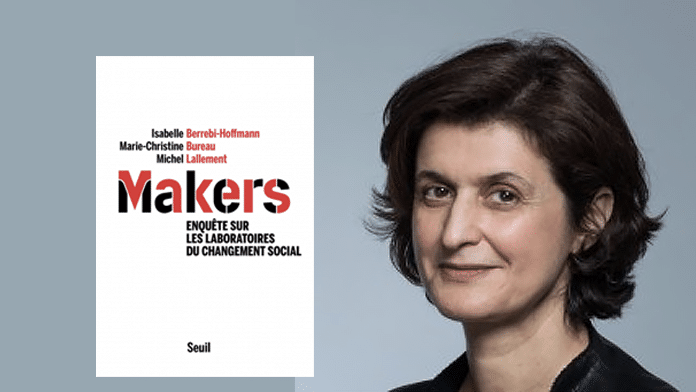Milo Lévy-Bruhl est doctorant en philosophie politique à l’EHESS et enseigne à l’Institut Catholique de Paris. Ses recherches portent sur les liens entre socialisme et judaïsme en France depuis le XIXème siècle. Pour les éditions du Bord de l’eau, il vient de rééditer l’œuvre de Léon Blum À l’échelle humaine, en l’agrémentant d’une longue préface. Dans cette dernière, il revient sur le contexte d’écriture de l’ouvrage, alors que Blum est emprisonné, et tente d’en dégager l’actualité. Après l’essoufflement d’un socialisme converti au libéralisme, Milo Lévy-Bruhl entend ainsi rappeler une autre voie inspirée du legs de Blum : celle d’un socialisme républicain, préférant à l’attentisme révolutionnaire, une inébranlable morale du présent. L’occasion pour lui de revenir sur les grands thèmes qui continuent de nourrir les indispensables débats du camp progressiste : inscription historique, horizon stratégique, rapport à la classe ouvrière, organisation partisane, conquête du pouvoir d’État, ou encore conditions du maintien de l’idéal socialiste.
LVSL – Soixante-dix ans après sa mort, vous préfacez la réédition de la dernière œuvre de Léon Blum, À l’échelle humaine. Écrite en 1941, après la débâcle, cette œuvre reste assez méconnue aujourd’hui. Comment l’expliquez-vous ?
M. L.-B. – Pierre Mendès France a écrit qu’« en dehors même de sa valeur pragmatique, les qualités intrinsèques de la pensée et du style devraient faire ranger À l’échelle humaine parmi les meilleurs œuvres de notre littérature politique. » Et pourtant, vous avez raison, elle reste assez méconnue. Quelques hypothèses pour l’expliquer. D’abord, le thème de l’examen de conscience devant le désastre national a très vite été occupé par L’étrange défaite de Marc Bloch. De fait, les deux livres ont beaucoup en commun : une même lucidité précoce sur les causes de la défaite, une même intransigeance morale dans l’autocritique, une même ambition de renouveau pour le régime abattu. Les livres se ressemblent parce que les hommes se ressemblent et se trouvent au moment de l’écriture dans la même disposition. En exergue des carnets dans lesquels il écrit, Bloch cite Lamennais : « Pour vivre, il faut savoir dire : Mourons. » Pensée à laquelle Blum fait écho dans À l’échelle humaine : « L’expérience enseigne qu’aux moments redoutables de sa vie l’homme ne la sauve qu’en la risquant. » Quand, à l’été 1940, le président Roosevelt propose à Blum de le rejoindre en Amérique, c’est logiquement qu’il refuse. Hors de question pour lui d’abandonner la France dans l’épreuve. Il sera arrêté quelques jours plus tard et c’est en prison, dans l’attente de son procès, qu’il écrit À l’échelle humaine. Marc Bloch aussi risque sa vie dans la Résistance ; et la perd. Dès lors, L’étrange défaite est comme auréolée du martyre de son auteur et c’est, selon moi, à juste titre que Gallimard la publie avec, en annexe, ce poignant Testament dans lequel on lit : « Attaché à ma patrie par une tradition familiale déjà longue, nourri de son héritage spirituel et de son histoire, incapable, en vérité, d’en concevoir une autre où je puisse respirer à l’aise, je l’ai beaucoup aimée et servie de toutes mes forces. […] Je meurs, comme j’ai vécu, en bon Français. » Depuis cette perspective exprimée dans sa dernière pensée, son analyse fulgurante, au plus près des combats, se donne rétrospectivement à voir pour ce qu’elle était : la forme, conforme à l’épreuve de la défaite, du devoir patriotique. C’est pour moi la grandeur de l’idéologie républicaine que de produire des hommes capables à la fois de formuler la critique la plus lucide et exigeante de la République, en même temps qu’ils donnent, littéralement, leur vie pour elle. La critique la plus haute et le dévouement le plus haut, je crois qu’il y a quelque chose ici comme un modèle d’accomplissement de la vie moderne bien comprise.
Néanmoins, Blum s’impose un devoir supplémentaire, et c’est sur ce point que les deux ouvrages diffèrent. Sa fidélité à la République et à la patrie passe par une fidélité au socialisme. Donc, lorsqu’il médite la défaite, il embrasse plus large. C’est à mon sens ce qui fait la valeur propre d’À l’échelle humaine par rapport à L’étrange défaite. À l’examen de conscience d’un Français, à l’examen de conscience d’un républicain, pour reprendre les titres des chapitres de Bloch, Blum ajoute l’examen de conscience d’un socialiste. Évidemment, cette perspective plus large est moins susceptible de consensus. Il y a moins de socialistes que de stricts républicains. Donc, Blum disparaît derrière Bloch. Sans rien dénier à Bloch, j’ai voulu réparer cet oubli. D’autant qu’à cet oubli s’était ajouté une confusion. La précédente édition, qui a déjà cinquante ans, préfacée par le grand historien René Rémond, tendait à minorer la dimension socialiste de l’ouvrage. C’est un grand classique des travaux sur Blum que de relativiser son socialisme. On le présente bien plus volontiers comme un humaniste, comme un républicain de gauche et ce faisant on passe à côté de certaines de ses analyses. C’est cette dimension socialiste, d’un socialisme particulier, que j’ai voulu restituer.
LVSL – Peut-être l’œuvre est-elle aussi méconnue parce qu’elle correspond à une partie de la vie de Blum qui l’est elle-même ?
M. L.-B. – Vous avez parfaitement raison. Pour beaucoup, la vie politique de Blum s’arrête en 1937, à la chute du premier gouvernement de Front Populaire qu’il dirige. On connait bien cette histoire – les avancées promises par le programme du Front Populaire et celles obtenues du patronat grâce aux gigantesques grèves, l’enthousiasme collectif mais aussi la terreur bourgeoise et la haine de « Blum pire que le diable » dont se souvient Deleuze à la lettre E de son Abécédaire (1) – on connait moins la suite. Ce qui est paradoxal, parce que pour Blum lui-même le Front Populaire n’est pas le sommet de sa vie politique. Pour comprendre ce paradoxe, il faut se débarrasser d’un anachronisme très répandu : l’idée que le Front Populaire aurait toujours été pensé comme une étape de l’histoire du socialisme. Pour une grande partie de la SFIO et à plus forte raison pour le Parti communiste, le Front Populaire ne fait alors pas partie de l’histoire du socialisme en tant que telle, parce que la politique qui a été appliquée n’est pas une politique socialiste, c’est une politique dite « anticrise ».
Pour saisir ce que recouvre ce terme, on est obligé de se replonger dans le contexte de l’époque. Depuis 1930, la crise économique américaine commence à faire sentir ses effets à travers le monde. Or, pour les socialistes, le krach de 29 n’est pas une crise de surproduction comme les autres. Paul Faure, le principal dirigeant de la SFIO de l’époque l’écrit très clairement dans un livre de 1934 auquel il donne le titre « Au seuil d’une révolution » : 29 c’est la crise finale. Or, puisque la révolution arrive, les socialistes décident de se tenir éloignés du pouvoir. Pas question de se compromettre avec des institutions politiques bourgeoises dont l’infrastructure économique est sur le point de vaciller. Les membres de la SFIO qui veulent participer aux gouvernements radicaux sont exclus du parti en 1933. Mais Février 1934 va tout bouleverser. Les socialistes comprennent que l’effondrement du capitalisme n’ouvre pas spontanément la voie au socialisme. Le fascisme peut surgir dans l’entre-deux. La phrase de Gramsci dont on abuse sur le vieux monde qui meurt, le nouveau qui tarde à naître et le clair-obscur où surgissent les monstres, rend compte en réalité d’une lecture qui s’impose dans beaucoup de partis socialistes européens dans les années 30. Car les « monstres » sont de plus en plus nombreux en Europe. Après l’Italie et l’Allemagne, qui pour l’instant se regardent encore en chien de faïence, février 1934 c’est aussi l’écrasement du Parti socialiste autrichien par les fascistes. Pour toutes ces raisons, les socialistes, et Blum en tête, comprennent qu’ils ne peuvent pas se complaire dans l’attentisme révolutionnaire. Dans ce contexte, le rapprochement entre Parti communiste, SFIO et radicaux commence à s’opérer mais il est très clair pour tout le monde que l’alliance ne se fera pas sur un programme socialiste. Pour le Parti communiste, cela n’aurait aucun sens : l’instauration de la cité socialiste ne peut se faire qu’après la révolution prolétarienne. Pour les radicaux, il n’est pas question d’entendre parler d’abolition de la propriété privée des moyens de production et d’échange. Le programme du Front Populaire reste donc très raisonnable. C’est un programme « anticrise », qui correspond plutôt à la politique de la gauche du Parti radical et qui vise avant tout à retenir les ouvriers et les classes moyennes susceptibles de basculer dans le fascisme en améliorant leurs conditions de vie. Les grandes grèves qui accompagnent l’arrivée au pouvoir du Front Populaire vont lui permettre, outre les Accords de Matignon, d’aller plus loin en faisant voter la loi sur les 40 heures de travail hebdomadaires et les congés payés, deux mesures qui ne figuraient pas dans son programme. Mais Blum refusera toujours les « réformes de structure ». Dans son esprit, elles viendront plus tard, lorsque les partis prolétariens, la SFIO et le PC, seront majoritaires.
LVSL – Après un an de gouvernement de Front Populaire, c’est plutôt la guerre que la révolution qui semble s’être rapprochée, notamment lors des premiers mois de la guerre d’Espagne.
M. L.-B. – En effet. Mais la guerre d’Espagne, c’est-à-dire l’attaque du Frente Popular espagnol par une partie de l’armée, renforce la lecture que Blum se fait des évènements. Pourquoi, par exemple, Blum refusera-t-il toujours de sortir de la légalité, n’appellera pas les socialistes à descendre dans la rue quand le Sénat lui barrera la route en 1937 ? Ce n’est pas par frilosité petite bourgeoise comme le raconteront certains trotskistes, c’est parce qu’à partir de 1934, et à plus forte raison après le début de la guerre d’Espagne, Blum raisonne toujours avec trois termes en tête : socialisme, capitalisme et fascisme. Renverser le capitalisme ne suffit pas, il faut éviter que le fascisme, que les fascismes – intérieur et extérieurs – en récoltent les fruits, et ça change tout. Mais vous avez raison, la montée du fascisme et les risques de guerre européenne vont en partie de pair. Elles constituent deux menaces immédiates et relèguent, dans l’esprit de Blum, la révolution au second plan, du moins pour un temps ; on le verra. Lorsqu’en mars 1938, le gouvernement Chautemps, qui a succédé à celui de Léon Blum, commence à tanguer parce qu’une partie des radicaux penche vers la droite, la situation européenne s’est encore aggravée. Chautemps tombe le 10 mars. Le lendemain le parti nazi autrichien lance son coup d’État. Les socialistes autrichiens ayant été écrasés en 1934, plus personne ne barre la route à la Wehrmacht et Hitler annexe le pays, c’est l’Anschluss.
Le lendemain, Blum est rappelé pour former un nouveau gouvernement. Convaincu que seul le rapport de force peut faire plier Hitler, il va proposer de substituer à la majorité de Front Populaire une majorité d’union nationale avec la droite. Selon lui, un gouvernement soutenu par toute la nation, avec comme premier objectif le renforcement de l’armement, est seul à même d’impressionner Hitler. Mais, à l’exception de Mandel, Reynaud, et quelques autres, la droite refuse. En conséquence de quoi, le deuxième gouvernement de Blum tombe en moins d’un mois et ce dernier est remplacé par Daladier. Munich, le pacte germano-soviétique, l’invasion de la Pologne, la déclaration de guerre, la drôle de guerre… À mesure que les évènements se précipitent, Blum devient une figure majeure du camp qu’on dit « belliciste » et ferraille aussi bien dans son parti qu’à l’assemblée contre le pacifisme à tout crin. Les divisions traditionnelles s’émoussent de plus en plus sur la question fondamentale de l’attitude à tenir face à Hitler puis du volontarisme à combattre. De Gaulle a raconté comment ce fut grâce à l’intervention de Blum que Paul Reynaud, qui militait depuis des années pour la fermeté, parvint à succéder à Daladier en mars 1940 : « Après la déclaration du gouvernement lue par son chef devant une Chambre sceptique et morne, on n’entendit guère, dans le débat, que les porte-paroles des groupes ou des hommes qui s’estimaient lésés dans la combinaison. Le danger couru par la patrie, la nécessité de l’effort national, le concours du monde libre, n’étaient évoqués que pour décorer les prétentions et les rancœurs. Seul, Léon Blum, à qui, pourtant, nulle place n’avait été offerte, parla avec élévation. Grâce à lui, Paul Reynaud l’emporta, quoique d’extrême justesse. » (2) Lorsque les défaites commencent à s’accumuler et que le cabinet Reynaud flanche du côté des partisans de l’armistice, Blum appuie Mandel et de Gaulle, et appartient au groupe des partisans de la poursuite des combats depuis l’Empire. Le remplacement de Reynaud par Pétain est un coup de massue et la demande immédiate par ce dernier de l’armistice le scandalise. Aussi se rend-il immédiatement à Vichy lorsqu’il apprend que Laval a prévu un vote sur la révision de la Constitution. Les journaux ayant déjà répandu leurs calomnies sur le « juif Blum débarqué à New-York avec sa vaisselle d’or », son arrivée à Vichy fait sensation. Mais après quelques réunions informelles, il comprend rapidement qu’il ne pourra pas inverser le rapport de force. Il se contente donc de prendre part au vote, refuse les pleins-pouvoirs à Pétain et quitte la ville. Petit à petit, les opposants revendiqués du nouveau régime sont arrêtés. Le 15 septembre 1940 au matin, c’est son tour. La police de Vichy le jette en prison, où il va commencer l’écriture d’À l’échelle humaine.

LVSL – Dans quelle mesure ce contexte pèse-t-il sur l’écriture du livre ?
M. L.-B. – Le contexte commande l’écriture du livre, du moins de sa première partie. Dans celle-ci Blum propose une lecture originale de la débâcle de 1940 en réintroduisant la perspective révolutionnaire qui travaille la SFIO depuis 1929. Pour lui, la défaite rend manifeste un autre évènement tout aussi important : la vacance de la souveraineté. En croisant analyse de l’évolution du capitalisme et retour sur les évènements politiques de l’entre-deux-guerres, il démontre que la classe bourgeoise qui détenait la souveraineté en France depuis 1871 s’est progressivement délitée dans l’entre-deux-guerres et que la défaite de 1940 exprime son effondrement définitif. Autrement dit, la défaite de 1940 a lieu sur fond d’une situation révolutionnaire. C’est le point de départ de l’analyse qui lui permet de relativiser l’ancrage du régime de Vichy et d’annoncer sa chute nécessaire à moyen terme, alors même que l’année de l’écriture apparaît davantage comme celle de son renforcement. Dans une formule lumineuse, Blum écrit que le régime de Vichy est la tentative d’une partie de la bourgeoisie de « ressusciter son cadavre grâce à une transfusion de sang jeune », le sang nazi, et annonce que la greffe ne prendra pas. Reste qu’il doit quand même expliquer pourquoi la souveraineté qu’occupait la bourgeoisie est restée vacante. Pourquoi la situation révolutionnaire ouverte par l’effondrement bourgeois n’a pas conduit à une révolution. Pour Blum l’explication est simple : le mouvement ouvrier et le Parti socialiste n’ont pas été à la hauteur de leur mission historique. De cet échec, il expose les raisons contingentes : le pacifisme jusqu’au-boutiste d’une partie du socialisme au moment où conduire la nation signifiait continuer les combats, et surtout la trahison communiste du pacte germano-soviétique. Mais la cause réelle est ailleurs.
Si le mouvement ouvrier et le Parti socialiste n’ont pas été reconnus par l’ensemble de la nation comme la nouvelle classe souveraine légitime, c’est parce qu’ils ont manqué de grandeur morale. La grandeur morale bourgeoise qu’avait incarné un Gambetta en 1871 ne trouva pas d’équivalent parmi les socialistes. La grandeur populaire des soldats de l’an II ne trouva pas d’équivalent dans le mouvement ouvrier. Non pas que les ouvriers et les socialistes aient été décadents. Au contraire, Blum montre qu’ils furent irréprochables, qu’ils prirent leur part à l’effort national. Mais, et c’est là que le bât blesse, ils ne prirent que leur part, quand il leur eut fallu, pour prétendre à la souveraineté, faire davantage. Non pas se comporter comme une excellente classe ouvrière, mais se comporter avec l’excellence d’une classe dont la vocation est désormais la direction de la nation. Je vais citer, un peu longuement si vous le voulez bien, le nœud du texte de Blum : « On n’a pas le droit de parler de perversion populaire à côté de la démoralisation bourgeoise ; on n’a pas le droit de charger de ce lourd grief la masse des travailleurs, le cadre des militants socialistes et syndicalistes, ni même leurs chefs responsables. À supposer que sur tel ou tel terrain, dans telle ou telle conjoncture, on parvînt à relever contre eux un excès d’exigence ou d’âpreté, ils seraient cent fois excusables. Mais le problème véritable n’est pas là. (…) La moralité de la classe ouvrière pouvait bien être demeurée intacte, mais il aurait fallu par surcroît que sa supériorité morale fût éclatante, et voilà ce qui a manqué. Il a manqué pour entraîner la nation une générosité, une magnanimité, une prestance idéale, une évidence de désintéressement et de sacrifice à l’intérêt collectif. » Si la situation révolutionnaire perdure, si la place de la souveraineté est restée vacante, permettant temporairement l’usurpation vichyste, c’est parce que la morale ouvrière n’a pas atteint ce sommet « où la morale touche à la religion et la propagande à l’apostolat », ce sommet qu’il l’aurait fait reconnaître comme la nouvelle classe dirigeante par l’ensemble de la nation et ce faisant aurait permis l’accomplissement révolutionnaire.
LVSL – La classe ouvrière et le Parti socialiste ont donc échoué, non pas dans le rôle économique et civique qui était le leur, mais dans le rôle nouveau de direction nationale auquel l’effondrement bourgeois les destinait. Comment Blum envisage le dépassement de cet échec ?
M. L.-B. – Il l’envisage dans et par la lutte. À l’échelle humaine n’est pas qu’une analyse, brillante, de la défaite, c’est aussi un testament politique que Blum adresse à une nouvelle génération de socialistes. Évidemment, à l’heure des carrières personnelles, des candidats à la présidentielle pour la énième fois, un tel désintéressement parait un peu étrange. Mais le fait est que lorsque Blum parle de lui, dans ce texte, ce n’est que pour se formuler des reproches. Il ne le fait pas par masochisme, mais par devoir. Ces reproches lui apparaissent comme autant de leçons susceptibles de servir la génération de socialistes à venir. Or, pour Blum la pérennité du socialisme n’est jamais liée à une génération, et encore moins à une personne. Le socialisme est une grande chaîne transhistorique dans laquelle chaque génération a le devoir de tenir son rang, de faire sa part, de méditer ses échecs, et de les offrir à la génération suivante sous forme de leçons pour que cette dernière fasse mieux. Blum en est là de sa vie. À l’échelle humaine est avant tout une adresse aux jeunes socialistes ; lui estime qu’il a déjà fait sa part. Grâce aux mesures du Front Populaire, il a libéré les ouvriers de la torpeur de l’usine, de la charge du travail. Pas seulement pour que les ouvriers accèdent aux loisirs ; encore que le corps usé ait ses droits. La réduction du temps de travail, les congés payés, ont d’abord une finalité politique, celle de permettre à la classe ouvrière de s’organiser, de se préparer intellectuellement et moralement pour le rôle de direction nationale qui l’attend. Parallèlement, Blum a aussi organisé le Parti pour ce rôle. Comme Jules Moch l’a raconté (3), lui qui fut l’un de ses principaux collaborateurs, à partir de son retour à l’Assemblée en 1929, Blum met en place une organisation inédite du travail au sein du groupe parlementaire. Il recrute de nouveaux profils, il incite les députés à la spécialisation thématique, il fait monter chacun en compétence, comme on dirait aujourd’hui, et, ce faisant, il prépare le Parti pour le rôle historique qu’il voit poindre, la direction de la nation. Ce rôle qui aurait dû lui revenir en 1940. Et de fait, l’historienne Claire Andrieu a montré comment les réflexions des socialistes des années 30, notamment sur l’organisation de l’économie, trouveront leur aboutissement dans les grandes politiques d’après-guerre : nationalisation, planification, etc. Dès lors, Blum n’est pas désespéré par l’échec momentané de 1940. Ce retard n’est pas une condamnation. Il traduit plutôt des errements ponctuels dont Blum estime devoir tirer les leçons pour aider la génération de socialistes qui vient à les corriger.
Au début de son emprisonnement, Blum reçoit d’ailleurs la visite d’un jeune socialiste : Daniel Mayer. Lui et sa femme, Cletta, sont militants depuis plusieurs années. Antihitlériens, antimunichois, ils ont une grande admiration pour Blum. Rapidement une relation filiale va se nouer entre les deux hommes, et c’est lui que Blum va désigner pour réaliser cette régénération morale du socialisme qui compensera l’échec de sa génération et permettra au socialisme et au mouvement ouvrier de se saisir de la souveraineté. Mayer est donc chargé par Blum d’organiser la Résistance socialiste. En m’appuyant notamment sur les travaux de Marc Sadoun, je rappelle, dans ma préface, comment, petit à petit, Mayer reconstitue les sections, réunifie le parti, relance le travail de propagande, impose l’idée d’un Conseil National de la Résistance et d’un programme commun dont son camarade, André Philip, va, le premier, proposer les principaux thèmes, notamment celui des nationalisations. Pour Blum cette action de la résistance socialiste, qu’il supervise depuis sa cellule jusqu’en 1943, est l’épreuve dans laquelle la nouvelle génération va former le surcroît de moralité qui lui donnera la légitimité pour assumer son rôle historique. De manière presque prophétique, quand on sait qu’il écrit À l’échelle humaine en 1941, au plus fort de l’emprise nazie sur l’Europe et de l’influence vichyste sur la France, les prévisions de Blum vont se réaliser. Le socialisme va se relever et apparaître, au lendemain de la guerre, comme le parti central. Surtout, le progrès social arraché à une classe bourgeoise majoritairement compromise se réalisera dans l’application du programme du CNR à la Libération.
LVSL – Qu’advient-il de Blum après son arrestation et la rédaction d’À l’échelle humaine ?
M. L.-B. – D’une part, comme je l’ai dit, il supervise la résistance socialiste naissante. De l’autre, il a l’occasion de passer de la critique à la lutte contre le régime qui usurpe alors la souveraineté. Depuis ses premiers discours, le Maréchal Pétain s’est choisi un bouc-émissaire : le Front Populaire. Ses principales figures sont accusées à la fois de la défaite et, pour contenter Hitler, d’avoir provoqué la guerre. Un grand procès, très médiatisé, est donc organisé, qui doit servir à condamner définitivement les coupables désignés – Léon Blum, Édouard Daladier, le général Gamelin, etc. – autant qu’à légitimer le nouveau régime du Maréchal Pétain. La logique est simple : plus les fautes des accusés sont grandes, plus Pétain est à même de justifier l’armistice qu’il a demandé, l’occupation à laquelle il a consenti, la collaboration qu’il mène. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Chiffres à l’appui, Daladier et Blum vont faire la preuve de la préparation française, vont imputer les faiblesses militaires, notamment celles de la ligne Maginot, à Pétain, ministre de la guerre en 1934. En quelques semaines, ils vont réussir à retourner l’accusation. Malgré les consignes de censure, l’attention que le régime a voulu braquer sur le procès va se retourner contre lui. La presse étrangère mais aussi la Résistance rendent compte des réquisitoires des accusés contre leurs juges et l’effet est si dévastateur que Darlan, pressé par Hitler, fait ajourner le procès. Cette humiliation de Vichy est un coup d’éclat pour la résistance socialiste qui voit ses troupes grossir subitement. Depuis sa cellule, Blum observe alors le pays sortir peu à peu de sa torpeur avec, dit-il, le sentiment du devoir accompli.
Du moins le voit-il jusqu’en avril 1943. Après avoir occupé la zone libre, la Gestapo s’empare de Blum et l’envoie dans un petit pavillon en lisière du camp de Buchenwald. Blum n’y connaîtra évidemment pas le quotidien et le sort des prisonniers du camp mais il vit avec la certitude que la mort l’attend. Cette crainte est fondée. Georges Mandel, qui le rejoindra dans ce pavillon et partagera quelques mois de captivité avec lui, sera réexpédié en France, livré, vraisemblablement à la milice, et assassiné, en représailles à l’attentat de la Résistance contre le propagandiste de la collaboration Philippe Henriot. Blum attend donc la mort, avec sérénité. En 1945, alors que l’armée américaine se rapproche du camp, la Gestapo décide de réunir ses prisonniers les plus précieux. Un grand cortège avance à travers l’Europe à la recherche d’un dernier réduit nazi. Dans les alpes italiennes, le cortège de la Gestapo finit par croiser une division de la Wehrmacht en déroute. Cette dernière chasse la Gestapo et récupère ces prisonniers de choix qui vont servir de monnaie d’échange dans les négociations de la reddition avec les troupes américaines et les partisans italiens. C’est ainsi, de façon assez miraculeuse, que Blum survit à la guerre et regagne Paris une semaine après l’armistice.

LVSL – Sa vie politique continue-t-elle après la guerre ?
M. L.-B. – Oui, mais différemment. Alors qu’une place lui a été réservée au sein de la direction du Parti et qu’on lui demande sur quelle circonscription il souhaite se présenter, Blum reste fidèle à ce qu’il écrivait en 1941: l’heure appartient à une nouvelle génération de socialistes. Aussi refuse-t-il tous les mandats. En revanche, il récupère la direction de son journal, Le Populaire, depuis lequel il va exercer un véritable magistère. L’influence de Blum est alors immense, et pas seulement en France. Avant-guerre, il a incarné, pour le monde, une France à l’avant-garde du progrès quand les pays européens sombraient, les uns après les autres, dans le fascisme ou le nazisme. Pendant la guerre, il a été présenté comme l’ennemi numéro un d’un régime qu’il a réussi à humilier, en même temps qu’il accompagnait la résistance socialiste intérieure. Très tôt, il a également apporté son soutien à la France Libre, écrivant depuis sa prison des lettres à Churchill et Roosevelt, qui avaient pour lui une grande estime, pour qu’ils apportent leur soutien à de Gaulle. Il est un modèle pour la France, et pour les socialistes un véritable guide.
Or, lui dont l’optimisme tranchait avec l’ambiance générale en 1941, le voilà qui, à peine rentré en France, fait montre d’un esprit critique détonnant. À mesure qu’il prend connaissance de la situation politique, Blum manifeste une grande déception. Évidemment, l’application du programme du CNR n’est pas négligeable, mais de son point de vue elle est extrêmement insuffisante. C’est un point que je crois important. Nous sommes nombreux aujourd’hui à gauche à nous être arc-boutés sur la défense des acquis du CNR. Cette posture défensive est absolument nécessaire, mais elle ne doit pas nous faire oublier que pour Blum et ses proches, le programme du CNR n’est qu’une première pierre. Il faut aller plus loin, beaucoup plus loin. Malheureusement, il y a alors deux blocages. Évidemment, un blocage à droite, d’une partie de la bourgeoisie, présente par exemple au MRP, l’un des trois grands partis issus de la Résistance. Mais Blum a bon espoir qu’une majorité du MRP puisse le soutenir. Paradoxalement, le principal blocage est plutôt sur la gauche, du côté du Parti communiste. Pour des raisons à la fois doctrinales et stratégiques, les communistes ne souhaitent pas aller plus loin que le programme du CNR. Doctrinales d’abord, parce que dans leur perspective, des réformes de structure ne pourraient venir qu’après la révolution prolétarienne. Stratégiques ensuite, parce qu’une telle perspective révolutionnaire n’est pas du tout à l’ordre du jour pour Staline qui se concentre alors sur l’Est de l’Europe. Au sortir de la guerre, Blum et ses proches dénotent donc en ce qu’ils proposent des réformes très audacieuses qui, pour des raisons éminemment différentes, sont refusées aussi bien sur leur droite que sur leur gauche. C’est très sensible en ce qui concerne par exemple les nationalisations. Pour Jules Moch, André Philip, Édouard Depreux, Daniel Mayer, et bien d’autres socialistes, les nationalisations de la Libération s’apparentent à des étatisations et, à ce titre, sont profondément insuffisantes. Elles doivent aller de pair, estiment-ils, avec une démocratisation des entreprises nationalisées pour fonder autant de petites « Républiques des travailleurs ». Ce ne sera pas le cas. Il faut dire que l’opposition qu’ils affrontent est aussi interne. Une grande partie du Parti socialiste s’éloigne de plus en plus de la direction de Daniel Mayer et de la doctrine de Léon Blum. Lorsqu’en juin 1946, Léon Blum propose une grande réforme sur l’héritage visant à interdire toute succession en ligne collatérale et à limiter la succession en ligne directe à une seule génération (4) afin de financer un service public d’orientation scolaire, la majorité du groupe socialiste écarte le projet. Le couperet tombe finalement lors du XXVIIIème congrès du Parti socialiste, en août 1946. Le rapport moral de Daniel Mayer est rejeté tout comme celui de Léon Blum pour Le Populaire.
Un tel rejet est absolument inédit dans l’histoire du Parti socialiste. Il s’explique par le fait qu’une grande partie de ses troupes partage avec les communistes l’idée que de telles réformes ne peuvent avoir lieu qu’après le début de la révolution prolétarienne. Mais il y a autre chose. Pour appuyer leurs propositions de réforme, Blum et Mayer ont proposé une alliance avec le MRP, ce qui revient, pour l’opposition interne menée par Guy Mollet, à déroger à la logique de lutte des classes. Cet écart doctrinal est intolérable pour des hommes qui professent encore le marxisme diffus qui habite depuis longtemps le Parti. Marxisme diffus dont Blum s’est éloigné. Il a tiré de la Résistance des idées qui le ramènent paradoxalement au socialisme de sa jeunesse, et notamment celle que l’émancipation des travailleurs ne sera pas l’œuvre des seuls travailleurs eux-mêmes mais d’un groupe social plus vaste, tel celui que forment, au-delà des différences de classes, les deux partis – SFIO et MRP – issus de la Résistance. C’est la Résistance, considérée comme groupe social doté de sa morale propre, forgée par l’épreuve, et non plus les seuls partis ouvriers, qui lui parait porteur de l’idéal de justice et de solidarité à même de réaliser le socialisme.
LVSL – Ce qui constitue une rupture avec la logique de classes du marxisme.
M. L.-B. – Oui, a fortiori avec le marxisme diffus du Parti socialiste de l’époque qui craint plus que tout le procès en trahison de la lutte des classes et les accusations d’embourgeoisement que pourrait lui faire le Parti communiste. Mais sans doute parce qu’il est plus âgé, Blum est totalement indifférent au qu’en-dira-t-on communiste. En réalité, il sait très bien ce qu’il est en train de faire : réactiver un vieux clivage interne au Parti socialiste. Je vais un peu remonter dans le temps pour l’expliquer mais je crois que c’est nécessaire et important pour notre présent. Contrairement à ce qu’on croit souvent la rupture de 1920, du Congrès de Tours, ne se fait pas entre réformistes d’un côté et révolutionnaires de l’autre. Le courant dit réformiste de la SFIO, incarné par Pierre Renaudel mais surtout par Albert Thomas a été totalement décrédibilisé par son jusqu’auboutisme durant la première guerre mondiale ; si bien qu’il est extrêmement minoritaire, avant 1920. Le Congrès de Tours oppose donc davantage d’un côté les révolutionnaires marxistes de la SFIO, dans la version qu’en a donné Jules Guesde depuis la fin du XIXème siècle, et de l’autre les révolutionnaires léninistes qui vont former le PCF. La division ne se fait pas sur la conception marxiste de la révolution mais davantage sur la reconnaissance, ou non, de l’apport léniniste. De ce point de vue, le discours de Blum du Congrès de Tours, dont on retient souvent le caractère prophétique, a surtout le grand mérite d’indiquer l’incompatibilité entre la conception guesdiste et la conception léniniste. Mais la minorité du Congrès de Tours qui, avec Blum, va rester à la SFIO demeure totalement guesdiste et donc marxiste, à l’image de son premier secrétaire durant toute l’entre-deux-guerres, Paul Faure. Or Blum a eu une vie au Parti socialiste avant 1920. Dans le sillage de l’Affaire Dreyfus, il s’est rapproché de Jaurès, jusqu’à devenir l’un de ses plus proches amis et pour beaucoup son héritier. Il a participé aux différents congrès d’unification du début du XXème siècle et au congrès de l’unité socialiste de 1905. Mais dans ces années Blum n’était pas du tout guesdiste, au contraire. La grande historienne Madeleine Rebérioux a même émis l’hypothèse que son départ du Parti, après avoir participé à sa fondation en 1905, résultait précisément de la domination qu’exerçaient les guesdistes en son sein. En face des guesdistes, on trouve alors un groupe, dit des réformistes, que Blum connait bien puisque c’est avec eux qu’il a milité, de l’Affaire Dreyfus au Congrès du Globe de 1905. D’abord proche de Jaurès, qui s’en éloigne pour apparaître au-dessus de la mêlée, le groupe est organisé autour de la figure d’Albert Thomas, député-maire. Il comprend des syndicalistes, des coopérateurs, des municipalistes, des animateurs de groupes d’études socialistes et des intellectuels, le groupe des socialistes normaliens (Lucien Herr, Charles Andler, Léon Blum, etc.), et le groupe des durkheimiens (Robert Hertz, Marcel Mauss, Paul Fauconnet, François Simiand, etc.) dont la plupart sont aussi militants. Avant la guerre, ce groupe s’oppose frontalement aux guesdistes majoritaires.
Les congrès de Saint-Quentin, en avril 1911, puis de Lyon, en février 1912 sont l’occasion de plusieurs passes d’armes entre proches d’Albert Thomas et guesdistes. Le débat porte, ce n’est pas un hasard, sur la question des nationalisations et, ce faisant, sur la conception de l’État. Albert Thomas demande au congrès l’inscription par le Parti, dans son programme, de la nationalisation des mines, arguant qu’elle permettra l’amélioration des conditions de vies ouvrières et l’intéressement de l’État aux bénéfices. Cette proposition implique une conception non-bourgeoise de l’État, ce dernier n’étant pas l’agent du capital mais, je cite Thomas, « un champ de bataille où les classes opposées se rencontrent » et au milieu duquel les troupes ouvrières organisées par le Parti socialiste peuvent prendre l’avantage. Pour Thomas, la nationalisation minière annoncerait les débuts d’une dynamique de socialisation dont l’État doit être l’un des acteurs. Pour Guesde, au contraire, toute nationalisation précédant la révolution ne fera que renforcer l’État bourgeois. Il réplique : « pour nationaliser, il faudrait d’abord qu’existe une nation, qui n’existera qu’après l’abolition des classes. » Et ajoute, d’ici là, « l’État, c’est l’ennemi, c’est l’arsenal et la forteresse de la classe ennemie que le prolétariat devra franchir […]. Et lorsque vous voulez étendre le domaine de cet État, doubler l’État-Gendarme de l’État-Patron, je ne comprends plus. » Les deux partis conviennent d’approfondir la question lors d’un prochain congrès mais les débats relatifs à la menace de guerre ne le permettront pas et le débat n’aura jamais lieu. Ou plutôt il faudra attendre 1945. Après-guerre, la même question se pose. Les guesdistes au sein du Parti, dont Mollet pourrait être considéré comme l’héritier, ont certes accepté la nationalisation, héritage du Front Populaire, ce qui est un progrès par rapport à Guesde. Mais cette nationalisation demeure une étatisation. Pour eux, elle ne peut pas impliquer une démocratisation, c’est-à-dire une socialisation, qui ne pourra advenir qu’après la révolution. Blum lui part de l’acquis de Thomas – l’État n’est pas l’appareil de la bourgeoisie – pour aller plus loin : la socialisation n’implique pas la révolution prolétarienne. Elle doit se faire, pas à pas, dès que l’occasion y est favorable, y compris avec l’appui des classes non prolétariennes. À la première victoire du réformisme sur le guesdisme, actée durant le Front Populaire : la possibilité d’une étatisation avant la révolution, c’est-à-dire le renoncement à la conception stricte de l’État comme appareil bourgeois ; il veut ajouter une deuxième victoire réformiste : le dépassement de la conception guesdiste de la révolution et de la lutte des classes. Malheureusement, il échoue.
LVSL – À travers Blum, vous essayez donc d’exhumer une tradition interne au socialisme – ce réformisme non libéral – qu’on aurait oubliée. Vous espérez en faire quelque chose ?
M. L.-B. – D’abord, je ne suis pas historien et ce travail d’exhumation du « réformisme », je mets des guillemets parce que la notion renvoie à quelque chose de fondamentalement différent de ce qu’on y projette aujourd’hui, est en réalité au cœur des ouvrages d’un historien contemporain extrêmement important, Emmanuel Jousse (5). Et il n’est évidemment pas le seul. Le groupe des Cahiers Jaurès, animé par Gilles Candar et Marion Fontaine, participe depuis plusieurs années de ces recherches. Tout comme des jeunes chercheurs comme par exemple Adeline Blaszkiewicz-Maison qui est la spécialiste d’Albert Thomas. Je m’appuie évidemment sur ces travaux importants, mais, et vous avez raison de poser la question du « Que faire », mon point est ailleurs, il est pratique. Je crois que le socialisme français n’a jamais réussi à se repenser depuis qu’il a abandonné le marxisme. Quand l’a-t-il abandonné ? Assez tôt sans doute. Sous la IVème République, la différence entre le discours et la pratique était déjà trop criante. Mais les institutions comme les partis dégorgent lentement. Il a donc longtemps fait illusion, en attendant l’épreuve. Et à mon avis, ce n’est pas un hasard si c’est François Mitterrand qu’on a chargé de l’affronter. D’abord, il avait montré qu’il n’était pas très embêté par les dénégations. On parle quand même de l’auteur du Coup d’État permanent devenu le plus long président de la Vème République. Surtout, si c’était assurément un homme de gauche, Mitterrand n’était pas, à proprement parler, socialiste. Comme disait Mollet, « le socialisme est une langue qu’il a appris à parler ». En 1983, il a donc rompu l’illusion qui persistait. Jean-Claude Milner en a fait précocement le constat dans un livre de 1993, Archéologie d’un échec (1950-1993). Puis, la logique institutionnelle de la Vème République a permis au Parti de persister tout en continuant sa dérive vers le libéralisme. Le dernier quinquennat actant, comme l’a dit Jospin, « la dissolution du socialisme dans l’infléchissement libéral ». Après avoir dévoilé au monde qu’il n’était plus marxiste avec Mitterrand, le Parti socialiste a dévoilé avec Hollande qu’il n’était plus qu’une énième caisse de résonance, certes pas la moins charitable, du sens commun libéral.
Mais je ne veux pas accabler le Parti socialiste, ni ses chefs passés. Ils ont individuellement leur responsabilité mais honnêtement il s’agit d’une dynamique historique très profonde qui dépasse largement ces acteurs considérés individuellement. Quant à ses chefs et militants actuels, j’admire leur fidélité, leur persévérance et, dans la situation actuelle, leur abnégation. Par ailleurs, c’est une dynamique qui ne touche pas que le Parti socialiste. L’abandon du marxisme a laissé toute la gauche orpheline. Il n’y a plus aucun parti qui puisse se revendiquer du socialisme. Europe-Écologie Les Verts pourrait peut-être s’en saisir mais pour l’instant je ne crois pas, et nous en avions parlé dans vos colonnes, que les travaux de Pierre Charbonnier soient leur principale influence, malheureusement… La France Insoumise n’est pas plus solide sur ses appuis idéologiques sur ce point, et je ne crois pas que le populisme, qu’il lui arrive de revendiquer, puisse être considéré comme un socialisme. Je sais que votre média en a été l’un des principaux propagateurs en France, mais parce que vous êtes ouverts d’esprit, vous avez bien voulu, il y a quelques années, me permettre de développer, avec mon ami Francesco Callegaro, nos critiques à son sujet. Le populisme reste un individualisme qui s’ignore tandis que le socialisme bien compris ne peut reposer que sur une théorie sociale. Celle de Marx n’a pas tenu la longueur. Il en faut une autre. En attendant, il n’y a plus aucun parti qui soit irrigué par un socialisme doctrinal. Paradoxalement, dans ce grand vide politique, c’est du côté de la recherche que la dynamique est la plus intéressante. Je pense évidemment à l’opération théorique que des philosophes et des sociologues construisent depuis plusieurs années, de concert, à l’EHESS et que Cyril Lemieux et Bruno Karsenti ont présentée dans ce petit livre si bien nommé, Socialisme et sociologie (Éditions de l’EHESS, Paris, 2017). Que des militants, que des dirigeants des partis de gauche se saisissent de cet effort théorique, et nous assisterons peut-être aux nouvelles noces entre un parti politique désireux d’émancipation et de justice sociale d’un côté et une théorie adéquate de la société de l’autre. De ce point de vue, je ne suis qu’un entremetteur qui essaie de rappeler à chacun que ce nouage entre socialisme et sociologie non marxiste a déjà eu lieu, sans doute sous des formes imparfaites, à certains moments de l’histoire. De l’Affaire Dreyfus à 1916, autour de Jaurès puis d’Albert Thomas d’une part ; de 1930 à 1950, autour de Léon Blum d’autre part. Et dès lors, Blum offre aussi un point de départ. On peut débarrasser le socialisme du marxisme sans compenser la perte ; c’est la voie Mitterrand – Hollande. Ou, on peut, comme Blum, s’éloigner du marxisme en étant réflexif sur son apport et sur les moyens de combler sa perte. Pour que le socialisme sans le marxisme ne soit pas qu’une forme charitable du libéralisme, Blum propose un chemin.

LVSL – Permettre au socialisme de ne plus subir la perte de la référence marxiste, c’est ce que vous permet cette exhumation d’un certain Blum ?
M. L.-B. – Précisément. Blum a souvent été raconté en opposition à la doxa marxiste, mais son socialisme n’était pas que négatif. Il avait aussi un contenu positif, strictement socialiste et non pas vaguement humaniste ; un contenu que l’historiographie a négligé et qu’on peut reconstituer en travaillant sur Blum et ses proches : Jules Moch, Georges Boris, Édouard Depreux, etc. Je n’ai pas fini de m’intéresser au cas Blum, mais par exemple je vois d’ores et déjà deux apports qui lui sont propres et qui sont liés, tous deux, à la levée de la perspective révolutionnaire. Le premier apport est, pourrait-on dire, organisationnel. Si le socialisme n’est pas un horizon à réaliser après la révolution, mais qu’il s’organise ici au présent, alors c’est toute la division et l’organisation du travail entre ses différentes composantes qu’il faut reprendre : groupe parlementaire, Parti, mouvement ouvrier dans ses différentes composantes (syndicats, coopératives, etc.). Or, ce que Blum voit très vite, c’est l’accroissement du risque de désajustement. Quand tous les acteurs tendent vers la perspective révolutionnaire, le risque est faible. Mais à mesure que chacun des acteurs se spécialise pour s’épanouir dans son champ d’action propre, le risque de désajustement augmente. Comment faire pour que les socialistes engagés dans l’appareil d’État continuent à penser leur action comme participant d’une action plus grande, pour le socialisme, et ne se contentent pas de suivre les normes qui sont celles des fonctionnaires. Même question pour les parlementaires socialistes : comment faire pour que leurs actions continuent d’être orientées vers la finalité du socialisme et ne se conforment pas à des objectifs électoraux ? Comment faire pour que les ministres socialistes se conforment à la finalité du socialisme plutôt qu’ils ne s’inquiètent de conserver leur pouvoir ? Bref, quelle éthique « professionnelle » de l’action socialiste permet de pallier le risque qu’entraîne nécessairement la spécialisation ? Parce qu’il témoigne aussi d’une nouvelle étape dans la division socialiste du travail, puisqu’avec lui le socialisme accède à l’appareil d’État, Blum est sensible à ce risque, et dégage, je crois, les premiers préceptes susceptibles de le prévenir. Il le fait par exemple lorsqu’il dit en 1945 à des camarades un peu trop concentrés sur les perspectives électorales, je le cite : « L’insuccès d’un jour n’est rien, et il y a des victoires qui, très vite, s’annulent d’elles-mêmes par un effet presque inéluctable. Par contre la moindre atteinte à notre loyauté, à notre finalité spirituelle et morale représenterait un désastre dont nous ne nous relèverions pas. »
Son deuxième apport, sensible dans cette citation, est, lui aussi, lié à la levée de la perspective révolutionnaire. Blum sait que, derrière le mot de révolution, se cachait surtout celui d’idéal. La révolution représentait un idéal de justice à venir. La pensée de la proximité de la révolution a servi de moteur à des militants socialistes qui s’y vouaient jusqu’aux plus grandes extrémités. Tout l’enjeu de Blum est là : comment ne pas perdre l’idéal, qui est le moteur du socialisme, en suspendant la perspective révolutionnaire ? Comment le socialisme peut-il demeurer la même puissance agissante s’il ne tend plus vers la proche réalisation pleine et entière, mais qu’il se réalise, pas à pas, petit à petit, sans fin. Cette difficulté travaille déjà Jaurès. Son discours à la jeunesse d’Albi rend compte de ce besoin de dévouement différemment : « Le courage c’est de se donner aux grandes causes sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l’univers profond, ni s’il lui réserve une récompense. » Je crois que Blum, parmi d’autres, incarne éminemment cette forme réajustée de dévouement. Levinas l’a très bien vu lorsque, commentant À l’échelle humaine, il écrit : « Travailler dans le présent pour les choses les plus lointaines auxquelles le présent est un irrécusable démenti. Il y a une vulgarité et une bassesse dans une action qui ne se conçoit que pour l’immédiat, c’est-à-dire, en fin de compte, pour notre vie. Et il y a une noblesse très grande dans l’énergie libérée de l’étreinte du présent. Agir pour des choses lointaines au moment où triomphait l’hitlérisme, aux heures sourdes de cette nuit sans heures – indépendamment de toute évaluation de “forces en présence” – c’est, sans doute, le sommet de la noblesse. » Peut-être que, sans trop de solennité, je peux conclure par ça. Quand on est socialiste, on ne cherche pas le triomphe immédiat, on travaille au succès du socialisme permanent, au succès ici et maintenant et au succès à venir, parce que c’est notre devoir. Telle est la morale de Blum. Une morale qui fait de lui, selon moi, un penseur et un homme politique bien plus radical que les radicaux revendiqués. Un homme qui dit : la révolution n’existe pas, le combat n’aura jamais de fin, il n’y a pas de sens à penser que le combat puisse être gagné ; et c’est précisément la raison pour laquelle nous devons redoubler d’efforts. Nous luttons, comme nos parents avant nous, comme nos enfants après nous, pour que progresse, chaque jour un peu plus, le socialisme. C’est de cette longue chaîne des temps de la justice que ce petit livre est un nœud. Un nœud qui pourrait, aujourd’hui, la resserrer.
(1) https://www.youtube.com/watch?v=Q2QDLSlC2c0
(2) Charles de Gaulle, Mémoires de guerre. L’appel : 1940-1942, Paris, Plon, 1954, p. 36.
(3) Jules Moch, Rencontres avec Léon Blum, Plon, 1970.
(4) Le projet de Blum prévoit que « dans toutes successions, soient ventilées la part de l’actif qui a déjà été transmise au de cujus par héritage et celle qui est le produit de son propre travail. Cette dernière sera reversée sur la génération suivante ; celle qu’il avait déjà recueillie par héritage reviendra à la nation ».
(5) Emmanuel Jousse, Les hommes révoltés, Paris, Fayard, 2017 & Réviser le marxisme ?, Paris, L’Harmattan, 2007.