Depuis l’élection d’Emmanuel Macron, la vie politique française serait désormais rythmée par un clivage entre libéraux et nationalistes. Or, le néolibéralisme a lui-même évolué ces dernières années dans un sens autoritaire, identitaire et nativiste. L’extrême-droite a patiemment construit une hégémonie culturelle en s’appropriant des concepts libéraux et marxistes. Un article pour comprendre la politique de l’oxymore de la Nouvelle Droite.
1989, le triomphe du capitalisme
La chute du Mur de Berlin a marqué la fin d’une ère. L’Union soviétique, une des deux superpuissances depuis 1945, se retirait purement et simplement du théâtre de l’Histoire. Le socialisme réel s’est apparemment effondré sous le poids de ses propres contradictions, et non par suite d’un conflit atomique ou d’une révolution violente. Francis Fukuyama a vu la fin de l’Histoire dans la chute de l’URSS. Celle-ci traduirait l’aspiration des peuples dits sous-développés aux standards de vie occidentaux, et leur conversion aux valeurs de la démocratie libérale.
« Il y a une guerre des classes, d’accord, mais c’est ma classe, celle des riches, qui fait la guerre, et nous gagnons » – Warren Buffett
En 2002, lorsqu’on demanda à Margaret Thatcher quelle était la réussite dont elle était la plus fière, elle répondit : « Tony Blair et le New Labour. Nous avons forcé nos opposants à changer d’avis ». La social-démocratie, sous Blair, Schröder, Hollande, Renzi, s’englue dans le centrisme. Pendant ce temps, les gauches postcommunistes et populistes demeurent durablement écartées du pouvoir. Le néolibéralisme est établi comme consensus, hégémonie culturelle au sens de Gramsci.
La réduction des dépenses publiques et des impôts est un axiome fondamental. De même, le néolibéralisme au pouvoir s’accommode très bien de tendances autoritaires lorsque l’austérité se heurte à des résistances populaires. La logique sociopolitique du néolibéralisme ressort crûment de cette citation du milliardaire américain Warren Buffett : « Il y a une guerre des classes, d’accord, mais c’est ma classe, celle des riches, qui fait la guerre, et nous gagnons ». Cela ne l’a pas empêché de cosigner cet été une lettre ouverte appelant les candidats à la présidentielle de 2020 à instaurer un ISF, au nom de la responsabilité morale de l’Amérique ! Les temps changent…
Aux origines du néolibéralisme
Il faut garder à l’esprit que le libéralisme désigne à la fois une théorie politique et une doctrine économique fondées sur le rationalisme et le droit naturel. Sémantiquement, néo-libéralisme signifie nouveau libéralisme, par opposition au libéralisme classique de l’école de Manchester. Dans les tourments de l’entre-deux-guerres, il est compris que la main invisible du marché ne génère pas inéluctablement le progrès et l’équilibre. Le libre-échange et le laissez-faire de Smith, Ricardo et Say n’ont pas su enrayer les crises et dépressions économiques récurrentes. Les économistes libéraux le voient bien, et s’attachent à redéfinir leur doctrine.
Le renouveau du libéralisme commence au tournant du XXème siècle avec le « New Liberalism », ou « social-libéralisme » qui s’ouvre aux sensibilités socialistes dans une optique humaniste. Keynes et Beveridge, libéraux britanniques et penseurs de l’État-providence, sont des représentants éminents de ce courant.
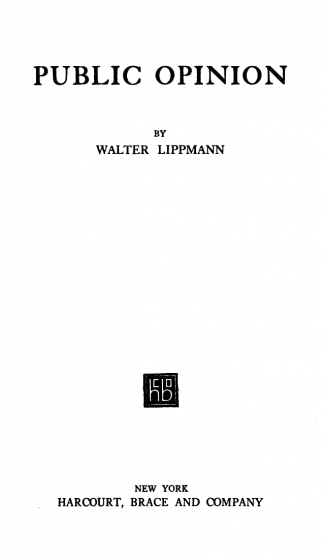
Tout autre est le libéralisme du Colloque Walter Lippmann, organisé en août 1938 à Paris. Plusieurs intellectuels majeurs y sont présents, entre autres Lippmann lui-même, Friedrich Hayek, Ludwig von Mises et Raymond Aron. C’est à cette occasion que l’économiste Alexander Rüstow, penseur de l’économie sociale de marché (soziale Marktswirtschaft), crée le mot néolibéralisme. On voit à cette occasion une division claire entre les classiques tels qu’Hayek, partisans d’une adhésion stricte au laissez-faire, et les modernes comme Aron, favorables à la régulation du marché et à l’interventionnisme économique.
Le libéralisme n’est donc pas un bloc monolithique. Au contraire, il est traversé de débats théoriques. Par exemple, Hayek est aux antipodes du monétarisme de Milton Friedman. Le premier propose de neutraliser l’inflation, et donc les crises, par la création d’un marché concurrentiel des monnaies. Le second émet l’idée contraire que les crises sont dues à un manque de liquidités qui peut être résolu par une politique monétaire inflationniste. Friedman, conseiller de Reagan, Thatcher et Pinochet, contempteur du keynésianisme, est un acteur important de la recomposition néolibérale des années 70-80.
Quand capitalisme ne rime plus avec démocratie
L’hégémonie néolibérale a été battue en brèche par la crise des subprimes. Les économistes orthodoxes croyaient que les crises et les récessions pourraient être évitées ou amorties par des politiques « contracycliques » (en période de récession, i.e. de cycle négatif, les banques centrales et les gouvernements mettent en place des politiques de relance). C’est ce qui a été fait en 2008-2009. Le ratio dette/PIB des États de la zone euro est passé d’environ 70% à 90% sous l’effet conjugué de l’augmentation des dépenses publiques liée aux politiques de relance et de la contraction des recettes fiscales due à la récession.
Au milieu de la crise, on a entendu de nombreux appels à réformer le capitalisme et à contrôler davantage la finance internationale. Mais le ralentissement de la croissance, de l’inflation et de l’investissement a passé tout cela sous silence. Il fallait désormais sortir de la trappe déflationniste. Cela passait par une austérité budgétaire massive couplée à une politique de relance monétaire désespérée, dite de Quantitative Easing.
Le point Godwin intellectuel est atteint lorsque des économistes orthodoxes comparent leurs confrères hétérodoxes à des « négationnistes ».
On en revenait donc au credo de Friedman. La grande différence étant que la voie chilienne est désormais applicable aux pays développés. Si les peuples s’opposent à la liberté du marché en élisant des gouvernements populistes ou de gauche radicale, il faut alors les contraindre par la voie autoritaire. L’exemple le plus patent est la mise sous coupe réglée de la Grèce par ses créanciers internationaux en 2015, en dépit de l’élection de Syriza et de la victoire du Non au référendum sur le mémorandum d’austérité. Mais quand Jean-Claude Juncker déclare qu’ « il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens », on atteint la limite des contradictions entre démocratie et capitalisme.
Le néolibéralisme est avant tout une idéologie économique, ou en tout cas fondée sur une prétention pseudoscientifique à la vérité économique. Le point Godwin intellectuel est atteint lorsque des économistes orthodoxes comparent leurs confrères hétérodoxes à des « négationnistes ». Le consensus se fait dogme. La capacité de questionner un paradigme (Kuhn), ou de falsifier des hypothèses (Popper) est pourtant la base même de l’esprit scientifique. Mais là n’est pas la motivation des épigones du néolibéralisme, qui confondent le progrès avec la croissance, et l’intérêt général avec les intérêts bancaires.
L’illibéralisme ou la politique de la frontière
Voici onze ans que la crise a frappé. Et le monde a changé. On constate une tendance globale à la montée des nationalismes. Celle-ci a été particulièrement spectaculaire en 2016 avec la victoire du Brexit et l’élection de Donald Trump. Elle s’est confirmée avec l’arrivée au pouvoir de l’extrême-droite dans de nombreux autres pays. On la subodore sous la conversion de partis de centre-droit et gauche à un discours illibéral en matière d’immigration et de libertés. Même la Commission européenne, chantre de l’État de droit quand il s’agit de s’opposer à la Pologne ou à la Hongrie, a désormais des portefeuilles aux titres inquiétants tels que démocratie et démographie ou pour la protection de notre mode de vie européen.
Pendant plusieurs années, les Européens de l’Ouest ont regardé avec mépris les dérives autoritaires dans l’Est. Après tout, ces pays qui ont intégré l’UE dans les années 2000, n’ont pas les mêmes traditions que nous… Puis, l’extrême-droite est apparue en Allemagne et en Espagne qu’on croyait immunisées, les libertés constitutionnelles et l’équilibre des pouvoirs ont reculé partout. Et pour finir, le vénérable Parlement britannique a été prorogé sans états d’âme par Boris Johnson, au nom de la « volonté du peuple ».
On entend souvent que la montée du populisme de droite en Occident est due à son succès à traduire les angoisses de la white working-class. Le caractère « blanc » des classes laborieuses est certes discutable. Mais le concept permet à l’extrême-droite de rassembler des citoyens ordinaires frustrés autour d’une identité ethnoculturelle, contre une supposée alliance des métropoles libérales, des migrants et des « assistés ». Se retrouve ici la thématique marxiste de la classe en soi qui se cristallise en classe pour soi. Cependant, il n’est pas ici question de classes sociales objectives, mais d’identités culturelles subjectives… La Nouvelle Droite déforme les concepts de la vieille gauche pour se les réapproprier.
Quand on regarde de plus près, on voit un nouveau modèle se profiler, celui de la démocratie illibérale. Le terme est de Viktor Orbán, le controversé Premier ministre hongrois. Il s’applique aussi à l’Israël de Netanyahou, à l’Inde de Modi, à la Turquie d’Erdogan. D’une part, les démocraties illibérales tiennent des élections libres qui permettent au leader et au parti dominants de revendiquer le mandat du peuple, au sens nationaliste ethnique du terme. D’autre part, les contre-pouvoirs, en particulier la justice et la presse, sont progressivement mis sous le contrôle direct ou indirect de l’exécutif, et les droits des étrangers et des minorités sont limités, voire éliminés. Pas de place ici pour le constitutionnalisme, c’est-à-dire pour la séparation des pouvoirs et la garantie des droits fondamentaux, au cœur du libéralisme politique des Lumières.
Le règne de la novlangue économique
La dynamique du capitalisme est celle d’un renforcement de la division internationale du travail. La mondialisation néolibérale ne fait qu’aggraver cette tendance en poussant les nations dans une course de compétitivité, c’est-à-dire à celui qui s’aplatira le plus vite et le plus platement devant les grands intérêts économiques. Dans les pays développés, la pression délocalisatrice des pays en développement résulte en une stagnation salariale et en une dégradation de l’État-providence. En même temps, les nouveaux enjeux globaux comme les flux migratoires, le changement climatique, le big data et le terrorisme nourrissent les sentiments d’insécurité.
La fragmentation et l’instabilité croissante des systèmes politiques sont l’écho de la crise globale du néolibéralisme. Et pourtant, même les partis communistes historiques ne proposent plus la collectivisation intégrale et les plans quinquennaux. Les programmes de la gauche radicale restent en fait assez sociaux-démocrates. Ce n’est pas l’économie de marché qui est en question, mais l’idéologie du marché-roi, de la propriété-reine et du démantèlement systématique du service public.
Macron lui-même ne suit pas l’orthodoxie néolibérale, car il ne s’embarrasse pas avec la règle d’or de l’équilibre budgétaire. Il ne faut cependant pas voir le néolibéralisme comme une école de pensée économique, ce qu’il a été à une époque. Maintenant que le néolibéralisme est hégémonique, ses concepts sont également instrumentalisés au service de cette hégémonie. Ironiquement, ils deviennent aussi malléables aux impératifs du moment que l’étaient ceux du marxisme officiel en URSS. Sous Macron comme sous Brejnev, lorsque le gouvernement a tort, ce sont les faits qui se trompent… La seule règle d’or du néolibéralisme actuel, c’est la théorie du ruissellement.
Ni néolibéralisme, ni illibéralisme !
Avec la progression des populismes au sens large, un antagonisme peuple-élites s’est surimprimé sur le clivage gauche-droite hérité de la Révolution française. C’est un écho finalement logique à l’alternance des partis conservateurs et sociaux-démocrates pendant la période néolibérale. Les peuples rejettent cette politique aseptisée, réduite à une simple lutte pour des sièges sans opposition fondamentale sur les programmes. Je ne crois cependant pas que l’adversité gauche-droite a décisivement perdu son pouvoir performatif.
Les progressistes peuvent peser à gauche des libéraux et des conservateurs.
L’aggravation des contradictions du capitalisme est telle que les digues qui séparaient jusqu’ici les libéraux des nationalistes sont en train de sauter. On peut citer l’alliance objective entre Ciudadanos, le PP et Vox en Espagne. Mais la plupart des gouvernements mondiaux déroulent, à différents degrés, des programmes économiquement néolibéraux et politiquement illibéraux. Freedom is slavery!
Dans certains pays, comme la France ou Israël, la conflictualité politique est reconfigurée dans un clivage entre libéraux et conservateurs, les grands partis s’opposant plus sur des enjeux sociétaux que sociaux. La gauche semble incapable d’atteindre les secteurs populaires et ouvriers qui ont durablement basculé à droite ou dans l’abstention. Les mauvaises performances électorales des populistes de gauche semblent le confirmer.
Cependant, aux États-Unis, en Espagne, en Italie, le clivage gauche-droite est encore bien présent. Le Brexit a créé un climat politique délétère pour le Labour, mais aussi une fenêtre d’opportunité maintenant qu’il est le seul parti favorable à un second référendum. En Allemagne, les Verts se battent pour le créneau du centre-gauche abandonné par le SPD. Les progressistes peuvent peser à gauche des libéraux et des conservateurs lorsque ceux-ci se ressemblent trop. La politique est par nature antagonique, et la nature a horreur du vide.










