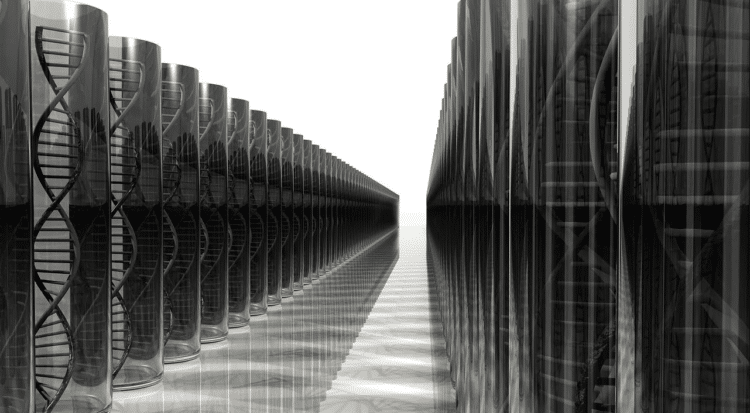Obsédé par sa performance en bourse, Sanofi va vendre sa filiale Opella, qui produit notamment le Doliprane, à un fonds d’investissement américain. Une opération financière qui s’ajoute à une longue liste de fermetures de sites de production et de recherche en France, ainsi que d’abandon de certains médicaments pour favoriser d’autres traitements plus rentables. Alors que l’entreprise bénéficie pleinement de l’argent public via la Sécurité sociale et le Crédit impôt recherche et a un rôle stratégique pour la souveraineté sanitaire française, le gouvernement laisse faire. Le député France insoumise – NFP Hadrien Clouet propose au contraire de nationaliser Sanofi, afin de créer un pôle public du médicament répondant aux besoins des Français. Tribune.
Avant de devenir cette société de chimie financiarisée que nous connaissons, Sanofi est une véritable entreprise de production et de recherche. Créée en 1973 par la société nationale publique d’extraction pétrolière ELF sous le nom d’Omnium Financier Aquitaine pour l’Hygiène et la Santé, Sanofi est le résultat de décennies d’investissement public et de profits pétroliers, désormais orientés vers une diversification en direction du pharmaceutique. Si elle ne compte alors qu’une poignée de salariés, la filiale Sanofi consiste en une « structure d’accueil à fins de concentration » [1] qui rachète tous azimuts, du laboratoire Michel Robilliart ou Choay, jusqu’à Roger & Gallet et Ceva, en passant par Clin-Midy Industries ou un tiers de l’Institut Pasteur [2]. Pas moins de 120 sociétés sont ainsi regroupées en 1980. Il s’agit alors de concevoir un pôle public industriel puissant, notamment autour des vaccins produits par l’Institut Pasteur, financé par des subventions, des donations et des souscriptions publiques, où un pôle lucratif finance les activités non-lucratives. Le chiffre d’affaires passe d’1,5 milliard de francs à 16 milliards en une décennie, de 1976 à 1986. Cette accumulation primitive a reposé sur la création de nombreux emplois, passant de 10 postes à 16.000, et une dynamique de recherche atteignant 20% des ventes pharmaceutiques.
Depuis la privatisation, des activités abandonnées pour gonfler les profits
Lors de la privatisation de 1994, la logique de recherche est abandonnée au profit d’une triple dynamique de croissance, d’acquisitions financières et d’internationalisation de l’activité. Dans les années suivantes, Sanofi disloque ses départements de recherche et développement précoce (consacré aux molécules innovantes) en ciblant successivement le diabète, le cardiovasculaire et l’oncologie. Bilan : 3000 emplois supprimés depuis 2006. Et ce, au seul profit des études cliniques en phase avancée et des maladies lucratives, seule préoccupation sérieuse de « Sanofi Pasteur ». Conséquence professionnelle : une chercheuse spécialisée dans les maladies infectieuses sera transférée vers le département… chargé de compiler les événements indésirables dans les cas de cancer. Les qualifications constituent la variable d’ajustement.
D’où le délaissement de certaines percées internes au profit de l’association avec un laboratoire concurrent visant le marché mondial, à l’instar du vaccin contre les infections à pneumocoque (pneumonie, méningite…) conduit avec le laboratoire sud-coréen SK Chemicals. Quoiqu’il en soit, on arrive alors à une contradiction insurmontable : si l’on abandonne l’étape de la recherche précoce, on sacrifie la diversité des molécules à placer sur le marché, d’où la seule option viable de la financiarisation et des opérations d’achat-vente. Dès lors, les financiers remplacent les entrepreneurs dans le conseil d’administration.
Lors de la privatisation de 1994, la logique de recherche est abandonnée au profit d’une triple dynamique de croissance, d’acquisitions financières et d’internationalisation de l’activité.
En conséquence, comme la plupart des industries pharmaceutiques, Sanofi a entamé la grande transhumance actionnariale, en abandonnant les génériques et les médicaments sans ordonnance pour ne plus se consacrer qu’aux spécialités ultra-lucratives sous brevet pendant plusieurs décennies. Ils tiennent les manettes de l’inflation pharmaceutique, sauf quand un gouvernement leur tient tête et mobilise la licence d’office, au risque de rétorsions vigoureuses devant les tribunaux ou d’embargo informel sur le marché national. Car dans le marché actuel, les laboratoires « d’innovation » déclarent 10% d’excédent brut d’exploitation, contre moitié moins chez les génériqueurs. Opella, filiale produisant notamment le Doliprane, est la queue de comète de ce processus, et la preuve que l’égalisation des taux de profit (ceux qui placent du capital vont là où la rentabilité est élevée, ce qui la fait baisser par la demande excessive, conduisant à rendre un concurrent plus attractif) est incapable d’assurer la fabrication rationnelle des molécules les plus demandées par la pharmacopée et se solde par des pénuries chroniques.
Sanofi fait désormais partie des 10 plus grands laboratoires pharmaceutiques du monde. Avec un bénéfice net important de 5,4 milliards d’euros en 2023… dont 80% sont redistribués (ou plutôt gaspillés) auprès des actionnaires. Le dividende a doublé depuis 2007 (avec 4 milliards d’euros versés en plein Covid-19 !), tandis que le PDG perçoit 112 fois le salaire moyen du personnel. Cette explosion du revenu des actionnaires et des dirigeants choque même l’ex-PDG Jean-François Dehecq, en témoigne son intervention dans l’émission Cash Investigation diffusée le 3 mars 2015 sur France 2. Les producteurs de médicaments rêvent aujourd’hui de faire côter l’entreprise à la bourse de New York.
Une société sous perfusion d’argent français mais tournée vers les Etats-Unis
Or, ce fonctionnement nous coûte désormais très cher. Cette entreprise a bénéficié durant de nombreuses années du financement initial de l’Etat. Ensuite, l’absence de transparence dans les prix des médicaments lui permet de dissimuler le coût réel de la production et de la R&D : les prix sont gonflés, mais l’assurance maladie rembourse… Ces deux coûts peuvent en outre être très largement surestimés par les sociétés. Dans une première hypothèse, le coût de production est artificiellement relevé. Par exemple, un principe actif conçu en France et livré pour conditionnement à une usine en France… peut être acheté à la branche suisse de Sanofi pour un prix élevé, donc refacturé à la Sécurité sociale en l’intégrant au coût de développement déclaré du produit, en plus de déclarer fiscalement sur place [3]. Dans une seconde hypothèse, la recherche et le développement sur le principe actif ont été effectués par des entreprises publiques (à l’instar de l’Inserm), mais sans intégrer ces aides au prix de vente. Non content de ces bénéfices records à moindre coût, le géant pharmaceutique a été récemment condamné pour avoir mis en place des mécanismes visant à discréditer le générique de leur médicament phare, le Plavix.
S’y ajoutent les subventions opaques et discrétionnaires. Prenons le Crédit impôt recherche (CIR), inventé en 1983, stabilisé en 2004 et étendu en dépit de la dénonciation régulière des abus auquel il donne prise. Concrètement, le CIR autorise les entreprises à déduire fiscalement une partie de leurs dépenses de R&D (30% sous la barre des 100 millions d’euros, 5% au-dessus). Mais les rapports se suivent et se ressemblent : cette dépense de 6 milliards d’euros par an est totalement indépendante de l’investissement des entreprises bénéficiaires dans la recherche [4]. Elle s’apparente à un pur effet d’aubaine, dans la mesure où les bénéficiaires auraient de toute façon investi dans la recherche et n’accroissent pas leur investissement en rapport avec ce versement. Sanofi est un cas d’école, puisque le CIR lui octroie 150 millions d’euros par an, soit 7% de prise en charge publique de sa R&D totale… qui est pourtant démantelée ! Outre les 3000 postes supprimés déjà mentionnés, on peut se rappeler de cette pantalonnade du vaccin contre la Covid-19 : incapable de produire son propre vaccin en interne, ou d’identifier des partenaires solides dans l’écosystème des start-ups, Sanofi avait même le projet de réserver la primeur du vaccin aux Etats-Unis… qui avaient financé les essais précliniques avec de l’argent public.
Cette société présentée comme française est devenue anglo-saxonne dans ses marchés et son territoire d’activité, en particulier depuis septembre 2019, avec l’accession à sa tête du PDG britannique Paul Hudson, dont le recrutement était justifié par sa connaissance du marché étasunien.
Car cette société présentée comme française est devenue anglo-saxonne dans ses marchés et son territoire d’activité, en particulier depuis septembre 2019, avec l’accession à sa tête du PDG britannique Paul Hudson, dont le recrutement était seulement justifié par sa connaissance du marché étasunien (son CV comprend notamment les groupes AstraZeneca ou Novartis), témoignant d’une stratégie d’extraversion accentuée. Un mois plus tard, Sanofi inaugure sa première usine digitale… à Boston. Un choix consistant à s’inscrire dans un écosystème de recherche étasunien sous l’ombre de son acquisition Genzyme et à deux pas du MIT ou d’Harvard. Mais, surtout, Sanofi se détourne de la conception et de l’alimentation d’un tel écosystème en France, traditionnellement plutôt inscrit à Lyon et Paris au milieu des pôles universitaires [5]. Au lieu d’amplifier les dépenses publiques en R&D, elle s’en détourne. L’inverse de ce que pratiquent les pays à fort investissement dans le domaine, comme l’Autriche ou les pays scandinaves.
Un tel tournant culmine avec le passage d’Opella sous pavillon étasunien, avec la bénédiction du conseil d’administration et au terme d’arrangements douteux avec le fonds capitalistique CD&R – qui verse 200 millions de dollars à la directrice sabordant sa société et s’est adjoint les services d’un membre du CA de Sanofi pour conduire l’opération. Loin de relever d’une lubie immédiate, la séparation d’Opella est un vieux projet, qui remonte à 2019 – toujours l’arrivée de Paul Hudson – lorsque la maison-mère Sanofi lance une restructuration interne de la filiale. Elle est séparée de la maison-mère et perd la moitié des sites de production, pour se concentrer exclusivement en France, au Japon, au Brésil, en Hongrie et aux Etats-Unis. Afin d’accroître la valeur strictement boursière, le groupe achète et lui adjoint Qunol, une société étasunienne positionnée sur le marché qui connaît la plus vive croissance aux Etats-Unis, soit la gamme des vitamines, minéraux et suppléments.
La liquidation d’Opella, après EuroAPI, vise ainsi à éliminer toute la chimie de synthèse, soit 95% de la production médicamenteuse. Bien sûr que ces sites sont rentables, mais ils empêchent d’atteindre la cible de 30% de rentabilité ! Les gagnants principaux, en dehors des actionnaires d’Opella ? Les banques d’affaires, qui sont 29 à prendre leur part aux opérations, certaines dans le conseil, d’autres pour financer le plus gros LBO (rachat par effet de levier, opération de rachat reposant principalement sur l’emprunt, ndlr) de l’année en France.
La nécessité d’une nationalisation
En somme, on ne peut pas continuer à dilapider l’argent public et tolérer des décisions irrationnelles et coûteuses pour le plus grand nombre. Puisque la direction se moque des contreparties au nom d’une gestion court-termiste de ses actifs rivée sur les cours boursiers, prendre le contrôle n’est qu’un retour sur investissement – on le sait bien chez moi, à Toulouse, où le centre de recherche a été sabordé et liquidé par la direction. Des licenciements aux regroupements, des restructurations aux fermetures, des ventes de fleurons aux investissements dictés par la rentabilité, il est clair que seule la puissance publique est en capacité d’imposer une planification sérieuse de la production de médicaments, en partant des besoins.
Seule la puissance publique est en capacité d’imposer une planification sérieuse de la production de médicaments, en partant des besoins.
Car les collectifs de travailleurs à Sanofi ont des capacités immenses, actuellement freinées ou sabotées par la direction. D’où l’importance de leur donner une voix directe sur les grands choix de l’entreprise. Ils savent produire, connaissent les délais réels des projets et leurs syndicats travaillent en lien étroit avec les associations et les collectifs de malades. Ne sont-ils pas mieux placés pour hiérarchiser les priorités et allouer les moyens, qu’un PDG qui est prêt à sacrifier la production de dizaines de médicaments efficaces, des milliers de postes et des branches entières de sa filiale pour quelques milliards de dollars ? Bien sûr, ce PDG est doué pour gonfler la valeur actionnariale. Mais les malades doivent passer avant les actionnaires – et beaucoup d’actionnaires tomberont un jour malade, donc ils pourraient soutenir la nationalisation par strict égoïsme glacé !

Dès lors, appuyée sur la puissance publique, Sanofi sera en capacité de retrouver le temps long. Aujourd’hui, pour trancher entre deux projets, le board de Sanofi se contente du taux de profit prévisionnel du produit et de sa durée avant commercialisation. Exemple : avec son projet baptisé “Play to win”, Sanofi a abandonné la recherche et la production de médicaments contre certaines pathologies cardiovasculaires, neurologiques (dont la maladie d’Alzheimer qui touche près d’un million de personnes en France) mais aussi les anti-infectieux pour des raisons de rentabilité financière. La puissance publique, elle, est en capacité de raisonner sur les coûts à l’échelle d’un pays entier, réalisant que les superprofits de Sanofi sont les déficits de la Sécurité sociale, ce qui la débarrasse de l’obsession de la marge nette de l’entreprise.
Le marché est ainsi en échec total sur le sujet du médicament. En juin 2023, Emmanuel Macron avait annoncé un plan de relocalisation de 450 médicaments, suite aux ruptures d’approvisionnement de l’hiver précédent. Celles-ci ont-elles disparu ? Pas le moins du monde. Le Praluent, médicament de Sanofi contre les problèmes de cholestérol, est en tension et l’Icatibant contre les oedèmes de Quinck vient juste de passer en rupture de stock. Pourtant, à chaque fois que l’opportunité advient de constituer un pôle public du médicament, le gouvernement fait des sauts périlleux arrière pour empêcher cette solution immédiate. Il préfère se livrer au marché… alors que le marché n’en veut pas. Car le bilan de ces relocalisations de médicaments est nul et non avenu. Sur les 531 projets de relocalisation, seuls 15 concernent des principes actifs de santé (pilule contraceptive, actifs naturels…) et moins de 10 des médicaments [6]. Il a même fallu passer outre les notations négatives de BPIFrance pour donner suite ! Seuls les dispositifs médicaux attirent du capital privé (pour des aiguilles chirurgicales, des aérosols ou des filtres à poche de transfusion). Allons-nous rester les bras ballants, à brûler des cierges en espérant qu’un capitaliste relocalise accidentellement nos boîtes de médicaments ?
La propriété publique de la production médicamenteuse sonnerait la fin du racket généralisé.
En outre, la propriété publique de la production de médicaments résout l’hostilité farouche du secteur à toute transparence. La chaîne de valeur sera enfin connue ! Avantage de taille, qui permettra de négocier chiffres à la main les prix publics des médicaments à partir des coûts réels de ces lignes de production. C’est la fin du racket généralisé. Prenons le cas du Lantus, un produit essentiel de Sanofi, qui lui a rapporté plus de 50 milliards d’euros de chiffre d’affaires depuis 2004, pour un stylo injectable à 5 cartouches vendu 38€. A quel titre ? Combien a investi Sanofi en recherche ou en frais de production ? On n’en saura rien… mais on sait que le stylo est une découverte de la recherche publique étasunienne, et que l’insuline des cartouches a été payée 1€ symbolique à ses découvreurs qui l’ont offerte à l’humanité. Où vont donc les 38€ ? La propriété publique nous le dira.
On entend déjà hurler certains fondés de pouvoir des conseils d’administration (aussi appelés « députés macronistes ») quant au prix de l’opération. Bien sûr, on peut discuter des modalités précises du contrôle… tout cela est de la tuyauterie terminale. L’enjeu est la prise de pouvoir collectif sur le producteur pharmaceutique principal du pays. La capitalisation boursière de la société dépasse effectivement les 100 milliards d’euros. Mais ce prix fictif est largement modulable au cours des débats parlementaires, en fonction de l’ampleur de la montée au capital, du périmètre finalement conservé, du rythme des acquisitions (veut-on construire autour d’une ou deux entités pour ensuite monter sur le reste ?). Mais quoiqu’il en soit, la rentabilité de l’entreprise jointe aux dépenses publiques économisées rembourserait en quelques années le prix même de la nationalisation ! Si nous en arrivons à ce niveau de discussion, c’est que nous avons déjà gagné les consciences.
Notes :
[1] François Chesnais, « L’industrie pharmaceutique dans la crise », Revue d’économie industrielle, 1985, vol. 31, p. 95.
[2] L’affaire Labaz, Courrier hebdomadaire du CRISP, 21/12/1979.
[3] Olivier Gros, « Médicaments, trou de la sécu et loi du marché ». Revue Projet, 2016/2 N° 351, 2016. p.83-89.
[4] « Évaluation du crédit d’impôt recherche », avis de la Commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation, France Stratégie, Paris, juin 2021.
[5] Jacques Bonnet, “De Rhône-Poulenc à Sanofi-Aventis : intérêts régionaux et logiques mondiales”, L’Information Géographique, 69-2, 2005, p. 117-131.
[6] Cour des comptes, Le dispositif de relocalisations sectorielles du plan de relance, S-2023-1160.