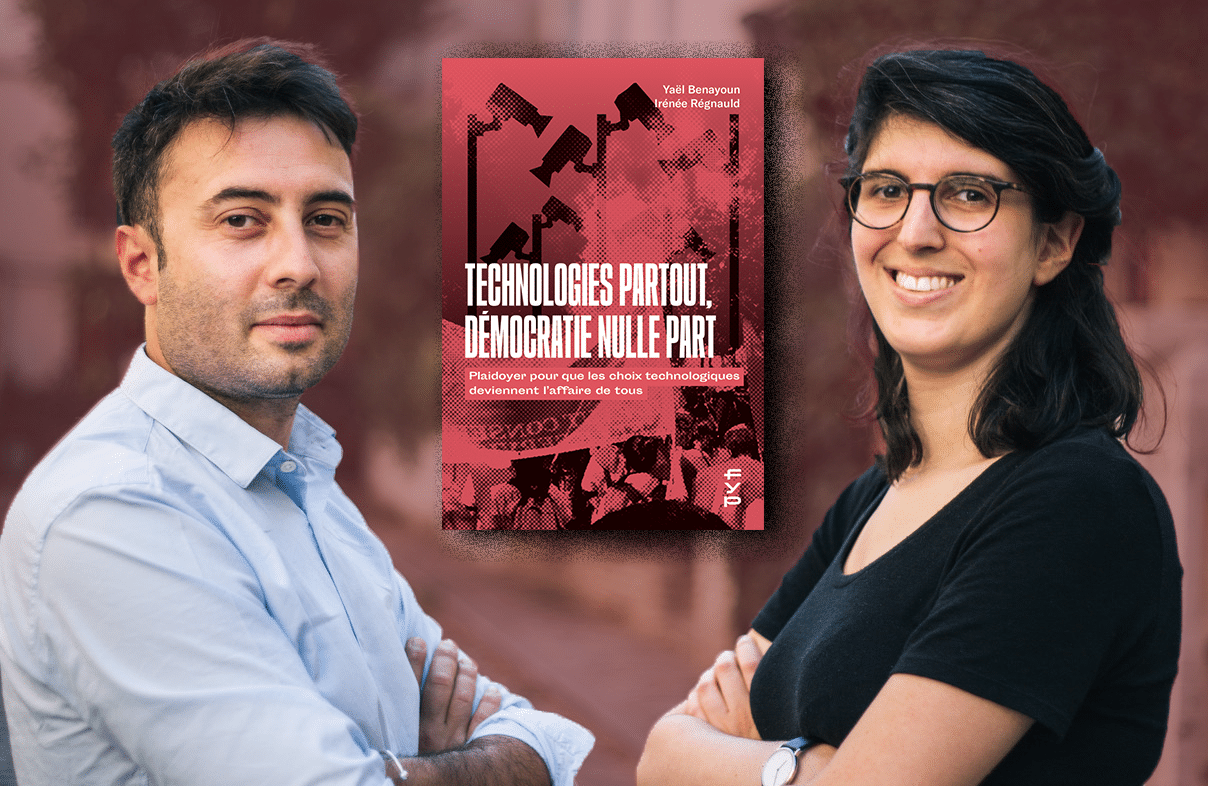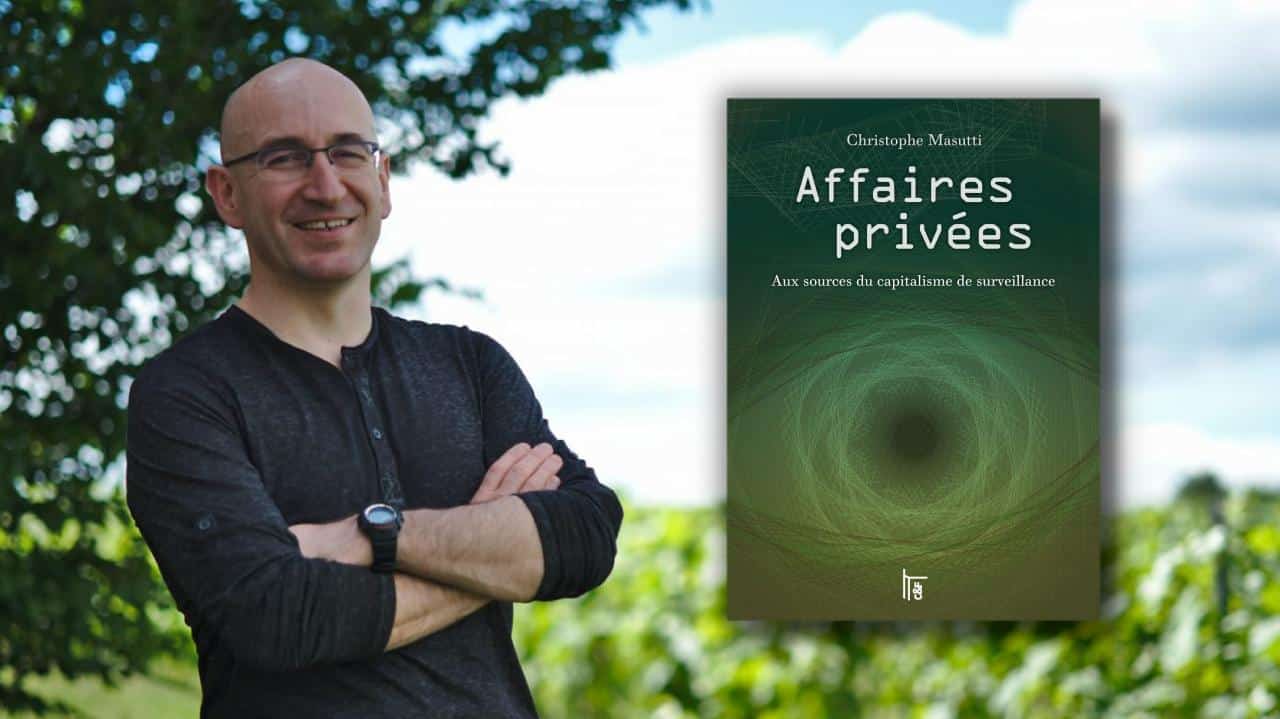La stratégie du choc poursuit sa mise en oeuvre : la crise sanitaire se révèle un marché juteux pour le secteur du numérique, qui n’hésite pas à tirer profit de la crise sanitaire pour étendre son influence. Accompagnées par un État guidé par la défense des entreprises dans des choix aussi essentiels que ceux de ses politiques numérique et sanitaire, les entreprises de la tech sont les grandes gagnantes de la pandémie, aux dépens du service public, des citoyens et de leur santé. Par Maud Barret Bertelloni et Augustin Langlade.
L’application StopCovid, mise en service le 2 juin, n’aura envoyé dans son premier mois d’activité que 14 signalements de contacts potentiels, selon les seuls chiffres disponibles à ce jour. L’instrument national de contact tracing, qui n’a été activé que par 1,8 million de français – pour 400 000 désinstallations – a néanmoins fait l’objet d’une saisine au parquet national financier pour risque de surfacturation et d’une mise en demeure de la CNIL, après la découverte d’un chercheur en cyber-sécurité : l’application collectait plus de données qu’annoncé.
Porté contre vents et marées par le secrétaire d’État au numérique, Cédric O, ce projet aussi ambitieux qu’inefficace rassemble quelques « fleurons » de l’industrie française, réunis dans un consortium public-privé : Dassault Systèmes et sa filiale 3DS Outscale pour le stockage des données, Capgemini pour l’architecture de l’application, Lunabee Studio pour son développement mobile, Orange pour la diffusion, Withings pour les objets connectés, ainsi qu’Accenture, Thalès, Atos, Bertin Technologies et d’autres. En tout, une centaine de représentants d’une petite trentaine d’entreprises ont participé de près ou de loin à l’application, dont les plus ardents défenseurs prétendent qu’elle pourrait ni plus ni moins sortir la France de la crise.
Un tel état d’esprit traduit à merveille l’époque que nous traversons. L’application StopCovid, très médiatisée, ne représente que l’une des innombrables technologies numériques mobilisées pour répondre à l’épidémie. Drones, caméras de reconnaissance automatique d’images, sites et applications de téléconsultation, partage et traitement de données, scanners thermiques, logiciels de surveillance des examens, objets connectés, aucun outil n’aura été négligé.
Saisissant l’opportunité qui s’offrait à lui, le monde de l’innovation a rivalisé d’ingéniosité et d’ardeur pour se présenter, une fois de plus, comme la panacée à toutes les difficultés que pose cette situation nouvelle. Ce déploiement inédit de technologies, dont certaines s’étaient jusqu’ici cantonnées au domaine de l’armée, du renseignement ou du maintien de l’ordre, n’a pas manqué de nourrir l’inquiétude des défenseurs des libertés publiques, qui craignent une extension sans précédent de la surveillance et de nouvelles atteintes au respect de la vie privée. Cependant, alors que le débat s’acharne à savoir si l’on préfère mourir libres ou vivre surveillés, un aspect est systématiquement passé sous silence : quels acteurs et quels intérêts se croisent dans les coulisses de ces technologies ?
Quand l’urgence sanitaire rencontre la transition numérique à marche forcée
Outre le fameux contact tracing, le déploiement de nouvelles technologies en tout genre a subi un coup d’accélération pendant l’épidémie. À quelques exceptions près, chacune de ces technologies trouve son origine dans une entreprise privée, qui a saisi la crise comme une excellente occasion de proposer ses produits tout en bénéficiant d’une image exemplaire.
Le domaine de la santé a vu prospérer les applications de diagnostic et de téléconsultation, comme Doctolib en France, parfois associées à des objets connectés reconvertis dans le médical. De Nice à Paris, de Lille à Saint-Malo, les drones ont patrouillé dans les cieux français, ainsi que les hélicoptères équipés de caméras infrarouges, pour faire respecter le confinement. La reconnaissance automatique d’images, si controversée, a quant à elle été déployée sur les lieux de travail (Amazon, Infosys) et dans l’espace public (dans les marchés à Cannes, à Chatelet-les-Halles à Paris) pour faire appliquer les mesures de distanciation physique ou le port du masque. Les plates-formes de livraison, de visioconférence, de contact, de formation, ainsi que des réseaux sociaux ont connu une prodigieuse explosion du fait du confinement et du télétravail : Amazon, UberEats, Deliveroo, Doctolib, Zoom, GoToMeeting, Tixeo, Google Meet, Udacity, Coursera, Datascientest ; un fourmillement de « solutions » aux difficultés de la crise sanitaire qui ne doit rien au hasard…
Les défenseurs comme les critiques de la technologie semblent parfois l’oublier : tous ces outils ne tombent pas du ciel ; ils sont au cœur d’un marché aussi florissant que féroce. Si, malgré la récession qui s’est amorcée, le secteur du numérique se prépare à la croissance, recrute et lève des fonds à tout-va, c’est au prix d’une lutte pour la survie, dans une nouvelle phase de sélection et de compétitivité redoublée.
C’est aussi au prix d’un placement de produits agressif, aux dépens des garanties légales, de protection de la vie privée des usagers et du débat public. L’usage des drones a par exemple été rapidement suspendu à Paris par le Conseil d’État. De la même manière, l’expérimentation en matière de reconnaissance automatique d’images menée par Datakalab à la station parisienne Châtelet-les-Halles a été interrompue le 12 juin par la CNIL, faute d’un cadre protégeant les données personnelles des usagers, comme le révèle une récente enquête de Médiapart.
Pire encore, le déploiement compulsif de ces outils se fait sans gage d’efficacité. C’est le cas des scanners thermiques qui n’ont pas tardé à s’imposer dans les aéroports, les gares et bien d’autres lieux de grande fréquentation, en Belgique, en Chine, en Italie ou en France, et cela malgré les propos décourageants de l’ancienne ministre de la Santé et de l’OMS, qui insistent sur leur inefficacité et sur le risque du faux sentiment de sécurité qu’ils peuvent susciter.
Alors qu’elles installent leurs produits, certaines entreprises ont trouvé le moyen de se faire de la publicité en offrant gratuitement leurs services, selon une stratégie de marketing partagée par Pornhub, qui a proposé un mois d’abonnement gratuit aux populations confinées, par Bending Spoons, la start-up qui a développé gratuitement « Immuni », l’application de traçage italienne, ainsi que par de petites sociétés telles que Pradeo (sécurité des terminaux mobiles) ou Intrasense (imagerie médicale) à Montpellier, dont les outils ont été mis gracieusement à disposition des administrations publiques et des particuliers.
Dans une société déroutée par les événements, subissant de plein fouet le bouleversement ou la suspension de ses activités ; alors que le gouvernement cherche à multiplier les moyens de lutte contre l’épidémie et à assurer le déconfinement et la reprise de l’activité économique ; tandis que les patrons et les directeurs d’établissements privés craignent d’être mis en cause pour négligence, les acteurs du numérique s’unissent et se mobilisent pour exploiter l’effet d’aubaine unique que leur fournit la crise.
Dans le secteur public comme privé, c’est une véritable stratégie du choc pandémique qui est à l’œuvre depuis le début de la crise, ainsi que la décrit Naomi Klein aux États-Unis. Dès le mois de mars, les lobbies du secteur, comme Syntec Numérique, Tech in France ou France Digitale, se sont mis à disposition du gouvernement et ont fourni à Bercy leurs propositions pour « le monde d’après », qui ressemble à s’y méprendre à une extension considérable du monde d’avant : équipement des ménages (notamment ceux du troisième âge), couverture du territoire en très haut débit, investissement public et privé dans les start-ups, numérisation des services de l’État, transition vers un monde hyperconnecté par leurs soins.
L’État, paladin des entreprises de la French Tech
Une grande partie des technologies mobilisées pendant la crise auront été largement financées ou promues par l’État, en aval comme en amont. En amont, car la start-up nation fait l’objet d’importants investissements publics, à travers la Banque publique d’investissements (BpiFrance), premier soutien de l’innovation « disruptive », à l’origine du plan extraordinaire de 4 milliards d’euros, spécialement destiné à renflouer les trésoreries des start-ups pendant la crise, auquel s’ajoutent celui de 1,2 milliard de soutien en juin et le volet « rattrapage numérique » de 1,4 milliard du Ségur de la Santé…
En aval, car l’État (à travers différents organismes publics) figure parmi les premiers acheteurs de ces technologies, comme on l’a vu pendant la période trouble de l’épidémie. Les technologies achetées par l’État sont la plupart du temps destinées aux services publics, sous-traitant ce marché immense financé par les contribuables et s’en dépossédant du même coup. L’exemple le plus frappant est sûrement celui de l’une des rares licornes françaises, Doctolib. Dopée par l’urgence et recommandée par le gouvernement, la plate-forme n’a fait qu’une bouchée du marché des téléconsultations, dont le nombre a explosé pendant le confinement. C’était l’occasion que la start-up attendait, puisque sa valeur est désormais passée au-dessus d’un milliard d’euros.
Sa foudroyante progression est le fruit d’une lente pénétration du système de santé français, d’un démarchage ininterrompu de particuliers, d’établissements et d’hommes politiques par des centaines de courtiers, d’une succession de contrats juteux avec l’AP-HP ou l’Assurance maladie ayant mis peu à peu hors jeu la concurrence. De sa position quasi monopolistique, Doctolib s’apprête maintenant à inaugurer la sous-traitance du domaine de la santé, dont l’État n’avait pas encore réussi à se débarrasser.
Dans ce contexte, ce n’est pas la silhouette d’un État totalitaire qui ressort, cherchant à connaître et à contrôler sa population par des technologies de surveillance, mais les maigres restes d’un État actionnaire, qui voudrait faire de ces entreprises son fer de lance numérique, mais qui continue de se délester de ses responsabilités et se contente d’être un soutien de l’innovation privée.
Sur la scène internationale, l’État se cantonne au rôle de paladin des industries du numérique sur les marchés européens et mondiaux. Ainsi, dans leur tribune conjointe, le secrétaire d’État au numérique Cédric O et ses homologues italiens, allemands, espagnols et portugais déclaraient la nécessité de garantir la « souveraineté technologique européenne » face à des GAFAM récalcitrants. Une souveraineté dont la définition laisse perplexe : « La souveraineté numérique constitue le fondement d’une compétitivité européenne durable » ; souveraineté réduite, donc, à la défense de l’industrie nationale sur les marchés européens ou de l’industrie européenne sur les marchés mondiaux.
GAFAM non, French Tech oui : ce cas de figure n’est pas sans rappeler le rapport protectionniste que la France entretient avec son industrie militaire, quand elle envoie son chef de l’État en tournée comme représentant commercial des entreprises, pour n’en retirer, maigres bénéfices, que le maintien des emplois et quelques revenus fiscaux accommodants. Du point de vue national, cela revient à favoriser les acteurs privés, quitte à écarter les agences publiques capables de développer des technologies pour le service public. Plutôt que d’investir dans de nouvelles structures et infrastructures, il soutient le développement des technologies qu’il achète et dont les éléments essentiels, comme les données, lui échappent.
La trajectoire de l’application StopCovid illustre parfaitement cette dynamique. Alors que la réalisation de l’application de tracing avait été initialement confiée à la direction interministérielle du numérique (DINUM), ainsi qu’à son incubateur, celle-ci a été progressivement écartée en faveur du consortium actuel, composé d’industriels chapeautés par l’INRIA, elle-même accompagnée par la vigilance de l’ANSSI en matière de sécurité – ce qui revient dans les faits à donner aux instances publiques un simple rôle consultatif, tout en laissant les entreprises privées aux commandes de l’application.
Malgré un bras de fer infructueux avec Google et Apple au sujet du protocole de l’application, à cause duquel celle-ci a rencontré d’importantes difficultés sur le petit tiers d’iPhones des Français, et malgré les critiques qui en dénoncent les risques, Cédric O et son « consortium » ont continué de développer leur outil, tenant pour acquise son efficacité. Mais le bilan des systèmes de traçage est accablant : échec à Singapour, en République tchèque, en Islande, retrait en Norvège et en Belgique, suspension au Royaume-Uni… En Australie, trois semaines et six millions de téléchargements n’auront permis de détecter qu’un cas, un unique “vrai positif”.
Des enjeux comme le positionnement et la réputation de ces industries sur les marchés compétitifs des données de santé ont pris le pas sur l’intérêt général et la santé publique. En toute inefficacité.
Technologie pour le service public ou technologie pour le marché ?
Dans cette course aux profits, à la croissance et à la compétitivité où l’État et les entreprises se passent le relais, il semblerait qu’un détail aussi simple que fondamental soit perdu de vue : tout développement, toute utilisation de technologies représente essentiellement un choix de société.
Prenons l’exemple d’un moteur de recherche. Celui-ci peut se contenter d’indexer les pages web et de faire remonter les informations aux utilisateurs, à la manière de Qwant ; ou bien, comme le fait Google, il peut s’ingénier à fournir un service qui lui permet de s’accaparer les données du plus grand nombre d’utilisateurs possible et de les monétiser sur les marchés de la publicité ciblée.
La technologie est par nature ouverte et plastique, c’est-à-dire qu’elle s’adapte aux usages qu’on en fait, à nos aspirations et à nos principes, le même outil pouvant fournir un service public ou s’imposer aux dépens de l’utilisateur.
En ce sens, faire le choix d’une technologie de profit plutôt que d’une technologie destinée au service public est un choix politique. Il faut le dire. À chaque fois que le gouvernement achète les gadgets que les lobbies du numérique lui suggèrent, à chaque fois qu’il écarte une agence publique pour la remplacer par des acteurs privés dont il défend les intérêts, à chaque fois qu’il sous-traite un service public aux entreprises du numérique, il fait le choix d’une politique technologique de marché.
Si l’on obéit à une telle doctrine, rien ne sert vraiment le bien commun. Une technologie apparaît et demeure quand elle est rentable, voilà tout. Le choix politique actuel consiste à ne jamais développer d’infrastructures technologiques publiques (comme le cloud pour le stockage des données), ou de capacité à mettre sur pied des logiciels, des plates-formes, des services. En abandonnant le numérique au marché, le gouvernement accepte que le développement et les formes de la technologie ne soient régis que par des intérêts économiques ; un paradoxe, puisqu’il prétend naviguer à pure rationalité.
Parmi les outils les plus efficaces pour contrer l’épidémie se trouvent de nombreuses « low », voire très « low-tech » : les masques, les imprimantes 3D qui ont permis de fabriquer du matériel de protection et des respirateurs, enfin les gestes barrières. Ce sont là des technologies qui auront davantage contribué à ne pas avoir sur la conscience « les morts supplémentaires et le reconfinement », spectres agités par Cédric O pour faire passer en force son application.
De la même manière, cette politique de marché s’oppose à toute tentative de démocratisation des questions technologiques. Alors que la Convention citoyenne pour le climat (CCC) s’est emparée de la 5G, demandant un moratoire jusqu’à ce qu’une évaluation environnementale et sanitaire soit menée, le gouvernement prépare comme si de rien n’était ses enchères pour la rentrée. Il ignore une fois de plus l’intérêt des citoyens et cède à la pression des grands groupes, seuls bénéficiaires de ce gigantesque déploiement de moyens.
Or, une politique technologique digne de ce nom développerait des infrastructures destinées au service public. Il ne faut pas croire qu’un État impliqué dans les technologies ressemblerait à la Chine, comme si le choix ne reposait qu’entre surveillance d’État et libre marché. On peut parfaitement imaginer que le développement technologique soit mené par des organismes indépendants dans leurs statuts, avec une protection juridique forte, et une propriété publique. La logique des communs, comme le soulignait l’ambassadeur du numérique Henri Verdier, n’est pas incompatible avec l’action publique.
Bien au contraire, l’emploi de l’open source par l’administration permet par exemple d’épargner de coûteuses licences d’utilisation et de développer des outils ajustés aux besoins spécifiques de chaque acteur. Dans un ordre d’idées similaire, l’ouverture des données publiques peut améliorer les services de l’État tout en laissant le champ libre à la civic tech, ainsi qu’à la contribution technologique citoyenne.
Cette politique requiert un brin d’imagination, en ce qu’elle met en cause un état de fait et une idéologie qui voudrait que la technologie soit affaire de spécialistes et d’entreprises privées, et non un outil puissant du service public, qui laisse voix au chapitre aux citoyens et sert leurs intérêts. C’est en ce sens que la première question des technologies n’est ni éthique ni philosophique, mais simplement politique : préfère-t-on que les affaires publiques de santé et de numérique soient guidées par l’intérêt général ou par la quête du profit privé ? Car pendant la crise du Covid-19, le déploiement des outils technologiques, plutôt que la protection de la population et l’amélioration de ses conditions de vie, n’a servi qu’à vendre les citoyens et leurs données aux entreprises privées, comme choix politique assumé.
Deuxième édition d’un article initialement paru chez La Relève et La Peste.