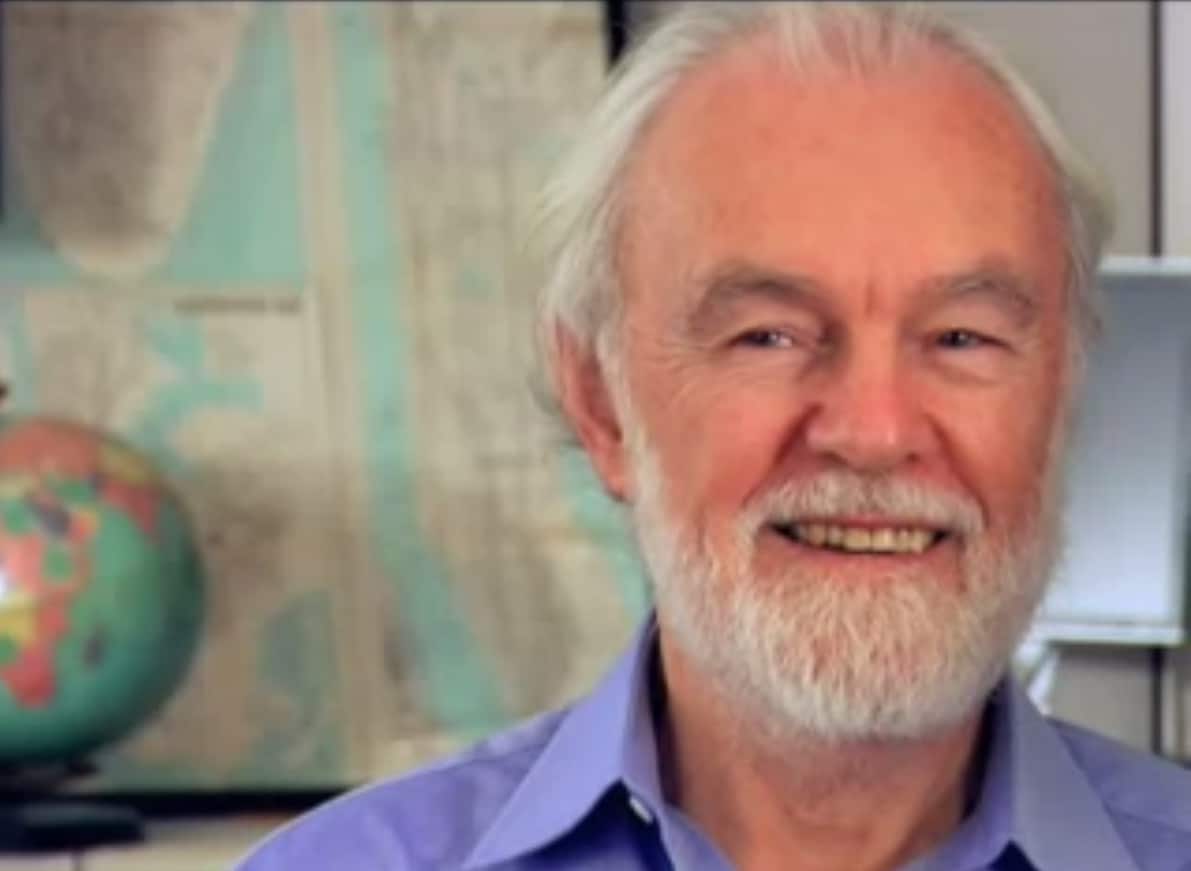David Harvey est un géographique britannique, auteur de nombreux ouvrages depuis les années 1960. Inspirés par la lecture de Marx, ses travaux balayent de nombreux thèmes, se focalisant particulièrement sur les évolutions des villes et du capitalisme. Entretien réalisé par Simon Vazquez pour Catarsi magazine.
Simon Vazquez – Nous aimerions commencer par parler de la crise. Dix ans après le krach de 2009, pensez-vous que nous sommes face à une crise globale du capitalisme ?
David Harvey – Il y a plusieurs façons de comprendre les crises. Je considère que les crises sont des périodes de réorganisation du capital. Il y a des gens qui croient que les crises marquent la fin du capitalisme. J’estime qu’elles sont plutôt des adaptations du capitalisme à de nouvelles circonstances et à des moments de restructuration vers un système alternatif.
SV – Selon vous, quelles ont été les conséquences de la crise de 2009 ? pensez-vous que la crise est terminée ou, comme certains économistes l’affirment, sommes-nous sur le point d’entrer dans une nouvelle récession ?
DH – C’est une question intéressante. En temps normal, on tend à constater que l’économie va bien, tandis que les gens vont mal. Ce qui s’est passé entre 2007 et 2009 est une grande anomalie car les réponses à la crise ont été différentes d’une aire géographique à une autre. En Occident, on a opté majoritairement pour l’austérité, en considérant que c’était une crise de la dette et qu’il fallait la réduire, qu’il fallait couper dans les dépenses au point de nuire à la qualité de vie de la majorité de la population. Cela n’a pas du tout affecté les ultra-riches, car les données montrent que les 1% (ou les 5%) ont très bien supporté la crise et ont réalisé d’importants bénéfices. Comme le dit le proverbe, « ne laissez pas passer l’opportunité d’une bonne crise ». Les financiers s’en sont plutôt bien sortis, de la crise.
« Dans les crises précédentes, comme dans les années 1930 ou 1970, le capitalisme a été réorganisé. Mais cette fois-ci, rien n’a changé. »
Mais il y a eu une autre réponse totalement différente, celle de la Chine. La Chine n’a pas opté pour des politiques d’austérité, elle a investi massivement dans les infrastructures et l’urbanisation. A tel point que les importations de matières premières ont grimpé en flèche, de sorte que les pays fournisseurs, comme le Chili avec le cuivre, l’Australie avec le fer et les minéraux, le Brésil avec les métaux et le soja, et ainsi de suite, ont eux aussi surmonté la crise assez rapidement. Je pense que la Chine, à elle seule, a sauvé le capitalisme mondial de l’effondrement. C’est un élément dont l’Occident ne tient pas vraiment compte. La Chine a créé plus de croissance depuis 2007-2008 que les États-Unis, l’Europe et le Japon réunis. Pour une réponse à une crise, c’est impressionnant.
Il y a donc eu deux façons de sortir de la crise. Techniquement, elle a pris fin en 2009, mais si l’on s’intéresse aux conditions de vie des gens, on constate une stagnation depuis 2007-2008. Pour ma part, je me focaliserais sur un élément : dans les crises précédentes, comme dans les années 1930 ou 1970, le capitalisme a été réorganisé. Dans les années 1930, la réponse a été l’économie keynésienne, l’intervention de l’État, le contrôle de la demande, etc. Dans les années 1970 ont émergé des recettes néolibérales qui ont fonctionné un temps. Mais cette fois-ci, rien n’a changé. Ou bien si, les politiques mises en œuvre sont encore plus néolibérales qu’auparavant. Mais le néolibéralisme a perdu de son pouvoir d’attraction et de sa légitimité. Nous sommes donc face à un néolibéralisme imposé par des moyens autocratiques, tantôt par le biais d’un populisme de droite, comme dans le cas de Trump, tantôt par le capital lui-même.
SV – Vous évoquez Donald Trump. Il arrive que les crises ouvrent la voie à l’organisation du peuple, mais aux États-Unis et en Europe, les citoyens ont davantage opté pour des idées et des dirigeants réactionnaires. Peut-on encore réfléchir au poids des termes comme les conditions objectives ?
DH – Oui, on peut y réfléchir, bien entendu. Pourquoi pas ? Les conditions objectives s’observent aussi en politique. Je pense que la gauche n’a pas bien réagi aux transformations du capitalisme et qu’elle peut encore reproduire les erreurs qu’elle a déjà commises. Par exemple, dans les années 1980 et 1990, l’Occident a été impacté par la désindustrialisation en raison des changements technologiques. La gauche a essayé de se défendre de la désindustrialisation et de protéger les classes populaires traditionnelles. Mais elle a perdu la bataille et avec elle, une grande partie de sa crédibilité. Aujourd’hui, l’Intelligence artificielle s’installe comme une thématique centrale. Elle prendra de l’ampleur et aura sur les services les mêmes effets que l’automatisation a pu avoir sur l’industrie. La gauche peut retomber dans l’écueil d’une lutte contre une innovation qui s’imposera quoiqu’il arrive. Je pense que nous devrions être une gauche créative qui embrasse l’intelligence artificielle, l’automatisation, l’idée de nouvelles organisations du travail, qui aillent au-delà de ce que nous propose le capitalisme.
Mais cela implique d’élaborer de nouvelles politiques, car la classe ouvrière traditionnelle a disparu dans de nombreux pays. Et, par conséquent, la base traditionnelle de la gauche a disparu. Pas intégralement, certes, mais pour une bonne partie. Nous avons donc besoin d’une nouvelle gauche qui se concentre sur des politiques anticapitalistes. Cela signifie que nous devons non seulement nous focaliser sur le travail et les travailleurs, mais aussi sur les conditions de vie, le logement, les services sociaux, l’environnement, la transformation culturelle. Nous avons besoin d’une gauche qui élargisse son regard pour appréhender ces questions dans leur ensemble, au-delà de la pensée traditionnelle d’une classe ouvrière comme la base sur laquelle tout reposerait.
SV – Si l’on se concentre sur ces points, il pourrait y avoir un potentiel révolutionnaire dans les mouvements sociaux urbains. Pensez-vous que ces derniers ont été sous-estimés par les partis de gauche ? Ou percevez-vous des changements ?
DH – Cela fait déjà un moment que les villes sont traversées par des mouvements sociaux. Par exemple, au cours des vingt dernières années, les principaux mouvements se sont concentrés sur la détérioration des conditions de vie dans les zones urbaines : les révoltes du parc Gezi en Turquie ; au Brésil, contre la hausse du prix des transports et le manque d’investissement dans les infrastructures. Nous devons admettre qu’il y a aujourd’hui plus de foyers de protestation dans ces mouvements que dans les revendications ouvrières. Il y a encore des problèmes sur les lieux de travail, mais la gauche doit être un canal politique pour les demandes des mouvements sociaux. Je le dis depuis un certain temps déjà. Dans les années 1970, j’avais déjà fait remarquer que la gauche devait s’engager sur cette voie, mais personne n’en tenait véritablement rigueur.
Depuis les années 2000, on m’a davantage écouté. Par exemple, le mouvement des locataires qui prend forme à New-York depuis un moment ainsi qu’en Californie est crucial. Combien de villes dans le monde comptent aujourd’hui des organisations de locataires ? Pourtant, peu de partis de gauche élaborent des politiques à ce sujet. Cela n’a pas de sens. Ces mouvements affrontent de grands groupes comme Blackstone, le plus grand promoteur immobilier du monde, qui contrôle déjà la Californie. Ils s’implantent à Shanghai, à Bombay, un peu partout, et ces mouvements de locataires sont fondamentalement anticapitalistes.
SV – Pensez-vous que ce problème global ouvre des possibilités d’unir les mouvements anticapitalistes issus de luttes différentes ?
DH – Les possibilités qui existent suscitent en moi de l’espoir : si un mouvement international d’expropriation de Blackstone venait à se constituer, par exemple, cela pourrait devenir intéressant.
SV – Dans votre livre Lógica geográfica del capitalismo [La logique géographique du capitalisme] vous dites être arrivé tardivement au marxisme. Quel élément de cette école de pensée retenez-vous plus que les autres ?
DH – Je travaillais sur des questions d’urbanisme quand je suis arrivé à Baltimore à l’âge de 35 ans. Je m’intéressais aux études sur la qualité du marché locatif, qui engendrait des contestations dans les villes américaines de la fin des années 1960. Dans le cadre de mes recherches, j’avais recours à la méthodologie des sciences sociales traditionnelles, mais elles ne fonctionnaient pas. J’ai cherché d’autres manières de l’aborder, et avec l’aide de quelques étudiants j’ai proposé d’en passer par Marx. J’ai trouvé ses apports pertinents, davantage pour des raisons intellectuelles que politiques.
« Lorsque Marx écrit Le Capital, le capitalisme dominait au Royaume-Uni, en Europe occidentale et aux États-Unis. Mais aujourd’hui, il est partout. Et les analyses de Marx au sujet des failles et des contradictions du capital me semblent toujours valables et importantes. »
Mais après avoir cité Marx à de multiples reprises, on a commencé à me qualifier de marxiste. Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais au bout d’un certain temps cela m’était égal et je leur donnais raison. Est-ce que je suis marxiste ? Oui, je suis marxiste, mais aujourd’hui encore je ne sais pas très bien ce qu’on veut me faire endosser avec cette étiquette. Il y a chez Marx une composante anticapitaliste, c’est une critique du capital qui, à mes yeux, est plus importante aujourd’hui qu’elle ne l’a jamais été. Car lorsque Marx écrit Le Capital, le capitalisme dominait au Royaume-Uni, en Europe occidentale et aux États-Unis. Mais aujourd’hui, il est partout. Et les analyses de Marx au sujet des failles et des contradictions du capital me semblent toujours valables et importantes.
SV – Que diriez-vous aux nouvelles générations de militants qui s’intéressent davantage à l’action politique ?
DH – Marx disait que notre tâche n’est pas de comprendre le monde mais de le transformer. Mais je ne crois pas pour autant qu’il ne cherchait pas à comprendre le monde. Pourquoi a-t-il écrit Le Capital ? Car il pensait que pour changer le monde, il fallait dans un premier temps le comprendre, et bien le comprendre. Je pense qu’il est important que l’on réinvestisse les idées de Marx associées aux circonstances actuelles pour aider les gens à comprendre ce à quoi ils sont confrontés.
SV – Tel que vous l’envisagez, pensez-vous qu’il y ait de nouvelles perspectives pour comprendre Marx, à travers la géographie et l’histoire par exemple ?
DH – C’est mon intérêt pour l’urbanisme et la géographie qui m’a amené à lire Marx sous un angle inhabituel. Par exemple, dans mon livre Les limites du capital, je parle principalement de finances, ce qui n’était pas courant dans les années 1970. Je parlais de l’usage de la terre et des terres. Ma lecture de Marx a toujours été orientée vers une compréhension du développement géographique et de l’urbanisme. C’est ce qui me conduit à mettre l’accent sur des aspects de Marx que d’autres ignorent. Et le fait de rééditer un livre écrit en 1982 signifie que les gens le considèrent encore pertinent et souhaitent parler d’urbanisme, de logement, etc. Il y a un cadre de pensée autour de Marx qui va au-delà de ce qui a été historiquement étudié.
SV – La crise a favorisé une redécouverte de Karl Marx. Pensez-vous que cela a soulevé de nouvelles questions, de nouveaux problèmes pour la gauche ? La redécouverte de Marx semble être davantage liée à un enjeu politique qu’à un enjeu académique.
DH – Au cours de toutes mes années d’enseignement, j’ai vu des périodes où Marx suscitait de l’intérêt, puis du désintérêt, et de l’intérêt à nouveau. Depuis la crise de 2007-2008, on observe un regain d’intérêt, qui s’est un peu atténué, car on se fixe davantage sur des thèmes comme l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, la vague néolibérale-fasciste, l’interdiction du port d’armes, Bolsonaro, etc. L’intérêt s’est aujourd’hui déplacé sur le terrain de la politique. Les thèmes de l’économie politique sont moins dans l’air du temps, mais si l’économie mondiale devait connaître de nouveaux soubresauts, on en entendra de nouveau parler.
SV – Il y a à Barcelone un tissu associatif procédant d’une longue trajectoire qui a fait confiance aux pouvoirs locaux, mais l’expérience à la tête de la municipalité d’une force de gauche [Barcelona en comú, le mouvement politique d’Ada Colau] a engendré quelques déceptions. Pensez-vous que nous devrions revoir notre conception du pouvoir municipal ?
DH – Nous commençons aujourd’hui à saisir l’importance du pouvoir réel des municipalités. Aux États-Unis, on compte un certain nombre de mairies radicales. Seattle, par exemple. Los Angeles est plutôt progressiste également. Il existe une aile progressiste à New-York. Je pense que cela vient du fait que l’accent n’est plus mis sur les problèmes du monde du travail mais sur tous les autres aspects de la vie quotidienne : le logement, l’accessibilité, et ainsi de suite. Je pense que la gauche, à travers ses politiques, doit se concentrer sur ces problèmes. Les administrations locales doivent manœuvrer avec des domaines de compétences et des ressources limitées.
« J’aimerais que davantage de compétences soient transférées des gouvernements centraux aux gouvernements locaux. J’aimerais que les municipalités aient plus de pouvoir sur les États. »
Par exemple, à New-York, le maire ne peut pas appliquer de politiques fiscales, ce qui limite ses possibilités, car il s’agit de compétences étatiques. Et il faut ajouter à cela des conflits entre les différents échelons du pouvoir. A Barcelone, il y a aussi un gouvernement régional, qui n’est pas de la même couleur politique que le gouvernement municipal et l’un essaie de prendre le pas sur l’autre et vice versa. Je pense que c’est une question importante. Si un parti arrive au pouvoir, comme c’est le cas à Barcelone, y a-t-il un corpus et une trajectoire de gauche qui peuvent l’aider à gouverner l’administration et à appliquer ses propositions ?
Les compétences locales sont limitées. Au Royaume-Uni, par exemple, elles sont presque inexistantes. Ils ne peuvent guère faire plus que le ramassage des ordures. Il est difficile de traiter de tous les sujets que l’on souhaiterait. J’aimerais que davantage de compétences soient transférées des gouvernements centraux aux gouvernements locaux. J’aimerais que les municipalités aient plus de pouvoir sur les États. A Barcelone, le Conseil municipal pourrait élaborer des politiques sur la base de compétences dévolues à l’heure actuelle au gouvernement régional. Je ne connais pas exactement le cadre actuel, mais il est en réalité peu étudié, c’est à nous d’interpeller les universitaires pour qu’ils prennent ces questions à bras le corps.
SV – Quels aspects prendre en compte ? En matière de logement, par exemple, quelles orientations politiques adopter ?
DH – Le logement est un droit et il doit être considéré comme tel. Même la législation du Congrès américain en 1949 affirmait que tous les citoyens des États-Unis avaient droit au logement et à un cadre de vie décent. Si l’on croyait réellement à ce droit, la société s’organiserait pour le garantir. Le problème, c’est qu’on nous dit depuis un certain temps qu’il ne peut être garanti qu’à travers le marché. Mais le marché se fait une spécialité de le garantir uniquement pour les classes supérieures. Il ne l’assure pas véritablement pour les classes moyennes, et il multiplie les obstacles et les difficultés pour les classes populaires.
Le système du marché est un désastre lorsqu’il s’agit de garantir un logement digne universel, accessible à tout le monde, sans distinction de revenus, de race ou de genre. Je crois que le marché immobilier devrait être régulé. Comment ? En limitant le prix des loyers, par exemple. Je ne suis pas favorable à cette idée sur le long terme, car je suis davantage partisan de l’institutionnalisation. Le logement social qui était en vigueur autrefois pourrait être une solution, même si le néolibéralisme nous a rabâché qu’il était inefficace. Mais dès lors que l’on sait quelles sont les recettes néolibérales en la matière, pourquoi n’essayons-nous pas de faire différemment ? Institutionnalisons le marché du logement et faisons du logement social. On peut garantir le droit au logement sans passer par l’achat et la vente de biens immobiliers.
SV – Le rôle du marché dans un cadre économique socialiste suscite encore des controverses. Quel rôle devrait-il jouer selon vous ?
DH – Je n’aurais pas de problème avec un marché fondé sur l’échange, mais le problème survient quand les forces du marché sont inégales. Marx insistait sur la masse du pouvoir et sur la question de son contrôle. Par exemple, aujourd’hui, le fonds d’investissement Blackstone contrôle une trop grande fraction du marché. On ne parle pas beaucoup des synergies d’intérêts, mais on a là un colosse qui a sous son contrôle une immense masse de capital. Ils peuvent utiliser cette masse pour acheter des politiciens, corrompre les médias, acheter des élections, etc. Cet enjeu est crucial, il faudrait rompre avec des géants comme Google ou Facebook pour pouvoir changer de modèle.
SV – En Catalogne a pris forme un mouvement social considérable en faveur du droit à l’autodétermination, mais il ne donne pas lieu à un débat sur la souveraineté réelle dans le cadre de l’UE. Que faut-il à un peuple pour être souverain ?
DH – Quand on parle de souveraineté, il s’agit de savoir qui contrôle l’État. L’État contrôle-t-il la finance ou la finance contrôle-t-elle l’État ? Si nous étions Grecs, nous pourrions incontestablement affirmer que la finance contrôle l’État. La souveraineté serait dès lors un élément insignifiant, minoritaire, dans les relations de pouvoir qui entrent en jeu dans le contrôle de l’État.
En 1992, lorsque Bill Clinton a présenté son programme économique, son secrétaire au Trésor a été catégorique : « tu ne peux pas faire ça ». Bill Clinton lui a demandé pourquoi, et il lui a répondu : « parce que les financiers ne te laisseront pas faire ». Et Clinton a eu cette réponse restée célèbre : « vous êtes en train de me dire que la réussite de mon programme économique et ma réélection dépendent de la Réserve Fédérale et d’une putain de bande de traders ? ». Et Robert Rubin, son secrétaire au Trésor, qui venait de Goldman Sachs, lui a répondu « oui ». Clinton a fini par appliquer un programme néolibéral, symbolisé entre autres par l’ALENA (Accord de libre-échange nord-américain). Il n’a pas tenu certaines de ses promesses électorales, dont celle d’instaurer un système de santé universel et gratuit.
Qui commande donc en réalité ? Les spéculateurs ? Les politiques ? A l’heure actuelle, je dirais que le pouvoir est détenu par les spéculateurs. D’une certaine façon, je pense que même si on dispose d’une autonomie politique ou du moins si on a la volonté d’en disposer, on est malgré tout sommés de traiter avec le monde de la finance et le capital. La véritable autonomie ne se résume pas à dire « je suis politiquement indépendant ». On peut avoir une certaine marge d’autonomie politique, mais on ne peut échapper au capital.
SV – À propos de la politique aux États-Unis, des changements sont à l’œuvre avec la visibilité nouvelle des Démocrates socialistes. En quoi leur émergence peut-elle inspirer les mouvements politiques ailleurs dans le monde ?
DH – Jusqu’à présent, nous avons connu un même parti avec deux âmes, le parti de Wall Street. Les Républicains et les Démocrates s’écharpent sur beaucoup de sujets, mais ils convergent sur l’essentiel. Hillary Clinton est un produit de Wall Street, par exemple. Avant sa campagne, elle a commis l’erreur de prononcer des discours grassement rémunérés pour Goldman Sachs. Elle a reçu beaucoup d’argent de la part de Wall Street, et cela se savait. Tout le monde disait d’eux qu’ils étaient le parti de Wall Street. Le chef démocrate du Sénat, Chuck Schumer, a lui aussi reçu de l’argent de Wall Street.
Le Parti démocrate est clairement le parti de Wall Street, et ce depuis qu’il s’est dissocié des syndicats dans les années 1980. On voit émerger aujourd’hui une autre âme du parti qui entend défaire le lien avec Wall Street. Bernie Sanders a explosé en disant qu’il fallait une révolution dans la politique, qui pourrait passer par un Parti démocrate détaché de Wall Street. Mais la majorité à l’intérieur du parti ne l’entend pas de cette façon. Je dirais qu’un tiers du parti opte aujourd’hui pour se libérer de Wall Street, tandis que les deux autres tiers considèrent que le parti a besoin de Wall Street, de son aide et de son soutien. Mais on voit bien désormais que ce lien avec Wall Street est au cœur du problème.
La mobilisation citoyenne dans la rue est aujourd’hui dynamisée par les secteurs les plus radicaux, en particulier les jeunes. Les jeunes Américains nés après la guerre froide ne comprennent pas la rhétorique anticommuniste ni pourquoi on leur assène que les politiques socialistes sont désastreuses. La droite les met en garde : le socialisme réduira les dettes que vous contractez pour entrer à l’université et vous donnera accès aux soins gratuits. Évidemment, les jeunes trouvent que ça sonne plutôt bien et qu’après tout, si c’est cela le socialisme, pourquoi pas. Nous en sommes à ce stade.
Par ailleurs, il est clair que l’irruption de Donald Trump a contribué à mobiliser politiquement beaucoup de citoyens qui souhaitent freiner son agenda. De même, les attaques à l’encontre du droit à l’avortement et des droits des femmes ont éveillé une conscience et fait naître ce message : « nous devons extirper notre pays des mains de ces malades de droite qui détiennent le pouvoir ». Pas uniquement à l’échelle fédérale, à tous les niveaux. Il y a donc un mouvement de fond aux États-Unis.
SV – Y voyez-vous un changement ?
DH – Je ne suis pas sûr qu’il s’agisse d’un changement, mais le recul va se poursuivre et on observera un virage à gauche aux prochaines élections. Cela dit, je ne suis pas sûr que ce virage aille très loin. C’est le parti de Wall Street, tout compte fait.