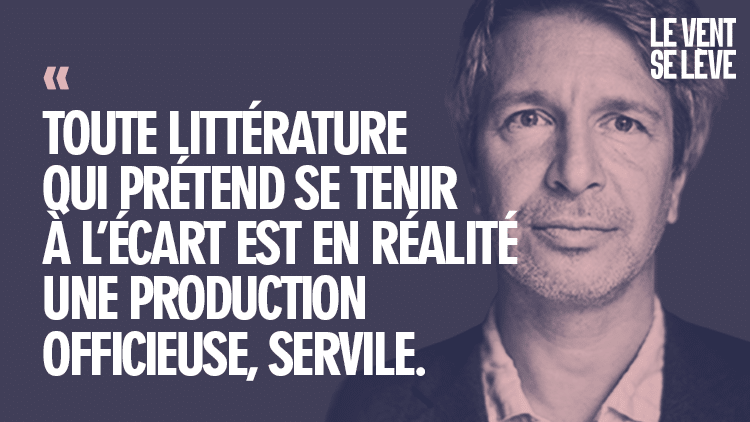Qu’est-ce qu’une littérature à la hauteur de l’époque ? Éric Vuillard en donne un certain ton. Ses récits s’efforcent d’accomplir l’intransigeante formule de Victor Hugo : « Il serait temps que l’histoire entrât dans la voie des aveux. » À l’inverse des écritures complaisantes, la sienne est enfiévrée et se refuse à la neutralité de façade. La critique s’en inquiète parfois – c’est qu’il ne faudrait pas que soudain l’émeute déborde du livre. Dans La Guerre des Pauvres (2020), qui remue le passé des premiers soulèvements de l’égalité, Éric Vuillard s’est pourtant promis de « raconter une victoire ». Il n’est en effet pas impossible que les injustices du présent contribuent à lever la grève des événements. Pour l’heure, il importe d’en trouver la trace dans les silences embarrassés des puissants. Éric Vuillard a découvert comment les faire entendre : les cabinets feutrés ont aussi leurs archives, reste à les exhumer. Entretien réalisé par Laëtitia Riss.
LVSL – « La mauvaise littérature, c’est le destin qui revient » laissiez-vous entendre dans un précédent entretien, si vous m’accordez la possibilité de transformer la ponctuation. La littérature aurait-elle alors pour tâche de démentir le destin, en nous délivrant du sentiment d’impuissance face aux événements ?
Éric Vuillard – La littérature moderne rompt avec le mythe. Ulysse de Joyce raconte la vie banale d’un petit employé, d’un jeune prof, et leur histoire se déroule dans l’unité de temps la plus naturelle qui soit, une journée. Joyce fait descendre L’Odyssée sur terre, entre le boulevard circulaire nord de Dublin, un convoi mortuaire et un pub. De ce point de vue, on pourrait dire, en effet, que le courant dominant de la littérature moderne nous débarrasse de toute idée de fatalité.
Mais il existe aussi des déterminations lourdes, qui pèsent sur nos vies. Au cœur des romans de William Faulkner, une profonde malédiction semble à l’œuvre, mais c’est une malédiction historique, concrète : l’esclavage, la traite. Il faudrait pouvoir tenir ensemble ces deux aspects de nos existences, d’un côté ce qui se perpétue, nous aliène, le monde où s’inscrivent nos vies, et d’un autre l’activité humaine, capricieuse ou obstinée, clairvoyante ou aveugle.
« Le courant dominant de la littérature moderne nous débarrasse de toute idée de fatalité. »
La littérature est toujours prise dans les coordonnées de son temps, elle tâche de défaire les préjugés qui nous orientent. Il me semble que, dans notre monde, un discours est en position de monopole, le libéralisme, comme le fut, jadis, la religion. Il est donc vital de tenir ensemble les deux forces qui nous constituent tous, les nécessités sociales et la subjectivité agissante ; afin de retrouver, sous le discours hégémonique, les contraintes qui étouffent et la liberté qui manque.
LVSL – Vos récits ne cessent de nous parler du présent depuis le passé et bousculent la compréhension apaisée de l’Histoire qui voudrait qu’on puisse s’accommoder de séparations strictes entre les époques. Cela conduit certains à disqualifier (ou à saluer !) vos textes parce qu’ils « pécheraient », pour reprendre le mot de Lucien Febvre, par anachronisme. Que cherche à nous dire le passé dans vos livres ?
E. V. – Il n’existe pas de discours hors-les-murs. Nous parlons tous depuis l’intérieur, immergés dans la vie sociale. Et il n’existe pas non plus de discours hors du temps, de discours pur, sans péché. On n’écrit pas dans l’éternité, mais exposé aux évènements, pris dans la conjoncture, présent. C’est pourquoi le passé se réverbère sans cesse en nous, réactivé, comme une page surchargée. Je préfère rendre les anachronismes perceptibles, ne pas les repeindre, les laisser affleurer dans la prose, plutôt que de les dissimuler derrière une écriture impassible.
« On n’écrit pas dans l’éternité, mais exposé aux évènements. »
On devrait se défier des langages prétendument objectifs, dont le personnage central de 1984 fait la douloureuse expérience. Dans le fameux roman d’Orwell, Winston Smith se débat contre le langage, mais pas contre la poésie, non, contre un langage froid, insensible, impartial. « Nous taillons le langage jusqu’à l’os », déclare la police de la pensée. Écrire, c’est se soustraire à tout langage aride, indifférent. La neutralité est une fiction, une ruse.
LVSL – Vous avez proposé l’année dernière une préface inédite à La guerre des paysans en Allemagne de Friedrich Engels, réédité par les Éditions Sociales. À vos yeux, ce dernier invente un « récit réfléchi », qui dans « un même mouvement, raconte et explique » et dont le style « s’adresse à nous, nous libère du surplomb de la science, et nous oblige à prendre parti ». N’est-ce pas précisément ce que, à votre tour, vous vous essayez à faire : relire l’histoire en matérialiste ?
E. V. – Si l’on se promène au Louvre, à l’Hermitage, dans n’importe quel grand musée où le passé déploie cet étrange miroir qu’est la peinture, que voit-on ? Des portraits en majesté, des scènes de bataille, des Christ en croix, des madones, et il est presque impossible de séparer la peinture ancienne de la violence de ses conventions, il est difficile de voir la contrepartie douloureuse, négative de toute cette grandeur, de même qu’il est vain de vouloir séparer l’art et la proclamation constante de l’autorité de ses commanditaires.
« Comme sous l’Ancien Régime, il règne aujourd’hui une idéologie unique. »
Comme sous l’Ancien Régime, il règne aujourd’hui une idéologie unique avec de modestes variantes, si bien qu’elle vit aussi incorporée que possible à la culture elle-même, à l’art, à l’écriture, au langage. Une solution consiste donc à refaire venir le sujet à la surface, à ne plus séparer mythiquement la narration et la pensée, le texte et celui qui écrit. C’est en effet ce qu’on appelle le matérialisme.
LVSL – Dans un texte de 1953, intitulé « L’utopie du langage », Roland Barthes soutient que « l’écriture littéraire porte à la fois l’aliénation de l’Histoire et le rêve de l’Histoire ». Faites-vous l’épreuve de cette contradiction, lorsque vous écrivez ?
E. V. – On écrit toujours entre deux souffles. Il y a le présent qui appelle et le passé qui enlise, le catéchisme qu’on a appris et l’espoir qu’on éprouve. Lorsqu’on écrit, on ne peut pas décréter par avance les mots qui vont venir, le rythme de la phrase, son ahan. On cherche un sens qui pour une part échappe, se reconfigure, au gré de l’expression, de la respiration, comme si à chaque mot, à chaque tournure, on reprenait son élan.
Écrire est une façon de s’orienter, de se perdre. Et si l’écriture ne porte pas autant de traces que la langue parlée de son élaboration progressive, elle sécrète à mesure sa structure porteuse, elle la soude entre les éléments qui retardent, les compléments inattendus, les divagations imprévues, et, puisqu’elle ne peut revenir en arrière, il lui faut en quelque sorte entrainer avec elle, récapituler tout ce qui précède. C’est dans ce mouvement où l’on est emporté, que l’on fait l’épreuve de l’aliénation et du rêve, que l’on tente de dépasser la contradiction, mais tout cela se fait dans le langage.
« Il y a le présent qui appelle et le passé qui enlise, le catéchisme qu’on a appris et l’espoir qu’on éprouve. »
Il y a deux courants indissociables dans la prose, une activité narrative, descriptive, tournée vers le monde, et une activité introjective, une sorte de fonction purement langagière, qui ne renvoie à rien d’autre qu’à ce qui s’écrit. Cette étendue de mots, d’expressions, de tournures, ces innombrables possibilités, les contraintes aussi, livrent l’écriture à la nécessité de décider sans cesse « du fond d’un naufrage. »
LVSL – Depuis Congo (2012) jusqu’à Une sortie honorable (2021), votre œuvre semble travaillée par un même désir, celui de faire sentir l’intolérable d’une formule qu’on trouve dans votre 14 juillet (2016) : « Certaines vies comptaient donc davantage que d’autres. » Quelles sont vos armes poétiques pour défendre l’égalité ?
E. V. – Il existe dans la langue un réseau marqué d’oppositions, une espèce d’animosité entre les mots, de lutte, où les phrases s’inscrivent, enregistrantdes bifurcations, variantes, tout un remous, l’écriture. Dans Le journal d’un manœuvre, Thierry Metz écrit : « Le lundi est une eau froide, une pluie glacée », cela qualifie concrètement le seuil de la semaine pour ceux qui triment, « une pluie glacée. » C’est peut-êtrecela « défendre l’égalité », inscrire, comme on peut, sur la page, le désaccord catégorique entre le labeur et le bon plaisir, entre Gatsby et Les damnés de la terre.
LVSL – Vos chapitres sont peuplés par des regards accusateurs, qui nous parviennent par l’intermédiaire de photographies exhumées par votre narration – je pense à Yoka (Congo) ou à Lizzy (La Bataille de l’Occident), par exemple, victimes du colonialisme et de l’humeur belliqueuse des puissances européennes. Selon l’expression commune, que l’on retrouve également dans votre dernier récit, vos livres nous obligent-ils à regarder la vérité en face ?
E. V. – Il y a longtemps, feuilletant le catalogue des films des Frères Lumière, je suis tombé sur un titre insolite : Enfants annamites ramassant des sapèques devant la pagode des dames. On dirait un conte oriental, une nouvelle de Marguerite Yourcenar. Mais non, il s’agit au contraire d’un petit film documentaire. Il dure quarante-trois secondes, et pendant quarante-trois secondes, on voit deux femmes élégantes, vêtues de robes blanches à crinolines, ouvrir leur réticule et semer devant elles des pièces de monnaies, les fameuses sapèques. Elles font cela en riant, elles s’amusent, et des enfants vietnamiens, mendiants vêtus de loques, se baissent et ramassent les pièces aussi vite qu’ils le peuvent. Mais brusquement, au milieu de cette scène pénible, un enfant s’arrête et se tourne vers l’opérateur, il regarde la caméra, il regarde à travers le temps.
« Nous ressentons dans cette distance ce qui devrait l’abolir, l’universalité de notre condition, l’égalité entre les hommes. »
Ce regard caméra me rappelle ce que vous décrivez. Le film des Lumière est une fiction coloniale que le regard de l’enfant déchire. À cet instant, il existe une concordance des temps. Bien sûr, entre lui et nous, il y a une distance énorme, infranchissable en vérité. Mais un instant, le regard de l’enfant abolit la distance, ou plutôt il nous la fait éprouver, il la manifeste si fort qu’il existe entre lui et nous un lien. Nous ressentons dans cette distance ce qui devrait l’abolir, l’universalité de notre condition, l’égalité entre les hommes. Cela rapproche les idées de l’expérience sensible. Par le regard de cet enfant vietnamien, nous reviennent les énoncés de Jean-Jacques Rousseau.
LVSL – En tant que lecteurs, vous nous invitez à nous pencher par-dessus votre épaule lorsque vous découvrez des documents que la mémoire collective a oubliés. J’ai été troublée, pour ma part, par les mémoires de Rossignol dans 14 juillet, par la lettre de Walter Benjamin à Margarete Steffin dans L’ordre du jour, ou encore par le témoignage de Bidault au sujet des « deux bombes » dont il a été question pour résoudre la guerre indochinoise dans Une sortie honorable. Avez-vous souvenir d’une archive qui vous a particulièrement ébranlé ?
E. V. – Un de mes prochains livres a pour origine l’émotion éprouvée à la découverte, pendant l’écriture de 14 juillet, des archives des enfants trouvés. Je suis tombé sur d’innombrables petits papiers où les parents pauvres griffonnaient à la hâte un mot, espérant conjurer le sort qui s’acharnait sur eux et retrouver, un jour, l’enfant qu’ils abandonnaient : « Lon prie sesdames davoir bien soint de cette petite fille elle est baptisée elle se nomme marie catherine lheureux et dans peu lon la retirera en produisant le pareil billet fait a paris ce sixieme fevrier mil sept cent quarante » L’orthographe, les formules de politesse, l’assurance que les formalités religieuses ont bien été accomplies, le nom de famille de l’enfant, Lheureux, qui contraste tant avec son destin de « malheureux » comme on disait alors, et la promesse peut-être tenue, mais troublante, et qui semble vaine, « dans peu lon la retirera », tout cela concourt à faire de ce petit mot un cri. Un cri poussé dans l’ombre depuis la nuit des temps.
LVSL – Le sous-titre « récit » a fait son apparition sur vos couvertures lors du passage de Conquistadors (2009) à Congo (2012). Est-ce une manière de signaler que vos livres ne sont pas « que » de la littérature, au sens courant du mot – qu’ils ne doivent pas être reçus comme des fictions romanesques, des prétextes à diversion esthétique, ou pire comme des alibis pour se dédouaner du réel ?
E. V. – C’est une manière d’indiquer que tout au long de l’histoire littéraire, ce n’est pas la fiction qui domine, mais la réalité,qui fait du Lazarillo de Tormes et des vers de François Villon les ancêtres de la littérature moderne. La précarité du Lazarillo, qui passe d’emploi en emploi, malmené, mal-payé, jamais sûr du lendemain, ressemble à la position de Charlot, et n’est pas sans évoquer les déambulations de Joseph K.
Au fond, Le Procès nous raconte un épisode de précarité aggravée, coupable. Et tous les romans de Franz Kafka peuvent être lus ainsi, L’Amérique, Le Château. Il serait temps de sortir d’une lecture psychologique ou allégorique de Kafka, afin de mieux sentir combien ses textes nous concernent directement. Ce n’est pas la vie qui est absurde, c’est l’organisation sociale,sa hiérarchie inflexible, aveugle, cette série de refus et d’ordres sur lesquels les personnages de Kafka butent inexorablement.
« Ce n’est pas la vie qui est absurde, c’est l’organisation sociale. »
Ce n’est pas l’œuvre de Kafka qui relève de la fiction, c’est la vie politique, l’organisation du pouvoir. Le Château n’est pas une fiction comme on pourrait le croire, il nous informe mieux que n’importe quelle enquête de terrain sur le fait que le pouvoir est hors d’atteinte, il est plus convainquant que n’importe quelle théorie politique sur la façon oblique et intense dont le pouvoir subjugue. On pourrait d’ailleurs lire la pluralité des interprétations possibles des œuvres de Kafka, non pas à la manière des mythes au sens indécis, énigmatique, mais comme le signe d’une ambivalence concrète, subjective, celle de l’homme moderne, placé dans un monde qui le dépasse, et sans explication religieuse, définitive. Ainsi, au contraire d’une représentation ordinaire, les romans de Kafka ne sont pas des allégories, ce sont des œuvres modernes, laïques, descriptives.Le noyau réaliste des œuvres de Franz Kafka vise à défaire la fable.
LVSL – Une étrange inversion paraît se confirmer de rentrées littéraires en rentrées littéraires. Les écrivains « réactionnaires » se tournent vers le genre de l’anticipation, prophétisant le futur sous un jour funeste, tandis que les écrivains « révolutionnaires » privilégient l’enquête, remuant le passé comme des archéologues en mal d’origine. S’agit-il, selon vous, d’un symptôme ou, au contraire, d’une cause du manque d’horizons progressistes qui s’offrent à nos sociétés ?
E. V. – On écrit pris dans un réseau de contraintes qui nous dépassent, nous saturent. La littérature se déploie dans un espace non euclidien. Si Tolstoï décrit avec tant de précision et de sensualité la vie sociale, il le doit en partie à une position panoramique. Bien des gens travaillent et vivent à Iasnaïa Poliana, des valets de chambre, des cuisinières, des nourrices, des gardiens de chenil, des paysans, de vieilles tantes, des gens de passage, tout un monde fourmille devant Tolstoï, une vie sociale riche, mais assujettie. On pourrait dire que la forme de réalisme minutieux, fidèle, du XIXème siècle, est liée à une hiérarchie sociale implacable, qu’il la dénonce souvent, s’y heurte, mais qu’elle est aussi sa condition de possibilité. Il faut attendre le troisième quart d’Anna Karénine pour qu’enfin un personnage secondaire, subalterne, ait une pensée à part soi. Encore est-ce une pensée bien triviale sur l’endurance d’un trotteur, et encore est-ce une pensée du « teneur de livres », autrement dit du comptable ; le cocher, lui, se contente de dissimuler sa confusion en s’empressant auprès des dames, son intériorité se limite à ça. Et pourtant, à l’époque, on ne manquait pas d’horizon progressiste, Tolstoï était même une sorte d’horizon progressiste à lui tout seul !
« Dans un contexte aussi rude, aussi glacé, l’écriture ne saurait être que politique pour être vraiment littéraire. »
De nos jours, l’écrivain vit immergé dans la vie sociale, sans surplomb réel, il ne voit, comme d’habitude, que ce qui est autour de lui, mais la vue s’est refermée. Cela est à la fois la conséquence d’un phénomène positif, la démocratisation de la fonction d’écrivain, et négatif, la segmentation de la vie sociale, le cloisonnement d’une société aux penchants de nouveau très inégalitaires. Il faut ajouter à cela le fait que désormais « le cocher » sait lire et écrire, ce qui change tout, et rend l’enquête sur nos contemporains délicates, et parfois indécentes. On enquête toujours sur les mêmes catégories, les plus pauvres, les classes aisées se protègent, se cachent, les enquêtes menées sur elles sont le plus souvent sans profondeur réelle, déceptives. C’est pourquoi l’Histoire est aujourd’hui un recours. Elle permet une enquête à la fois plus ouverte sur le monde, où les privilégiés peuvent être surpris, inquiétés, et où la vie peut être saisie largement. Et puis l’Histoire exige que nous prenions parti sur des faits, des événements, on ne peut pas se défausser ; il est plusfacile d’embrouiller les choses avec la fiction. Au fond, le recours à l’Histoire est une nécessité dans un monde où le discours hégémonique est en apparence si dépolitisé, si neutre, si objectif, que toute littérature qui prétend se tenir à l’écart est en réalité une production officieuse, servile. Dans un contexte aussi rude, aussi glacé, l’écriture ne saurait être que politique pour être vraiment littéraire. C’est sans doute pourquoi il ne faut pas prendre seulement pour une dénégation la jolie phrase de Mallarmé : « Je ne sais pas d’autre bombe qu’un livre. »
LVSL – « Il est temps. L’été frappe à nos portes » rapporte votre plume dans La Guerre des Pauvres, en épousant la langue fiévreuse de Thomas Müntzer, traversée par l’élan de la promesse. Pour achever cet échange, de quoi le temps est-il venu ?
E. V. – Le temps des cerises.