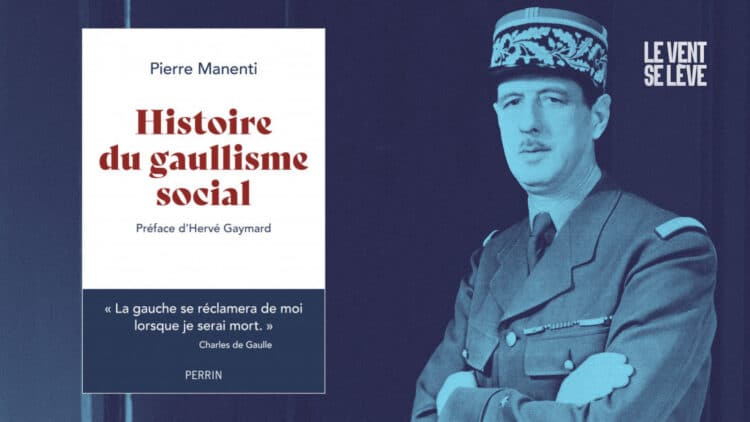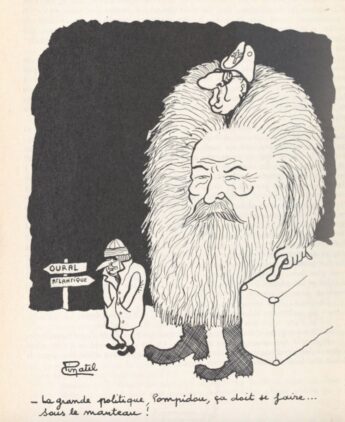L’opposition d’une partie des députés Les Républicains au projet de réforme des retraites porté par le gouvernement a fait rejaillir dans le débat public une expression aux contours flous, et pourtant récurrente : le gaullisme social. Quelle définition donner à ce concept qui a traversé plus d’un demi-siècle de vie politique ? Le général de Gaulle lui-même avait-il théorisé ce courant ? Quelle est d’ailleurs la part de réalité et celle du mythe derrière l’action « sociale » du Général ? Auteur d’une Histoire du gaullisme social (Perrin, 2021), Pierre Manenti, conseiller politique, retrace la généalogie et l’héritage de cette tradition politique qui a marqué la IVe et la Ve République de son empreinte. Des « gaullistes sociaux » aux « gaullistes de gauche », cette histoire ne se résume pas à quelques trajectoires individuelles. Au contraire, elle s’est traduite, selon l’auteur, dans des organisations politiques et syndicales qui ont cherché à reconcilier Capital et travail auprès du monde ouvrier, tout en défendant l’héritage du Conseil national de la Résistance. Au risque de servir de caution de gauche aux tendances plus conservatrices du gaullisme ? Entretien réalisé par Léo Rosell et retranscrit par Guillemette Magnin.
LVSL – Qu’est-ce qui est à l’origine de votre intérêt pour la figure du général de Gaulle et pour son héritage politique ?
Pierre Manenti – Pendant mes études à l’École normale supérieure, j’ai étudié et exploré le mandat du général de Gaulle, président de la République, de 1958 à 1969. Dans ce cadre, j’ai beaucoup travaillé sur les archives de la Fondation Charles-de-Gaulle et de l’Institut Georges-Pompidou. J’ai découvert que, contrairement à l’idée que je m’en faisais, il n’y avait pas un gaullisme monolithique, un chef indiscuté avec un parti encadré et rigide, mais en réalité des gaullismes, des personnalités diverses, parfois voire souvent opposées entre elles. Le parti gaulliste était en effet composé d’hommes de droite mais aussi d’hommes de gauche, ceux qu’on a appelé les tenants du gaullisme social. Tout ce petit monde était réuni par sa fidélité au général de Gaulle, tout en ayant des pensées radicalement différentes sur l’économie ou la société.
Il se trouve par ailleurs qu’en 2020, le Premier ministre de l’époque, Jean Castex, a fait sa première interview télévisée en se présentant comme un « gaulliste social ». Le lendemain, la presse a unanimement salué son positionnement politique, parce qu’alliant le meilleur de la droite, le gaullisme, et l’esprit de la gauche, celui des luttes sociales. Ce qui est incroyable, c’est que le gaullisme social est donc passé d’une chapelle politique du gaullisme à un mot-valise de la vie politique française, une sorte d’équilibre politique parfait.
À ce compte-là, de nombreux centristes pourraient se revendiquer du gaullisme social, alors que pour les hommes de gauche engagés dans l’aventure gaulliste, il s’agissait de construire un véritable « socialisme gaulliste ». Il manquait donc un travail d’historien pour rappeler l’origine de la pensée sociale du général de Gaulle, l’histoire politique de ses partis et mouvements, ainsi que la place des hommes de gauche dans cette aventure et, après sa disparition, la vie de ce courant du gaullisme social qu’ont incarné, tour à tour, René Capitant, Louis Vallon, Philippe Dechartre ou encore Philippe Seguin plus récemment.
LVSL : À vous écouter, on a l’impression qu’il manque une vraie définition du gaullisme…
C’est vrai. De son vivant, le général de Gaulle s’est toujours refusé à définir le gaullisme. Il n’existe donc pas de définition donnée par le Général lui-même ; ce sont donc ses contemporains, notamment les hommes politiques, ou plus tard les historiens, qui ont construit la définition du mot « gaullisme ». La plupart des commentateurs s’accordent cependant pour dire qu’elle est fondée sur trois éléments invariables.
Le premier élément est le dépassement des clivages politiques au service de l’intérêt de la nation. Le gaullisme un courant politique qui refuse le clivage droite-gauche, le système des partis, la politique politicienne, et qui veut agréger au sein d’un même mouvement des personnalités de droite et de gauche, toutes animées par la volonté de servir leur pays.
Le deuxième élément intrinsèque au gaullisme est la politique de la grandeur, c’est-à-dire l’idée que le gaulliste doit contribuer à faire rayonner la France à l’international, notamment à travers de la défense des valeurs des Lumières, de la Révolution et du Conseil national de la Résistance (CNR). Il doit porter avec noblesse ces valeurs inhérentes à l’identité française. Dans cette politique de grandeur, il y a aussi la défense de la francophonie, de l’identité française, dit autrement l’idée d’une France éternelle.
L’ambition du gaullisme, c’est un État ni capitaliste, ni socialiste, mais une troisième voie française, c’est-à-dire un État interventionniste.
Le troisième et dernier élément, qui est pour moi inscrit dans l’ADN du gaullisme, c’est le combat en faveur du progrès social. Le gaullisme s’est toujours soucié des plus faibles, des plus nécessiteux, de ceux qui en ont besoin. L’ambition du gaullisme, c’est un État ni capitaliste, ni socialiste, mais une troisième voie française, c’est-à-dire un État interventionniste, participationniste et libéral, au sens où le libéralisme, contrairement au capitalisme, implique une intervention de l’État pour corriger les défaillances du marché.
LVSL : Quelle est la part du général de Gaulle dans tout cela ? Quelle définition donne-t-il du gaullisme social ?
Charles de Gaulle est d’abord un homme du XIXe siècle – il est né en 1890. Il a été très marqué par l’éducation de son père et de son oncle, tous deux imprégnés du catholicisme social. Avec eux, il a acquis la conviction que l’homme politique a un rôle social. Dans la bibliothèque du général de Gaulle, il y a également un livre du maréchal Lyautey sur le rôle social de l’officier. Charles de Gaulle a été très influencé par ce livre et par l’idée que le militaire a un rôle dans l’organisation de la société et de ses solidarités. Pour lui, la dimension de fraternité catholique est très importante dans la construction du corps social. Sa foi a donc nourri sa pensée politique.
Pour répondre à votre question, si l’on s’en tient à la définition la plus simple, le gaullisme désigne l’action et la pensée du général de Gaulle. Pour la pensée, il existe dix-neuf tomes de lettres, notes et carnets qui permettent d’étudier la doctrine politique du Général, sans compter ses très nombreuses archives. Pour l’action, c’est la manière dont il a mis en œuvre cette pensée au contact de la réalité, pendant la guerre, sous la IVe et la Ve République.
La naissance du gaullisme politique tient donc profondément à l’expérience de la guerre et à l’entrée des Soviétiques et des Américains dans le conflit en 1941, lorsque l’on commence à se dire que les Alliés pourraient gagner.
La première fois que le général de Gaulle a développeé cette pensée politique, il était à Londres, en 1940. Il avait déjà cinquante ans et avait été, jusque-là, un militaire, un tacticien, un stratège, mais pas un homme politique. La naissance du gaullisme politique tient donc profondément à l’expérience de la guerre et à l’entrée des Soviétiques et des Américains dans le conflit en 1941, lorsque l’on commence à se dire que les Alliés pourraient gagner.
On demande alors au général de Gaulle quelle serait sa doctrine politique s’il devait demain gouverner le pays libéré. D’où l’émergence, à ce moment donné de l’histoire, d’un des premiers discours politiques du Général à Oxford, le 25 novembre 1941. Dans ce discours, il développe trois idées fondamentales qui caractérisent le gaullisme et plus particulièrement sa dimension sociale.
La première idée, c’est de faire attention aux effets de la mécanisation de l’économie. On est à l’époque du film Les Temps modernes de Charlie Chaplin, dans lequel le héros est écrasé par la roue de la machine. Il y a une inquiétude réelle sur la place du travailleur dans l’usine et il faut veiller à ce que la machine ne le détruise pas. La seconde idée concerne la société à rebâtir. Il faut tout faire pour que cette société épanouisse l’ouvrier et le détourne des totalitarismes. La troisième idée est qu’il faut être capable de penser à long terme, aussi bien dans sa vision de l’économie que de la politique. L’homme politique doit être capable de se projeter à vingt ou trente ans, de faire les choix difficiles, qui s’imposent pour la survie du pays.
LVSL – Qu’est-ce qui distingue alors le gaullisme social des autres courants du gaullisme?
P. M. – Dans l’aventure de la France libre, qui pose les prémices du gaullisme social, il y a évidemment des tendances, des grandes idées qui se sont dégagées au fur et à mesure des débats politiques, mais c’est véritablement lors de l’épopée du Rassemblement du peuple français (RPF), le parti animé par le général de Gaulle de 1947 à 1954-55, que les différentes écuries politiques du gaullisme se sont construites, avec leurs personnalités et leurs chefs.
Il y a d’abord le gaullisme anticommuniste, avec notamment André Malraux, qui est conduit avant toute chose par le rejet du modèle soviétique et la « peur du rouge ». Il y a ensuite le gaullisme social, qui est persuadé que pour lutter contre cette ascension du modèle soviétique, il faut aller parler aux ouvriers, aux travailleurs, dans les usines, donc il faut un gaullisme social et populaire pour convaincre les classes ouvrières de la justesse du gaullisme. Puis, au fil des années, la IVe République connaît une crise économique sans précédent et se développe alors un gaullisme libéral, qui épouse l’esprit de libéralisation et modernisation de l’économie française.
La particularité du gaullisme social, par rapport aux autres courants du gaullisme, c’est son ancrage dans le temps long et l’affection personnelle du général de Gaulle pour ce courant politique.
Ces différentes chapelles sont en concurrence auprès du général de Gaulle, qui va soutenir tantôt les unes, tantôt les autres, et les rendre plus ou moins influentes au gré de son humeur et de l’actualité nationale. La particularité du gaullisme social, par rapport aux autres courants du gaullisme, c’est son ancrage dans le temps long (dès la France libre et jusqu’aux jours les plus récents) et l’affection personnelle du général de Gaulle pour ce courant politique (qui se manifeste notamment via le financement de leur journal sur les deniers personnels du Général).
Après la disparition du général de Gaulle, un gaullisme orthodoxe et conservateur émerge autour de Pierre Messmer et d’Hubert Germain [le dernier Compagnon de la Libération, NDLR]. Ces deux hommes veulent préserver le gaullisme des origines et s’inquiètent d’éventuels dévoiements. Chacun se revendique alors d’être le plus légitime dans son discours gaulliste : c’est le combat qui oppose Georges Pompidou, président de la République, et les barons du gaullisme (Chaban-Delmas, Debré, Frey).
LVSL – L’un des mythes fondateurs du gaullisme social est l’application du programme du CNR à la Libération, en particulier la mise en place de la Sécurité sociale. Certains ont même parlé d’un « gaullo-communisme » pour qualifier cette période. Souscrivez-vous à cette thèse, qui semble évacuer la grande conflictualité qu’il y avait à cette époque, entre gaullistes et communistes ?
P. M. – Sur la question de la Sécurité sociale ou des comités d’entreprise, qui sont deux grandes réformes mises en place à la Libération, l’empreinte du général de Gaulle est très forte. Sans le général de Gaulle, cela n’aurait pas pu se faire. Néanmoins, il a travaillé dans le cadre d’un gouvernement de coalition, d’abord avec la gauche socialiste puis avec la gauche communiste, après les élections d’octobre 1945. Avant l’entrée des communistes au gouvernement, Charles de Gaulle défend le comité d’entreprise, que les communistes rejettent à l’Assemblée nationale. Après les élections législatives, il les fait entrer dans son gouvernement et c’est seulement à partir de ce moment que les communistes se mettent à défendre cette idée.
[Sur la Sécurité sociale], de Gaulle avait une vision très technique de ce sujet, là où les communistes ont apporté un regard plus politique et populaire.
Il y a donc une forme de captation et de réappropriation politique par les communistes de cet acquis gaulliste de la Libération. Quant au modèle de Sécurité sociale, il est vrai que la vision du général de Gaulle était encore très marquée par le paternalisme, issu du grand courant du catholicisme social. Le retrait progressif du Général des affaires politiques en novembre-décembre 1945, puis son départ du pouvoir en janvier 1946, ont conduit à l’émergence d’un modèle de Sécurité sociale qui n’est peut-être pas celui que de Gaulle aurait voulu mettre en place.
C’est donc à la fois la volonté politique initiale du général de Gaulle de porter ces réformes et leur reprise puis leur transformation par la gauche communiste et socialiste – plus ambitieuses que le projet initial – qui ont permis l’émergence du modèle que l’on connaît aujourd’hui. De Gaulle avait une vision très technique de ce sujet, là où les communistes ont apporté un regard plus politique et populaire sur de ces réformes.
Paradoxalement, à partir de 1947, l’argument massue du général Gaulle dans sa lutte pour revenir au pouvoir est celui de la participation des ouvriers à la gouvernance des entreprises et au partage de ses résultats. C’est une sorte de « match retour » pour le Général, qui a beaucoup évolué sur ces questions dans l’intervalle. On parle d’ailleurs parfois, pour désigner le gaullisme, d’une politique de circonstances, c’est-à-dire de grands principes qui doivent être appliqués selon les circonstances. C’est une forme de realpolitik.
LVSL – Vous montrez l’importance du catholicisme social dans la pensée de Charles de Gaulle, en même temps que des visées stratégiques. C’est la fameuse phrase que vous utilisez, « homme de droite par conviction et homme de gauche par nécessité de l’action »…
P. M. – Tout à fait. Pourquoi Charles de Gaulle développe-t-il ce discours social ? Parce qu’en 1941, alors qu’il est à Londres, certains Français libres le soutiennent mais d’autres s’inquiètent du régime qu’il pourrait mettre en place dans la France libérée. L’amiral Muselier, grand-père de Renaud Muselier, fait ainsi partie de ces gens, plutôt marqués à gauche, qui s’inquiètent de ce que le Général pourrait faire après la guerre. Les Anglais, les Américains mais aussi beaucoup de socialistes français réfugiés à Londres le voient comme un militaire de droite, conservateur, donc dangereux par définition. Certains journaux français le qualifient même de fasciste. De Gaulle comprend rapidement qu’il a besoin de développer un discours social pour parler au peuple de gauche. C’est quelqu’un qui est fondamentalement, par son éducation et son milieu d’origine, un homme de droite, mais qui va développer un discours de gauche, par la politique et le besoin de rassemblement des Français.
Pourquoi Charles de Gaulle encourage-t-il l’émergence d’un gaullisme social sous la IVe République ? Parce qu’il existe alors deux partis de droite, le Parti républicain de la liberté (PRL), qui s’est construit sur les débris de la droite d’après-guerre, et le Mouvement républicain populaire (MRP), qui incarne une droite chrétienne et humaniste. Le général de Gaulle se dit qu’il doit aller chercher les ouvriers, en développant un discours sur la condition sociale et le statut des travailleurs afin d’installer son parti, le RPF, dans le paysage politique d’après-guerre ; c’est donc une stratégie politique, nourrie par une conviction intime sur le sens de la nation et de la République.
Si je vais plus loin : pourquoi y a-t-il un sursaut du gaullisme social sous le mandat présidentiel de Charles de Gaulle ? De 1958 à 1965, les avancées du gaullisme social sont très mineures et les premières tentatives du Général en faveur de l’intéressement sont un échec, en raison de l’hostilité de son entourage comme du patronat. Lors de l’élection présidentielle de 1965, le général de Gaulle est mis en ballotage, alors même qu’il pensait être élu dès le premier tour. Il avait refusé de faire des entretiens avec des journalistes et il finit par accepter, sous la pression de Jacques Foccart, face au risque d’être défait. Il fait alors trois entretiens avec Michel Droit, qui sont entrés dans la légende.
En janvier 1966, lorsque Charles de Gaulle réélu reconduit Georges Pompidou à Matignon, il prend cependant la décision de rappeler Michel Debré dans son gouvernement. C’est le retour d’une certaine tradition gaulliste, dit autrement la victoire des anciens face aux modernes. C’est aussi la fin de la parenthèse libérale conduite par Pompidou entre 1962 et 1965. C’est dans ce contexte que le général de Gaulle relance la réforme de la participation avec plusieurs lois successives, mais surtout un grand référendum, en 1969, sur la participation à la gouvernance des entreprises, des universités, de la vie politique, etc. Ce que de Gaulle recherche, c’est un modèle d’association du Capital et du travail, un modèle paritaire, dans lequel chacun est reconnu pour son apport à une œuvre commune.
Derrière cette main tendue aux ouvriers et aux travailleurs, il y a une stratégie politique et une inquiétude sociale.
Il ne faut pas oublier qu’il y a, chez de Gaulle et les gaullistes, la peur de l’insurrection communiste. On pense aux grandes grèves de 1947-1948, à la peur du rouge dans l’après-guerre, aux menaces de la rue en 1968, etc. Tout cela se construit et s’exprime dans un contexte de Guerre froide, où l’Union soviétique est une menace réelle pour les démocraties occidentales. Derrière cette main tendue aux ouvriers et aux travailleurs, il y a donc une stratégie politique – aller chercher le vote ouvrier avec un discours de rassemblement du pays pour dépasser les clivages – et une inquiétude sociale – si on ne partage pas suffisamment, le pays explosera et une révolution pourrait alors s’emparer du pouvoir.
LVSL – Vous expliquez cependant que le courant du gaullisme social a toujours été assez minoritaire, au point d’apparaître à certains moments comme une caution politique pour une doctrine plus autoritaire et conservatrice.
P. M. – Oui, c’est particulièrement vrai dans l’aventure du RPF [entre 1947 et 1955], où les grands cadres du parti étaient des hommes plutôt anticommunistes et conservateurs, peu portés sur la question sociale. Le parti était alors sous l’influence d’hommes de droite. Pourtant, certains militants, comme Jacques Baumel ou Yvon Morandat, sont parvenus à convaincre le général de Gaulle de créer un syndicat gaulliste, l’Action ouvrière. Son existence permet alors une forme d’équilibre politique au sein de la famille gaulliste et fait taire certaines accusations sur le positionnement très à droite du RPF.
Il faut rappeler qu’avant que le RPF ne soit créé en 1947, il y avait eu un autre mouvement gaulliste, créé en 1946 à l’initiative de René Capitant, qui s’appelait l’Union gaulliste et qui avait servi de ballon d’essai. Très vite pourtant, le général de Gaulle s’était aperçu que cette Union gaulliste ne marchait pas, car elle était devenue un rassemblement hétéroclite de gens d’extrême-droite, qui venaient de la droite autoritaire et qui tentaient de « se recycler ». De ce point de vue, dans l’aventure du RPF, l’Action ouvrière et le gaullisme social ont donc servi de caution pour replacer le gaullisme au centre de l’échiquier politique.
Par la suite, notamment après la mise en sommeil du RPF, le gaullisme social a pris son indépendance du reste du parti gaulliste : plusieurs clubs et mouvements ont ainsi existé entre 1955 et 1958, puis différents partis se sont structurés comme le Centre de la Réforme républicaine (CRR) en 1958 ou l’Union démocratique du travail (UDT) entre 1959 et 1962. C’est peut-être d’ailleurs le grand échec politique de Philippe Seguin, qui a voulu ressusciter le gaullisme social non pas comme un mouvement autonome mais comme une composante du RPR chiraquien. Il a voulu faire percer le gaullisme social au sein de la famille chiraquienne.
Or, à partir de 1969 et plus encore à partir de 1974, il y a une rupture au sein de la famille gaulliste, car les héritiers du gaullisme social estiment que la défense du gaullisme n’est ni avec Georges Pompidou, ni avec Valéry Giscard d’Estaing, ni même avec Jacques Chirac, mais qu’elle est à gauche, quitte à travailler avec les ennemis d’hier. Jean Charbonnel ou Léo Hamon, tous les deux des anciens ministres, vont ainsi œuvrer directement avec la gauche socialiste de François Mitterrand. Ce moment marque, pour moi, la rupture entre les gaullistes sociaux et les gaullistes de gauche, les premiers cherchant à faire vivre une droite sociale, les seconds ralliant les partis de la gauche socialiste et communiste.
Les gaullistes de gauche vont, au nom d’une certaine idée du gaullisme, travailler main dans la main avec la gauche.
Au contraire, à partir de 1978-1981, un mouvement inverse s’opère. Certains gaullistes de gauche vont revenir dans le giron du RPR chiraquien, notamment à l’occasion des élections européennes de 1979, et vont donc redevenir des tenants de la droite sociale. D’autres vont néanmoins définitivement décrocher, comme Michel Jobert, ancien ministre de Pompidou, qui devient ministre de Mitterrand. Ces deux familles, issues de la vision sociale du général de Gaulle, coexistent pendant de nombreux années… Les gaullistes sociaux font vivre l’idée d’une droite sociale et populaire au sein de la famille gaulliste puis chiraquienne ; tandis que les gaullistes de gauche, au nom d’une certaine idée du gaullisme, travaillent main dans la main avec la gauche. Ce sont eux que l’on retrouve, en 2002, autour de la candidature de Jean-Pierre Chevènement.
LVSL – Certains observateurs, tel que l’historien Grey Anderson, ont décrit le retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958 comme un coup d’État, dans un contexte de guerre civile. Que pensez-vous de cette analyse ?
P. M. – Je ne pense pas qu’on puisse qualifier le retour au pouvoir du général de Gaulle de coup d’État, mais il est vrai que la crainte d’un coup de force militaire a indéniablement pesé sur les conditions de son accession aux responsabilités en mai 1958. De Gaulle s’est toujours tenu à l’écart des tractations avec les militaires de l’Algérie française, ce qui n’est pas le cas de tous les gaullistes, notamment son premier cercle, ainsi Jacques Foccart et Olivier Guichard.
Le général de Gaulle ne pouvait pas non plus ignorer la volonté qu’avaient les pieds-noirs et l’armée d’Algérie de le voir revenir au pouvoir, ni même les agissements de son entourage. Au moment où le gouvernement de Salut public est proclamé à Alger, le Général profite donc de la situation pour mettre la pression sur l’écosystème politique métropolitain et pour être choisi non seulement comme dernier président du Conseil mais aussi pour obtenir les pleins pouvoirs au début du mois de juin 1958.
Je dirais donc que de Gaulle n’a pas organisé de coup d’État militaire, mais qu’il a profité d’un climat général d’angoisse politique, vis-à-vis de la possibilité d’un tel coup d’État, pour accéder au pouvoir.
LVSL – En-dehors de ce que vous appelez la « valeur refuge » que constitue le gaullisme dans une partie très importante du champ politique français, quel est, selon vous, l’héritage du gaullisme aujourd’hui, et en particulier du gaullisme social ?
P. M. – Ce qui est très intéressant, c’est que lorsque le général de Gaulle est décédé en 1970, la question de savoir s’il existait encore un gaullisme s’est immédiatement posée. Or elle n’a jamais été résolue depuis. Si l’on reprend la définition de la pensée gaulliste apportée dans mes réponses précédentes, y a-t-il eu une continuité à travers d’autres figures politiques ? On peut bien sûr penser aux barons du gaullisme, avec la candidature de Chaban-Delmas en 1974 ou celle de Michel Debré en 1981.
Pour rappel, on parle généralement de six barons du gaullisme : Chaban-Delmas, Debré, Foccart, Frey, Guichard et Palewski. Pourquoi ces six hommes sont-ils considérés comme des barons du gaullisme ? Parce qu’ils étaient des hommes qui parlaient au nom du général de Gaulle et au général de Gaulle. Ils étaient parmi les rares personnes capables de lui tenir tête. Ils déjeunaient régulièrement ensemble, à la Maison de l’Amérique latine, boulevard Saint-Germain. À partir de là, est né une sorte de mythe selon lequel ils seraient les grands décideurs du régime. Dans la vie quotidienne du parti, le Général se refusant aux bases œuvres de la vie politique, les barons du gaullisme étaient en effet les animateurs du gaullisme politique.
Puis, au fur et à mesure de la disparition des barons, disparition politique ou personnelle, d’autres ont essayé de reprendre cet étendard et ce rôle au sein de la famille gaulliste comme Pierre Lefranc (fondateur de l’Institut Charles-de-Gaulle en 1971) ou encore des anciens Premiers ministres comme Maurice Couve de Murville ou Pierre Messmer. Ces nouveaux barons ont cherché à faire vivre le gaullisme après de Gaulle. Dans des temps les plus récents, d’autres figures se sont imposées comme les derniers gardiens du temple du gaullisme, comme Albin Chalandon qui, en 1986, était le seul ministre du général de Gaulle à servir dans le gouvernement de cohabitation de Jacques Chirac. Il apportait alors une caution politique importante mais aussi un témoignage de la survivance du gaullisme, comme je le raconte dans mon livre [NDLR : Albin Chalandon, Le dernier baron du gaullisme, Perrin, 2023].
L’élection présidentielle de 2022 l’a montré : la quasi-totalité des candidats, de droite mais aussi de gauche, a en effet invoqué la figure du général de Gaulle
De là, une question demeure. Les derniers grands représentants du gaullisme ayant disparu, existent-ils encore des gens légitimes en France pour porter cette parole politique ? Je suis persuadé que le gaullisme est un ensemble de grands principes qui ont encore toute leur légitimité et leur vitalité dans la France contemporaine. L’élection présidentielle de 2022 l’a montré : la quasi-totalité des candidats, de droite mais aussi de gauche, a en effet invoqué la figure du général de Gaulle, qu’il s’agisse d’Anne Hidalgo qui s’est rendue à Colombey-les-Deux-Églises ou de Marine Le Pen qui l’a célébré à Bayeux, d’Éric Zemmour qui a utilisé la référence au discours du 18-juin dans son clip de campagne, d’Emmanuel Macron qui a appelé à voter pour lui des sociaux-démocrates aux gaullistes, ou encore de Valérie Pécresse, qui se présentait comme une gaulliste sociale et libérale.
Alors pourquoi cette appropriation politique unanime du terme de « gaullisme » ? Parce que les grands principes du gaullisme sont devenus transpartisans. De Gaulle et le gaullisme sont désormais plus que des notions politiques, ce sont des concepts historiques. Qui se souvient en effet des tensions politiques inhérentes à l’époque de général de Gaulle, exception faite des événements de mai 1968 ? En revanche, on se souvient tous du héros de la France libre, de celui qui, après avoir relevé le pays, a voulu réconcilier la droite et la gauche, bref de la figure de rassemblement.
J’ajouterais que lorsque de Gaulle revient au pouvoir en 1958, il est persuadé qu’il est légitime pour parler à la droite, mais aussi à la gauche, et que ce qu’il entreprend devrait avoir son soutien. Il est donc écœuré de voir que la gauche, derrière François Mitterrand (qui publie Le coup d’État permanent en 1964), refuse de le soutenir pour ce qu’il estime être une histoire de politique politicienne. Il confie d’ailleurs à un proche : « La gauche se réclamera de moi lorsque je serai mort », ce qui est une manière de dire que son différend avec la gauche est uniquement personnel. Tout cela lui semble contraire à l’intérêt du pays ; c’est le fameux « régime des partis », qu’il abhorre et contre lequel il s’est battu toute sa vie.
LVSL – Qu’est devenu le gaullisme après de Gaulle ? Vous parlez beaucoup du gaullisme social mais vous écrivez aussi qu’il existe aussi un gaullisme néolibéral et européen, ce qui peut sembler antithétique…
P. M. – Le gaullisme néolibéral, qu’on présente aussi parfois comme un néo-gaullisme, est l’héritier des politiques libérales menées par le général de Gaulle en 1958-1959, au moment de la réforme Pinay-Rueff de l’économie française. Il s’enracine, en 1962, avec l’arrivée de Georges Pompidou à Matignon.
Quant au gaullisme social, il a lui-même muté du catholicisme social des origines, au gaullisme ouvrier, en passant par l’opposition au pompidolisme puis par les grandes heures du séguinisme.
Quant au gaullisme européen, il faut rappeler que le général de Gaulle n’est pas contre l’Europe ; il est pour l’Europe des nations. Mais lui-même évolue au cours de son mandat. À la fin de sa vie, en 1969, il a ainsi des entretiens avec l’ambassadeur britannique Soames et lui confie : « Je suis prêt à faire entrer l’Angleterre dans une certaine Europe, telle que je l’ai imaginée ». Ce changement de pied explique qu’il y a, dans la famille gaulliste, un courant pro-européen, avec Jacques Chaban-Delmas, par exemple, partisan de l’accord de Maastricht, et à l’opposé, un courant souverainiste, dans lequel on retrouve Philippe Séguin ou Charles Pasqua, défenseurs de l’Europe des nations.
Quant au gaullisme social, il a lui-même muté du catholicisme social des origines, au gaullisme ouvrier, en passant par l’opposition au pompidolisme puis par les grandes heures du séguinisme. Je suis persuadé que le gaullisme social, qui est à la fois un discours souverainiste d’exaltation de la nation française et en même temps un discours de lutte contre la fracture sociale, a aujourd’hui encore une audience particulière mais aussi une légitimité forte.
L’usage et la captation du « gaullisme social », comme mot-valise du parfait équilibre entre la droite et la gauche, est donc évidemment politique. C’est une expression qui répond aux nécessités d’une époque où les Français, après avoir goûté à la globalisation, recherchent un État qui protège face aux crises comme aux marchés concurrentiels, et en même temps, un État qui préserve leur identité, leurs particularismes, face à une sorte d’uniformité culturelle, économique, sociale, qu’on cherche à nous imposer.
Alors faut-il préserver, coûte que coûte, les particularités françaises ? Ou faut-il, au contraire, rechercher l’efficacité en allant vers le copier-coller de modèles étrangers ? Je crois que, dans ce débat, le discours gaulliste résonne de manière particulièrement évidente aujourd’hui : volonté de dépasser les clivages politiques, souci de la grandeur du pays et de la défense de son modèle si unique, mais aussi recherche d’une concorde sociale, qui soit le ferment de l’unité nationale, il y a là un véritable programme politique !