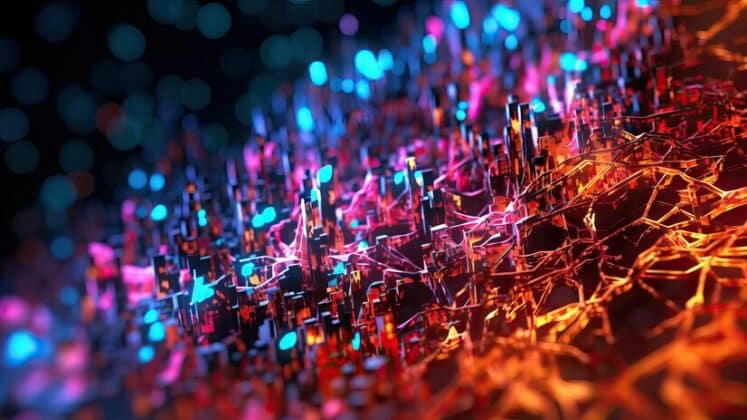Nous avons rencontré Ignacio Ramonet, ex-rédacteur en chef du Monde Diplomatique, co-fondateur d’Attac et du Forum Social Mondial. Ex-professeur à l’Université Paris VII devenu une figure marquante de l’altermondialisme, il s’est spécialisé dans l’étude de l’Amérique latine et du système médiatique. Il revient dans cet entretien sur les mutations qu’a connu le champ médiatique, sur la manière dont les réseaux sociaux contribuent à le modifier, sur l’érosion de l’hégémonie néolibérale, le phénomène populiste, ou encore les phénomènes politiques récents qui ont marqué l’Amérique latine (élection d’AMLO au Mexique, défaite de Gustavo Petro en Colombie, élection de Jair Bolsonaro au Brésil…). Propos recueillis par Vincent Ortiz et Antoine Cargoet. Retranscription réalisée par Marie-France Arnal.
LVSL – La loi anti “fake news”, préparée en concertation avec les grands patrons de presse et avec les firmes qui s’occupent des serveurs Internet et des réseaux sociaux, a été adoptée par l’Assemblée nationale française en novembre 2018. Que vous inspire le vote de cette loi ?
Ignacio Ramonet – Dans le champ médiatique, les fake news [fausses informations] ne constituent pas un élément réellement nouveau. Ce n’est pas parce que l’expression “fake news” est neuve que les contre-vérités et les mensonges dans les médias le sont également. On a connu la désinformation, la manipulation, l’intoxication et les bourrages de crâne depuis l’essor de ce qu’on appelle les “médias de masse” à la fin du XIXe siècle. Est-ce qu’on va enrayer l’actuelle épidémie d’infox par une loi ? L’intention est sans doute louable mais, personnellement, je suis sceptique.
Comme toutes les lois qui cherchent à empêcher les « excès » des médias, celle-ci aura un effet limité. C’est un peu comme si le législateur décidait qu’« il est interdit de mentir dans les médias ». Bien sûr, c’est moralement correct. Mais les lois sur la presse (dont, en France, celle de 1881), les codes de déontologie médiatique (comme la Charte de Munich de 1971) ou l’éthique professionnelle des journalistes l’imposent déjà. Et on en voit bien les limites… La preuve c’est qu’il a fallu inventer plus récemment, au sein des rédactions, la figure du « médiateur », puis les cellules de « fact checking » (vérification des faits)… Je pense que cette loi anti fake news répond surtout à une préoccupation de la société. Et qu’elle est, pour les grands oligarques des médias ainsi que pour bien de journalistes dominants, un simple alibi destiné à apaiser l’inquiétude sociale. Je ne pense pas qu’elle changera grand chose.
Nous sommes installés dans un système médiatique de type « quantique », qui opère aussi bien avec la vérité qu’avec le mensonge. Cette coexistence simultanée de la vérité et du mensonge est la caractéristique principale de la mécanique médiatique actuelle. Et c’est la menace centrale, en matière d’information, que doit affronter le citoyen. Il lui faut vivre désormais avec les infox comme, en matière de santé, il vit avec les menaces que représentent les virus ou les bactéries. Ce qui ne veut pas dire qu’il doit s’y résigner. Au contraire, il lui faut se mobiliser, s’armer pour les combattre et se vacciner contre ses effets nocifs. A cet égard, on pourrait même imaginer – sans être complètement paranoïaque -, que cette loi, en prétendant rassurer, vise d’une certaine manière à démobiliser les citoyens… Et à en faire, paradoxalement, des cibles encore plus faciles pour les fake news…

LVSL – D’aucuns estiment que les fake news sont le produit des réseaux sociaux qui fonctionnent au buzz, aux algorithmes… Pensez-vous qu’on a une lecture un peu simpliste du phénomène “fake news” ?
IR – Quelle devrait être la principale préoccupation de tout système médiatique ? Diffuser une information vérifiée, garantie « sans mensonges » comme certains produits alimentaires sont garantis « sans caféine », « sans sucre » ou « sans gluten ». « Zéro infox ». Informer les citoyens, mais en soumettant les infos à un filtrage préalable, une épuration (comme on dit « station d’épuration » pour dépolluer les eaux usées) qui élimine les fausses informations et les « infox » de toutes sortes…
Cependant, à partir du moment où l’accélération médiatique a atteint la vitesse de la lumière, la vérification sérieuse est devenue quasiment impossible. De surcroît, nous sommes tous désormais devenus, via les smartphones et les réseaux sociaux, des producteurs compulsifs d’informations. Le système médiatique et les journalistes ont donc perdu le monopole de la diffusion d’infos. Dans un tel contexte, les médias auraient tout intérêt à garantir la vérification, ne serait-ce que pour nous convaincre que les infos qui nous parviennent par leur intermédiaire sont plus crédibles que celles qui nous arrivent via le système sauvage des réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube, etc.).
Mais ce n’est pas le cas. Le système médiatique n’apporte pas, ou presque pas, de garanties complémentaires aux réseaux sociaux. Et ce n’est pas pour des raisons morales. Il ne peut le faire pour de simples raisons techniques, de concurrence et, en définitive, d’intérêts commerciaux. D’abord parce que, en raison de l’accélération de la circulation des infos, le hiatus entre l’instant où un media reçoit une information et celui où il la diffuse a disparu. Car devant la crainte qu’un media concurrent diffuse une info en premier, les medias ont désormais tendance à diffuser les infos dès qu’ils les reçoivent. Sans prendre le temps de les vérifier… Quitte à démentir ou à corriger plus tard. Ce qui place les citoyens en situation de ce que j’appelle une « insécurité informationnelle » car ils ne savent jamais si une info est vraie ou fausse…
Je compare souvent le journaliste contemporain au commentateur sportif d’un match de foot à la télé. Présent au stade, le commentateur n’en sait pourtant pas plus que le téléspectateur en ce qui concerne l’issue de la partie. Il ignore le score final du match, exactement comme la personne installée chez elle devant son petit écran. Si le téléspectateur – qui connaît les règles du jeu – venait à couper le son, il pourrait parfaitement suivre le match sans l’aide du commentateur…… A quoi sert donc celui-ci? Quelle est, en quelque sorte, sa « valeur ajoutée » ? Se poser ces questions est déjà significatif sur le rôle secondaire, voire négligeable, du commentateur.
Dans le champ de l’information, il se produit le même phénomène : le rôle du journaliste est en passe de devenir celui d’un simple commentateur… Incapables techniquement de vérifier les infos, les médias ne sont plus garants de la qualité de l’information, et enveloppent cette carence dans un surplus de commentaires… Moins ils en savent, plus ils en disent.
LVSL – Vous aviez écrit en 2011 un article intitulé ‟Automates de l’information”, dans lequel vous pointiez du doigt l’automatisation de l’information, chaque jour davantage régie par les algorithmes, destinée à un public de plus en plus ciblé. A l’époque, vous estimiez que ce n’était pas en passe de devenir un modèle dominant. Aujourd’hui, Facebook signe des contrats avec de grands journaux américains et français pour mettre en avant leurs publications et, en échange, ces médias peuvent s’adapter aux algorithmes de Facebook pour maximiser leurs vues. Pensez-vous que, à l’heure où tout le monde utilise Facebook, Twitter, etc. ce modèle d’information régi par les algorithmes est en passe de devenir le modèle dominant ?
IR – C’est déjà le cas. Qu’est-ce qui faisait qu’une info se retrouvait à la « une » des journaux de la presse papier traditionnelle ? C’est le conseil de rédaction ou, en dernière instance, le rédacteur en chef ou le directeur du journal qui décidait souverainement en fonction de l’actualité. Aujourd’hui, qui décide de placer en ouverture d’écran telle ou telle information dans la version web d’un média? C’est le nombre de « clicks », de consultations numériques, qui fait automatiquement « monter » l’information à la « une » et qui la tire parfois des abîmes digitaux où elle était enfouie. La hiérarchie de l’information est désormais déterminée par le nombre de « clicks ».
Mais d’autre part, on sait que Google comme Facebook faussent leurs données. C’est-à-dire qu’on a aujourd’hui la possibilité, moyennant finance, d’acheter les « premières places » pour se retrouver parmi les informations qui apparaissent le mieux situées sur l’écran quand on recherche une donnée sur le web. Les premières propositions de Google ne sont pas celles qui sont le plus consultées mais celles dont les firmes-mères font de la publicité et ont payé pour cela. Si l’internaute ne fait pas attention, il se laisse prendre. En dehors de ces cas, pour tous les médias, c’est le même système : ce sont les réseaux sociaux qui déterminent la hiérarchie de l’information.
Le champ médiatique ne se réduit plus à la seule galaxie médiatique traditionnelle, constituée de la sainte trilogie : presse écrite, radio, télévision. Aujourd’hui, le média dominant ce sont les réseaux sociaux. Rappelons que l’ancien président des Etats-Unis Barack Obama avait déjà gagné sa première campagne électorale, en novembre 2008, sur la base d’un usage novateur des réseaux sociaux. Et c’était pourtant à un stade embryonnaire. Obama allait encore sur les plateaux de télévision donner des entretiens parce que ses conseillers en marketing électoral pensaient que la télévision était encore le média dominant. Tout a changé en 2016. Pour la première fois depuis les années 1940 et l’essor de la télévision, Donald Trump a fait sa campagne électorale victorieuse sans donner un seul entretien à aucune des quatre principales chaînes américaines (ABC, CBS, NBC, Fox). Il faut savoir que l’audience moyenne cumulée des journaux télévisés des quatre principales chaînes des États-Unis est d’à peine 29 millions de téléspectateurs (dans un pays de 325 millions d’habitants…). En revanche, sur les réseaux sociaux, Donald Trump compte environ 30 millions d’ « amis » sur Facebook et quelque 60 millions de followers sur Twitter… A qui il parle directement…
Il faut également mentionner le phénomène nouveau des “moi-médias” et des influencers, c’est-à-dire de personnes qui – pour la première fois depuis l’apparition au XIXe siècle des mass media – ne doivent pas leur notoriété publique aux grands médias traditionnels (presse, radio, télévision) mais exclusivement aux réseaux sociaux. Ces influencers peuvent avoir une audience supérieure à celle, cumulée, de plusieurs grandes chaînes de télévision… C’est le cas, par exemple, de Kim Kardashian, au départ starlette de la téléréalité, qui possède, sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Snapchat et Instagram, quelque 224 millions de followers cumulés… Rappelons, à titre de comparaison, que l’événement télévisuel qui rassemble la plus formidable audience au monde est le Super Bowl américain et ses 113 millions de téléspectateurs… Kim Kardashian, à elle seule, fait 100 millions de mieux !
Il y a désormais, à travers le monde, des centaines d’influencers très prescripteurs qui peuvent vendre, à leurs millions d‘abonnés fidèles, toutes sortes de produits : de la mode, des vêtements, des objets, du maquillage, des voyages, des hôtels, de la technologie, etc. Et aussi, bien entendu : des idées, des causes et des candidats à des élections… Ces « moi-média » n’existaient pas dans l’écosystème médiatique traditionnel dont parlent encore les facultés de communication ou les écoles de journalisme… Il n’y a donc pas que les automates… On est aujourd’hui dans une mécanique médiatique où les effets perturbateurs des réseaux sociaux vont bien au-delà de cette « explosion du journalisme » dont j’ai parlé.
“Une « démocratie médiatique » dont Jean-Luc Godard, on s’en souvient, avait cruellement démontré l’absurdité en la définissant ainsi: « Une minute pour les nazis, une minute pour les Juifs. »”
LVSL – A propos des réseaux sociaux et des médias dominants qui souvent se conjuguent, quelles stratégies de contournement sont possibles ? Quelles opportunités offre la mise à disposition des réseaux sociaux ?
IR – On sait que, dans les années 1990 ou 2000, quelques intellectuels hors cadre – par exemple, Pierre Bourdieu – ont fait le choix du contournement, en effet. Ne plus se rendre sur les plateaux télé parce qu’ils y étaient inaudibles à cause du cadre rhétorique qu’ils considéraient piégé. Pierre Bourdieu avait raconté, dans son livre Sur la télévision, comment il s’était insurgé contre le dispositif dans lequel on voulait le contraindre à penser. Il avait alors dénoncé la supercherie du « débat télévisé » dont se servent les médias dominants pour mettre en scène leur idée de la “démocratie médiatique”. Une « démocratie médiatique » dont Jean-Luc Godard, on s’en souvient, avait cruellement démontré l’absurdité en la définissant ainsi: « Une minute pour les nazis, une minute pour les Juifs. »
À la même époque, Noam Chomsky démontrait également que, à la télé, le signifiant déterminait le signifié. Parce que la structure médiatique finissait par conditionner ce que vous alliez dire. Il l’expliquait ainsi : « Dans un débat télévisé, si vous dites ce que tout le monde pense, c’est-à-dire si vous répétez la doxa sociale, une minute vous suffit en général pour défendre n’importe quel argument. Mais si vous voulez affirmer le contraire de ce que tout le monde pense, alors une minute ne suffit pas. Parce qu’il vous faut d’abord démentir les idées reçues, déconstruire, puis remonter une démonstration, etc. Il vous faut plus de temps. Mais alors on vous le refuse au prétexte qu’ « à la télévision ça va vite »… Donc, sur un plateau de télévision, vous ne pouvez jamais dire ce que vous pensez, si ce que vous pensez n’est pas ce que pense tout le monde… »
Sur ce même registre, il y a environ trente ans, un mensuel comme Le Monde diplomatique s’est construit également, par choix de sa rédaction, en marge du système médiatique dominant. Il a pris à cet égard deux décisions novatrices : d’une part, faire de la communication un sujet d’information. Créer une sorte de métagenre : informer sur l’information. Développer auprès du grand public un intérêt pour la théorie de la communication et pour la théorie de l’information. C’était nouveau. A part les revues spécialisées, les médias grand public n’en parlaient pas. Le Diplo a été pratiquement le premier à dire, dans ses colonnes, que la communication et l’information étaient des sujets politiques auxquels les citoyens devaient s’intéresser. Parce que les médias jouent un rôle déterminant dans la vie de la cité. L’économie de la presse, la propriété des médias, leur structure industrielle, la rhétorique des discours médiatiques, le dévoilement de manipulations ou la propagande sont des thèmes que des citoyens modernes doivent connaître au même titre que la géopolitique ou la géoéconomie. Cela d’ailleurs s’est imposé et généralisé.
La seconde décision était précisément celle dont vous parlez, du contournement. Nous pensions, au Diplo, qu’on ne pouvait pas conduire une véritable réflexion critique à l’égard des médias dominants tout en étant présents en permanence, en tant que journalistes invités, dans ces mêmes grands médias que nous critiquions. L’un de nos arguments était qu’intervenir dans les médias de masse revenait à se compromettre, à se laisser “récupérer” – pour reprendre un terme soixante-huitard – par les médias dominants dont il ne faut jamais oublier que la fonction première est de domestiquer le peuple. Il fallait donc observer une distance critique et prophylactique.
Je pense que, à l’heure de l’hégémonie des réseaux sociaux, il faudrait poursuivre cette réflexion sur le rapport aux médias dominants. Nous vivons un très grand chambardement technologique. Qui constitue l’un des défis principaux des sociétés contemporaines. Et ce sont les médias qui reflètent le mieux cette formidable mutation. Parce qu’ils se trouvent dans l’œil du cyclone. Ne pas oublier que ce qu’on appelle les « nouvelles technologies » sont avant tout des technologies de la communication et de l’information. Qui concernent, de plein fouet, le journalisme et les médias. Par conséquent il n’est pas possible d’avoir une théorie critique immuable sur les médias. Qui aurait été valable il y a trente ans et qui le serait encore aujourd’hui. Alors que tout a changé… En matière de théorie des médias, il faut donc reprendre l’analyse. Parce que les lois de la mécanique médiatique ne sont pas constantes.
Par exemple, à propos de cette question sur notre présence dans les médias dominants, le contexte a complètement changé. Si les médias dominants sont désormais les réseaux sociaux, la question d’y aller ou pas ne se pose plus. Chacun d’entre nous peut posséder maintenant son propre réseau social. Nul besoin d’aller chez quelqu’un d’autre. C’est vous qui imposez votre cadre. C’est à cela qu’a répondu Donald Trump. Il ne va pas dans les plateaux des grands médias classiques puisqu’il est son propre « moi-media ».
LVSL – Nous voudrions revenir plus en détail sur le regard rétrospectif que vous portez sur le rôle qu’ont assumé « Le Monde diplomatique », mais aussi ATTAC – dont vous êtes l’un des fondateurs – et le Forum Social Mondial dans les années 1990 et 2000, dans une période où régnait l’idée de « la fin de l’histoire » chère à Fukuyama et la résignation de la gauche institutionnelle. Quels rôles ont tenu ce type d’initiatives comme ATTAC (Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l’Action Citoyenne) –, ou « Le Monde diplomatique » dans la refondation en train de s’engager ?
IR – Le moment néolibéral le plus dur, l’apogée de l’hégémonie néolibérale, a eu lieu en 1995, lorsque, en France, Édouard Balladur était premier ministre. Il y avait alors, non pas une croyance, mais une certitude quasi religieuse que la solution aux problèmes du monde était toute trouvée, que l’histoire était terminée. La démocratie libérale s’était imposée et l’économie de marché ainsi que le libre-échange devaient dominer la planète. C’était quelques années après la chute du mur de Berlin en novembre 1989 et l’implosion de l’Union soviétique en décembre 1991. Les forces de gauche étaient matraquées violemment. Et pas uniquement le Parti communiste, qui avait soutenu jusqu’au bout l’Union soviétique. La gauche dans son ensemble a été déstabilisée par cette pensée néolibérale dominante. Face à cela, nous avons alors proposé, pour nommer cet unanimisme des élites dirigeantes et des médias, le concept de “pensée unique“. Nous avons publié, sous ce titre, en février 1995, un édito qui a eu un certain succès.
C’est à ce moment-là que, au sein de la rédaction du Monde diplomatique, nous avons estimé que le journal devait aller au-delà de l’information, dans le sens de ce que nous réclamaient de nombreux lecteurs. Notre réponse traditionnelle jusque là consistait à dire que nous étions journalistes – intellectuels à la limite -, que nous étions là pour informer, pour analyser, réfléchir, mais pas pour prendre la place des organisations politiques. En d’autres termes, pour paraphraser Marx : interpréter oui, transformer non.
Nous avons décidé de briser cette tradition et, en quelque sorte, de miser sur l’action. Puisque nul ne le faisait, nous avons proposer de créer un instrument social d’intervention dans le débat public, politique, et nous avons lancé cette idée d’ATTAC dans un éditorial intitulé « Désarmer les marchés » en décembre 1997. Le nom de cette association n’était pas anodin bien entendu. Il voulait annoncer la fin de la résignation. Et appelait à passer intellectuellement, socialement, politiquement à l’offensive, « à l’attaque ». Pour transformer le monde et changer la vie. Elle a été crée dans un grand élan d’enthousiasme. Et a apporté une boîte à outils qui a permis de mieux comprendre la globalisation néolibérale pour mieux la dénoncer. Attac a favorisé aussi l’invention de nouvelles formes d’organisation des luttes. Son modèle s’est étendu à l’ensemble de l’Europe et au-delà.
Dans ce même esprit, nous avons conçu le projet du Forum Social Mondial, avec l’idée d’en faire le symétrique inversé du Forum de Davos qui est le rendez-vous international de tous les défenseurs de la globalisation néolibérale. Le premier Forum Social Mondial s’est tenu en 2001 à Porto Alegre au Brésil. Il a été conçu comme un espace d’éducation populaire, un laboratoire d’idées, d’échanges, de propositions mais aussi comme une fabrique de résistances. Beaucoup de phénomènes politiques survenus en Amérique latine dans les années 2000, et notamment les grandes expériences progressistes, ont été conduits par des personnalités (Hugo Chavez, Lula da Silva, Evo Morales, Rafael Correa, Fernando Lugo, etc.) venues aux Forums Sociaux. Ce fut une grande école de riposte sociale. De nombreux intellectuels y ont également apporté leurs points de vue, de Noam Chomsky à Eduardo Galeano, en passant par Arundhati Roy, José Saramago, John Berger, François Houtart…
Je dois préciser que l’essor d’Attac comme celui du Forum Social Mondial se sont faits en marge du Monde diplomatique. Nous avons certes contribué à les créer ou à les impulser. Mais une fois ces organisations lancées, nous pensions que ce n’était pas notre rôle que de nous impliquer directement dans la conduite concrète de mouvements pleinement engagés dans les luttes.

LVSL – On constate que l’hégémonie néolibérale s’écorne légèrement en Europe, sous la forme de plusieurs mouvements notamment d’une nébuleuse qu’on qualifie de “populiste”. Que pensez-vous du populisme ? Est-ce pour vous un mouvement uniquement réactionnaire ou alors peut-on y puiser les germes d’une pensée, d’un mouvement progressiste ?
IR – Je pense que nous sommes en train de vivre une sorte de nouveau millénarisme et cela provoque ou conditionne de nombreux phénomènes politiques. Qu’est-ce que ce millénarisme ? Après trente ans d’hégémonie néolibérale et dix ans de souffrances sociales accrues en raison des conséquences de la crise de 2008, ce millénarisme résulte de la prise de conscience, de plus en plus nette, qu’un monde – celui qui nous est familier – arrive à sa fin. Et que celle-ci est précédée de toutes sortes de menaces et de défis. Pensons, par exemple, à l’alerte écologique devenue quotidienne, qui annonce d’imminents changements climatiques dévastateurs. C’est non seulement un récit apocalyptique mais une réalité de plus en plus palpable. Cela conduit désormais les gouvernements à prendre des mesures – par exemple, en France, la taxation carbone sur les combustibles fossiles – qui bouleversent la vie des gens. Et les poussent, en retour, à protester… On le voit, en France, avec la révolte des « bonnets rouges », en 2013, contre l’écotaxe ou, plus récemment, celle quasi insurrectionnelle des « gilets jaunes » contre l’augmentation du diesel.
Il faut ajouter à cela l’autre grande mutation en cours dont j’ai parlé. Celle que produisent, dans tous les domaines de notre vie quotidienne, les changements technologiques qu’on observe partout: Internet, Big Data, intelligence artificielle, nanotechnologies, imprimantes 3D, objets connectés, biotechnologies, cybersurveillance, génomique, robotique, cyborg, etc. Tout notre environnement technique est chamboulé. Comme il l’avait été au XIXe siècle lorsque l’ère industrielle atteignit son apogée et fit table rase du passé au nom de ce qu’on a alors appelé la “modernité”. Un univers de traditions centenaires s’est brutalement effondré. Et ce phénomène, par le biais des conquêtes coloniales, avait touché le monde entier. Des modes de vies ancestraux avaient rapidement disparu. Rappelons-nous que c’est dans un tel contexte que l’Europe connut les plus violentes secousses politiques de toute son histoire : la naissance du nationalisme et du socialisme, ainsi que cinq grandes révolutions (1789, 1830, 1848, 1870, 1917) et une guerre mondiale…
Aujourd’hui, après quarante ans d’inégalités neolibérales, on vit donc deux grandes mutations simultanées. Et elles produisent à leur tour de formidables désarrois. Aux victimes de la désindustrialisation massive viennent désormais s’ajouter d’autres catégories professionnelles, dans le secteur des services, qui voient à leur tour leurs emplois menacés ou détruits ou dégradés : employés de banque, journalistes, éditeurs, postiers, chauffeurs de taxis, hôteliers, petits commerçants, etc. Cette grande mutation et les diverses « ubérisations » produisent une nouvelle classe de « forçats de la terre » : la masse des salariés précaires, le précariat. C’est ce précariat surexploité qui aura probablement un rôle important dans les luttes sociales à venir. Comme, au XIXe siècle, les ouvriers des usines se sont battus pour améliorer leur condition.
Tous ces perdants et tous ceux qui paniquent devant les mutations en cours sont à la base du populisme contemporain en Europe. Dont les caractéristiques sont le repli sur la nationalité et l’identité, la peur du changement et du déclassement, et la terreur de l’Autre (actuellement le migrant). C’est pour cette raison que le populisme européen diffère du populisme latino-américain. On n’explique pas le populisme hongrois ou italien de la même manière que le populisme au Venezuela ou en Equateur, en Amérique latine. C’est pour cela qu’on peut défendre, en effet, l’idée d’un populisme de gauche.
“S’appuyer sur les corps intermédiaires en Amérique latine, c’est tomber dans les mains de ces oligarchies qui dominent tout : banques, entreprises, gouvernements, parlements, justice, médias…”
LVSL – On effectue souvent le parallèle entre les populismes latino-américains comme vous le disiez et les populismes européens… Cette comparaison est-elle justifiée ? Quels sont les facteurs qui peuvent expliquer certaines différences ?
IR – En Amérique latine, la domination des élites, des oligarchies est telle que les sociétés luttent encore pour sortir d’une ère disons néo-féodale ou néocoloniale. S’appuyer sur les corps intermédiaires, dans cette région du monde, c’est tomber dans les mains de ces oligarchies qui dominent tout : banques, entreprises, gouvernements, parlements, justice, médias… A la base, ce sont des latifundistes (grands propriétaires terriens) qui possèdent les exploitations agricoles et les mines, c’est-à-dire le sol et le sous-sol, principaux facteurs de richesse dans cette région. Globalement, avec quelques variantes, les Etats latino-américains demeurent des exportateurs de produits du secteur primaire, agriculture et mines. Ils vivent de cela depuis des siècles. Le seul pays d’Amérique à avoir réussi à échapper à cette malédiction coloniale ; qui est passé de l’état de mono-exportateur de coton à celui de grande puissance, ce sont les États-Unis. A la différence du Mexique, du Brésil ou de l’Argentine, les Etats-Unis sont parvenus à développer un système bancaire et financier solide, allié à une politique commerciale protectionniste, qui leur a permis de bâtir une industrie nationale à une vitesse impressionnante. C’est à cette saga, cette success story à laquelle se réfère en permanence le populiste Donald Trump.
En Amérique latine, quand par miracle un candidat ou une candidate progressiste gagne les élections et arrive au pouvoir avec un programme de réformes sociales, il ou elle ne peut pas s’appuyer sur les oligarchies traditionnelles. Parce qu’elles contrôlent tout. Et que tout progrès social en faveur des humbles ne peut se faire qu’à leurs dépens… Il faut donc qu’il ou elle parle directement au peuple : c’est ça le populisme latino-américain. Prenons l’exemple d’Hugo Chavez, arrivé au pouvoir en février 1999. Lorsqu’il a souhaité mettre en oeuvre ses réformes sociales – alphabétisation, santé publique gratuite, éducation, nationalisations, etc. – les ministères eux-mêmes s’y sont opposés. Les cadres ministériels, issus des classes dominantes, bloquaient administrativement les réformes. Chavez a été obligé de créer des « missions » (misiones), des sortes de by-pass, pour contourner ses propres ministères… L’obstacle à ses réformes ne venait pas de l’opposition politique : c’étaient les cadres de l’Etat, les « énarques » vénézuéliens qui faisaient barrage… Chávez a donc dû en appeler au peuple. Voilà le sens du populisme en Amérique latine : s’adresser directement au peuple, passer par-dessus les corps intermédiaires dominés par les oligarchies, pour procéder aux indispensables réformes sociales.
Cela ne ressemble pas à ce que nous voyons surgir un peu partout en Europe. Ici, le populisme est le fait de gens paniqués – c’est le cas des Italiens qui perdent leur emploi à cause des mutations technologiques, ou celui des Hongrois qui craignent l’arrivée de migrants de l’Est ou du Proche-Orient. Le populisme est un « peurisme », le fruit pourri de peurs multiples. Il propose des solutions simples, imposées avec autoritarisme. C’est la différence que je vois entre le populisme latino-américain et européen.
Il faut dire toutefois que l’élection récente de Jaïr Bolsonaro au Brésil modifie la donne. Dans son cas nous avons affaire, je crois, à un populisme de droite de type européen – autoritariste, xénophobe et raciste – qui voudrait répondre, comme un retour de balancier, à une longue expérience politique de gauche conduite au Brésil pendant quatorze ans par le Parti des travailleurs (PT) de Lula da Silva et Dilma Rousseff.
LVSL – Les populismes de gauche en Europe importent un certain nombre de leurs recettes d’Amérique latine – rhétorique patriotique inclusive, place centrale du leader conçu comme à même de faire appel aux affects populaires… Cette importation est-elle justifiée?
IR – Le rôle du dirigeant est important, en Amérique latine comme ailleurs. Nous vivons dans des sociétés où les grands médias de masse ont imposé depuis longtemps une métonymie politique forte : un parti c’est l’homme ou la femme qui le dirige. Tout le système médiatique est structuré autour de cette idée : un parti c’est une personne, celle qui en est à sa tête. A la télévision, c’est le patron ou la patronne du parti qui est naturellement invité. Son point de vue est considéré comme étant celui de sa formation. On finit par associer naturellement son nom à celui du parti. Dans une campagne électorale c’est son visage qui figure sur les affiches, pas son programme.
Cette métonymie, ce sont les médias qui l’ont imposée. La gauche a été très réticente, pendant longtemps, à cela. Elle avait des « leaders » un peu honteux, qui n’étaient pas « présidents » du parti mais plus simplement « secrétaires généraux »… Elle mettait surtout en avant les idées, les programmes, plutôt que le chef. Mais je pense qu’aujourd’hui elle fait bien de repenser le rôle du (ou de la) leader. J’ai expliqué pourquoi en Amérique latine son rôle est important.
“Une période d’opposition ne fait pas de mal à un parti demeuré trop longtemps au pouvoir. En démocratie, nul n’a vocation à rester aux commandes éternellement”
LVSL – Il y a 6-7 ans, l’Amérique latine était en grande partie à gauche, dominée par des gouvernements sociaux-démocrates, voire socialistes. Aujourd’hui, les néolibéraux reviennent en force. On parle souvent de retour aux années 1980-1990, marquées par la mise en place de “plans d’ajustement structurels” dans les pays latino-américains, sous l’égide du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque Mondiale, consistant en la réduction des dépenses publiques, la compression des salaires et la libéralisation de l’économie et du commerce. Pensez-vous que cette comparaison est justifiée ?
IR – On a beaucoup théorisé sur la fin du “cycle progressiste” [ouvert par l’élection d’Hugo Chávez au Venezuela en 1999, suivi par l’élection de Lula au Brésil en 2002, Nestor Kirchner en Argentine en 2003, Evo Morales en Bolivie en 2006, Rafael Correa en Equateur la même année…]. En politique, il existe des cycles dont la durée de vie n’a rien à voir avec la pertinence ou non d’un programme. Les sociétés connaissent des cycles politiques, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. L’expérience historique montre que, en général, au-delà de quinze ans, toute gestion politique conduite par une même personne, même élue démocratiquement, paraît insupportable… Des enfants qui avaient dix ans au moment où est arrivé au pouvoir tel ou tel président ont l’impression, au bout de quinze ans, de l’avoir connu toute leur vie… Ils en éprouvent une forme de lassitude. La politique n’est pas rationnelle. Et les électeurs dans nos « démocraties médiatiques », nos « sociétés du spectacle » sont souvent gagnés par le sentiment de « déjà vu » et de « ras le bol ».
En mai 1968, en France, une génération avait l’impression d’avoir toujours eu pour président le général De Gaulle qui n’était pourtant au pouvoir que depuis 10 ans… En Equateur, par exemple, Rafael Correa a été objectivement un excellent gouvernant démocratique avec des résultats spectaculaires, mais – au bout de dix ans – il a lui aussi fini par lasser une partie importante des citoyens… En Bolivie, Evo Morales, également excellent gouvernant en termes de résultats macroéconomiques, connaît aussi un effet de lassitude et – d’après les sondages actuels – pourrait avoir des difficultés à remporter l’élection présidentielle d’octobre 2019.
Il existe des exceptions, comme le cas de l’Uruguay, toujours solidement ancré à gauche. Et qui n’a pas connu les mêmes problèmes de corruption que d’autres pays progressistes latino-américains. Peut-être également en raison de trois changements de président pour un même parti, en quinze ans. Et sans doute aussi grâce au phénomène José Mujica, leader populiste modeste. Il faut ajouter que, dans certains pays (Paraguay, Honduras, Brésil), des présidents progressistes ont été renversés, parce que les oligarchies locales ont tout simplement décidé que cela suffisait…
D’une manière générale, une période d’opposition ne fait pas de mal à un parti demeuré trop longtemps au pouvoir. En démocratie, nul n’a vocation à rester aux commandes éternellement. C’est normal de perdre des élections, à condition qu’il n’y ait pas fraude. Car l’un des objectifs structurels des mouvements progressistes en Amérique latine, ne l’oublions pas, c’est de garantir dans la durée le fonctionnement de la démocratie. En soi cela constitue une grande avancée pour des sociétés qui ne la connaissent que depuis quelques décennies.
LVSL – “AMLO” (Andrés Manuel López Obrador) au Mexique et Gustavo Petro en Colombie sont deux nouveaux phénomènes en Amérique latine qui donnent l’impression qu’une nouvelle génération néo-progressiste émerge. Elle est assez différente de l’ancienne [Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Nestor et Cristina Kirchner, Lula…], dans la mesure où on ne note pas de références au “socialisme”, que les attaques contre le néolibéralisme se font plus discrètes, que ses objectifs socio-économiques paraissent modestes, voire contradictoires. Pensez-vous que cette nouvelle génération néo-progressiste a intériorisé certains aspects du néolibéralisme ?
IR – Le Mexique est un cas très particulier. Et celui d’ AMLO également. Le Mexique est un Etat proche de la faillite. Certains États mexicains – le Mexique est un État fédéral – sont des narco-États régionaux. La structure étatique est quasiment affaissée et le pays connait une telle violence depuis si longtemps que ce n’est pas un hasard si López Obrador, à sa énième tentative, a fini par être élu après que les électeurs aient tout essayé.
Le PRI (Parti Révolutionnaire Institutionnel) a gouverné depuis la fin de la révolution mexicaine en 1921 jusqu’en 2000, soit pendant quelque 80 ans… En raison de cette si longue domination, la société a souhaité changer et a élu, en 2000, Vicente Fox, candidat du principal parti d’opposition, le PAN (Parti Action Nationale), chrétien libéral. C’était déjà une révolution. Mais, après 13 ans au pouvoir, le PAN a également échoué et les Mexicains ont de nouveau élu, en 2013, un candidat du PRI, Enrique Peña Nieto. Lui aussi a échoué. Il ne restait donc qu’à essayer Andrés Manuel López Obrador, du parti Morena (Movimiento Regeneración Nacional)… Devant l’accumulation des désastres, la société mexicaine a choisi d’essayer quelque chose de nouveau. C’est la principale leçon du scrutin, me semble-t-il, au-delà du programme de López Obrador, à la fois nationaliste, progressiste et en effet timidement anti-néolibéral.
Le problème principal que devra régler López Obrador, hormis celui de la violence, c’est celui des inégalités qui restent abyssales. Songeons qu’il y a encore quelque 6% d’analphabètes, 110 ans après la Révolution mexicaine… Autre élément: les relations avec les États-Unis. Le cas López Obrador est donc sui generis, très particulier. Son système de pensée est adapté à la complexité de la situation politique mexicaine. Je ne crois pas que l’on puisse en tirer une leçon générale pour le reste de l’Amérique latine.
Le cas de Gustavo Petro, en Colombie, est différent et fort intéressant. Rappelons que la Colombie est l’un des rares pays d’Amérique latine – avec le Brésil – qui n’a pas fait de réforme agraire, réclamation de base des masses paysannes et cause de la guerre civile qui a duré 60 ans [en 1948, le leader populiste Jorge Eliécer Gaitán, soutenu par des organisations paysannes favorables à une réforme agraire, fut assassiné, déclenchant la guerre civile colombienne]. Petro est un ancien guérillero qui a été maire de Bogota. Il possède une exceptionnelle expérience de la vie politique. En juin 2018, la gauche rassemblée a voté pour lui. Petro a pu ainsi se qualifier pour le second tour. Et a finalement obtenu 42% des suffrages. Il y a là, sans doute, le germe de quelque chose de positif. A la prochaine élection, en 2022, la gauche pourrait arriver au pouvoir. Pour la première fois dans l’histoire de la Colombie.
Gustavo Petro a su notamment parler aux classes moyennes urbaines fort nombreuses parce que les campagnes ont été vidées en raison des violences de la guerre civile. Il a aussi fait campagne sans omettre de critiquer certaines expériences progressistes latino-américaines dans les termes que je signalais plus haut : le leader est essentiel, mais un leader permanent et éternel n’est pas nécessaire ; un système progressiste est positif, mais un système progressiste corrompu est éminemment critiquable ; un parti doit s’adresser aux classes populaires, mais aussi aux classes moyennes…
Ce dernier enjeu paraît essentiel : un gouvernement progressiste, par définition, si ses réformes ont du succès, fait chuter la pauvreté et renforce statistiquement les rangs des classes moyennes… Au Brésil, Lula et le Parti des travailleurs (PT) ont fait sortir de la pauvreté environ 40 millions de Brésiliens. Ces personnes ont donc intégré les classes moyennes. Mais le PT n’a plus eu de discours à leur égard. Il s’en est désintéressé. Abandonnés à eux-mêmes, ces ex-pauvres ont fini par tourner le dos à la gauche… Et nombre d’entre eux ont même voté pour Bolsonaro…
Crédits photo : © Clément Tissot pour LVSL