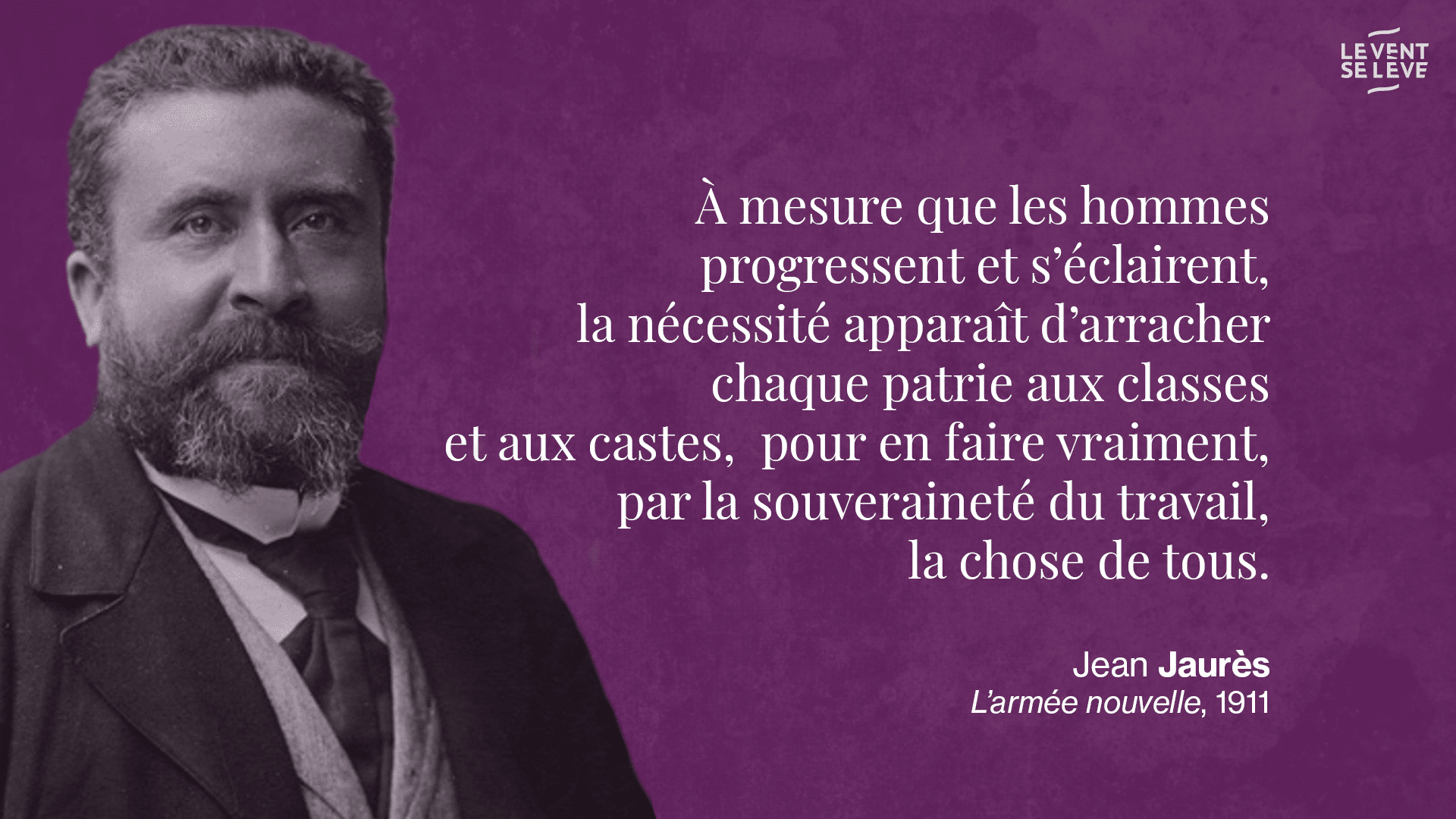Qu’est-ce qui fonde la patrie ? Réfutant tout à la fois les points de vue de ceux qui prétendent l’abolir et de ceux qui l’abaissent en tentant de se l’approprier, Jean Jaurès consacre quelques-unes de ses plus belles lignes à l’idée de patrie. Dans sa collection « Les grands textes », LVSL vous propose de découvrir ces extraits choisis tirés du dixième chapitre de L’armée nouvelle, ouvrage de Jean Jaurès paru en 1911, trois ans seulement avant sa mort.
L’apparente crise de l’idée de patrie est une crise de croissance. Anatole France se trompe quand, dans l’introduction à la Vie de Jeanne d’Arc, il appuie la patrie sur la propriété foncière, quand il croit qu’elle n’a de sens et de valeur que pour ceux qui possèdent le sol. L’histoire des patries déborde en tous sens cette définition étroite (…) Il serait enfantin d’imaginer que les prolétaires, les ouvriers des faubourgs ou des sombres rues du centre de Paris, quand ils se passionnaient pour la Révolution, quand ils donnaient leur sang pour elle, étaient conduits par l’appât de quelques miettes de terre qui, un jour peut-être seraient distribuées aux vétérans de la patrie, ou même par l’espérance définie d’une participation précise à une forme quelconque de la propriété. Ils allaient vers l’avenir sans lui demander, si j’ose dire, des engagements formels. Ils savaient bien que leur action aurait un jour des effets sociaux, et tout de suite ils trouvaient une noble joie dans cette action même. La Révolution leur donnait d’emblée mieux qu’un titre de propriété, mieux qu’un bon à valoir sur le domaine public, immobilier ou mobilier. Elle leur donnait la conscience de leur dignité et de leur force, et de vastes possibilités d’action qu’aurait, dans la pleine démocratie, le travail robuste et fier.
Ainsi la patrie n’a pas pour fondement des catégories économiques exclusives, elle n’est pas enfermée dans le cadre étroit d’une propriété de classe. Elle a bien plus de profondeur organique et bien plus de hauteur idéale. Elle tient par ses racines au fond même de la vie humaine et, si l’on peut dire, à la physiologie de l’homme. Les individus humains ont toujours été capables de rapports plus étendus que les rapports de descendance et de consanguinité, qui sont la base plus ou moins large de la famille. Mais les conditions mêmes de la vie sur la planète ont rendu impossible jusqu’ici la formation d’une société unique. La terre a été longtemps plus grande que l’homme, et elle a imposé à l’humanité la loi des dispersions. C’est par groupes multiples, séparés, défiants, souvent ennemis, que la race humaine a dû tout d’abord se constituer.
Les patries, les groupements distincts ont été la condition des groupements plus vastes que prépare l’évolution. Et en chacun de ces groupes une vie commune s’est développée qui garantissait et amplifiait la vie de tous et de chacun ; une conscience collective s’est formée en qui les consciences individuelles étaient unies et exaltées. Même pour les exploités, même pour les asservis, le groupement humain où ils avaient du moins une place définie, quelques heures de sommeil tranquille sur la marche la plus basse du palais, valait mieux que le monde du dehors, plein d’une hostilité absolue et d’une insécurité totale.
Pour l’esclave aussi le dur foyer qu’alimentait sa peine avait parfois un reflet réchauffant, une lueur joyeuse, et les ténèbres extérieures l’épouvantaient. L’esclave, dit le grand Homère, n’a que la moitié de son âme, mais cette moitié même il risquait de la perdre en se séparant du milieu social où il avait du moins un abri et quelques liens d’affection réciproque.
À l’intérieur d’un même groupement régi par les mêmes institutions, exerçant contre les groupements voisins une action commune, il y a forcément entre les individus, même des classes les plus opposées ou des castes les plus distantes, un fond indivisible d’impressions, d’images, de souvenirs, d’émotions. L’âme individuelle soupçonne à peine tout ce qui entre en elle de vie sociale, par les oreilles et par les yeux, par les habitudes collectives, par la communauté du langage, du travail et des fêtes, par les tours de pensée et de passion communs à tous les individus d’un même groupe que les influences multiples de la nature et de l’histoire, du climat, de la religion, de la guerre, de l’art, ont longuement façonné. Même pour se railler, même pour s’outrager, deux individus de classes hostiles, en un même pays, sont obligés de faire appel à des ressources communes. De cette présence en chacun de toute une vie collective, résulte, pour toutes les consciences individuelles, un étrange agrandissement. La multiplication de l’âme individuelle par l’âme de tous se révèle parfois en des manifestations superficielles et naïves (…).
C’est le mystère, c’est le prodige des âmes individuelles qu’elles soient à la fois impénétrables et ouvertes. Tout le groupe historique dont elles font partie, dont elles sont solidaires, les affecte sans cesse et les émeut, souvent à leur insu. C’est seulement dans les grandes crises, quand un grand événement remue toute la profondeur et toute l’étendue d’un groupe humain, que cette solidarité se révèle pleinement à elle-même.
Mais les formidables crises de passion collective seraient impossibles si un fond inaperçu d‘impressions communes ne s’était pas formé, dans la familiarité des jours, au fond de toutes les consciences. Quand, au sortir de la représentation des Perses, les Athéniens, tout enivrés de la grande poésie d’Eschyle et comme transportés d’une divine fureur de patriotisme guerrier, faisaient résonner au rythme de leurs lances les boucliers d’or attachés au temple de l’Athènes protectrice, ce n’était pas, quelle que fût la puissance de l’artiste créateur, une magnifique improvisation d’âme. Les Athéniens qui, tout à l’heure, étaient entrés au théâtre en échangeant sans doute des propos légers, portaient en eux, à ce moment même, à un degré qu’ils ne supposaient pas, toutes les forces accumulées de la patrie. Soudain, elles se déchaînaient en eux comme une surprise, mais c’est de toutes ces sources familières et profondes que le torrent avait jailli.
Forces à demi instinctives et par là même immenses à la fois et redoutables. Elles sont prodigieusement efficaces, car elles prennent l’être humain par une action insensible et de tous les jours ; elles se confondent pour ainsi dire avec les habitudes organiques elles-mêmes, avec la façon de parler, de regarder, de marcher, de sourire, de penser, avec les innombrables souvenirs, joyeux ou douloureux, par lesquels la vie de chacun, dans un groupe humain à la fois défini et vaste, se mêle à la vie de tous. Aussi, à certaines heures de plénitude exaltée, elles peuvent donner aux âmes des émotions de douleur et de joie qui dépassent à l’infini tout ce que la conscience isolée pourrait se promettre d’elle-même. C’est donc l’apprentissage de la vie collective et de la grande sensibilité humaine, non pas dans l’abstrait d’une humanité qui ne fut longtemps qu’à l’état de rêve et d’incertaine préparation, mais dans la réalité substantielle et historique d’un groupe humain ample et riche de vie, mais assez déterminé, concret et saisissable pour que le haut élan de l’esprit ait une base de nature.
Oui, forces grandioses et bonnes, mais aussi pleines de péril et pleines de troubles. D’abord une association d’idées se produit trop souvent entre la patrie et les formes sociales sous lesquelles longtemps elle se développa. Souvent, dans l’histoire, les oligarchies, les monarchies, les privilèges politiques et sociaux de tout ordre ont cru, ou affecté de croire, que l’intérêt de la patrie se confondait avec leur intérêt. Même à l’heure ou la monarchie et l’aristocratie françaises trahissaient la nation et faisaient appel à l’étranger, elles étaient convaincues que la France était en elles, que sans elles la patrie ne pouvait que se dissoudre et tomber dans le chaos. Les forces instinctives d’habitude, de tradition, de solidarité brute qui concourent à la formation de la patrie, et qui en sont peut-être la racine physiologique, deviennent ainsi des forces de résistance et de réaction. Et c’est d’un grand effort que les révolutionnaires, les novateurs, les hommes d’un droit supérieur doivent dégager de la patrie ancienne une patrie nouvelle et supérieure (…).
À mesure que les hommes progressent et s’éclairent, la nécessité apparaît d’arracher chaque patrie aux classes et aux castes, pour en faire vraiment, par la souveraineté du travail, la chose de tous. La nécessité apparaît aussi d’abolir dans l’ordre international l‘état de nature, de soumettre les nations dans leurs rapports réciproques à des règles de droit sanctionnées par le consentement actif de tous les peuples civilisés.
Quand on dit que la révolution sociale et internationale supprime les patries, que veut-on dire ? Prétend-on que la transformation d’une société doit s’accomplir de dehors et par une violence extérieure ? Ce serait la négation de toute la pensée socialiste, qui affirme qu’une société nouvelle ne peut surgir que si les éléments en ont été déjà préparés dans la société présente. Dès lors, l’action révolutionnaire, internationale, universelle, portera nécessairement la marque de toutes les réalités nationales. Elle aura à combattre dans chaque pays des difficultés particulières, elle aura en chaque pays, pour combattre ces difficultés, des ressources particulières, les forces propres de l’histoire nationale, du génie national. L’heure est passée où les utopistes considéraient le communisme comme une plante artificielle qu’on pouvait faire fleurir à volonté, sous un climat choisi par un chef de secte. Il n’y a plus d’Icaries. Le socialisme ne se sépare plus de la vie, il ne se sépare plus de la nation. Il ne déserte pas la patrie ; il se sert de la patrie elle-même pour la transformer et pour l’agrandir. L’internationalisme abstrait et anarchisant qui ferait fi des conditions de lutte, d’action, d’évolution de chaque groupement historique ne serait qu’une Icarie, plus factice encore que l’autre et plus démodée.
Il n’y a que trois manières d’échapper à la patrie, à la loi des patries. Ou bien il faut dissoudre chaque groupement historique en groupements minuscules, sans lien entre eux, sans ressouvenir et sans idée d’unité. Ce serait une réaction inepte et impossible, à laquelle, d’ailleurs, aucun révolutionnaire n’a songé (…). Ou bien il faut réaliser l’unité humaine par la subordination de toutes les patries à une seule. Ce serait un césarisme monstrueux, un impérialisme effroyable et oppresseur dont le rêve même ne peut pas effleurer l’esprit moderne.
Ce n’est donc que par la libre fédération de nations autonomes répudiant les entreprises de la force et se soumettant à des règles de droit, que peut être réalisée l’unité humaine. Mais alors ce n’est pas la suppression des patries, c’en est l’ennoblissement. Elles sont élevées à l’humanité sans rien perdre de leur indépendance, de leur originalité, de la liberté de leur génie. Quand un syndicaliste révolutionnaire s’écrie au récent congrès de Toulouse : « À bas les patries ! Vive la patrie universelle ! », il n’appelle pas de ses vœux la disparition, l’extinction des patries dans une médiocrité immense, où les caractères et les esprits perdraient leur relief et leur couleur. Encore moins appelle-t-il de ses vœux l’absorption des patries dans une énorme servitude, la domestication de toutes les patries par la patrie la plus brutale, et l’unification humaine par l’unité d’un militarisme colossal. En criant : « À bas les patries ! », il crie : « À bas l’égoïsme et l’antagonisme des patries ! À bas les préjugés chauvins et les haines aveugles ! À bas les guerres fratricides ! À bas les patries d’oppression et de destruction ! » Il appelle à plein cœur l’universelle patrie des travailleurs libres, des nations indépendantes et amies (…).
Nous prenons à témoin la patrie elle-même dans sa continuité et dans son unité. L’unité sera plus forte quand, à la lutte des classes dans chaque patrie, sera substituée l’harmonie sociale, quand la propriété collective servira de fondement à la conscience commune. La continuité sera plus profonde quand tous les efforts du passé aboutiront à l’universelle libération, quand tous les germes d’égalité et de justice s’épanouiront en une magnifique floraison humaine, quand le sens vivant de l’histoire de la patrie se révélera à tous par un accomplissement de justice, quand les œuvres les plus fines et les plus hautes du génie seront enfin, dans la culture individuelle et la culture sociale agrandies, l’orgueil et la joie de toutes les intelligences. Par là, la patrie sera le miroir vivant où toutes les conscience pourront se reconnaître. Par là, les prolétaires qui n’eurent au cours des temps qu’une possession partielle et trouble de la patrie en auront enfin la possession pleine et lumineuse. Elle sera bien à eux, même dans le passé, puisque par leur effort suprême tout le travail des siècles aura abouti à leur exaltation dans la justice.
Dès aujourd’hui, parce qu’ils peuvent lutter dans la patrie pour la transformer selon une idée plus haute, ils ne sont pas extérieurs à la patrie. Ils sont en elle parce qu’ils agissent sur elle ; parce que l’indépendance des nations, comme nations, abrite l’effort socialiste international ; parce que la démocratie forme des nations modernes, seconde l’action des salariés ; parce qu’ils ne peuvent vaincre qu’en s’appropriant, en chaque pays, les plus hautes qualités d’esprit et d’âme, et l’essence même du génie de la nation ; parce que l’humanité nouvelle ne sera riche et vivante que si l’originalité de chaque peuple se prolonge dans l’harmonie totale, et si toutes les patries vibrent à la lyre humaine.
Ainsi les patries en leur mouvement magnifique de la nature à l’esprit, de la force à la justice, de la compétition à l’amitié, de la guerre à la fédération, ont à la fois toute la force organique de l’instinct et toute la puissance de l’idée. Et la classe prolétarienne est plus que toute autre classe dans la patrie, parce puisqu’elle est dans le sens du mouvement ascendant de la patrie. Quand elle la maudit, quand elle croit la maudire, elle ne maudit que les misères qui la déshonorent, les injustices qui la divisent, les haines qui l’affolent, les mensonges qui l’exploitent, et cette apparente malédiction n’est qu’un appel à la patrie nouvelle, qui ne peut se développer que par l’autonomie des nations, l’essor des démocraties et l’application à de nouveaux problèmes de toute la force des génies nationaux, c’est-à-dire par la communauté de l’idée de patrie jusque dans l’humanité.
Voilà pourquoi, en tous ses congrès, l’Internationale ouvrière et socialiste rappelle aux prolétaires de tous les pays le double devoir indivisible de maintenir la paix, par tous les moyens dont ils disposent, et de sauvegarder l’indépendance de toutes les nations. Oui, maintenir la paix par tous les moyens d’action du prolétariat, même par la grève générale internationale, même par la révolution. (…)
Arracher les patries aux maquignons de la patrie, aux castes de militarisme et aux bandes de finance, permettre à toutes les nations le développement indéfini de la démocratie et de la paix, ce n’est pas seulement servir l’Internationale et le prolétariat universel, par qui l’humanité à peine ébauchée se réalisera, c’est servir la patrie elle-même. Internationale et patrie sont désormais liées. C’est dans l’Internationale que l’indépendance des nations a sa plus haute garantie ; c’est dans les nations indépendantes que l’Internationale a ses organes les plus puissants et les plus nobles. On pourrait presque dire : un peu d’internationalisme éloigne de la patrie ; beaucoup d’internationalisme y ramène. Un peu de patriotisme éloigne de l’Internationale ; beaucoup de patriotisme y ramène.