Dans le discours de nombreux responsables politiques, l’égalité des chances est souvent décrite comme une panacée, et la méritocratie, érigée en idéal. La droite en célèbre les vertus, et la gauche en dénonce l’imparfaite réalisation, mais le consensus sur son bien-fondé et sa valeur intrinsèque est rarement remis en cause. Pourtant, derrière ces discours lénifiants sur l’idéal républicain méritocratique, se cache avant tout une illusion dangereuse et une machine idéologique redoutable de justification de l’ordre social.
Le sophisme méritocratique
On entend parfois, dans le débat public, des “purs produits de la méritocratie républicaine”, comme ils se qualifient eux-mêmes, chanter les louanges du système social qui les a vu réussir, et se donner en exemple à qui voudrait nier que “quand on veut, on peut” – ce qui leur permet également de s’auto-gratifier au passage du titre flatteur de “self-made man”. Bien sûr, on trouve toujours des exceptions, mais elles ne sont que l’arbre méritocratique qui cache la forêt inégalitaire : ce n’est pas parce que quelques heureux élus, dont l’origine sociale ne les y prédestinait pas, finissent chef d’entreprise ou personnalité en vue, que les conditions sociales ne déterminent pas dans une large mesure le destin des individus.
Certes, il y aura toujours des pseudo-intellectuels pour propager ce grossier sophisme, tels ces “sociologues” dont se gaussait Bourdieu, et qui consacrèrent beaucoup d’énergie à montrer que tous les fils de polytechniciens ne devenaient pas polytechniciens – et que décidément, on exagère beaucoup les déterminismes sociaux –, mais les chiffres sont têtus. À l’école Polytechnique, justement, 64 % des élèves ont un père qui appartient à la catégorie socioprofessionnelle des “cadres ou professions intellectuelles supérieures” (CPIS), tandis qu’à peine 1 % des élèves ont un père ouvrier (alors même que dans la population active, on compte 14 % de CPIS, contre 22 % d’ouvriers). Peut-on, dès lors, qualifier notre société de “méritocratique” ?

Sous sa forme la plus fruste, l’idéal méritocratique hérité des Lumières considère que dans les sociétés démocratiques modernes, où l’égalité des droits a enfin remplacé les privilèges héréditaires, les individus sont justement récompensés de leurs efforts, “selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents”, d’après la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Pourtant, l’égalité de droit – déjà dénoncée par Marx comme un paravent servant à masquer les inégalités réelles – ne suffit pas à assurer une compétition équitable entre les individus, comme les recherches sociologiques du siècle dernier, mais aussi le simple bon sens, nous l’enseignent.
L’école est l’exemple paradigmatique de ce hiatus entre égalité proclamée et inégalités de fait. Elle est aujourd’hui le lieu où se déterminent dans une large mesure les choix d’études, les perspectives de carrière et la position sociale future des uns et des autres – en bref, leur avenir. Or, point n’est besoin d’être grand clerc pour comprendre qu’entre un enfant d’immigrés, dont les parents ne maîtrisent pas assez bien le français pour pouvoir l’aider dans ses devoirs, et un enfant de professeurs d’université, les chances de réussite à l’école ne sont pas les mêmes, et ce à cause de facteurs étrangers à leurs volontés individuelles.
Énumérons donc les divers facteurs susceptibles de jouer un rôle dans la réussite scolaire, afin de donner une idée du poids des déterminismes sociaux qui sont à l’œuvre. Certains d’entre eux peuvent paraître évidents : la situation économique et familiale de l’enfant, ses conditions de travail à la maison, le niveau de ses camarades de classe (“l’effet de pairs”), l’expérience et les compétences de ses professeurs (du fait de leur mode de recrutement, ce sont souvent de jeunes professeurs inexpérimentés qui enseignent dans les ZEP)… D’autres le sont moins : on peut évoquer le poids des stéréotypes qui contribuent à créer la réalité qu’ils sont censés refléter (“l’effet Pygmalion”), les choix d’orientation plus stratégiques des familles de classes moyennes ou aisées, et bien sûr ce que Bourdieu appelle le “capital culturel”1.
En cumulant tous ces éléments, on comprend pourquoi la réussite scolaire est avant tout tributaire d’un ensemble de conditions sociales favorables. En tout cas, aujourd’hui, l’attribuer au seul mérite relève au mieux de l’ignorance, et plus vraisemblablement de la mauvaise foi.
Mais surtout, en plus de reproduire les inégalités, l’école transforme “ceux qui héritent” en “ceux qui méritent”, comme l’écrivent les sociologues Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron dans La Reproduction. Tandis que les plus doués reçoivent l’onction du diplôme consacrant leur “mérite” indubitable, ceux qui échouent sont renvoyés à leur médiocrité individuelle et la responsabilité de leur échec leur est imputée. L’institution scolaire entretient le mythe d’une évaluation et d’une sélection justes des élèves, dues à leur seul mérite, alors même que les conditions d’apprentissage sont à l’évidence inéquitables.
« L’école transforme ceux qui héritent en ceux qui méritent »
La méritocratie apparaît dès lors – pour reprendre un néologisme forgé par le sociologue allemand Max Weber – bien plus comme une “sociodicée”2, c’est-à-dire un discours de justification de l’ordre social, que comme une réalité tangible.
D’ailleurs, comme le fait remarquer le sociologue François Dubet, ce que l’on appelle l’égalité des chances méritocratique se réduit en fait, dans notre société, à quelques dispositifs permettant à une infime minorité de jeunes défavorisés de rejoindre l’élite. On se focalise, dans le débat public, sur les conventions entre Sciences Po et des lycées de ZEP, ou sur l’objectif d’atteindre 30% de boursiers en classes préparatoires. On s’émerveille de même des internats d’excellence, créés sous Nicolas Sarkozy et permettant à quelques jeunes d’origine populaire d’échapper à leur destin… Mais cela ne concerne que quelques milliers de jeunes, alors que 150 000 élèves quittent chaque année l’école sans le moindre diplôme. La méritocratie permettrait dès lors simplement de sélectionner les meilleurs éléments des “classes inférieures” pour qu’ils rejoignent l’élite et légitiment son maintien, selon un mécanisme qui n’est pas sans rappeler les théories de Vilfredo Pareto sur la circulation des élites, chères aux idéologues de la Nouvelle droite.

La compétition méritocratique
Il faut par ailleurs souligner que les défenseurs les plus acharnés de la rétribution au mérite – qui sont, sans surprise, ceux qui y trouvent leur compte, c’est-à-dire les plus riches – ont souvent des pratiques qui sont en contradiction flagrante avec leurs discours, comme le montrent les sociologues Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon. Peut-on sérieusement prôner l’égalité des chances et se payer de belles paroles sur la méritocratie lorsque l’on envoie ses enfants dans des lycées privés ultra “sélect” et qu’on leur paie des professeurs particuliers ? La contradiction n’apparaît pas gênante à bien des représentants de l’élite économique, qui persistent à invoquer sempiternellement ces généreux principes, censés leur conférer une légitimité indiscutable.
Mais ces stratégies “égoïstes” sont imputables au mécanisme même de la méritocratie, comme le montre encore une fois François Dubet : “Les familles et les élèves, acceptant que tout le destin des individus se joue à l’école, développent des conduites compétitives et instrumentales (choix judicieux des établissements et des filières…), afin de creuser les petites différences scolaires qui font les grandes différences sociales. Comment imaginer que les catégories sociales qui ont aujourd’hui le quasi monopole de l’accès aux filières d’élite aient la courtoisie de laisser la place aux challengers sans se défendre en renforçant la sélectivité scolaire ?”3
En fait, la méritocratie semble être une idéologie intrinsèquement viciée, parce qu’elle repose sur la fiction qu’il est possible de faire abstraction des conditions sociales et de “calculer” le mérite des uns et des autres de façon relativement probante, et de les hiérarchiser sur la base de ce critère. Or ce présupposé apparaît, à la lumière d’une littérature sociologique bien documentée, hautement problématique, pour ne pas dire complètement aberrant. Et ce n’est pas quelques dispositifs correctifs, censés remédier aux inégalités de départ entre les individus, comme les ZEP par exemple, qui vont y changer quelque chose.
Pourquoi persiste-t-on, alors, à parler de mérite, quand sa mesure apparaît si difficile ? Comme le fait observer la sociologue Marie Duru-Bellat dans son ouvrage Le mérite contre la justice (2009), une ambiguïté terminologique bien pratique explique peut-être le succès du terme de “mérite”, terme qui recouvre en fait deux acceptions bien distinctes. Le mérite, en effet, peut être compris comme une caractéristique morale : on mérite quelque chose car on a fait des efforts pour l’obtenir. Mais il peut également être entendu comme la récompense d’une réussite mesurée de façon objective, sans prendre en compte les efforts fournis : on obtient quelque chose grâce à ses talents ou ses compétences.
Cette polysémie du mérite était déjà inscrite en filigrane dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, lorsque “vertus” et “talents” étaient mis en parallèle. Doit-on récompenser les citoyens en fonction de leurs “vertus” (ce qui renverrait au mérite moral des individus) ou selon leurs “talents” ? Contrairement à ce que les révolutionnaires semblaient suggérer, ce n’est pas du tout la même chose. En effet, il peut arriver que ceux qui doivent fournir le plus d’efforts ne soient pas ceux qui réussissent le mieux : il n’y a souvent pas de correspondance exacte, et peut-être même qu’un lien très lâche, entre efforts et résultats.
Comme principe de justice sociale, il paraît difficile de défendre la méritocratie au second sens, c’est-à-dire la méritocratie des “talents”. Celle-ci se confondrait d’ailleurs avec “l’aristocratie”, au sens littéral du terme : le gouvernement des meilleurs. Dans le discours dominant, c’est donc plutôt le mérite moral qui est censé déterminer la part qui revient à chacun. Cela n’est pourtant qu’une mystification de plus : que l’on prenne la quantité de travail ou encore les efforts fournis, il est évident que tel n’est pas, actuellement, le critère principal déterminant sa rétribution. Au contraire, on prend souvent comme mesure adéquate du “mérite” d’un individu sa réussite scolaire, alors même qu’elle n’est pas entièrement – loin de là – imputable à ses efforts, et comme si elle suffisait à décider de ce qu’il pourra mériter tout au long de sa vie !
De fait, quelqu’un qui a eu le “mérite” – ou plutôt la « chance », aux deux sens du terme – de faire des études sera toujours favorisé par rapport à celui qui n’en a pas faites, et peu importe, ensuite, la difficulté effective du métier qu’exerce chacun d’entre eux.
Comme le note le sociologue Louis Chauvel, directeur de l’Observatoire des inégalités : “Si l’on prend l’exemple des médecins et des aides-soignants, comment expliquer que l’immense majorité du mérite ne revienne – si on en juge par les salaires – qu’aux premiers ? Pourquoi les métiers les plus difficiles physiquement, ceux qui usent le corps en profondeur, qui réduisent l’espérance de vie, sont-ils les moins rémunérés dans notre société ?”. Il ne s’agit pas de faire une hiérarchie de difficulté ou de pénibilité des métiers, mais de ne pas oublier qu’une caissière a un travail probablement plus éreintant qu’un cadre, et que leurs salaires sont pourtant sans commune mesure4. Bref, il faut voir à quel point les déterminations des salaires obéissent à d’autres logiques que celle du “mérite” entendu au sens moral.
« Pourquoi les métiers les plus difficiles physiquement, ceux qui usent le corps en profondeur, qui réduisent l’espérance de vie, sont-ils les moins rémunérés dans notre société ? »
Mais en plus d’être un mensonge, la méritocratie est aussi un fléau. En effet, en établissant un lien entre la “valeur” d’une personne (encore une fois, on retrouve l’ambiguïté terminologique) et l’attribution d’une position sociale, la méritocratie apparaît comme un principe de classement – classement dont on a vu le caractère arbitraire, mais qui est peut-être aussi par lui-même problématique. De fait, encenser la méritocratie, c’est aussi promouvoir une société ou les individus sont d’emblée mis en concurrence, et où l’ascension des uns est corollaire du déclassement des autres. Une ascension ou un déclassement “mérités” : alors que la plupart des riches considèrent leur rétribution comme juste, la pauvreté est à l’inverse souvent représentée et ressentie comme la conséquence d’un démérite moral individuel5.
Abolir la méritocratie ?
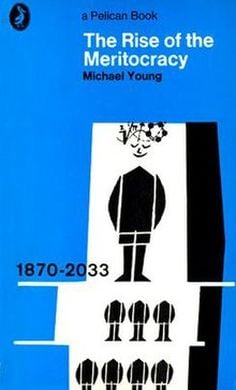
L’inventeur du terme même de “méritocratie”, Michael Young, sociologue britannique et “intellectuel organique” du parti travailliste, avait d’ailleurs été le premier étonné de la connotation positive bientôt associée à son néologisme dans le débat public. La méritocratie, dans son roman The Rise of the Meritocracy (1958) apparaissait de fait comme une forme de dystopie particulièrement perverse où les “non-méritants” étaient renvoyés à leur échec individuel, tandis que les “méritants” s’arrogeaient tous les droits en invoquant le critère suprême, le mérite. Une telle société, dans laquelle le mérite des uns s’oppose à la responsabilité des autres, pourrait bien se révéler une forme euphémisée de darwinisme social, comme le défend le philosophe israélien Khen Lampert dans Meritocratic Education and Social Worthlessness (2012).
Que faire, alors, du mérite, entendu comme principe de justice sociale ? Pour beaucoup, il paraît impensable de cesser de prendre en compte ce critère, tout imparfait qu’il soit, parce qu’aucun autre n’est véritablement satisfaisant. Mais cet argument boiteux du “moindre mal” ne doit pas nous dispenser de nous rendre compte de la faiblesse, voire de la vacuité, de la notion de mérite. Au lieu de s’efforcer de hiérarchiser les individus en fonction de leur hypothétique “mérite”, ne pourrait-on pas plutôt réfléchir à l’application du bon vieux principe “à chacun selon ses besoins” ? On peut bien rêver, pour une fois…
Pour conclure de façon plus pragmatique, évoquons les arguments de François Dubet en faveur de la primauté de la lutte contre les inégalités sur les politiques d’égalité des chances. Dans Les places et les chances (2010), Dubet montre que l’idéal d’égalité des chances s’est, au cours des dernières décennies, progressivement substitué à celui d’égalité des places – qu’on appelle parfois “égalité des conditions”, c’est-à-dire une situation où les différents individus d’une société jouissent de conditions de vie relativement similaires.
Cet idéal d’égalité des chances vise à établir les conditions d’une compétition équitable entre les individus, afin que chacun puisse accéder – en fonction de son “mérite” – à l’ensemble des positions sociales, mais n’a pas vocation, en revanche, à réduire les inégalités des conditions ou à changer la structure sociale dans le sens d’une plus grande égalité. Dès lors, si tout le monde – même un fils d’ouvrier – peut devenir cadre, les écarts de rémunération entre les cadres et les ouvriers ne sont plus considérés comme un problème.
Pourtant, l’établissement d’une véritable égalité des chances semble en fait nécessairement subordonné à la réalisation d’une relative “égalité des places”, ou des conditions : favoriser l’égalité des places, de ce fait, est “sans doute la meilleure des manières de réaliser l’égalité des chances”.
Dubet conclut en montrant que si l’égalité des places paraît bien favoriser l’égalité des chances, à l’inverse, dès que l’on se met à privilégier l’égalité des chances, les inégalités des places se creusent. Il semble toucher là un paradoxe peut-être insurmontable de l’égalité des chances, qui ne peut être pleinement mise en place qu’en assurant une égalité préalable des places, et qui pourtant détruit en permanence cette égalité des places, rendant toujours plus difficile son propre accomplissement – dans un cercle vicieux de renforcement des inégalités et de la compétition entre les individus, dont la sombre réalité contraste singulièrement avec l’imaginaire radieux d’ordinaire associé à la notion de méritocratie…
1. “L’effet de pairs” peut être constaté au travers des enquêtes PISA : la différence de performance à ces tests entre deux groupes d’élèves d’origine sociale similaire, mais dont l’un d’eux est dans un établissement scolaire dont la composition sociale est moyenne, et l’autre dans un établissement scolaire à public privilégié (c’est-à-dire les 10% des établissements scolaires dont la composition sociale est la plus favorisée), représente l’équivalent d’une année scolaire supplémentaire.
Pour l’effet des attentes des professeurs sur les résultats des élèves, voir l’article de Robert Rosenthal et Lenore Jacobson, “Pygmalion à l’école” (1968). Les auteurs ont mené une expérience dans laquelle ils ont fait passer des tests de QI fictifs à des élèves à la fin de l’année scolaire, attribué les notes aléatoirement, et se sont arrangés pour que les professeurs de l’année suivante aient connaissance des résultats. À la fin de l’année suivante, les élèves qui avaient été (arbitrairement) désignés comme “supérieurement intelligents” avaient plus progressé que la moyenne.
Pour l’effet de l’origine sociale sur les choix d’orientation, voir l’ouvrage de Raymond Boudon L’inégalité des chances (1973). Voir également l’ouvrage d’Agnès Van Zanten, Choisir son école (2009), pour une étude des stratégies de choix d’établissement des classes moyennes, ainsi que celui de Pierre Merle, La ségrégation scolaire (2012), pour une analyse de la logique ségrégative à l’œuvre dans le système éducatif français.
Pour l’effet du “capital culturel”, voir les analyses désormais classiques de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron dans Les Héritiers (1964) et La Reproduction (1970). D’après Bourdieu et Passeron, les professeurs valorisent des compétences acquises en-dehors de l’école – c’est-à-dire principalement dans la famille –, comme une certaine familiarité avec la culture savante, et à l’inverse, reprochent paradoxalement aux élèves n’ayant pas cette familiarité d’être “trop scolaires”. L’école “apprend aux poissons à nager”.
Voir encore : Basil Bernstein, qui dans Langage et classes sociales (1971) montre que le langage des classes supérieures, caractérisé par une grammaire souple et un souci permanent d’explicitation, est mieux adapté à l’institution scolaire que celui des classes populaires, fondé sur un usage stéréotypé de la grammaire et un recours fréquent à l’implicite.
2. Le concept de “sociodicée” est forgé sur le modèle de “théodicée”, néologisme dû quant à lui à Leibniz, et qui désigne la justification de la bonté de Dieu, malgré le mal que l’on observe dans le monde. Il est intéressant de remarquer que, comme l’explique Pierre Rosanvallon dans une conférence, la notion de mérite elle-même a une origine théologique : “elle s’est développée sur une base théologique pour imposer la vision catholique du salut (par le mérite des œuvres) et critiquer la notion protestante de grâce divine (salut par la seule foi)”. Le mérite est donc à l’origine ce par quoi Dieu récompense les bons, et punit les méchants. “On n’a que ce que l’on mérite”, tel est le mensonge qui, auparavant propagé par l’Église, l’est maintenant par les grands prêtres de la société méritocratique, prompts à condamner les “paresseux” ou les “incapables”, et à encenser les “méritants”. Luc Boltanski et Pierre Bourdieu, dans leur article sur “La production de l’idéologie dominante” (1976) relèvent également ce parallèle : “la “pauvreté” qui, en un autre temps, eût été la juste sanction du vice, était devenue […] la sanction inévitable de l’incompétence (pour ne pas dire de la sottise)”.
3. L’école est en effet aujourd’hui non seulement le lieu de transmission d’un savoir, de l’éducation citoyenne et de l’épanouissement intellectuel, mais aussi – et surtout, de plus en plus – le lieu d’une compétition : d’après les tests PISA, la France est le pays, parmi les pays développés, où les élèves ont le rapport le plus anxiogène à l’école. Joanie Cayouette-Remblière, dans L’école qui classe (2016), montre ainsi comment l’école transmet une idéologie méritocratique “individualisante et responsabilisante” qui conduit les élèves des classes populaires à se sentir responsables de leur échec et à mépriser les emplois qu’un grand nombre d’entre eux exerceront. Voir également l’excellent ouvrage de Dominique Girardot, La société du mérite (2011), pour une étude approfondie du lien entre “idéologie méritocratique et violence néolibérale”, la première conférant d’après elle une “apparence de légitimité” à la seconde.
4. Même le recours à la notion de mérite dans son second sens (donc de compétence, ou de performance) pour justifier des écarts de rémunération parfois abyssaux paraît souvent fallacieux : comment peut-on réellement “valoir” cent fois plus que quelqu’un ? (Ou plus exactement 498 fois plus : Jean-François Kahn a calculé qu’un chef de grande entreprise côtée au CAC 40 gagne en moyenne 498 Smic annuels). En réalité, la rémunération de la plupart des gens n’est en rien le reflet de leur productivité, comme l’explique l’économiste hétérodoxe Ha-Joon Chang dans Deux ou trois choses que l’on ne vous dit jamais sur le capitalisme (2010). Voir également l’article de Marianne Bertrand et Sendhil Mullainathan, “Are CEOs rewarded for Luck ? The ones without principals are” (2001), dans lequel les auteurs montrent que la rémunération des cadres dirigeants n’est pas seulement liée à leurs performances objectives, et que les émoluments considérables dont ils bénéficient sont aussi imputables au fait que les conseils d’administration, où l’on décide justement des rémunérations des cadres dirigeants, sont composés principalement d’autres cadres dirigeants, qui se renvoient ainsi la politesse…
5. Dans Une théorie empirique de la justice sociale (2010), Michel Forsé et Maxime Parodi montrent que parmi les plus aisés, la part de ceux qui estiment être trop rémunérés par rapport à leur mérite est résiduelle. Serge Paugam, dans La disqualification sociale (1994), montre à l’inverse que les pauvres eux-mêmes présentent souvent la pauvreté sur le registre du mérite moral individuel – et non comme un problème de la société dans son ensemble.
Addendum : au moment de la rédaction de cet article, son auteur ne connaissait pas le livre très récemment paru de David Guilbaud, L’Illusion méritocratique (2018). Néanmoins, après l’avoir lu, il ne peut que recommander cet ouvrage extrêmement éclairant et convaincant, qui, présentant des thèses similaires à celles défendues ici, propose également des pistes de réforme pour remédier à ce fléau destructeur qu’est l’idéologie méritocratique.









