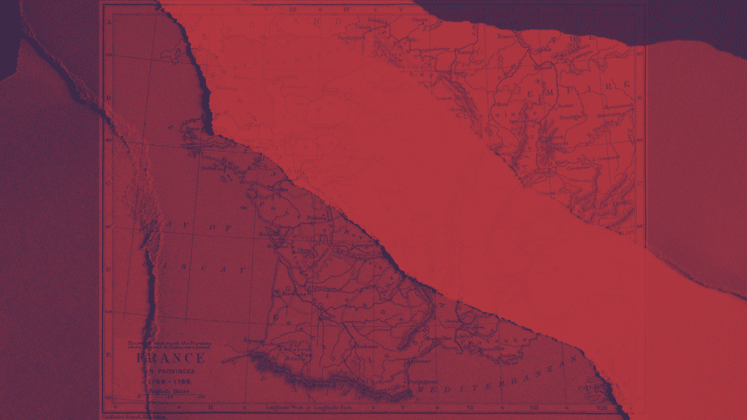La période actuelle semble devoir marquer une profonde mutation de la Ve République, pour le meilleur mais aussi pour le pire. Si l’absence de majorité aux ordres nous rappelle que nous sommes dans un vrai régime parlementaire, l’épisode actuel démontre aussi de vraies failles dans notre édifice constitutionnel. Par Benjamin Morel, professeur de droit public.
La Ve République est un vrai régime parlementaire. Nous l’avons oublié, et pourtant, le texte constitutionnel ne saurait être plus clair sur ce point. Le gouvernement est responsable devant le Parlement. Le Président dispose certes de pouvoirs importants, mais ce sont des pouvoirs d’exception. Dire que le Président est fort parce qu’il peut déclencher l’article 16 (pleins pouvoirs), l’article 12 (dissoudre l’Assemblée nationale) ou utiliser le feu nucléaire relève du sophisme. Ces pouvoirs sont rarement utilisés, et c’est heureux. Le Président est le chef des armées et il nomme le Premier ministre, c’est vrai. Le Roi des Belges aussi. Dans la Constitution de la Ve République, c’est le Premier ministre qui dispose du pouvoir réglementaire et des forces armées ; sous l’empire des lois de 1875, il s’agissait du Président. En droit donc, pour les affaires courantes du pays, le Président de la Ve République a moins de prise que son homologue de la IIIe.
Emmanuel Macron, au regard du droit, dispose d’un rôle moins important que Paul Deschanel. Pour autant, en fait, le Président de la République dispose d’un pouvoir bien supérieur à son homologue américain, hors période de cohabitation. Ce dernier doit composer avec les contre-pouvoirs parlementaires et judiciaires dans un régime fédéral. La notion de régime semi-présidentiel est donc absurde. Les présidents portugais, autrichiens ou finlandais sont également élus au suffrage universel direct, mais ils ne disposent pas de plus de pouvoir que leurs homologues italiens ou allemands. Le Président est tout puissant en fait, peu puissant en droit.
Le Président est tout puissant en fait, peu puissant en droit.
D’où vient ce paradoxe ? Nous sommes dans un régime parlementaire, le gouvernement est donc responsable devant le Parlement. Qui contrôle l’Assemblée contrôle Matignon. Or, si le Président contrôle la majorité parlementaire, il concentre autour de lui le pouvoir gouvernemental et le pouvoir parlementaire. Depuis 1962, un phénomène étrange se produit. Les élections législatives suivent, par dissolution ou automatiquement depuis la mise en place du quinquennat, les élections présidentielles. Ces dernières sont marquées par un jeu de mobilisation différentielle : l’électorat de l’opposition, pensant avoir déjà perdu, se démobilise ; celui de la majorité se mobilise. Or, le mode de scrutin majoritaire à deux tours est très sensible à cette mobilisation différentielle. Ce phénomène apporte donc quasi systématiquement au Président nouvellement élu une majorité absolue. Cette dernière lui doit tout, car les députés ont été élus grâce au ricochet de la présidentielle. Si leur champion se présente à nouveau et l’emporte, ils en profiteront à nouveau. Si un autre gagne, alors ils sont sur des sièges éjectables. La majorité est donc non seulement importante, elle est également soumise. Le pouvoir du Président n’est pas prévu par le droit, il est le fruit de l’allégeance inconditionnelle d’une majorité parlementaire.
Cette époque est probablement terminée. En effet, on a trop facilement assimilé le mode de scrutin majoritaire à deux tours à des majorités absolues. Il n’en a jamais produit sous la IIIe République, où il fut presque continuellement appliqué. Il n’en a pas non plus produit en 1959, alors que le système des partis n’avait pas encore pris la forme bipolaire qu’il revêtirait sous la Ve République. Le mode de scrutin majoritaire à deux tours ne produit une majorité absolue qu’en cas de mobilisation différentielle et de forte bipolarisation de la vie politique. La gauche s’est concentrée dans ses fiefs (centre-ville et banlieues), ce qui ne lui permet pas de prendre le pouvoir, mais fait de ces circonscriptions des forteresses. Le centre et la droite dominent l’espace « modéré » dans le périurbain et le rural, où ils se disputent avec un RN dont on voit mal ce qui pourrait provoquer un effondrement. Notre vie politique est donc tripolaire, et l’affaiblissement du front républicain, qui pourrait être amplifié par un gouvernement Barnier tenant sur une non-censure de Marine Le Pen, devrait encore accentuer ce phénomène. Cela serait d’autant plus acté si nous passions à un scrutin proportionnel.
Ce changement politique modifie profondément notre vie publique. Sans majorité, le Président ne peut plus dicter sa loi. Il est cantonné à un rôle d’arbitre ou, au mieux, d’influence. Quand un Président dit, lors de sa campagne, qu’il fera, au hasard, une réforme des retraites, en bon droit il ment. Il n’a même pas le pouvoir de déposer un projet de loi. Son seul contact avec la réforme se fait en bout de course, lorsqu’il promulgue le texte. En faisant une telle promesse, il présuppose qu’il aura une majorité à l’Assemblée. Si demain il sait d’avance qu’il ne pourra en obtenir une, une telle promesse devient absurde, comme elle le serait lors d’une campagne présidentielle portugaise ou autrichienne. Le changement de notre configuration parlementaire transforme donc en profondeur la façon même dont nous concevons le régime.
Toutefois, une telle évolution ne se fait pas sans mal. Car si un Président a été élu en disant qu’il allait faire une réforme des retraites, il se sent légitime à avancer dans cette voie, même si les élections législatives ne lui en donnent pas les moyens. L’usage répété de l’article 49 alinéa 3 lors de la dernière législature et, de façon plus technique, le contournement des conventions parlementaires sont les symptômes de ce présidentialisme qui tente de survivre au changement de système. De même, lorsque le gouvernement utilise sur le même texte l’article 47-1, réservé au PLFSS (Projet de loi de financement de la sécurité sociale), il s’agit d’une manière de contourner une situation de blocage liée à l’impossibilité de tenir des promesses qu’en bon droit, on pourrait juger absurdes de faire. La situation demeurait toutefois gérable si l’on comprend que la Constitution a été pensée par Michel Debré pour permettre à des gouvernements minoritaires de tenir et d’appliquer un programme. En d’autres termes, la Constitution avait été écrite pour gérer une situation parlementaire telle que celle de 2022 à 2024, donnant à un gouvernement répondant au Président les moyens d’appliquer le programme de ce dernier.
La situation se complique lorsque, après la dissolution du 9 juin, le chef de l’État ne dispose plus d’aucune majorité, même relative. Là encore, le présidentialisme tente de survivre. Un chef d’État dans un régime parlementaire classique n’aurait pas nommé Lucie Castets à Matignon. Il aurait reçu Lucie Castets et lui aurait donné 15 jours pour prouver qu’elle pouvait réunir une majorité suffisante pour ne pas être renversée. Il aurait ensuite rencontré les chefs de partis s’engageant dans cette voie, et s’il avait jugé l’option crédible, il l’aurait nommée. À défaut, au bout des 15 jours, il aurait demandé la même chose à un Bernard Cazeneuve, puis à un Xavier Bertrand… À l’inverse, Emmanuel Macron a fixé lui-même, dans sa lettre du 10 juillet, les cadres des coalitions possibles, d’EELV à LR. Il a ensuite demandé aux partis qu’il jugeait acceptables de s’entendre sur un gouvernement qu’il nommerait. Par la suite, c’est le chef de l’État qui a mené les consultations et nommé un Premier ministre après avoir négocié avec lui les grandes lignes politiques et s’être assuré d’un pacte de non-agression avec le Rassemblement national. La vie d’un tel gouvernement est par définition difficile, puisqu’il va devoir composer avec un Président qui ne veut pas lâcher prise et une Assemblée capricieuse, où il ne tient que par la bonne grâce de son principal adversaire politique.
Régime parlementaire sur le modèle de nos voisins ou pente glissante vers un présidentialisme illibéral, la Ve République est à un tournant.
Mais les fractures ouvertes ne sont pas uniquement conjoncturelles. On comprend les choix tactiques d’Emmanuel Macron. Ce dernier a montré une rare compétence à exploiter les failles de la Constitution. Quoi qu’en disent certains, il n’est pas un apprenti dictateur, et le régime qu’il met en place n’est pas une démocratie illibérale… mais les précédents qu’il crée rendent possible une telle dérive. Demain, toute réforme sociale pourrait passer par l’article 47-1, réduisant à peau de chagrin les débats parlementaires. En laissant expédier les affaires courantes pendant deux mois au gouvernement Attal, Emmanuel Macron a également montré qu’il existait une voie de sortie du régime parlementaire. Les pouvoirs d’un gouvernement démissionnaire augmentant avec le temps pour assurer la continuité de la vie de la nation, ce dernier peut se rapprocher des compétences d’un gouvernement de plein exercice. Pour autant, une motion de censure ayant pour effet de faire démissionner le gouvernement, un gouvernement démissionnaire ne peut être renversé par le Parlement, puisqu’il est déjà tombé. Un président qui déciderait demain d’ignorer pendant cinq ans la censure se verrait donc offrir une porte ouverte.
Régime parlementaire sur le modèle de nos voisins ou pente glissante vers un présidentialisme illibéral, la Ve République est à un tournant. Plus que jamais, le droit constitutionnel ne saurait rester uniquement l’affaire des spécialistes, mais doit redevenir un bien commun, celui dont naguère la Constitution montagnarde consacrait le peuple comme gardien.