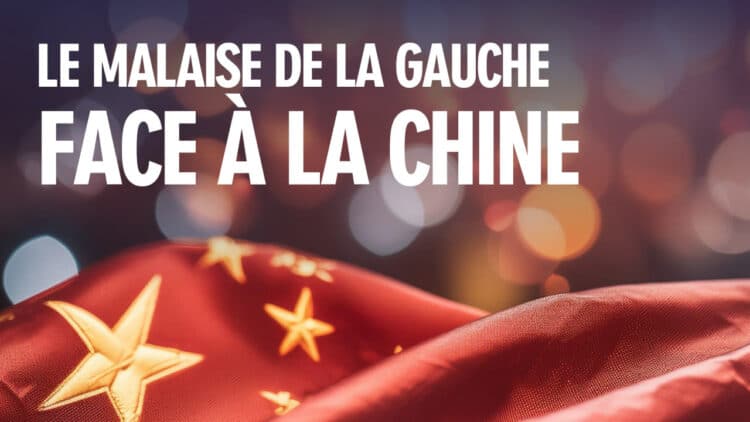À gauche, la République populaire de Chine (RPC) déroute toujours autant. Dans les pays émergents elle est parfois érigée en modèle, ou perçue comme une alliée, en raison de son rôle central dans la dynamique de désoccidentalisation qui s’amorce. En Europe, elle est souvent considérée avec une défiance qui rejoint parfois celle des dirigeants américains. Pour échapper à ces deux impasses, il faut appréhender la géopolitique chinoise à l’aune de transformations économiques en cours depuis la mort de Mao Zedong. Par Martine Bulard [1].
Aux yeux d’une fraction – très minoritaire – du camp progressiste, la RPC apparaît, sinon comme un phare, du moins un pôle de contestation de l’hégémonie américaine. Pour la grande majorité, c’est une toute autre vision qui prédomine, alimentée par des clichés médiatiques : nouvel empire du mal, « péril jaune », omniprésence de la main de Pékin, etc. Mais que veut exactement la Chine ? Comprendre les ressorts de sa politique étrangère implique de considérer ses ambitions à la lueur de son histoire.
L’irrésistible ascension de la Chine
Du XVIè siècle au début du XIXè, on comptait la Chine et l’Inde au nombre des puissances dominantes. Les expéditions militaires occidentales devaient changer la donne, au prix d’un dépeçage de ces pays – lequel a pris la forme d’une occupation en Inde, et d’enclaves territoriales étrangères en Chine. Si des causes internes ont également conduit au déclin subséquent de celle-ci, ce sont les facteurs exogènes que la population chinoise garde aujourd’hui à l’esprit. Ainsi, l’idée qu’aujourd’hui leur pays ne fait que reprendre sa place dans le monde demeure prégnante. Tout comme celle d’associer intimement prospérité économique et intégrité territoriale. Ces éléments permettent de comprendre pourquoi le gouvernement de la RPC est aujourd’hui soutenu par la majorité des Chinois, malgré la répression et les difficultés quotidiennes.
Peut-on s’appuyer sur la Chine, sinon pour construire un bloc alternatif aux États-Unis, du moins s’en servir comme point d’appui face à la puissance américaine ? Pour répondre, il faut revenir sur la manière dont la Chine s’est insérée dans l’ordre international actuel. Et rappeler quelques faits élémentaires : à la mort de Mao Zedong, la Chine ne possède pratiquement pas d’industrie, de capitaux et de technologie. Tout juste une main d’oeuvre qui sait lire et écrire, avec un taux d’alphabétisation qui avoisine les 60 à 75 %. Il s’agit d’un acquis remarquable si l’on garde à l’esprit qu’en Inde, à l’époque, seuls 40 à 42 % de la population maîtrise la lecture et l’écriture.
On dit parfois que Pékin menace de vendre ses dollars, mais il ne peut le faire du jour au lendemain : la valeur du billet vert diminuerait alors considérablement et paupériserait… ses détenteurs
Au sortir de la période maoïste, la Chine cherche un mode de développement, et lorgne du côté de Singapour ou du Japon – deux modèles capitalistes avec un degré variable d’autoritarisme. Elle se tourne vers l’Occident pour obtenir des investissements, mais avec une condition essentielle : elle exige des capitaux productifs, et non de simples capitaux financiers. Les Chinois deviennent ainsi rapidement en mesure d’exiger des transferts de technologie, comme ce fut par exemple le cas pour les investissements nucléaires français.
Heureuse coïncidence : cette ouverture de la Chine rencontre la vague de dérèglementation et de délocalisations qui frappe alors le « premier monde ». Pour le patronat occidental, il s’agit d’accroître ses profits par l’exploitation d’une main-d’oeuvre à bas coût et de pressurer les salaires européens et américains, contre une importation de biens chinois à prix modiques. Au fil du temps, la Chine se développe. Elle devient l’« atelier du monde », inondant la planète de produits finis. Mais elle n’en reste pas là et fabrique des biens de plus en plus sophistiqués, à « haute valeur ajoutée », comme les nomment les économistes. Au point de mettre en danger les multinationales occidentales, qui lui avaient fait la courte-échelle.
Avec cette stratégie, les dirigeants chinois ont gagné leur pari de développer leur pays, fût-ce à marche forcée, au prix d’une exploitation de la main d’oeuvre et d’un sabotage de l’environnement. Toutefois 800 millions de personnes sont sorties de la grande pauvreté, et plus personne n’y meurt aujourd’hui de faim.
Nouvelle lueur à l’Est ou « péril jaune » ?
La Chine a choisi le capitalisme – un capitalisme d’État, certes, mais un capitalisme tout de même, avec ses inégalités et ses crises cycliques. Elle n’a accouché d’aucun « modèle » alternatif. Et si elle peut faire figure d’exemple pour de nombreux pays en voie de développement pour la vitesse à laquelle elle s’est industrialisée, elle demeure fortement dépendante du reste du monde. Les États-Unis et l’Europe ne peuvent vivre sans marchandises chinoises, de même que les Chinois ont besoin des technologies occidentales.
Le degré d’interdépendance financière sino-américaine est tout aussi parlant. La Chine demeure le deuxième acheteur de la dette américaine, derrière le Japon. En janvier 2024, on comptait dans les caisses chinoises près de 800 milliards de dollars. On dit parfois que Pékin menace de les vendre mais il ne peut le faire du jour au lendemain : la valeur du billet vert baisserait alors considérablement et paupériserait… ses détenteurs. Ainsi, les Chinois financent les Américains, lesquels achètent des produits chinois, qui permettent en retour aux Chinois d’acheter de la dette américaine. Cette chaîne perverse, la RPC n’a pas réussi à la rompre, même si l’affrontement sino-américain actuel risque d’accélérer le découplage.
La Chine s’est ainsi insérée dans le système international sans barguigner, et ne souhaite nullement le remettre en cause : elle veut y avoir toute sa place, ce qui n’est pas la même chose. Retournement de situation : ce sont les États-Unis qui ne veulent plus de cet ordre international. Les Américains multiplient les mesures protectionnistes, ainsi que les subventions pour encourager les capitaux délocalisés à revenir sur leur territoire. De manière tout à fait extraordinaire, alors que pendant des années les États-Unis ont dénoncé le montant des subventions chinoises – supposément en contradiction avec les règles de la libre concurrence -, aujourd’hui ce sont eux qui, avec l’Inflation Reduction Act (IRA) financent la relocalisation de leur économie !Ils veulent y consacrer 369 milliards de dollars !
La Chine ne souhaite pas être le chef de file d’un camp. Elle n’est à la tête d’aucune alliance militaire. Elle demeure traumatisée par l’expérience soviétique, estimant que l’URSS a payé le prix de son positionnement « campiste »
Sur le plan des mesures protectionnistes, on a vu les Big Tech américaines s’allier à Donald Trump pour interdire ou taxer les produits de haute technologique venus de Chine. En plus, Washington brandit la dimension extraterritoriale du droit américain qui est une arme létale : il suffit, par exemple, qu’un produit français ait utilisé un seul composant chinois, dans une série de secteurs de haute technologie, pour que l’entreprise coupable tombe sous le coup des sanctions. Ou à l’inverse que cette société utilise un élément américain ou même un morceau de logiciel pour qu’elle ne puisse plus exporter son produit en Chine sous peine d’amende. Et l’on sait à quel point elles peuvent être sévères : BNP-Paribas a été condamnée à payer 9 milliards d’euros au Trésor américain en 2013 pour avoir commercé en dollars avec des pays sous embargo américain (et non de l’ONU), sans protestation notable des élites françaises…
Les États-Unis veulent garder leur avance technologique et bloquer les produits novateurs sur lesquels la Chine possède un avantage comparatif. Ils ont donc organisé un blocus total des semi-conducteurs de la dernière génération auquel participent Taïwan, le Japon et les Pays-Bas. Du jour au lendemain, les entreprises chinoises doivent se rabattre sur des semi-conducteurs moins performants. Dès 2019, le numéro un chinois des smartphones et de la 5G, Huawei, a vu son marché occidental s’effondrer, faute de puces performantes. Il s’est depuis requinqué au moins en Chine et dans le reste du monde, mais le coup fut rude. Si d’une façon plus générale, l’industrie chinoise est touchée par cet embargo, l’État a lancé un vaste plan de recherche-développement dans le domaine des semi-conducteurs et dans celui de l’intelligence artificielle, pour tenter de combler son retard et acquérir son indépendance. Gagnera-t-il son pari ? Trop tôt pour le dire
Porte-avions à Formose et explosion des budgets militaires
Autre noeud des affrontements américano-chinois : Taïwan. Les États-Unis, sur cette question, agitent le chiffon rouge – ce qui ne veut pas dire que, dans ses rapports avec l’île, Pékin est blanc comme neige. Dans le Détroit de Formose, assez étroit, les médias parlent souvent des incursions d’avions et de navires chinois — réelles — mais rarement des avions militaires et porte-avions américains, et même un porte-avion français, qui y circulent régulièrement. Imagine-t-on la réaction américaine si un porte-avion chinois bordait les côtes américaines, entre la Floride et Cuba ? Ou si les Chinois installaient un système de surveillance à proximité à cet endroit, comme les Américains l’ont fait à Formose ? Ils ont même établi un contingent de forces spéciales sur la petite île taïwanaise de Kinmen (ou Quemoy) qui se situe à 4,5 kilomètres de la Chine continentale.
On ne peut que regretter l’alignement européen sur ces manoeuvres américaines. Reconnaissons au président Emmanuel Macron la justesse de sa position diplomatique lorsqu’il a rappelé la doctrine officielle de la France (qui est aussi celle de l’ONU) : il n’existe qu’une seule Chine – il est même allé plus loin, rappelant que Taiwan n’était pas une affaire française ni américaine.
Des provocations américaines de cette nature constituent un jeu dangereux, dans une région qui compte trois puissances nucléaires : Inde, Pakistan, Chine – et presque une quatrième, la Corée du Nord. Cet accroissement des tensions conduit à une escalade sans fin des budgets militaires. Rappelons que le Japon – à la Constitution « pacifiste » depuis 1945 – est en passe de multiplier son budget de défense par deux, essentiellement pour alimenter l’industrie américaine de défense. Il est de bon ton de s’extasier devant la croissance outre-Atlantique… en oubliant de rappeler le rôle qu’y tient l’armement, lui-même alimenté par les commandes des alliés des États-Unis.
Cette dynamique d’accroissement des tensions conduit à un rapprochement entre Russie et Chine. Ces deux pays ne sont pourtant pas des alliés naturels : gardons simplement à l’esprit les conflits sino-soviétiques qui ont failli dégénérer en guerre en 1969. C’est l’agressivité américaine actuelle qui les conduit au rapprochement.
La Chine et les BRICS, au-delà des fantasmes
La Chine souhaite-t-elle construire un bloc anti-occidental ? Les BRICS sont l’objet de tous les fantasmes. La dernière réunion de ce groupe a généré des commentaires médiatiques particulièrement fournis – et hostiles. On peut le comprendre : que ce groupe informel parvienne à se structurer, et à intégrer cinq nouveaux membres – Arabie Saoudite, Iran, Émirats arabes unis, Éthiopie et Égypte – mérite que l’on s’y arrête [NDLR : l’Argentine devait rallier les BRICS, mais cet agenda est devenu lettre morte depuis l’élection de Javier Milei].
Ce nouveau bloc possède de 45 à 55% des réserves pétrolières du monde, et près de la moitié des réserves de métaux rares. Ces matières premières s’échangent en dollars mais les BRICS souhaitent dé-dollariser le monde ou en tout cas commencer à s’en émanciper.
Il faut dire que la politique de sanctions tous azimuts des États-Unis conduit plutôt à fragiliser l’empire du billet vert. Que les États-Unis aient gelé les fonds souverains de Russie et expulsé ce pays du système SWIFT – une première mondiale – ont fait paniquer de nombreuses grandes fortunes. Personne ne se sent à l’abri – et certainement pas les pays qui carburent aux pétro-dollars, comme l’Arabie Saoudite. On comprend donc l’intérêt, pour les BRICS, de la Nouvelle banque de développement impulsés par Pékin, qui permet de commercer en monnaies nationales. Pour la Russie, la possibilité d’échanger sans dollar est fondamentale.
Certes, on est encore loin d’une dédollarisation, telle que la réclamait le Brésil lors du sommet des BRICS d’août 2023. Mais ces dynamiques ne devraient pas être balayées d’un revers de la main. Rappelons simplement que les BRICS, s’ils se coalisent, ont un droit de veto au FMI. Pour l’heure, cette condition n’a bien sûr rien d’évident : elle nécessiterait qu’Inde, Chine et Arabie Saoudite s’entendent pour défier les États-Unis… Les BRICS ont-ils le pouvoir d’édifier un nouvel ordre ? Non. Les BRICS ont-ils un vrai pouvoir de bousculer certaines règles ? Oui. Ce qui les unit, c’est simplement la volonté de se faire une place au soleil dans un système international conçu au temps où ils n’étaient que des nains économiques et politiques.
La Chine ne souhaite pas être le chef de file d’un camp. Elle n’est à la tête d’aucune alliance militaire – et c’est assez rare pour être souligné. Elle ne possède qu’une seule base à l’étranger, à Djibouti. Elle demeure traumatisée par l’expérience soviétique, estimant que l’URSS a payé le prix de son positionnement « campiste » et de sa militarisation. Elle cite souvent l’Organisation de Shanghai, qui réunit la Russie, la Chine, les pays d’Asie centrale, l’Inde et le Pakistan, etc, comme le modèle de sa conception du monde. Ces pays qui ne sont pas des alliés et sont parfois en conflits plus ou moins larvés, se parlent pourtant régulièrement dans ce forum et peuvent même faire avancer des dossiers communs. De plus, Pékin s’inscrit dans un temps long. C’est ainsi qu’il faut entendre la vision « multi-civilisationnelle » évoquée par Xi Jinping – ce qui ne manque pas de sel, lorsqu’on considère ce qu’il fait de la diversité culturelle au sein de son propre pays…
La Chine ne cherche pas à remplacer les États-Unis, comme puissance dominante. Elle veut offrir un modèle alternatif suivant de nouvelles normes de relations internationales, et retrouver la place qui était la sienne avant l’ère coloniale – si possible au centre du monde…
Note :
[1] Martine Bulard est journaliste, spécialiste de la région asiatique. Cet article est issu de son intervention à la conférence « Occident : fin de l’hégémonie » co-organisée par LVSL et l’Institut la Boétie. Martine Bulard y est intervenue aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, Christophe Ventura et Didier Billion – ces deux derniers étant auteurs du livre Désoccidentalisation paru chez Agone (2023).