En novembre 1980, alors que Ronald Reagan est élu président des États-Unis, le film La porte du Paradis réalisait un échec cuisant entraînant la chute de la société de production United Artists. Cette fresque critique de l’histoire américaine symbolisait ainsi la fin d’une ère artistique débutée à la fin des années 60, qui avait vu Hollywood passer d’usine à rêve à un miroir du mal-être américain en pleine période de contestations.
Dans son fameux essai rédigé en 1957, Roland Barthes écrit : « Le mythe ne nie pas les choses, sa fonction est au contraire d’en parler ; simplement, il les purifie, (…) il abolit la complexité des actes humains (…) il organise un monde sans contradictions parce que sans profondeur, un monde étalé dans l’évidence, il fonde une clarté heureuse ; les choses ont l’air de signifier toutes seules » (p.217).

Ainsi, les États-Unis d’Amérique ont souvent présenté une vision mythique de leur Histoire : le rêve américain, la démocratie libérale, la consommation ostentatoire ou encore le mythe du self made man. Issu du transcendantalisme d’Emerson et des romans de l’écrivain Horatio Alger, il promeut le fait que tout individu a les capacités d’accomplir ses ambitions les plus folles, quelles que soient ses origines sociales ou ethniques. C’est ce que le philosophe canadien C.B Macpherson analyse comme « l’individualisme possessif ».
Cette mythification est motivée par le fait que, contrairement au continent européen, les États-Unis sont perçus comme une terre vierge découverte notamment par la conquête de l’ouest, le mythe de la destinée manifeste occultant ainsi le passé indien. Ce concept de terre vierge et l’absence d’Histoire ancienne avec une société féodale a pour conséquence une absence fondamentale de vision de classe comme on pourrait en trouver dans les pays européens. Tocqueville déjà relève en son temps cette vision égalitariste de la société américaine avec la fameuse « égalité des conditions ». Or les États-Unis, comme le fait remarquer l’ancien haut-fonctionnaire Pierre Conesa dans son essai Hollywar : Hollywood, arme de propagande massive (2018) n’ont jamais eu de ministère de l’éducation nationale et par conséquent aucun récit national institutionnel.

Le cinéma américain apparaît de facto comme un outil essentiel dans la propagation de ces mythes historiques énoncés pour fabriquer un imaginaire commun à la société américaine.
Il serait excessif de ne voir chez Hollywood qu’une officine idéologique au service de l’État américain, en raison de la complexité de l’industrie cinématographique américaine. Hollywood a plusieurs fois proposé une variété de sujets sensibles dès les premières décennies, avec des réalisateurs courageux tels que Frank Capra avec Monsieur Smith au Sénat (1940) évoquant les zones d’ombre de la démocratie américaine ou King Vidor qui réalise Notre pain quotidien en 1934 sur la question sociale.
Il faut pourtant constater que l’industrie hollywoodienne se distingue par sa situation quasi-monopolistique. Dès 1939, les grands studios surnommés les majors représentent 80% de la production cinématographique. Ils véhiculent alors dans une large majorité de leurs œuvres une idéologie consensuelle accompagnée des mythes fondateurs américains, fabriquant un imaginaire commun pour la population américaine comme l’a analysé Anne-Marie Bidaud dans le livre Hollywood et le rêve américain : Cinéma et idéologie aux Etats-Unis (1994).
De plus, la violence de la chasse aux sorcières durant la période du maccarthysme à Hollywood, avec la liste noire mise en place par la MPAA (Motion Picture American Association, rassemblement des majors) en 1947 active jusqu’aux années 1960, démontre bien l’importance du cinéma américain comme vecteur de cohésion nationale.
Le déclin du Hollywood traditionnel
Toutefois, dans l’après-guerre, les studios qui régnaient de manière monopolistique vont progressivement voir leur pouvoir s’affaiblir face aux arrêts anti-trusts de la Cour suprême entre 1948 et 1952.
La perte de puissance des majors procède également de la démocratisation de la télévision qui concurrence de plus en plus Hollywood. Ces différents bouleversements font chuter l’audience cinématographique, mettant en péril l’industrie hollywoodienne. Le déclin de ces studios se vérifie avec différents échecs de super-productions à l’image de Cléopatre de Joseph L. Mankiewicz en 1963 qui manque de peu de faire couler la Fox. Par ailleurs, les nababs, dirigeants emblématiques de ses studios, sont morts tel Louis B. Mayer en 1957 ou trop vieux pour comprendre les évolutions de la société à l’image de Sam Goldwyn qui qualifie Blow-Up (1967) d’Antonioni « d’ignoble cochonnerie ». Enfin, le code Hayes, implanté dans les années 30 sous la pression des groupes puritains et des ligues de vertu perd en influence. Il est remplacé en 1968 par un nouveau système plus conciliant.

Le début du nouvel Hollywood
Si le cinéma américain traverse une crise existentielle durant l’Après-guerre, le cinéma européen connaît au même moment une renaissance. D’une part, le cinéma italien avec le néoréalisme cherche à montrer de manière quasi-documentaire la réalité et le quotidien des classes populaires italiennes. D’autre part, la nouvelle vague française révolutionne les conventions cinématographiques. Ces deux mouvements vont alors particulièrement influencer les jeunes réalisateurs trentenaires américains à la fin des années 1960.
Cette période voit également les fondements de la société américaine complètement bouleversés. Un désenchantement général touche alors toutes les catégories de la population américaine en raison de la guerre du Viêt-Nam qui remet en cause le bien-fondé de la destinée manifeste américaine, du scandale du Watergate remettant en cause la confiance dans les institutions américaines et le début de la crise économique qui fait perdre foi dans le rêve américain.
Divers sondages traduisent en effet ce mal-être qui traverse la société américaine. Le centre de recherche sur l’opinion publique de l’Université du Michigan révèle en 1972 que 53% des Américains interrogés croient que « le Gouvernement est aux mains de grands intérêts économiques qui travaillent pour leur seul profit ». En 1975, un organisme catholique effectue un sondage révélant que 83% des personnes interrogées pensent que “les responsables qui dirigent le pays” ne disent pas la vérité. Enfin, le New York Times révèle dans ces mêmes années que des analystes d’opinion publique s’adressant au Comité du Congrès affirment que « la confiance du public à l’égard du gouvernement et de l’avenir économique du pays était sans doute à son plus bas niveau depuis qu’il est possible de calculer scientifiquement ce genre de choses ».
L’ensemble de ces facteurs artistiques et politiques convergent alors pour produire ce que le journaliste américain Peter Biskind a nommé en 1998 « le nouvel Hollywood ». Ces jeunes cinéastes trentenaires pétris des évolutions cinématographiques européennes vont pouvoir imposer leurs vues artistiques face à l’affaiblissement du pouvoir des studios.
Le critique français Jean Baptiste Thoret va jusqu’à parler d’une «Prise d’assaut de la citadelle hollywoodienne ».
Biskind fait débuter ce mouvement par la sortie de Bonnie and Clyde d’Arthur Penn en 1967, qui devait initialement être réalisé par François Truffaut ou Jean Luc Godard. Cette œuvre présente une vision idyllique et révolutionnaire du célèbre couple de gangsters avec une mise en scène sauvage et violente à l’image de la scène finale qui montre l’assassinat du couple de manière frontale. Pauline Kael, critique au New-Yorker, déclarait à l’époque « Bonnie and Clyde montre sur grand écran cet espace public terriblement révélateur des choses que les gens ressentent en ce moment, des choses dont ils parlent et sur lesquelles on écrit beaucoup ».
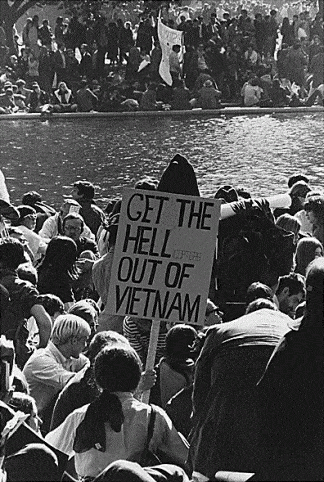
Le cinéma américain, auparavant outil de fabrique du rêve américain et du consensus national, s’est désormais transformé en fenêtre sur le paysage politique américain. Si l’analogie est faite par Pauline Kael vis-à-vis de la violence du conflit vietnamien, la génération de ces jeunes réalisateurs qui émerge n’hésite pas à traduire le scepticisme général vis-à-vis des mythes américains et de la société actuelle en appuyant sur les défauts du système américain. La génération de ces nouveaux cinéastes va ainsi réaliser pléthore de films critiques sur les fondations de la société américaine : le rêve américain [1], les institutions américaines [2]. Enfin, ces films sont aussi témoins d’un mépris pour une vision idyllique en préférant montrer la violence des structures sociales [3] et refusent aussi le traditionnel happy end qui avait autrefois lieu même pour les films critiques du système américain.
Pourtant, à partir de 1975, on peut déjà voir que le mouvement du Nouvel Hollywood commence à s’effriter du fait des évolutions économiques. Les succès de Jaws et Star Wars font apparaître un nouveau modèle plus prolifique pour l’industrie hollywoodienne : le blockbuster, qui plait à toutes les classes sociales et en particulier aux adolescents américains, jeune public dépolitisé. Enfin, les nouveaux rois du nouvel Hollywood dans les années suivantes, assurés de la confiance des studios se lancent dans des films qui ne rencontrent pas le succès escompté. Scorcese voit par exemple son film New York New York réalisé en 1977 échouer au box-office.
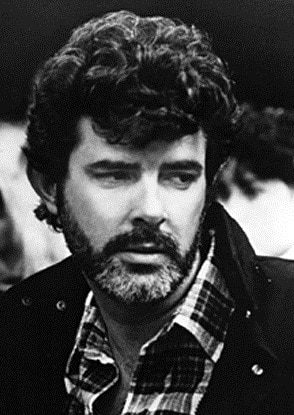
Enfin en 1977 Friedkin réalise un remake du film Le salaire de la peur (1953) de Clouzot, Sorcerer, avec un aspect critique sur le pouvoir. Mais son film termine en fiasco total du fait de la sortie conjointe avec Star Wars. Le critique Samuel Blumenfeld déclare ainsi : « Le public américain de la fin des années 70 voulait voir un film dans l’espace, déconnecté du réel, où la frontière entre le bien et le mal est clairement délimitée, plutôt qu’un film dans la jungle, dont les quatre personnages principaux sont à la base des ordures. Et qui en plus tient un discours politique dénonçant la mainmise des multinationales américaines sur l’Amérique du Sud ».
Une fois de plus ces évolutions cinématographiques sont en corrélation avec les évolutions politiques. En 1974, Nixon quitte la Présidence face aux révélations du Watergate. Il est remplacé par Ford tandis les troupes américaines quittent définitivement le Viet-Nam en 1975. À cela s’ajoute en 1976 les célébrations du bicentenaire de l’indépendance américaine qui ravivent le patriotisme américain et les mythes fondateurs de la société américaine, alors qu’en 1979 la prise des otages américains lors de la révolution iranienne est vue comme une grave humiliation par une majorité d’Américains. Enfin, dans son récent essai La société ingouvernable : une généalogie du libéralisme-autoritaire (2018), le philosophe français Grégoire Chamayou démontre à partir de multiples archives l’organisation d’une réaction opérée par le haut (milieux économiques, industriels, politiques) face aux luttes écologiques, politiques et sociales qui agitaient la société américaine au début des années 70.
La porte du paradis : Le chant du cygne du nouvel Hollywood
Pourtant, en février 1979, tout laisse à songer que le nouvel Hollywood a encore de beaux jours devant lui. L’un de ses réalisateurs emblématiques, Francis Ford Coppola remet à Michael Cimino l’oscar du meilleur réalisateur pour The Deer Hunter (Voyage au bout de l’enfer), fresque de trois heures évoquant le conflit vietnamien depuis l’oeil de trois cols bleus de Pennsylvanie.
Auréolé par ce succès, Cimino signe avec United Artists un contrat lui donnant carte blanche pour réaliser le film La Porte du Paradis. Le scénario écrit dès 1974 évoque de manière romancée un événement sombre et peu connu de l’Histoire américaine, la guerre du Comté de Johnson qui, en 1892, vit un conflit sanglant entre des paysans immigrés originaires de l’Europe de l’est et une association de propriétaires fonciers soutenue par les autorités fédérales américaines.
Rapidement, la production du film va dépasser les prévisions avec un tournage de sept mois au lieu de deux et un budget prévisionnel qui va être dépassé pour atteindre le chiffre de 44 millions de dollars (ce qui équivaut aujourd’hui à un budget digne d’une superproduction Marvel). Le montage aboutit alors à une durée finale de 3H39. Le film sort en novembre 1980. Il est étrillé d’une manière particulièrement violente par la critique puis retiré au bout d’une semaine d’exploitation par United Artists pour refaire le montage. Le film ressort en 1981, avec cette fois une durée de 2H30 mais rien n’y fait. Il est retiré au bout d’une semaine d’exploitation. Quelques mois après, la société United Artists fait faillite.
Beaucoup expliquent alors l’échec de La porte du paradis par la mégalomanie de Cimino. D’un point de vue artistique, nombreux sont ceux qui lui reprochent la durée beaucoup trop longue du film faite d’ellipses, son style trop européen, contemplatif et la lenteur du rythme. Enfin, la faillite de United Artists n’est pas directement liée à l’échec de La porte du Paradis mais plutôt de la réalisation d’une dizaine de films non sortis la même année.
L’échec de La porte du Paradis symbolise quelque chose de plus important. Le film sort deux semaines après l’élection de Ronald Reagan. Ancien acteur de série B, ayant participé directement à la chasse aux sorcières à Hollywood en tant que président de la SAG (Screen Actor Guild), il fait ses premières armes politiques en militant activement auprès du candidat républicain à la présidence de 1964 Barry Goldwater, partisan de la suppression de la sécurité sociale, des droits civiques, et de l’usage de l’arme nucléaire.
Après 10 ans en tant que gouverneur de Californie, Reagan est élu en 1980 sur un programme libéral-conservateur associé à une volonté de retour aux mythes fondateurs de la société américaine. Jean Baudrillard écrit à ce propos dans son excellent essai Amérique (1998) : « L’Amérique entière est devenue californienne, à l’image de Reagan. Ancien acteur, ancien gouverneur de Californie, il a étendu aux dimensions de l’Amérique la vision cinématographique et euphorique, extravertie et publicitaire, des paradis artificiels de l’Ouest. Il a installé une sorte de chantage à la facilité, renouvelant le pacte primitif américain de l’utopie réalisée. (…) Si l’utopie est réalisée, le malheur n’existe pas, les pauvres ne sont plus crédibles. Si l’Amérique est ressuscitée, alors le massacre des Indiens n’a pas eu lieu, le Vietnam n’a pas eu lieu. ».

Or La porte du paradis est une charge frontale contre l’ensemble de la mythologie américaine tel que le rêve américain, la conquête de l’ouest, le mythe du self made man, l’optimisme mais surtout celui de la terre vierge américaine faisant normalement abstraction des classes sociales. En effet lors de la réunion des propriétaires qui décide de l’exécution des émigrés, l’un des personnages principaux déclare « Je suis prisonnier de ma classe », ce qui valut ainsi à Cimino d’être accusé de crypto-marxisme par différents critiques.
La porte du paradis est donc un film anachronique dans cette nouvelle période de résurrection des mythes américains. Il est victime d’une réaction artistique symbolique des années Reagan. La décennie qui suivra verra alors une large reprise en main de la production cinématographique par les studios tandis que le cinéma américain des années 80 n’est pas exempt de « l’effet Kaboul »[4], avec un retour de l’opposition binaire du bien contre le mal et le retour du mythe from rags to riches, malgré quelques productions indépendantes tel que Reds de Warren Beatty en 1981.
La porte du paradis est ainsi « l’inutile cassandre » énoncée à la société américaine à l’aube d’une décennie qui verra l’installation durable du paradigme néoconservateur et néolibéral
Cimino réussira malgré tout à retourner à la réalisation 5 ans plus tard avec L’année du dragon (1985), film noir où il fait dire à l’un de ses personnages : « Plus personne ne se souvient de rien dans ce pays ».
La période du Nouvel Hollywood a ainsi accompagné artistiquement la grande vague de contestations qui a touché la société américaine. Le rôle politique du cinéma a aussi eu une forte importance durant les années 70 dans d’autres pays tel l’Italie au travers de réalisateurs comme Elio Petri qui dans des films marquants comme Enquête sur un citoyen au dessus de tout soupçon(1971) ou Todo Modo(1977) dresse un réquisitoire puissant du pouvoir italien en pleines années de plomb.
[1] La Lauréat, Le Plongeon, Cinq pièces faciles
[2] À cause d’un assassinat, Conversation secrète
[3] Macadam Cowboy, Un après-midi de chien, Taxi Driver
[4] Cette formule est de Olivier Duhamel et Jean-Luc Parodi
Bibliographie:
Jean Baudrillard, Amérique, Le Livre de Poche, 1998
Anne-Marie Bidaud, Hollywood et le rêve américain: Cinéma et idéologie aux Etats-Unis, Armand Colin, 1994
Peter Biskind, Le nouvel hollywood, Le Cherche Midi, 2002
Pierre Conesa, Hollywar, Robert Laffont, 2018
Jean Baptiste Thoret, Le Cinéma Américain des Années 70, Cahiers du Cinéma, 2017










