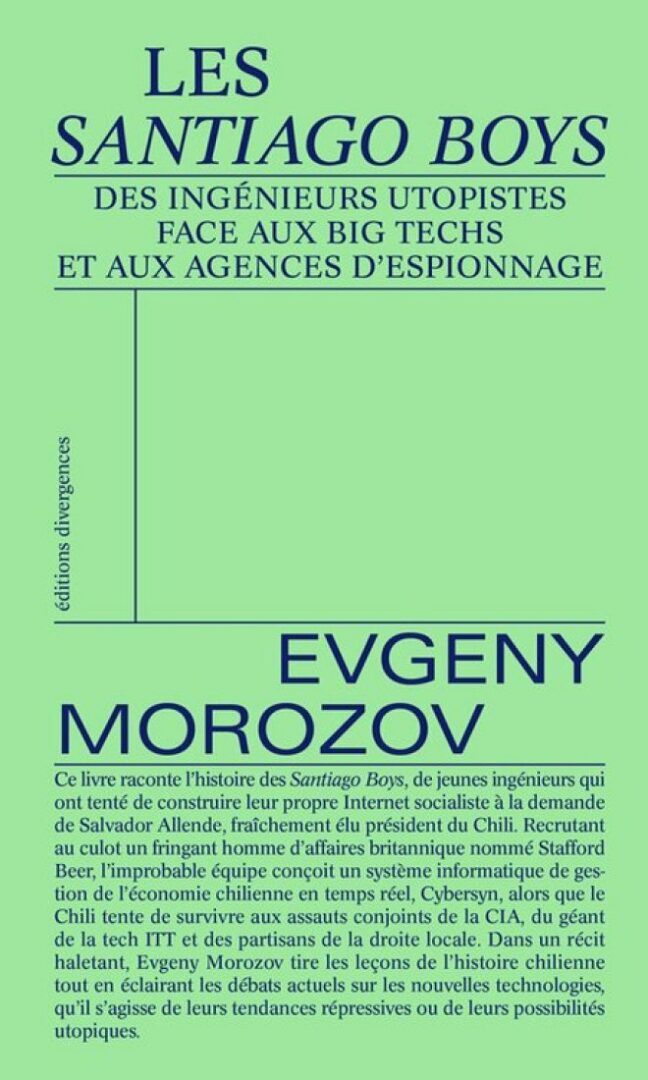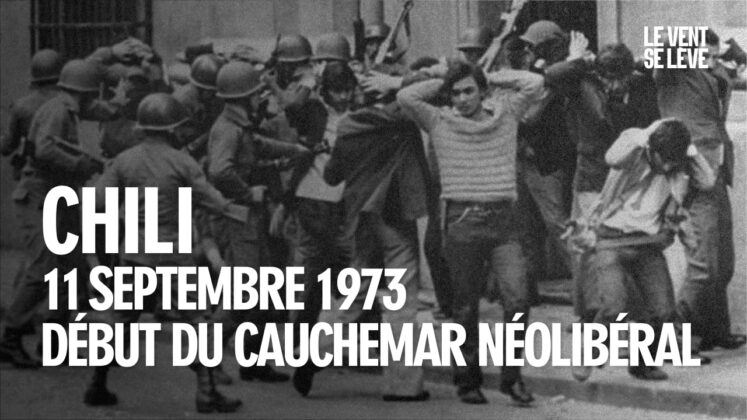Bien avant la Silicon Valley, un embryon de système informatique avait été conçu. C’était au Chili des années 1970, sous la présidence du socialiste Salvador Allende. Celui-ci avait requis les services de l’ingénieur britannique Stafford Beer et d’une poignée des technocrates chiliens et internationaux. Les Santiago Boys, ainsi qu’ils étaient surnommés, avaient mis en oeuvre un système révolutionnaire de télécommunications. À leurs yeux, Cybersyn (tel était le nom du projet) pourrait être un instrument de l’émancipation des masses. Une utopie technologique au service de la planification socialiste, qui cartographierait l’ensemble des besoins du pays et les communiquerait à une plateforme centralisée. Un outillage qui autoriserait l’échange d’informations complexes, en temps réel, sur des écrans – et permettrait au Chili de mettre fin à sa dépendance technologique vis-à-vis des États-Unis en matière de télécommunications.
Evgeny Morozov, chercheur et journaliste spécialisé dans les Big Tech, a dédié un podcast à cette aventure, dont LVSL avait rendu compte. Il publie un livre qui en reprend les grands traits : Les Santiago Boys – des ingénieurs utopistes face aux Big Tech et aux agences d’espionnage (Éd. Divergences, 2024). On y apprend que le projet des Santiago Boys était en réalité moins novateur qu’il ne le semblait : depuis une décennie, la CIA utilisait déjà un système similaire de télécommunications. Pour coordonner la traque aux opposants des régimes autoritaires d’Amérique latine. Aussi révolutionnaire qu’ait été Cybersyn, aussi importants qu’aient été les efforts de Salvador Allende pour conquérir la souveraineté technologique, les États-Unis possédaient un coup d’avance… Extrait.
Il existait en effet un autre chantier technologique au Chili. Un système plus ancien et plus avancé que Cybersyn. Un système conçu dans un but très différent. Un système créé par un homme dont les objectifs n’étaient pas ceux d’Allende ni de Stafford Beer. Vicente Celis Huerta, puisque tel était son nom, fut le cerveau de la surveillance cybernétique dans le pays. Cet ancien directeur des carabineros avait des relations très importantes à Washington. Dans les écoles de police américaines destinées aux officiers du sud du continent, ils étaient alors nombreux à s’être familiarisés, comme lui, avec les technologies de pointe. Huerta a utilisé ses connaissances et ses relations pour mettre en réseau les commissariats du pays entier à l’aide de la radio et, surtout, du téléscripteur.
Cela se produit des années avant l’arrivée au pouvoir d’Allende. Huerta bénéficie de l’aide du gouvernement américain, naturellement prêt à traquer de potentiels communistes révolutionnaires par tous les moyens possibles. N’oublions pas que ce dernier mène alors une vaste campagne de contre-insurrection sur tout le continent. Mais Huerta commet des erreurs. Il déteste Allende et tente de l’empêcher de devenir président. Peu après l’élection, il se rend aux États-Unis, et il a déjà quitté le Chili lorsque naît le projet Cybersyn.
Mais voici le plus important: le Chili n’est pas le premier pays à se doter d’un réseau télex. La CIA en a mis en place un autre, au début des années 1960, en Amérique centrale. Reliant le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Salvador et une poignée d’autres pays. Aidés par la CIA, ces pays se sont servi de la technologie pour partager des informations sur les révolutionnaires, les opposants, la masse des agitateurs communistes. Ce réseau est une sorte de précurseur d’Internet, mais dédié à la répression plutôt qu’à la liberté. Cybersyn arrivera bien plus tard.
«Il y avait des cartes, des écrans, les photos d’agents subversifs potentiels, une cartographie des cambriolages, des incendies, des marques au crayon de cire pour faire ressortir à l’écran le mouvement des forces de police, une communication permanente à l’aide de téléphones et de téléscripteurs.»
Je me suis entretenu avec Allan Nairn, journaliste d’investigations expert des escadrons de la mort en Amérique centrale. Il a écrit sur ce réseau il y a déjà plusieurs dizaines d’années : «J’ai pu parler avec des fonctionnaires et des techniciens américains qui ont contribué à le mettre en place, et j’ai consulté une partie de leur documentation […]. J’ai fait de même en Amérique centrale […]. Tout le monde décrit le même système. Basée sur le télétype, il s’agissait […] d’une opération combinée de l’USAID, du département d’État et de la CIA […]. Chaque régime surveillait ses opposants au moyen d’un système d’archivage centralisé.»
Il s’agissait donc d’une opération d’envergure : «Les informations étaient enregistrées et livrées en copie aux États-Unis, via la station de la CIA résidant à l’ambassade du pays concerné. Ensuite, si nécessaire, elles étaient partagées avec d’autres gouvernements au moyen de téléscripteurs. Ainsi les forces de sécurité salvadoriennes et guatémaltèques communiquaient-elles souvent les unes avec les autres…»
Au début des années 1960, un réseau télex reliait ainsi déjà les forces de police au sein d’une structure complexe et relativement sophistiquée d’échange d’informations. Que pouvaient faire les Santiago Boys, avec leur croyance naïve dans le pouvoir salvateur de la planification cybernétique, et leurs grands débats sur les travailleurs et les technocrates, pour s’opposer à cette répression high-tech?
Il y a plus : la fameuse salle d’opérations n’était pas une grande nouveauté non plus [NDLR : le système Cybersyn était centralisé autour d’une grande salle d’opérations]. La police utilisait ce genre de dispositifs depuis des années. Huerta devait s’être familiarisé avec eux quand il suivait ses cours dans les écoles de police dont nous avons parlé, à Washington.
Stuart Shader, à qui je dois d’avoir été mis sur la piste de Huerta, est historien à l’Université Johns Hopkins. Il précise: «Le Centre de contrôle des opérations de police (POCC) était l’un des joyaux de l’Académie internationale de police de Washington DC. L’idée, dans cette salle de simulation, était que les recrues apprennent à centraliser le commandement, coordonner les communications, les ressources, collecter des renseignements.»
Stafford aurait été en adoration devant les données dont ils disposaient: «Il y avait des cartes, des écrans, les photos d’agents subversifs potentiels, une cartographie des cambriolages, des incendies, des marques au crayon de cire pour faire ressortir à l’écran le mouvement des forces de police et du reste des forces d’intervention, une communication permanente à l’aide de téléphones et de téléscripteurs.»
Bien sûr, il manquait les fauteuils design comme de table pour poser son verre de whisky. N’empêche, les policiers avaient édifié un appareil de contrôle sophistiqué – qui a contribué à la défaite d’Allende.
Stafford Beer et ses amis chiliens étaient si fiers de leur salle d’opérations. Ils pensaient avoir inventé un outil neuf, révolutionnaire. Ils ignoraient que la CIA avait aussi les siennes, depuis plus longtemps encore que la police. Dès le renversement du gouvernement guatémaltèque en 1954, elle recourt à de tels espaces bourrés de téléscripteurs, de câbles et de gadgets étranges, utiles pour coordonner les opérations de déstabilisation.
Pour David Phillips, la tête pensante de nombreuses opérations de ce genre à la CIA, les salles d’opérations étaient un outil on ne peut plus banal. Au début des années 1960, lorsque John McCone prend la direction de l’agence, on décide de leur accorder plus d’importance encore. Une salle de commandement permanente, de grande ampleur, est aménagée dans le nouveau siège de la CIA, qui date de cette époque. Un article de magazine de 1967 la décrit ainsi: «Dans le poste de commandement sophistiqué du septième étage de Langley, une banque d’imprimantes à haute vitesse reçoit des flux top secret de la National Security Agency, des rapports diplomatiques des différentes ambassades à l’étranger, des informations de la Defense Intelligence Agency envoyées depuis le Pentagone, ainsi que des tuyaux provenant des agents de la CIA en activité partout dans le monde.»
Les lieux devaient être impressionnants : La salle d’opérations est reliée à la salle de crise de la MaisonBlanche, au PC militaire du Pentagone, ainsi qu’au département d’État par le truchement d’une phalange de téléscripteurs quasi miraculeuse, capable de coder une page de données par minute, et de la transmettre à un autre centre où elle peut être instantanément déchiffrée.»
On peut imaginer les éclats de rire de la CIA lorsqu’ils ont découvert l’article consacré à Cybersyn dans The Observer. Une salle d’opérations à Santiago. C’est cela, oui…