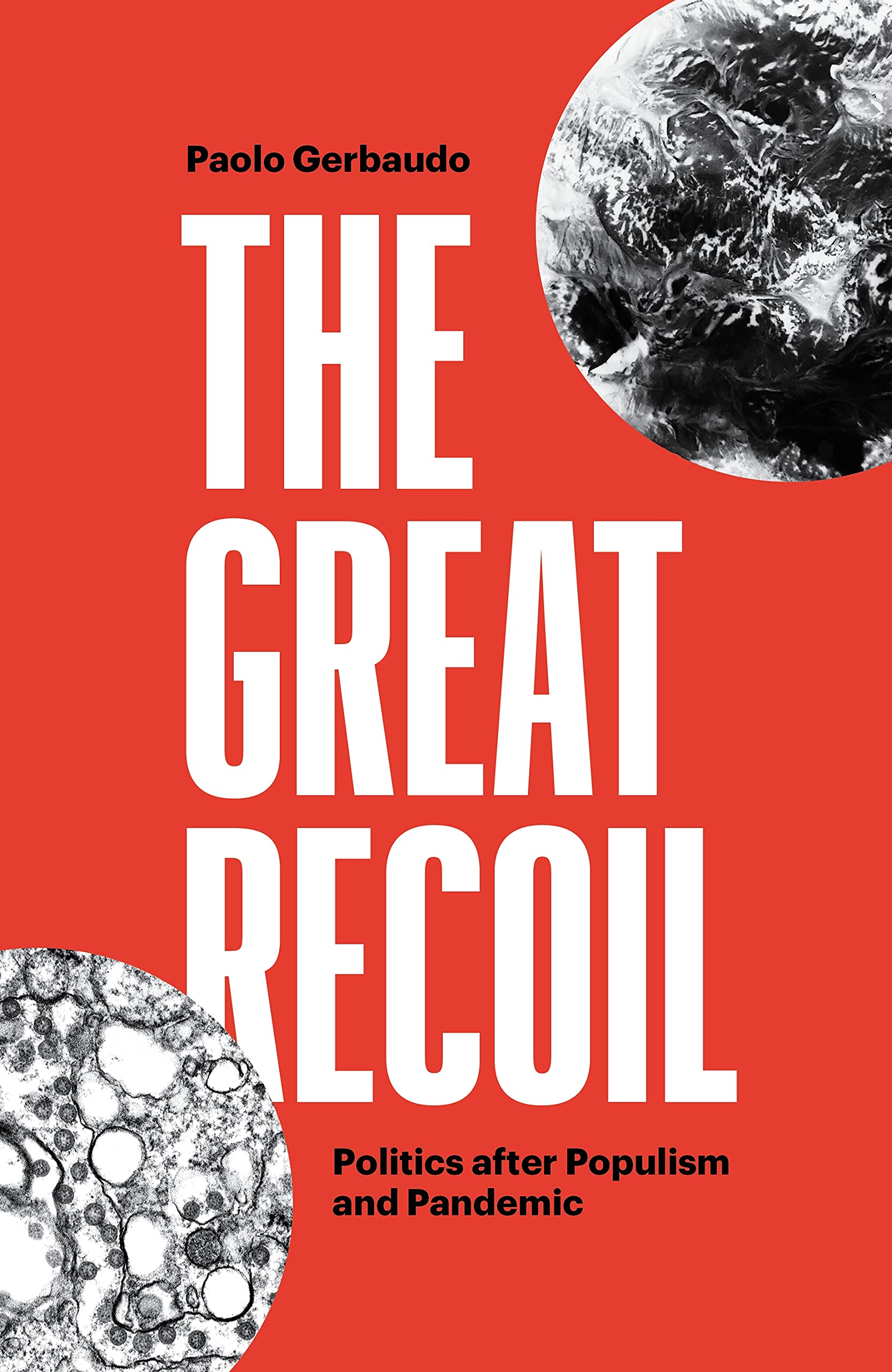Les poussées populistes des années 2010 et la crise du COVID ont-elles sonné la fin du néolibéralisme ? S’il reste prudent, le sociologue Paolo Gerbaudo constate un retour en force de l’État, des plans de relance aux mesures sanitaires en passant par le retour de la planification. Mais au bénéfice de qui ? À l’aide d’une vaste littérature de théorie politique, son essai The Great Recoil. Politics after populism and pandemic (Verso Books, 2021) décrit finement la recomposition politique en cours et les visions antagonistes du rôle de l’État de la gauche socialiste et de la droite nationaliste. Selon lui, si la gauche souhaite parvenir au pouvoir, elle doit renouer avec le patriotisme inhérent à son histoire et ne pas avoir peur du protectionnisme économique. Entretien réalisé, traduit et édité par William Bouchardon.
LVSL – Votre livre s’articule autour de ce que vous appelez un « Grand recul » du néolibéralisme et de la mondialisation, qui ont été hégémoniques depuis les années 1980. A sa place, vous affirmez qu’un nouveau Zeitgeist (« esprit du temps » en allemand, ndlr) est en train d’émerger, vous parlez de « néo-étatisme ». Quelles sont les raisons qui expliquent ce changement d’hégémonie ?
Paolo Gerbaudo – Le « Grand recul » est le moment où le capitalisme néolibéral atteint ses limites ultimes, tant économiques que politiques et écologiques. Ce rebondissement est le résultat net du succès même du projet néolibéral et de la manière dont il a intégré toujours plus de marchés et de pays dans son giron. Cependant, comme toute ère idéologique, le néolibéralisme tend à un moment donné à épuiser son élan initial et à se heurter à ses propres contradictions. Cela ouvre à son tour la voie à l’émergence d’un nouveau consensus, qui englobe l’ensemble de l’espace politique et imprègne tous les acteurs politiques, qui doivent se positionner par rapport à ce discours dominant.
Ce « Grand recul » est une réponse de la société au stress produit par la mondialisation néolibérale, sous la forme d’une exposition à des forces économiques incontrôlables, de l’agoraphobie, de la peur de l’ouverture, de cette peur d’être à découvert, sans défenses contre des forces qui échappent visiblement à tout contrôle politique. En bref, il s’agit du sentiment d’être l’objet de la politique plutôt que le sujet de la politique. Cela conduit à un réajustement du sens commun qui est le plus visible au sein du mainstream.
« Les représentants du capitalisme mondial abandonnent certains dogmes du néolibéralisme et s’approprient certaines formes d’interventions étatiques. Mais leur objectif est plus de sauver le capital de lui-même que de changer le système économique. »
Même les défenseurs du néolibéralisme et de l’austérité font aujourd’hui des concessions sur la nécessité d’équilibrer les excès de l’économie de marché, et font une embardée dans la direction opposée. On peut citer l’exemple de Joe Biden, qui a eu une longue carrière de démocrate centriste et modéré, mais qui a lancé un important programme d’investissements publics. Mario Draghi (Premier ministre italien non élu, à la tête d’un gouvernement technocratique, ancien président de la BCE, passé par Goldman Sachs, ndlr) est un autre exemple, il parle maintenant de « bonne dette ». Les représentants du capitalisme mondial abandonnent donc certains dogmes du néolibéralisme et s’approprient certaines formes d’interventions étatiques. Mais leur objectif est plus de sauver le capital de lui-même que de changer le système économique.
LVSL – Cette fin du néolibéralisme a si souvent été annoncée, notamment après la crise de 2008, que beaucoup de gens peuvent être assez sceptiques. Vous nous avez donné quelques exemples de ce retour de l’État, mais le cas de Biden semble également montrer les limites de cette nouvelle ère idéologique : il a signé un grand plan d’investissements dans les infrastructures de 1000 milliards de dollars, mais le « Reconciliation Bill », qui est plus axé sur les dépenses sociales, est toujours bloqué par le Sénat américain. Finalement, n’assistons-nous pas à une intervention plus forte de l’Etat dans certains secteurs de l’économie, afin de soutenir le capital – ou des sections du capital – mais pas à un retour d’un Etat-providence qui protège les travailleurs ?
P. G. – La théorie marxiste de l’État et les travaux de Louis Althusser, Ralph Miliband ou Nikos Poulantzas nous apprennent que l’État que nous connaissons est un État capitaliste. C’est donc un État qui vise à reproduire les mécanismes de l’économie capitaliste. Plus précisément, nous sommes entrés depuis un certain temps dans un capitalisme monopolistique, par opposition à un capitalisme plus concurrentiel qui existait en partie au début de la mondialisation. Aujourd’hui, il existe d’énormes concentrations de pouvoir et d’argent dans de nombreuses industries : Big pharma, Big tech, les médias, la fabrication de microprocesseurs… Les secteurs stratégiques de notre économie sont marqués par d’énormes niveaux de concentration. Il suffit de penser à Jeff Bezos et Elon Musk, qui se battent pour être l’homme le plus riche du monde et sont des démonstrations des concentrations grotesques de ressources qui existent dans nos sociétés. Dans ce contexte, le rôle de l’État est de soutenir le capital, et en particulier le capital monopolistique, c’est-à-dire de protéger le butin des vagues précédentes d’accumulation capitaliste qui ont constitué les empires d’aujourd’hui.
Comme vous le dites, ce néo-étatisme capitaliste permet certaines choses et en interdit d’autres. Le projet de loi sur les infrastructures a été approuvé parce qu’il était dans l’intérêt des grandes entreprises, puisqu’il signifie des profits pour les entreprises de construction. Au contraire, les mesures sociales n’ont pas d’utilité directe pour le capital. Par exemple, les congés maternité et les congés maladie, que nous considérons comme acquis dans des États-providence comme la France, l’Italie ou le Royaume-Uni, ne sont pas des droits statutaires nationaux aux États-Unis ! Cette composante de dépenses sociales du programme de Biden a jusqu’à présent été entravée par des centristes tels que Joe Manchin et Kyrsten Sinema, qui sont financés par de grandes entreprises et se sont opposés aux mesures qui réduiraient le coût des produits pharmaceutiques.
Pour en savoir plus sur les combats internes au parti démocrate sur le projet de Reconciliation Bill promis par Biden, lire sur LVSL l’article de Théo Laubry : « L’aile gauche démocrate, dernière chance pour le plan d’investissements ? »
Les mesures qui étaient bénéfiques pour le capital – et qui créent également des emplois, il ne faut pas le nier – ont été approuvées, tandis que celles qui visaient plutôt une sorte de redistribution douce sont bloquées. Un grand nombre des mesures les plus radicales promises par Biden vont être sévèrement édulcorées. Il semble maintenant que ce soi-disant « nouveau cadre » des dépenses sociales et du pacte climatique sera approuvé, mais que le chiffre initial de 3 000 milliards de dollars sera ramené à 1 750 milliards de dollars. Ce sera toujours une amélioration des conditions de vie pour des millions d’Américains, mais sa réduction révèle les nouveaux défis de l’ère néo-étatiste, les nouveaux dilemmes politiques qui émergent dans l’ère post-néolibérale.
Fondamentalement, toute politique de redistribution est aujourd’hui un jeu à somme nulle, ce qui signifie que vous devez aller chercher l’argent qui est déjà là. Or, il y en a beaucoup, et pas seulement dans l’expansion de l’offre monétaire. Par exemple, Apple a 500 milliards de dollars en réserve ! Mais les propositions de Biden sont loin des taux d’imposition élevés de l’après-guerre, que l’on a connus sous Eisenhower ou Lyndon Johnson. Les riches refusent furieusement de tels taux d’imposition, ils ne veulent même pas céder une petite partie de leur richesse. Si cette résistance gagne la bataille, nous risquons d’avoir un autre Donald Trump, car les petites mesures redistributives de Biden ne suffiront pas à calmer le mécontentement de la classe ouvrière américaine. La nouveauté de Biden est qu’il a réalisé, avec d’autres membres de l’establishment néolibéral, que Trump ne vient pas de nulle part, mais qu’il émerge des effets de la mondialisation, de la douleur subie par les travailleurs laissés pour compte. Ainsi, il comprend la nécessité de politiques pragmatiques pour résoudre ces problèmes. Sauf que si celles-ci sont édulcorées, elles risquent de ne pas être suffisantes pour affronter les forces qui ont conduit à l’élection de Donald Trump.
LVSL – Vous avez parlé de l’agoraphobie et du mécontentement des travailleurs, mais l’émergence de la Chine, et les rivalités géopolitiques que cela entraîne, ne sont-elles pas une autre raison de ce changement de paradigme vers le « néo-étatisme » ?
P. G. – Oui, sans aucun doute. La montée en puissance de la Chine et le succès de l’économie chinoise, certes temporairement obscurci par l’affaire Evergrande, sont l’un des principaux moteurs de ce réajustement du mainstream. Cela conduit à abandonner certains principes du néolibéralisme, tels que les politiques monétaristes, et au retour à une gestion keynésienne de la demande avec des dépenses de relance sous forme d’investissements publics. Certains piliers du néolibéralisme tiennent toujours, mais ceux qui ont été le plus affaiblis sont la vénération fanatique des budgets serrés et de la prudence fiscale, d’où le retour d’une gestion keynésienne de la demande.
Le capitalisme d’État chinois a obtenu de bien meilleurs résultats, en termes de productivité, d’innovation ou de prospérité, que le modèle néolibéral de capitalisme. Sous la direction de Xi Jinping, la Chine, après avoir brièvement poursuivi les politiques d’ouverture mises en place par Deng Xiaoping, est revenue à des politiques plus étatistes. D’une certaine manière, la Chine a déjà fait marche arrière face au néolibéralisme. 60 % de l’économie chinoise est directement ou indirectement contrôlée par l’État. Il semble donc que les États-Unis souhaitent ressembler davantage à la Chine, qu’ils veulent un « État activiste », pour reprendre les termes de Boris Johnson. Le Royaume-Uni et les États-Unis sont les deux pays où ces changements sont les plus visibles.
« Contrairement à la Chine, l’État américain ne contrôle pas les entreprises les plus stratégiques de l’économie. Cela signifie que le “néo-étatisme” aux États-Unis ou dans d’autres pays équivaut à un “État sous-traitant”. »
En même temps, il existe des différences significatives entre l’État américain et l’État chinois : l’État américain ne contrôle pas le coeur névralgique de l’économie, c’est-à-dire les entreprises les plus stratégiques, celles qui sont fondamentales pour l’efficacité et la compétitivité du système dans son ensemble, comme les réseaux, l’énergie, la construction… Cela signifie que le néo-étatisme aux Etats-Unis ou dans d’autres pays équivaut à un « État sous-traitant ». Certes, l’État recommence à dépenser et à investir par rapport à l’austérité des années 2010, mais ces dépenses alimentent le marché privé. Les projets financés sont réalisés par des entreprises privées, aux conditions des entreprises privées et à leur profit. Ainsi, cette expansion de l’État ne s’accompagne pas d’une expansion du contrôle politique et démocratique réel sur l’économie comme on pourrait s’y attendre.
LVSL – Une des évolutions contemporaines de l’État que vous avez peut-être moins étudié dans votre livre est le renforcement de la surveillance, notamment depuis la guerre contre le terrorisme et la pandémie de COVID. Ne s’agit-il pas là aussi d’une autre évolution de l’État qui favorise les intérêts des grandes entreprises plutôt que ceux du peuple ?
P. G. – L’État comprend différents appareils. Comme nous le savons depuis Althusser (philosophe marxiste français, connu notamment pour son ouvrage Idéologie et appareils idéologiques d’État, publié en 1970, ndlr), il y a les appareils répressifs, les appareils idéologiques, et le grand phénomène du 20e siècle a été le développement de l’appareil économique de l’État. Historiquement, une part importante de l’appareil répressif est tournée vers la surveillance des activistes et des mouvements de protestation. Il est tout à fait évident que la pandémie a introduit, dans l’urgence, des mesures de surveillance et de contrôle généralisées, par le biais de l’endiguement de la contagion, du contact tracing, de l’État qui dit aux gens ce qu’ils sont autorisés à faire, s’ils peuvent voyager ou non, de la nécessité de se faire tester en permanence, de se faire vacciner…
C’est un élément de l’État qui est assez peu familier à beaucoup de gens, surtout pour ceux d’entre nous qui n’ont jamais traversé de cataclysme majeur ou de conflit guerrier, ou qui n’ont même pas eu à servir dans l’armée pendant un an comme c’était le cas pour nos pères ou nos grands-parents. Dès lors, il est évident que ces formes de surveillance suscitent des réactions de colère. Elles sont en effet perçues par beaucoup comme un intrusion de l’État dans leur vie quotidienne, alors même que l’État a essentiellement renoncé à de nombreuses autres interventions qui auraient été bien plus positives. Ainsi, à mesure que l’appareil économique de l’État reculait sous le néolibéralisme, les structures répressives de l’État étaient renforcées, tandis que, dans le même temps, l’appareil idéologique de l’État s’effaçait ou devenait confus à cause de l’idée de la centralité du marché. Je pense que cela risque de créer un discours de suspicion culturelle à l’égard de l’autorité, sous quelque forme que ce soit, comme on peut le voir dans le mouvement antivax ou anti-masque, qui exprime de la suspicion et de la colère à l’égard de mesures qui, en fait, affectent surtout matériellement certaines personnes, tels que les travailleurs de la restauration ou du tourisme, où les dommages ont été considérables.

Dans ce contexte, je pense que l’attitude stratégique de la gauche devrait être la même qu’après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les travailleurs se sont tournés vers l’État qui leur avait demandé tant de sacrifices et ont dit en gros « maintenant, il est temps que nous soyons récompensés pour nos efforts ». Il était temps que l’État assume financièrement le coût des sacrifices et les difficultés que les gens ordinaires ont subi. Par exemple, à l’automne dernier, Andy Burnham, le maire de Manchester, s’est exprimé très fermement, en demandant à l’État une véritable protection sociale qui vienne compenser les effets économiques néfastes des mesures de distanciation sociale. Telle devrait être l’attitude de la gauche selon moi : au lieu de considérer le contrôle de l’État comme quelque chose à dénoncer pour des raisons éthiques ou juridiques, la gauche devrait le considérer comme quelque chose qui ne peut être accepté que dans la mesure où, en même temps, l’État apporte un soulagement économique. En bref, pas de contrôle étatique sans protection sociale.
LVSL – Voilà qui nous mène aux concepts clés de votre livre : les notions de contrôle et de protection. Dans votre livre, vous affirmez que ces concepts, ainsi que celui de la souveraineté, forment le nouveau sens commun politique actuel. Pourtant, la signification réelle de ces mots fait l’objet d’une lutte entre la gauche et la droite. Comment la gauche et la droite définissent-elles ces concepts ?
P. G. – Ce que je veux dire, c’est que, dans les discours politiques, vous rencontrez des signifiants maîtres, c’est-à-dire des mots qui sont répétés de manière obsessionnelle et sont partagés à travers tout le spectre politique, de la gauche à la droite. Le néolibéralisme s’est accompagné de termes familiers, tels que opportunité, entrepreneuriat, modernisation, ouverture et ainsi de suite. Dans les discours contemporains, les termes sont très différents. Les nouveaux slogans et mots clés sont nombreux, mais les plus importants, selon moi, sont la protection, le contrôle et la souveraineté.
La souveraineté soulève la question de la suprématie de l’État, un principe érodé pendant la mondialisation néolibérale, au cours de laquelle le pouvoir de l’État s’est estompé et celui des entreprises a augmenté. Mais les événements récents ont démontré qu’en réalité l’un et l’autre ne sont pas si distincts : les États sont toujours décisifs lorsqu’il s’agit de jouer le rôle de mécènes du capital, comme nous l’avons vu lors du sauvetage des banques après 2008 ou lorsqu’il s’agit de prendre des mesures pour fournir des produits de première nécessité comme nous l’avons vu lors de la pandémie. La droite présente la notion de souveraineté comme quelque chose d’exclusif qui peut s’exprimer par la souveraineté nationale ou la souveraineté territoriale. Pour la gauche, la suprématie de l’État n’est quelque chose de positif que dans la mesure où celui-ci est l’instrument de la volonté populaire, de la souveraineté populaire. Ainsi, pour la gauche, la souveraineté est une expression de la démocratie plutôt que de l’identité et de l’exclusion.
La protection est peut-être le terme le plus significatif de tous, car c’est celui qui est devenu iconique pendant la pandémie, pensons au slogan « protégez-vous et protégez les autres ». La protection est partout : dans les politiques climatiques (contre les événements météorologiques extrêmes, en plantant des arbres dans les villes ou en protégeant les plages de l’érosion…) dans la protection sociale etc. Pour moi, ce signifiant maître est un champ de bataille à part entière. Quel est le sens de la protection ? Quel type de sécurité les différentes forces veulent-elles mettre en place ? Là encore, vous avez deux récits très différents : l’un est le « protectionnisme propriétaire » de la droite, qui vise à protéger le capital, la richesse et le statu quo. Comme le capital n’a pas beaucoup d’espoir de trouver de nouvelles voies de profits de nos jours, la protection de ce qui est déjà là devient décisive. En parallèle, pour la gauche, la protection consiste à rétablir les formes de protection de base, longtemps considérées comme allant de soi mais qui ont disparu, ainsi qu’à établir de nouvelles formes de protection : de nouvelles mesures contre la pauvreté, face au changement climatique, à établir un nouveau paradigme de Sécurité sociale…
« L’un des risques de ce “néo-étatisme” est l’exacerbation des tendances technocratiques dans la société. »
Enfin, le contrôle a trait à la manière dont l’État se rapporte aux citoyens. L’État est synonyme de contrôle : contrôle des impôts, contrôle du travail, contrôle de la contagion pendant la pandémie… En fait, le contrôle vient de l’invention même de l’art de gouverner au Moyen Âge. Là encore, il y a différents paradigmes : pour la droite, le contrôle est lié au contrôle territorial, à l’exclusion, au maintien de certains flux à l’extérieur, notamment les migrants. Pour la gauche, le contrôle consiste à planifier, à déterminer l’avenir après des années où l’on vous a dit qu’il n’y avait pas besoin de plan car le marché déciderait. Mais la planification ne peut être progressiste que si elle est démocratique. En effet, le retour de la planification a également vu le retour de la technocratie. L’un des risques de ce « néo-étatisme » est l’exacerbation des tendances technocratiques dans la société. Ainsi, pour éviter de nouvelles formes de suspicion envers l’État, il est indispensable de créer de nouvelles formes de participation démocratique qui permettent aux gens de prendre des décisions collectivement. Ce pouvoir ne doit pas être laissé aux experts, qui peuvent aider tel ou tel intérêt.
LVSL – Lors du référendum sur le Brexit, le slogan de la campagne Leave était « Take back control ». À l’époque, la gauche avait une position défensive, puisqu’elle faisait campagne pour rester dans l’UE. Dans votre chapitre sur la notion de souveraineté, vous affirmez que même si la gauche promeut parfois des concepts comme la souveraineté alimentaire ou la souveraineté énergétique, lorsqu’il s’agit de libre-échange et de mondialisation, elle semble beaucoup plus modérée. Plus largement, il semble parfois que la droite ait davantage embrassé le protectionnisme que la gauche. Comment l’expliquez-vous ?
P. G. – D’abord, parce qu’il y a longtemps eu un débat très confus sur le protectionnisme au sein de la gauche, pour savoir si elle devait tactiquement se ranger du côté du libre-échange ou du protectionnisme. Dans un discours très célèbre en 1848, Karl Marx disait en substance : « Je suis pour le libre-échange parce qu’il va accélérer la chute du capitalisme ». En d’autres termes, le libre-échange amènera le capitalisme à ses contradictions et créera donc les conditions d’une révolution.
D’autre part, il ne s’agissait pas seulement d’une question de doctrine pour la gauche, mais aussi du fait que les travailleurs européens étaient souvent plus favorables au libre-échange qu’au protectionnisme pour des raisons très matérielles : comme nous le savons, le protectionnisme a tendance à affecter la consommation en augmentant les prix des produits de base. Par conséquent, pour les travailleurs, il s’agit d’une perte immédiate de pouvoir d’achat, qui était déjà maigre. En ce sens, le protectionnisme a toujours été une question difficile pour la gauche, alors que pour la droite, il pouvait correspondre à leur agenda nationaliste, ou aux intérêts des industries protégées. Les entreprises protégées par des droits de douane, des quotas et des barrières réglementaires ont en effet un intérêt direct au protectionnisme.
« Le protectionnisme a toujours été une question difficile pour la gauche. »
Personnellement, j’ai un regard pragmatique : oui le libre-échange peut être bénéfique pour certaines choses, il est indéniable qu’il peut apporter des avantages aux producteurs et aux consommateurs, mais le commerce sans droits de douane que nous connaissons actuellement, qui est sans précédent dans l’histoire, a des effets extrêmement perturbateurs. Cette perturbation est surtout ressentie par les secteurs les plus fragiles de l’économie, en particulier dans les zones périphériques ou rurales, où se trouve aujourd’hui l’essentiel de l’industrie manufacturière. En revanche, la plupart des services ne sont pas autant exposés à la concurrence internationale que l’industrie manufacturière, car tout ne peut pas être délocalisé et produit à l’étranger.
Je pense que la gauche socialiste devrait récupérer certaines formes légères de protectionnisme commercial, tant en termes d’application de droits de douane qu’en termes de réglementation, afin d’empêcher le nivellement par le bas que nous avons sous les yeux. Comme nous le savons tous aujourd’hui, de nombreux biens sont produits avec d’énormes dommages environnementaux et par des personnes ayant des salaires extrêmement bas. L’idée de « protectionnisme solidaire » promue par Mélenchon est un pas dans la bonne direction, puisqu’elle préconise de redéfinir les limites et les critères du commerce mondial.
LVSL – Vous avez dit que deux des raisons qui peuvent expliquer pourquoi la gauche craint le protectionnisme sont la doctrine héritée du marxisme et le fait que le libre-échange sert parfois les intérêts consuméristes de la classe ouvrière. Mais ne pensez-vous pas qu’il y a aussi une sorte de cosmopolitisme superficiel au sein de la gauche qui l’amène à considérer que le protectionnisme est mauvais parce qu’il est associé à la volonté de la droite de fermer les frontières par exemple ? On a l’impression que la gauche rejette le protectionnisme car elle se concentre sur les aspects culturels du protectionnisme plutôt que sur son aspect économique. Qu’en pensez-vous ?
P. G. – Avec le référendum sur le Brexit, la gauche s’est retrouvée divisée : la grande majorité du parti travailliste soutenait le maintien dans l’Union européenne, même s’il y avait aussi une composante Lexit (raccourci pour « left exit », c’est-à-dire pour une sortie de l’Union européenne autour d’objectifs de gauche, ndlr) assez minoritaire. Dans l’électorat travailliste cependant la division était plus prononcée : quelque chose comme 30/70 (en 2016, environ un tiers des électeurs travaillistes ont voté pour le Brexit, ndlr). C’était un scénario cauchemardesque pour la gauche, car nous étions alors dans une période de fortes critiques à l’encontre de l’Union européenne, suite à l’austérité imposée dans de nombreux pays. N’oublions pas que le référendum grec de juillet 2015, un énorme moment de confrontation entre un gouvernement de gauche et l’Union européenne, avait eu lieu juste un an auparavant. Par conséquent, pendant la campagne du Brexit, la gauche s’est retrouvée à défendre l’ordre établi sous la bannière du « Remain and reform », même si la seconde partie du slogan n’a jamais été claire. Je pense que cet épisode illustre plus généralement une certaine difficulté de la gauche à formuler des demandes claires vis-à-vis de l’Union européenne. Pourtant, à cette époque, il y avait un groupe de partis de gauche autour de gens comme Varoufakis et Mélenchon, qui disaient en gros « nous devons réformer radicalement l’Union européenne, et si cela ne se produit pas, alors la sortie de l’Union européenne sera légitime ».
À lire également sur LVSL, l’article de William Bouchardon : « À Liverpool, le Labour déchiré par le Brexit »
La gauche a eu du mal à se rassembler autour d’un plan consensuel, à s’unir autour de ce qui devrait être entrepris pour rendre l’Union européenne plus acceptable. Dans le livre, lorsque je parle de l’Union européenne, je n’adopte ni une position pro-sortie, ni la défense de l’Union européenne actuelle. À certains égards, l’Union européenne joue certaines fonctions de coordination entre les États membres, qui, dans la phase historique actuelle, sont peut-être inévitables. Mais, dans le même temps, elle est une source majeure d’illégitimité politique, d’absence de contrôle démocratique. L’Union européenne a été le moyen par lequel les élites nationales ont imposé à leurs citoyens des mesures très impopulaires sous prétexte qu’elles étaient recommandées par Bruxelles. Cette question, en fin de compte, a hanté la gauche britannique et a été la principale cause de la chute de Corbyn : s’il y avait eu un débat ouvert sur l’Union européenne, les choses seraient probablement très différentes aujourd’hui.
LVSL – La campagne du Brexit nous a aussi montré que la droite invoque souvent les notions de nation et d’État et parle de patriotisme et de nationalisme comme si c’était des synonymes. Mais, comme vous le rappelez dans votre livre, ce ne sont pas des synonymes et l’idéal du patriotisme vient historiquement de la gauche. Pourtant, la gauche ne semble plus très disposée à invoquer ce concept. Pourquoi ?
P. G. – L’approche de la gauche vis-à-vis de la nation est une question stratégique clé, car c’est un enjeu sur lequel elle a constamment adopté une position défensive. Même lorsque la gauche n’a pas une vision cosmopolite et élitiste de la nation, elle ne parvient souvent pas à articuler positivement ce que sont la nation et son identité. De nos jours, la gauche a souvent cette croyance erronée que les États-nations sont en quelque sorte un phénomène anachronique ou résiduel. En d’autres termes, les États seraient toujours là et ce pour encore un certain temps, mais ils auraient de moins en moins d’importance. Nous avons pourtant assisté à un renouveau des identités nationales à tous les niveaux ces dernières années : durant les mouvements de protestation contre l’austérité, dans le retour de l’interventionnisme étatique… Pendant la pandémie, nous avons vu une explosion des sentiments patriotiques, sous la forme d’un patriotisme isolationniste, lorsque les citoyens ont senti que leur nation était en difficulté et qu’ils devaient tous se plier aux règles.
En fait, l’histoire de la gauche commence avec les luttes de libération nationale. Le patriotisme était alors compris dans le sens suivant : le peuple définit la communauté politique, qui doit s’émanciper et s’auto-gouverner. C’est quelque chose que les marxistes et les républicains avaient en commun. En définitive, l’idée moderne de la nation vient des Jacobins, qui sont en quelque sorte les pères fondateurs de la gauche. Il est donc surprenant que la gauche ait tant de mal à traiter cette question de la nation. J’estime que bâtir un sentiment d’identité, un sentiment d’appartenance est fondamental pour articuler une vision progressiste. Car, en fin de compte, lorsque la gauche promeut un idéal de ce qui serait l’avenir d’une communauté, cela se joue invariablement au niveau de l’État. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’intérêts de classe, ou que tout le monde est d’accord et s’unit, mais que la gauche doit toujours articuler différents intérêts autour de l’idée d’une société commune.
« L’idée moderne de la nation vient des Jacobins, qui sont en quelque sorte les pères fondateurs de la gauche. »
Je pense aussi qu’il y a beaucoup de confusion au sein de la gauche entre internationalisme et globalisme. La position standard de la gauche, comme Marx et Engels l’ont dit dans le Manifeste du Parti communiste, était la fraternité entre tous les peuples du monde. Mais si la classe ouvrière est internationale, elle doit d’abord mener des luttes au sein de chaque nation. J’invite donc la gauche à être moins hystérique lorsqu’il s’agit de l’identité et de la question nationale, parce que cette attitude est exploitée par la droite pour dire que les gauchistes sont des citoyens de nulle part, sans ancrage, sans fondement, qu’ils ne sont pas responsables devant un peuple.
LVSL – Tout à l’heure, lorsque nous avons parlé de la souveraineté, vous avez dit que la gauche a perdu la plupart de ses soutiens parmi les ouvriers de l’industrie en raison de sa position sur le libre-échange. Dans votre livre, vous consacrez un chapitre entier aux nouvelles coalitions de classe de la gauche et de la droite. Vous semblez être d’accord avec Piketty, qui décrit ce qu’il appelle une « droite marchande » et une « gauche brahmane ». Pouvez-vous expliquer ce que signifient ces concepts ?
P. G. – J’essaie de clarifier cette question avec mon schéma du soutien des classes aux différents partis politiques, car il existe une perception erronée selon laquelle les allégeances de classe se sont inversées. Selon certains, la gauche représentait auparavant la classe ouvrière et la droite la classe moyenne et que maintenant, ce serait l’inverse. Cette analyse est trop simpliste. Ce que je montre avec ce schéma, c’est que la classe ouvrière et la classe moyenne sont divisées en deux parts, qui, dans une large mesure, peuvent s’expliquer par le clivage rural/urbain. Chez une partie de la classe ouvrière, principalement les travailleurs pauvres dans les services qui sont très exposés à l’exploitation (agents de nettoyage, livreurs, transporteurs, soignants…), la gauche a marqué des points ces dernières années. C’est l’une des rares bonnes nouvelles concernant le rapport de la gauche avec la classe ouvrière.
Mais dans le même temps, de nombreux travailleurs dans les emplois manufacturiers se sont éloignés de la gauche. Je ne suis pas d’accord avec l’argument courant selon lequel ces personnes ont cessé de soutenir la gauche pour des raisons culturelles, parce qu’elles sont préoccupées par l’immigration, parce qu’elles veulent protéger la famille traditionnelle, ou je ne sais quoi. Au contraire, ces personnes ont tourné le dos à la gauche, parce que, comme l’a également dit Piketty, elles ne se sentent plus protégées par elle. Ils ont le sentiment que la gauche les a sacrifiés sur l’autel du libre-échange et de la mondialisation parce que cela convenait aux classes moyennes urbaines. Le seul moyen de récupérer cette partie de la classe ouvrière est de concevoir des politiques publiques autour du développement régional, du rééquilibrage territorial, de bonnes rémunérations pour les emplois manuels bien rémunérés, que l’État offre des emplois manuels qualifiés et sécurisés, etc. Sinon, il est évident que ces travailleurs iront voter à droite pour des raisons matérielles, en raison de ses postures contre la mondialisation.
LVSL – En effet. Le magazine Jacobin a récemment publié un sondage réalisé par Yougov dans lequel était étudiée la réaction de la classe ouvrière vis-à-vis de différents messages politiques. Selon cette étude, le programme que vous avez décrit (développement régional, création de nouveaux emplois…) avait beaucoup plus de chances de remporter leurs votes qu’un discours axé autour des guerres culturelles et identitaires.
P. G. – Je pense que nous avons malheureusement tendance à tout interpréter par le prisme des identity politics de nos jours. Cela a conduit à des conflits très vicieux entre ceux qui seraient prétendument « culturellement progressistes » et ceux qui seraient « culturellement conservateurs ». Mais, cette guerre n’implique pas vraiment la classe ouvrière, elle occupe surtout les classes moyennes. Il est vrai que les travailleurs vivant en dehors des grandes villes peuvent avoir une vision plus conservatrice, et cela a toujours été le cas. Mais dans le passé, la gauche avait une offre économique suffisamment séduisante pour que ces personnes mettent de côté leurs préoccupations culturelles ou sociétales. En votant pour la gauche, ils pouvaient obtenir quelque chose que la droite ne pouvait leur donner. Quelque part, c’est ce qu’il nous faut aujourd’hui. Il n’y a aucun espoir de reconquérir ces personnes en attaquant les immigrants ou en adoptant un patriotisme très superficiel, sans aucun fond en matière économique, comme c’est par exemple le cas de Keir Starmer (leader de l’opposition travailliste, ndlr) ici au Royaume-Uni.