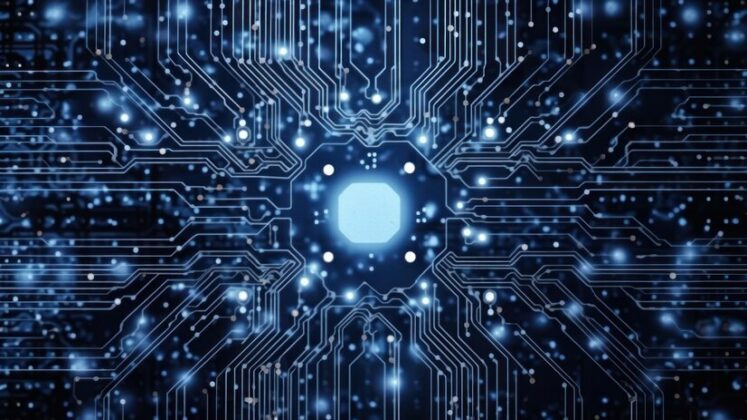Le 16 août 2012, dans les mines de platine de Marikana, la police sud-africaine massacrait 34 grévistes, en coordination avec la direction de la multinationale britannique Lonmin. Cette tuerie a été présentée par la presse occidentale comme une affaire exclusivement « sud- africaine », relative à l’intensité des conflits sociaux du pays. Une lecture qui passe sous silence l’insertion des mines de platine d’Afrique du Sud dans les chaînes de production globales. Les bénéfices de « l’or blanc », essentiel à la « transition écologique » que les gouvernements occidentaux prétendent impulser, se paient en coûts environnementaux et en violences multiformes sur les lieux de son extraction. Dix ans plus tard à Marikana, rien ne semble avoir changé. Ni pour les mineurs qui risquent leur vie pour de faibles salaires, ni pour les communautés qui vivent dans des baraquements en tôle à proximité des mines, dans un environnement pollué. Reportage.
Un métal pour un futur plus vert : c’est ainsi qu’est présenté le platine par le World Platinum Investment Council. Essentiel à la fabrication des catalyseurs automobiles – conçus pour limiter les émissions de CO2 -, des semi-conducteurs et des alliages magnétiques pour les disques durs, son importance continue de croître avec la « transition numérique » qui se profile en Europe. À Maditlokwa, dans la région de Marikana, « l’or blanc » évoque immédiatement une tout autre réalité. Après l’ouverture de la mine, en 2008, « les femmes victimes de fausses couches ont été de plus en plus nombreuses. Nous avons fini par comprendre que l’eau, polluée par les activités minières, en était la cause. », témoigne Cicilia Manyane, présidente de l’association Mining Host Communities in Crisis Network (MHCCN) qui rassemble plusieurs membres de la communauté.
Plusieurs études ont documenté le lien entre extraction minière dans la région et pollution de l’eau – du fait de l’usage de produits chimiques lors de l’extraction et du raffinage des minerais, du dépôt de déchets miniers et d’investissements insuffisants de la part de l’entreprise pour en prévenir les effets. « Légalement, nous ne devrions pas consommer l’eau qui arrive dans nos robinets. Nous ne devrions même pas nager dedans », continue-t-elle.

Tharisa, l’entreprise minière qui opère dans le village, affirme avoir fourni aux communautés locales un accès régulier à l’eau. L’expérience quotidienne permet aux habitants de constater sa dangerosité. « Lorsque nous faisons bouillir de l’eau, un dépôt blanc apparaît – comme si le lait tournait dans le thé », commente Christina Mdau, secrétaire du MHCCN – preuve à l’appui. « Rien n’a changé ».
La pollution de l’eau générée par les activités minières n’est que l’une des nombreuses récriminations adressées par les habitants et les travailleurs à l’égard des entreprises du platine. En août 2012, ces revendications ont été portées lors d’une grève violemment réprimée par la police. Plus de trente grévistes ont été tués lors du « massacre de Marikana », devenu le symbole des luttes sociales et environnementales dans le secteur minier. « Rien n’a changé », nous répète-t-on, depuis cette tuerie.
Économie politique de « l’or blanc »
La presse internationale a insisté sur les déterminants nationaux du massacre de 2012 : violence de la police, intensité des conflits sociaux, implication sulfureuse de Cyril Ramaphosa – actionnaire de la multinationale Lonmin, figure clef de la politique sud-africaine et aujourd’hui président du pays. À la veille du massacre, dans un échange de mails avec la police, ce dernier avait qualifié les grévistes de « criminels » et affirmé s’engager auprès du ministère de l’Intérieur afin qu’une action soit prise en conséquence. Si la répression fut indéniablement le fait de la police sud-africaine, il est impossible de comprendre ce climat incandescent de tensions sociales sans prendre en compte les caractéristiques de l’industrie du platine.
L’année du massacre, celle-ci connaît une perte de profitabilité. Les multinationales du platine subissent alors le contrecoup du processus de financiarisation entamé dans la période post-apartheid, qui leur avait au départ tant bénéficié. La chercheuse Samantha Ashman résume : « Depuis 1996, l’ANC [African National Congress, le parti au pouvoir depuis l’élection de Nelson Mandela NDLR] a réduit le contrôle sur les capitaux et les échanges, et permis aux conglomérats de déplacer leurs cotations en bourse à l’étranger ». Cette ouverture du pays aux marchés financiers internationaux était censée permettre un accès facilité à des financements et capitaux étrangers. Les actionnaires de Lonmin, d’Anglo-American et d’Impala, les trois maîtres du platine, ont d’abord connu des années fastes. Tant que d’importants profits étaient dégagés et que les agences de notation certifiaient la rentabilité de l’industrie, les capitaux continuaient à affluer. Puis la conjonction de la chute du cours du platine, des rendements décroissants des activités minières – le platine se raréfiant et nécessitant davantage d’investissements pour être extrait – et plus largement de la crise de 2008, ont fait baisser les taux historiques de retour sur investissement de 30 % à près de 15%.
La dépendance aux actifs étrangers impliquait que les géants du platine retrouvent rapidement leurs marges antérieures pour rassurer investisseurs, prêteurs et agences de notation. Afin de préserver leur accès aux marchés financiers, ils ont promis des taux de retour sur investissement « absolument irréalisables ». Leur modèle : « distribuer et réduire » (distribute and downsize), soit continuer à distribuer des revenus conséquents aux actionnaires tout en réduisant le nombre de travailleurs, licenciés par milliers après 2008. La pression comptable liée à l’évasion fiscale aux Bermudes de plusieurs centaines de millions de rand par an, documentée par Dick Forslund, n’a rien arrangé à la chose.
C’est dans ce contexte que les conflits sociaux se sont multipliés dans la ceinture de platine – une bande traversant l’Afrique du Sud d’Est en Ouest où l’on trouve une grande quantité de ce métal précieux. Pour la première fois, ils se sont déroulés en-dehors du cadre des organisations traditionnelles. Le syndicat majoritaire, la NUM, alliée historique de l’ANC, avait été discrédité auprès des travailleurs miniers par son refus d’engager une action frontale contre la société minière. La grève qui s’annonçait pour le mois d’août 2012 à Lonmin tranchait avec les conflits antérieurs. D’une part, les travailleurs qui portaient la revendication d’un salaire « de survie » de 12,500 rands – plus du double de leur revenu de l’époque – étaient déterminés à lutter jusqu’à obtenir gain de cause. De l’autre, l’entreprise minière, sous une pression internationale intense, était déterminée à rétablir le rythme de production. Tout était réuni pour que le conflit débouche sur une répression violente.

Le 16 août 2012, à l’issue d’une grève « sauvage », la police sud-africaine ouvrait le feu sur les mineurs en train de se disperser. La médiatisation du massacre, qui a fait la part belle aux images insoutenables de grévistes mitraillés, tend à faire apparaître ce conflit comme une affaire intégralement sud-africaine. La vulnérabilité des entreprises du platine à l’égard des marchés financiers et la politique de licenciements et de compression des salaires qui en résulte en temps de récession, est pourtant une affaire transnationale. Au lendemain de Marikana, l’agence Moody’s avait averti : accepter une « augmentation des salaires » généralisée des travailleurs de la mine aurait « des effets négatifs en termes d’accès aux crédits pour les entreprises minières ». De fait, Lonmin a connu un lent dépérissement les années suivantes en raison des concessions finalement accordées aux grévistes, qui ont enclenché un cercle vicieux de retrait des actionnaires et de dévalorisation boursière. La multinationale a fini par être vendue en 2018 après avoir perdu 98% de sa valeur…
Alors que l’on commémore les dix ans du massacre, aux pieds de la colline où s’étaient retirés les travailleurs en grève, les trente-quatre croix qui avaient été érigées en hommage aux victimes ont disparu. Siphiwe Mbatha, co-auteur avec Luke Sinwell d’un livre sur les événements de 2012, y voit la manifestation d’un rapport de force toujours aussi défavorable aux travailleurs de la mine.
Permanence des conflits sociaux
La plaine, traversée par les pylônes électriques qui alimentent la mine, est bordée de campements informels composés de baraquements en tôle ondulée, sans eau courante, dans lesquels résident la majeure partie des travailleurs qui se relaient dans les puits et les fonderies. L’air est chargé de poussière, soulevée par l’activité dans les décharges de gravats et le va-et-vient incessant des pick-ups sur les routes en terre battue. Les relations avec les services de sécurité de la mine sont toujours aussi exécrables. Et le spectre de la violence, toujours présent. En juin dernier, une militante qui défendait les communautés locales a été abattue sur le pas de sa porte, tandis qu’un syndicaliste a été assassiné dans la ville voisine de Rustenburg, suite au déclenchement d’une importante grève.
Le démantèlement de Lonmin et son rachat en 2018 par la sud-africaine Sibanye-Stillwater auraient pu faire espérer une amélioration dans les conditions de travail et de vie des habitants. Il n’en a rien été. La revendication d’un « salaire de survie » de 12,500 rands a bien été satisfaite. Mais l’inflation galopante (près de 50 % depuis 2013) contribue à relativiser cette augmentation, de même que l’endettement croissant des travailleurs, y compris à l’égard de leur employeur. Ces gains ne concernent pas les travailleurs contractuels, exclus des structures de négociation collective et systématiquement moins bien payés que leurs collègues directement employés.

Si la prévention des maladies telles que la silicose et la tuberculose a fait des progrès, les travailleurs portent le poids d’années de travail sans protection. Ces enjeux ne sont pas propres à la région de Marikana. Les statistiques sud-africaines font état de conditions de santé dégradées pour l’ensemble des travailleurs du secteur minier. David Van Vyk, chercheur pour la Bench Marks Foundation, est catégorique. « Dans La situation de la classe ouvrière en Angleterre, Engels rapporte qu’au XIXème siècle les ouvriers avaient une espérance de vie qui s’échelonnait entre 40 et 60 ans. Nous sommes au XXIème siècle et c’est aujourd’hui la condition des travailleurs des mines en Afrique du Sud ». Une étude, menée sur 300.000 Sud-Africains de 2001 à 2013, fait état d’un taux de mortalité supérieur de 20 % à celui du reste de la population pour les ex-mineurs…
Les membres du syndicat AMCU (Association of Mineworkers and Construction Union – le syndicat désormais majoritaire dans la région) mettent en cause la politique de logement de l’entreprise Sibanye-Stillwater. Certains mineurs continuent de vivre dans des hostels, ces habitations collectives où les travailleurs, qui partagent leurs chambres, sont soumis au contrôle des horaires d’entrée et de sortie. Jusqu’en 2020, les invitations de personnes extérieures à la mine demeuraient interdites. Elles sont aujourd’hui autorisées, mais seulement pour un temps limité. Un mineur peut obtenir une chambre individuelle pour y recevoir sa femme, pour la durée maximale d’un mois. « Ils nous considèrent comme des esclaves », commentent-t-ils. Bien sûr, les travailleurs sont libres de refuser d’habiter ces hostels… à condition, bien souvent, d’accepter de vivre dans les baraquements informels, comme ceux du village de Maditlokwa.
Les membres de l’organisation Mining Host Communities in Crisis Network, dénoncent la pollution et la dégradation des conditions de vie aux abords de la mine. Ils pointent du doigt la responsabilité de l’entreprise Tharisa, accusée de violer systématiquement ses engagements.
La mine, qui a pourtant déplacé les habitants du village il y a quelques années, continue de grignoter sur leurs terres. Elle décharge désormais ses gravats juste en face de l’école primaire, soulevant des nuages de poussière, et installe ses grillages électriques à quelques mètres des habitations. « Nous avons toujours peur qu’un enfant, inconscient du danger, soit électrocuté », témoigne un habitant. L’air est chargé de dioxyde de soufre, de dioxyde d’azote et de poussière. Les habitants souffrent de sinusites chroniques et de maladies respiratoires. Dans la région, les raffineries et les excavations à ciel ouvert ont systématiquement dépassé les taux de pollution de l’air réglementaires, même lorsque ces derniers sont graduellement augmentés, bien au-delà des recommandations internationales, comme l’ont documenté les rapports de la Bench Mark Foundation.

Les entreprises profitent du flou juridique de la législation sud-africaine. Depuis 2002, la loi responsabilise les entreprises pour les dégradations environnementales causées par leurs opérations. Mais elle est plus ambiguë sur le cas des communautés déplacées par les activités minières – comme ce fut le cas des habitants de Maditlokwa : de simples « compensations » sont évoquées, sans en préciser la nature. De même, les obligations sociales des entreprises ne sont pas clairement définies – en particulier sur la question du logement. Des documents intitulés Social and labour plans (SLP), censés impliquer dans leur rédaction les communautés locales, les syndicats et les autorités municipales, détaillent leurs engagements sociaux et environnementaux. Le Département des ressources minières et de l’énergie est chargé d’évaluer leur respect pour renouveler les concessions minières. Ces obligations légales donnent lieu à des haussements d’épaules de la part des habitants. L’entreprise Sibanye-Stillwater avait été autorisée à racheter Lonmin en 2018 par les autorités sud-africaines, à condition d’appliquer les SLP de celle-ci, qui prévoyaient entre autres la construction de plusieurs milliers de logements. Pourtant, les engagements les plus récents pris par l’entreprise n’incluent aucun objectif chiffré en la matière. Elle a récemment refusé de fournir les documents attestant le respect de ses SLP à Amnesty International après avoir promis de les rendre publics.
Délocaliser la pollution
Les métaux du groupe du platine (MGP), parmi lesquels on trouve le platine, le palladium, ou l’irridium, occupent un rôle essentiel dans la « transition écologique » – comme c’est par ailleurs le cas de nombreux métaux rares – : ils permettent la production de catalyseurs automobiles qui réduisent les émissions. Une part croissante de ces métaux est dirigée vers le secteur numérique : ils permettent d’améliorer les capacités de stockage des disques durs et le rendement des data centers. Le conflit ukrainien n’a fait qu’accroître la centralité de l’Afrique du Sud dans la production de MGP : premier fournisseur mondial, son principal concurrent demeure la Russie, à présent frappée par de sévères sanctions.
La transition écologique des pays du Nord aura-t-elle pour contrecoup l’accroissement de la pollution dans l’autre hémisphère ? Le coût énergétique de l’extraction de platine n’est en effet pas négligeable. Il n’a fait que s’accroître avec le temps : en raison de la profondeur croissante des gisements, il fallait en 2010 entre quatre et dix fois plus d’énergie pour l’extraction d’une quantité similaire qu’en 1955, selon l’étude de deux universitaires australiens. Ceux-ci notent que l’extraction des MGP émet en moyenne près de quatre fois plus de CO2 que celle par exemple de l’or, en raison notamment de « la prévalence du charbon dans le mix énergétique sud-africain ».

Plus qu’une forme de greenwashing, les entreprises du numérique et de l’automobile pratiquent une délocalisation du coût environnemental de leurs équipements. Ainsi, leurs filières « zéro émission nette » sont tributaires de l’extraction de matières premières au coût environnemental accablant, qui ne sont pas prises en compte dans leurs calculs…
Le platine de Marikana est issu d’une chaîne de production qui relie l’industrie suédoise (Atlas Copco, Sandvig) – laquelle fournit les équipements pour percer la roche et les camions pour transporter les gravats – aux concessionnaires transnationaux (Lonmin, Amplats, Implats) et sud-africains (Sibanye, Tharisa). Après l’extraction et le raffinage, la chaîne s’étend aux premiers acheteurs de platine, comme l’allemand BASF, le britannique Johnson Matthey et la belge Umicore, à leurs clients dans l’industrie automobile (Volkswagen, BMW…), à leurs actionnaires dans le Nord du monde.
À de rares exceptions près, les ONG et mouvements écologistes européens ignorent l’étendue de cette chaîne de production, et se contentent de pointer du doigt le coût environnemental de la production à l’intérieur des frontières du Vieux continent.1
De même, les objectifs de « neutralité carbone » des pays européens ne prennent pas en compte la pollution importée. Si les rapports de la Commission européenne lient transition « écologique » et « numérique », ils oublient que la seconde se fera très probablement au prix de l’intensification de l’extraction de platine en Afrique du Sud, et de ses risques de pollution et de violences.
Notes :
1 On mentionnera cependant la campagne Plough Back our Fruits, menée par un collectif sud-africain et allemand, centrée autour de la responsabilité de BASF, géant de la manufacture bavarois et premier client de Lonmin, parcourant les chaînes de responsabilité transnationale dans le massacre. Ou les rapports de plusieurs ONG suédoises, dénonçant l’implication de leur industrie automobile.