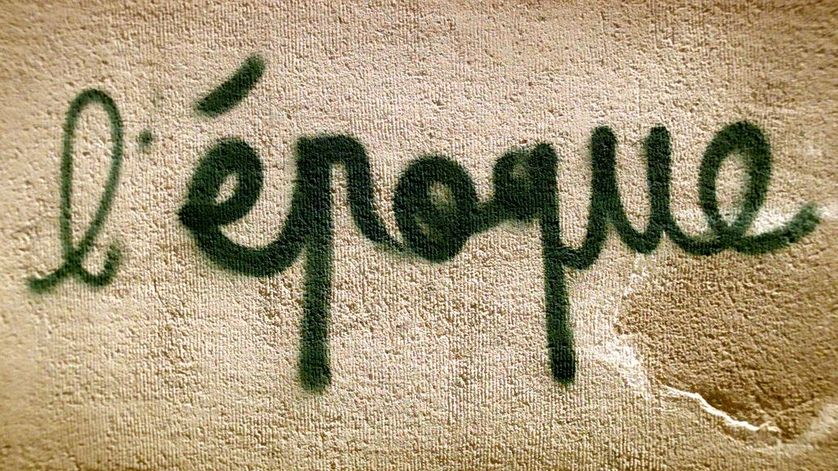Pour son premier long-métrage, Matthieu Bareyre a réalisé un documentaire appelé “L’Époque” dans lequel il part à la rencontre de jeunes qu’il filme la nuit dans les rues de Paris, des attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015 jusqu’à l’élection d’Emmanuel Macron au printemps 2017.
Nous l’avons rencontré pour comprendre d’où lui était venue l’idée de ce film et ce qu’il pouvait représenter aujourd’hui. Première partie de l’entretien réalisé par Pierre Migozzi et retranscrit par Adeline Gros.
LVSL – C’est quoi L’Époque?
Matthieu Bareyre – « C’est nous le Grand Paris », « c’est une classe bien sage ». C’est un film maintenant.
LVSL – Avant qu’on s’interroge sur la manière dont vous avez fait ce film et pourquoi vous l’avez fait, que représente-t-il pour vous ? Pourquoi il porte ce nom-là ?
MB – Je n’avais pas envie que mon premier film se concentre sur un détail, sur une petite partie du monde qui était le mien, ou sur un personnage. J’avais envie de prendre la mesure de tout ce qui m’entourait, en me demandant « dans quoi je vis ? Dans quoi vivons-nous ? ». D’un côté, il y avait la liberté des jeunes, ou en tout cas à laquelle aspire en général la jeunesse. Et de l’autre, il y avait un cadre : Paris, le Grand-Paris, qui me paraissait très peu propice à donner de l’ampleur à cette liberté, à répondre à ce désir de liberté.
Une des questions que j’ai posées au gens dans la rue était : « qu’est-ce qui vous empêche de dormir ? ». Et pour moi, L’Époque est un peu tout ce qui nous empêche de dormir. C’est à la fois une question, « c’est quoi l’époque ? » – que je me posais et que je pose à Rose au début du film – et un pressentiment que c’était forcément contradictoire avec la réalisation de soi. Il y avait une phrase de Mallarmé « On traverse un tunnel – l’époque – ».
LVSL – Quand vous commencez à travailler sur ce projet, vous pressentiez donc quelque chose ?
MB – Oui. À la fois je pressentais qu’énormément de choses allaient bouger, c’est la bascule que représente Charlie. Et en même temps c’était que j’avais maintenu en moi vivaces des sentiments qui m’ont traversés depuis l’adolescence et qui étaient liés au fait d’être jeune : une insatisfaction, « c’est quoi ce monde qu’on nous lègue et qui est totalement ingérable ? ». Une insatisfaction vis-à-vis de mes aînés.
« Dans mon film, il n’y a pas de pères, pas d’aînés, ça n’existe pas, il n’y a que la vie des jeunes, tels qu’ils sont, livrés à eux-mêmes »
Quand j’ai décidé à 26 ans de faire du cinéma, spontanément j’ai essayé de me tourner vers des pères, de trouver des pères de cinéma, masculin ou féminin, des aînés, des figures tutélaires, des personnes qui pourraient m’apprendre ou m’inspirer. Je me suis rendu compte que je n’en trouvais pas, qu’il y avait comme une sorte de cassure dans la transmission. Les seuls qui m’inspiraient, qui me donnaient envie d’en faire, étaient des grands-pères. C’était Marker, Godard, Rivette, Chabrol, la Nouvelle Vague et même des réalisateurs d’avant la Nouvelle Vague qui étaient déjà morts depuis longtemps. Donc c’étaient soit des grand-pères soit des fantômes, donc des gens qui ne faisaient plus du tout partie de mon monde. Rien de présent. Personne de présent pour moi.
Au bout d’un moment, j’ai eu envie de faire un film qui montrerait une jeunesse. Dans mon film, il n’y a pas de pères, il n’y a pas d’aînés, ça n’existe pas, il n’y a que la vie des jeunes, tels qu’ils sont, livrés à eux-mêmes. Et ça, je pense que c’était très important pour moi, je voulais pas de vieux quoi. Au bout d’un moment, j’ai pris une décision personnelle, intime, en me disant « puisque je ne trouve pas de père, et bien je vais faire sans ». Et je pense que ce film c’est aussi la conséquence de ça.

LVSL – C’est cette volonté d’entériner cette non-présence – non pas absence parce que si on parle d’absence, ça signifie qu’il y a eu présence – de ces figures tutélaires dans votre monde qui vous a guidé ? Ou ce qui prédominait c’était de faire un film sur la jeunesse, sur Paris la nuit, les événements, capter l’air du temps, voire tout ça à la fois ?
MB – J’avais des idées assez simples à l’origine du film, j’avais ce titre L’Époque. Il y avait la musique de Vivaldi, l’envie de filmer des libérations dans la nuit. Mais je pensais surtout le film comme un endroit où je pourrai m’exprimer pleinement. Si je regarde un peu avant dans ma vie, on ne m’a jamais donné la possibilité de m’exprimer vraiment. Finalement, la question n’est pas ce que pense ou dit l’auteur. Plutôt les sentiments qui me traversaient, que je sentais chez les autres et donc que je sentais chez moi. Je n’ai jamais eu un endroit où mettre tout ce que je sentais. Donc dans ce film, j’ai eu envie d’y mettre tout ce que je n’avais jamais pu dire, tout ce que je n’avais jamais pu montrer, tout ce qui était compliqué de partager parce qu’on ne nous laisse pas la possibilité de nous exprimer. Et ça prend des chemins très pervers, la façon dont on nous tient un peu dans le silence ou en tout cas quand on nous demande de dire des choses qui nous ressemble pas.
« Je voulais attraper plein de petites choses qui seraient inventées par ma génération, presque comme une enquête sur ce que notre jeunesse est en train de mettre en place »
Je voulais vraiment un film qui soit profondément fidèle à ce que je ressentais, du début jusqu’à la fin, qui étaient des choses, des sentiments très anciens en moi. C’était l’idée d’y mettre tout ce que je n’étais pas censé dire, tout ce que j’avais envie de remettre en question, tout ce que j’avais envie de casser. Dans ce film, je ne voulais mettre que des choses qui me semblaient neuves, des choses que moi je n’avais jamais vues. Au montage avec Isabelle Proust, on se posait toujours la question de « est-ce que cette image-là, on l’a déjà vue ? Est-ce que cette parole-là, on l’a déjà entendue ? ». On dit toujours que notre génération n’a rien inventé, on a tous entendu « vous comprenez, nous on a fait Mai 68… ».
Donc je voulais attraper plein de petites choses – des visages, des gestes, des paroles, des façons de s’approprier la ville – qui seraient en fait inventées par ma génération et que personne n’aurait encore vues, presque comme une enquête sur ce que notre jeunesse est en train de mettre en place. Ce n’est pas quelque chose de visible, de spectaculaire, ce serait plutôt des prémices.
LVSL – Quand vous parlez de la conception du film, avez-vous senti un moment où il fallait démarrer ? Y-a t-il eu un moment où vous vous posiez des questions, où vous ne saviez pas trop où vous alliez ? Et est-ce que vous avez su quand il fallait s’arrêter?
MB – Oui oui. Le démarrage est simple. J’ai eu une idée du film pendant la semaine de Charlie Hebdo. C’était pendant le temps de la traque des terroristes que j’ai décidé de faire ce film et que j’ai trouvé le titre. Je me suis donné un cadre. On passait manifestement dans une nouvelle période, une nouvelle ère parce que je ne voyais pas comment on allait pouvoir sortir du paradigme qu’instituait Charlie et qui était lié à la peur. C’était une période de peur qui a duré en fait jusqu’à la menace de l’élection de Marine Le Pen. Les gens ont toujours eu peur, pendant 2 ans, les gens avaient peur de tout : de Marine, de Charlie, des terroristes, du gouvernement, de sortir dans la rue. C’était vraiment une sorte de peur décuplée. C’était le cadre général. Aller jusqu’aux élections présidentielles me semblait cohérent. Ça ne voulait pas dire que les élections allaient nous faire basculer dans une autre époque, ça je n’y croyais pas du tout. Simplement ça me semblait cohérent d’un point de vue un peu extérieur.
LVSL – Quand est-ce que vous décidez d’aller jusqu’à la présidentielle, située environ deux ans et demi après ?
MB – Dès le début. Ça me semblait cohérent. Et surtout c’était un laps de temps suffisamment large pour me donner le temps de vivre, de trouver ce que j’allais faire. Des doutes, j’en ai eu tout le temps. On ne savait jamais ce qu’on allait faire, on ne savait jamais où est-ce qu’on allait sortir, qui on allait filmer. Toutes les rencontres du film sont hasardeuses, ça s’est fait dans la rue, en boîte, en manif… Dans tout ce que nous offre Paris la nuit en fait.
Il n’y avait pas de cadre. C’était un film déambulatoire. C’est une recherche très intime, très personnelle, qui croise le temps large de l’histoire, des élections – du politique en fait – et en même temps quelque chose qui se résume à moi, ma quête personnelle. On était tout le temps en train de se poser des questions : « Est-ce qu’on est au bon endroit ? Est-ce qu’on a le bon optique (de caméra) ? Est-ce qu’on a rencontré la bonne personne ? Est-ce qu’on peut lui faire confiance ? Où est-ce que va l’époque, en fait ? »
« Pour moi ce qui est nouveau, c’est ce qui permet de mettre en avant des choses qui existent, mais que personne n’a encore vues »
Parce qu’évidemment, quand on veut sortir le vendredi soir, il y a plein de possibilités. Donc la question c’est : qu’est-ce qui est saillant ? Qu’es-ce qui sera particulier, et pas un truc qui aurait pu se passer en 2013 ? La question c’est : qu’est-ce qui se passe en 2015 ou en 2016 ou en 2017 qui ne se passait pas avant et qui ne se passera plus après ? C’est-à-dire qu’est-ce qui n’est pas du tout général ? On cherchait du singulier, des choses très particulières.
De façon générale, pour moi ce qui est nouveau, c’est ce qui permet de mettre en avant des choses qui existent, mais que personne n’a encore vu. C’est ça qui rend une chose nouvelle. C’est de faire apparaître des choses qui sont sous nos yeux et qu’on ne sait pas voir.
LVSL – Vous disiez avoir cherché des choses particulières, spécifiques à 2015, 2016, 2017. En quoi le fait de filmer des jeunes – dont les préoccupations concernant les études notamment, ne sont pas complètement nouvelles non plus – qui font la fête est un écho direct à cette période-là ? Pourquoi ce n’est pas un moment qui peut exister en 2013 ou 2014 ?
MB – Des jeunes qui font la fête ça a toujours existé ou en tout cas ça existe depuis longtemps. Je pense que la fête est intéressante si elle est mise en regard avec toutes nos défaites. Il y a les défaites de la semaine, le poids de la semaine, tout ce qu’on encaisse la journée, et ensuite il y a les week-ends. La question est : qu’est-ce que la fête, le week-end, la nuit, nous permettent d’exprimer qu’on ne peut jamais exprimer le reste du temps ? C’est pour cela qu’on a autant besoin de la fête. S’il y avait plein d’espaces d’expression prévus, pensés intelligemment par notre façon d’imaginer le travail, la famille etc, on n’aurait pas besoin de ça, de se lâcher à ce point. Même le terme est intéressant, on a besoin de « lâcher », ça veut dire qu’il y a trop de choses sur nous, trop de choses qui nous tiennent. Donc lâcher prise quoi.
LVSL – Quand on lâche prise, est-ce nous qui lâchons prise sur quelque chose ou est-ce qu’on se défait des liens ?
MB – On se défait des liens qu’on veut bien maintenir nous-mêmes en nous. C’était intéressant parce c’était des années où il y avait un raidissement du cadre – politique, idéologique, les mœurs, l’ambiance générale. Certains spectateurs sortent du film, des vieux souvent, et me disent « c’est quand même très pessimiste ». Je leur rappelle que le monde dont on hérite c’est la résurgence de la mort. Ça me rappelle Paul Valéry qui disait à la sortie de la guerre de 14 : « Nous-autres, civilisations, savons désormais que nous sommes mortelles ». Depuis Charlie et surtout le 13 novembre, dans la conscience urbaine de métropole, c’est exactement ça. C’est le moment où on se dit « ah oui en fait on peut mourir. Sortir dehors ce n’est pas si inintéressant ». C’est ça la beauté de la vie, cette légèreté-là, le fait d’être absolument insouciant. Ça a une valeur et c’est pas normal, ce sont des choses qui se gagnent. Notre génération a vécu sur des choses qu’ont gagné les générations précédentes. D’un coup, on se rend compte et on se rappelle que ces choses sont précaires et donc précieuses. Précieuses parce que précaires.
Et puis il y a l’idée aussi que, politiquement parlant, on ne va pas pouvoir s’appuyer sur nos aînés. Par exemple Greta Thunberg. Elle tient un discours extraordinaire : elle s’adresse à ses aînés en disant « on sait très bien qu’on ne pourra pas compter sur vous, que vous n’allez pas nous écouter, et qu’on va être obligés de se débrouiller tout seul parce que vous ne comprenez pas les problèmes qui sont les nôtres ».
« Notre génération a vécu sur des choses qu’ont gagné les générations précédentes. D’un coup, on se rend compte que ces choses sont précaires et donc précieuses »
A priori ça n’a rien à voir et pourtant : il n’y a pas longtemps j’ai revu Mission Impossible de Brian De Palma, 1996. Un film que j’ai vu quand j’avais 10 ans à sa sortie en salles. Je n’avais jamais pris conscience que ce film raconte comment les fils prennent conscience que les pères trahissent les fils. Ethan Hunt – Tom Cruise – prend conscience que le type qu’il admirait, qui lui a tout appris, n’a pas hésité à le trahir pour sauver, en gros, sa retraite. C’est ça l’histoire de ce film, au-delà du film d’espionnage. Et ce qu’on vit aujourd’hui c’est ça. On prend conscience que ce n’est pas parce qu’on a été enfanté par des gens qu’on peut leur faire confiance. Et c’est d’une puissance hallucinante.
Il y a toute une fiction comme quoi on est protégé. Et la seule chose qui a remis en question ça c’est les gilets jaunes. Franchement, si j’avais fait mon film après les gilets jaunes, ça aurait été très différent. Pourquoi ? Parce que pour la première fois de ma vie, j’ai vu des gens de 60-70 ans dire « nous on n’a plus de souci on est là pour nos enfants, pour nos petits-enfants, parce qu’on se dit que ça va être une catastrophe »
Donc le cadre de la fête c’est : la mort, la conscience qu’on ne peut pas faire confiance à nos aînés et qu’on ne peut compter que sur nous-mêmes. On doit accepter le fait qu’on est presque des orphelins. On doit apprendre à décevoir les générations passées et à ne pas être ce qu’ils attendent de nous. Il faut arriver – c’est très dur quand on a 20 ans, on n’en a absolument pas conscience, j’en prends conscience qu’aujourd’hui peut-être parce que je suis un adolescent attardé – à comprendre que le rapport intergénérationnel est un rapport de force, presque de négociation : « vous nous demandez ça, très bien mais nous, nos problèmes c’est pas ça, c’est ça ». Comment on fait ? On grandit avec la conscience de ces questions de générations aussi.
Dernière chose : comment peut-on admirer des gens qui nous lèguent un monde promis à la destruction ? Il y a un vrai problème qui est spécifique à ma génération. C’est pour ça que dans la version salle du film il y a un panneau tenu par un blackblock en 2015 à la COP21 : « C’est le climat qui est en état d’urgence ». Il y a un problème, une cassure générationnelle. Comment peut-on admirer, écouter, suivre les conseils de gens qui nous lèguent un monde promis à la destruction? Il y a un paradoxe, il y a quelque chose qui est absolument impensable là-dedans. Et voilà on est face à ça.
LVSL – Ça me fait penser à une phrase que j’ai entendue à propos de la catastrophe écologique d’une jeune qui disait « nous actons d’une rupture de votre monde vers le nôtre, ou de notre monde vers le vôtre ». Donc on acte la rupture, la fin. On n’est même plus en résistance. Si on résistait, ça voudrait dire qu’on serait contre vous. On dit que vous n’existez plus, vous n’êtes plus là.
MB – C’est sur ce point que le rap français m’a beaucoup intéressé depuis 2014. J’écoute du rap depuis l’enfance. Si on regarde dans les années 90, il y avait l’idée de revendiquer de faire partie de ce monde-là : du système, du monde blanc, de l’argent, des médias. D’avoir notre part du gâteau, d’être dedans, d’être représenté. Au bout d’un moment, un changement s’est opéré : en fait, on n’a pas besoin d’eux, on n’a pas besoin de passer chez Ardisson. Quand on voit comment il traite Nekfeu et Vald. La vidéo de Vald est extraordinaire pour ça, c’est à dire qu’à un moment donné un matin il se réveille deux jours après le passage chez Ardisson et il se rend compte qu’il a été humilié. Et là il. se dit « mais en fait je n’ai pas besoin de vous, on a nos médias, on a Youtube, etc… ». Et ça c’est hyper important, la cassure est là. Il y a quelque chose de finissant quand on regarde même le décor de chez Ardisson, la façon dont c’est éclairé, mis en scène, on est totalement à côté de la plaque. C’est vieilli, c’est finissant.
Je trouve très intéressant ce qu’il se passe dans le rap depuis 2014, c’est fascinant pour ça. PNL c’est exactement ça : on va faire sans vous.
LVSL – « Avant j’étais moche dans la tess, aujourd’hui j’plais à Eva Mendes ».
MB – Tout à fait. D’ailleurs, cette phrase, ce vers de PNL c’est la forme même de leur mélancolie. C’est-à-dire qu’avant ils étaient rien, mais maintenant c’est seulement parce qu’ils ont de l’argent qu’ils sont quelque chose. Mais ils savent qu’ils ne sont pas considérés pour leur beauté intrinsèque, donc mélancolie. Donc finalement je vais faire quoi : je vais rester fidèle au moins que rien, au dealer que je fus et que j’ai toujours été.
La chose qui m’inspire le plus depuis 2014 c’est le rap français parce qu’ils ont une puissance d’autonomie qui est magnifique, enviable. Je ne vois même pas vers qui me tourner dans le cinéma actuel qui pourrait autant m’inspirer, c’est-à-dire me donner envie de faire. Eux ils me donnent vraiment envie de faire.
LVSL – Quand vous dites que la jeunesse est perpétuelle… Est-ce que finalement L’Époque n’aurait pas pu être tourné à une autre période, post-Charlie ? Là aujourd’hui avec les Gilets Jaunes, avec les grandes fêtes de la Coupe du Monde, avec tout ce qui s’est passé depuis l’élection de Macron, toute cette France-là ?
MB – Mon rêve, ce serait de donner des caméras à une dizaine d’équipes de jeunes dans toute la France, de les envoyer faire des rushs et après je veux bien être le monteur de ce film-là.
« Il ne faut pas sous-estimer la puissance de la rencontre »
C’est marrant parce qu’avec ce film, on me fait tout le temps des reproches. Moi j’avais un projet : filmer la jeunesse du Grand Paris, dans le Grand Paris. Mais le reproche principal est que finalement il n’y a pas que Paris, il faut aller en province. Je filme aussi à partir de ce que je connais, de mon entourage. C’est une chose qu’on a toujours opposée au film : le fait que ce n’est pas la province, que c’est pas ça la France, que c’est un truc très particulier. Et en même temps, quand je projette le film en province, il y a des jeunes, au Festival d’Angers par exemple, qui m’ont sauté de dessus en disant « Ce n’est même plus votre film, c’est le nôtre, c’est nous que vous avez filmés ». Et j’ai discuté avec eux pendant 2 heures et ils viennent d’Angers. Ils ne se sont pas dit « Oulala qu’est-ce que ça nous paraît loin, cette jeunesse parisienne… Ils ne parlent pas comme nous ! ». Pas du tout. Heureusement qu’une jeunesse peut parler à une autre. Heureusement qu’un film chinois peut m’émouvoir. Heureusement qu’une réalisatrice peut filmer un homme. Heureusement qu’une rencontre est possible. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de la rencontre. On ne sait jamais ce qui peut nous émouvoir dans un film. On n’est pas bornés sociologiquement sinon ça ne servirait à rien de faire des films. D’en faire et d’en voir.
LVSL – Cela tombe bien que vous parliez de ça, le fait que d’autres jeunes se soient reconnus, parce que je voulais vous demander si ce film aurait pu se passer ailleurs qu’à Paris. Est-ce qu’il fallait Paris ? Est-ce que vous auriez pu imaginer L’Époque à Lyon, à Marseille, à Montpellier, à Lille, à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse ? Ou à Angers, justement ?
MB – Non. J’aurais pu imaginer un film beaucoup plus large sur les jeunes, dans plein de villes françaises. Mais d’abord c’est ingérable d’un point de vue pratique et financier. Et surtout, ça dit quelque chose de la France. Qu’un film comme L’Époque soit seulement possible à Paris, ça dit quelque chose de la France. Le seul endroit en France où je peux rencontrer des banlieusards, des urbains, des gens intra-muros, des provinciaux, des Américains, des Japonais, c’est Paris. C’est juste que ça concentre. Et surtout ce que je trouvais intéressant c’était de montrer des gens qui ne sont pas forcément de Paris et de rester dans ce cadre-là. Parce qu’en réalité Paris n’appartient pas qu’aux Parisiens, Paris est traversée par plein de gens. C’est un endroit où tout le monde va le week-end. J’ai rencontré des Marseillais qui venait à Oberkampf, à Pigalle, Bastille ou aux Champs-Elysées. J’ai rencontré des Pakistanais. J’ai rencontré plein de gens qui viennent là parce que c’est Paris. On ne va pas non plus refaire les couleurs de l’arc-en-ciel, Paris ça reste Paris. Ici c’est Paris. Ça ne veut pas dire que c’est la France, ça n’a rien à voir. Ça veut dire que c’est Paris.
« Avec ce film, on me fait tout le temps des reproches. Moi j’avais un projet : filmer la jeunesse dans le Grand Paris. Mais le reproche principal est que finalement il n’y a pas que Paris, il faut aller en province »
Pourquoi je filme Paris ? On est aussi dans un mouvement d’homogénéisation des villes. Mon film est compris par les Londoniens et par les gens du Caire, par les gens à Séville, à Francfort aussi. Parce que les métropoles européennes, et même ailleurs dans le monde, se ressemblent de plus en plus, elles deviennent des musées à ciel ouvert, des villes froides, maîtrisées, sous contrôle. Je n’ai pas beaucoup voyagé dans ma vie, mais là comme j’ai voyagé en allant présenter le film je le vois bien et j’avais ce sentiment-là. C’est pour ça que le teaser du film que j’avais fait en 2016 commence par « Quelque part en Europe… » parce que je me disais qu’il faut bien qu’on comprenne que la France n’existe quasiment plus, elle ne compte pas. Il faut remettre les choses au bon niveau d’un point de vue économique, symbolique. Aujourd’hui on est entre 3 blocs : la Chine, la Russie et les États-Unis. On voit bien comment les Présidents français se démènent pour compter aux yeux de Poutine, de Trump. On a vu comment Macron s’est comporté, il fait de la gesticulation.
LVSL – Pensez-vous que le film puisse parler à toute notre génération, qu’il ait un aspect universel ou a contrario trop parisien, trop francilien, trop citadin?
MB – Les retours que j’ai pour l’instant, même si le film n’est pas encore sorti, en tout ce que je vois, c’est qu’il y a quand même des gens qui publient des posts sur Instagram en disant « c’est notre génération », « le film de notre génération » : ce n’est pas moi qui le dis ça. Moi je n’ai jamais revendiqué le fait de réaliser un film générationnel. Jamais. Je n’ai pas dit que j’allais faire un film sur une génération. Ce n’est pas comme ça que je concevais les choses. C’est un discours qu’on peut avoir mais après. C’est parce que je vois que des jeunes disent « c’est ma génération, c’est moi », les jeunes d’Angers qui me disent « c’est notre époque, c’est nous, c’est notre film ». Ce n’est pas à moi de dire ça. Moi, j’espère que cette époque n’est pas qu’à moi. Franchement, c’est avec grand plaisir que je la donne à tout le monde parce que je n’en peux plus de ce film…. Donc L’Époque est à vous !
LVSL – Est-ce que vous pouvez dire que ce film représente un pavé dans la mare ? Il parle de la jeunesse mais il est très violent vis à vis des spectateurs.
MB – Un gars que je connais qui a grandi à Saint-Denis dans une cité m’a dit « quand j’ai vu ton film, j’ai pensé à La haine ». Et ce n’est pas la première fois qu’on me fait ce rapprochement. Personnellement, ce serait plus l’amour que la haine parce que je n’ai pas l’impression qu’il soit de ce côté-là des sentiments, de la haine. Simplement, je voulais que ce soit une autre façon, ou plutôt nos façons de nous amuser, nos goûts musicaux, nos paroles, notre façon de nous exprimer. Ce dont je me rends compte, et que je n’avais pas vraiment prévu, c’est que le film plaît beaucoup aussi à des personnes qui sont des parents voire des grands-parents et qui me disent après les projections : « ça nous permet de rentrer dans la tronche de nos gosses ». Donc c’est intéressant. Je n’ai pas envie de mettre les gens sur le côté sous prétexte qu’ils ont 40 ou 50 ou 60 ans.
Ce qui m’intéressait, c’est que ce film soit un film fait de l’intérieur de la jeunesse, pas un regard sur la jeunesse, que ça vienne de la jeunesse. La question c’était : toi, en tant que jeune, qu’est-ce que tu es en train de vivre, tu vis quoi ? Qu’est-ce qui t’empêche de dormir ? Quand est-ce que tu te sens libre ? Où est-ce que tu aimes aller ? Est-ce que tu fais des rêves, des cauchemars ? Comment ça va dans ta tête ? C’était ça ma priorité.
C’est ça aussi qui est très difficile dans le cinéma. Le cinéma est un monde de vieux que ce soit dans les financements ou ailleurs. Nous, on n’a pas eu le CNC. Devant moi, je n’avais pas une seule personne de moins de 40 ans. Alors, forcément, ça ne peut pas beaucoup leur parler, ils ont d’autres priorités. Ce n’est pas qu’ils sont contre nous, c’est qu’ils ont d’autres problèmes, d’autres priorités. C’est pour ça que je parlais de rapport de force, c’est une confrontation d’intérêts. Ce n’est pas un clash générationnel, il n’y en a pas du tout, il y a juste des intérêts différents, divergents, des visions de l’avenir différentes. Et je pense qu’il faut assumer cette différence.
« Ce qui m’intéressait, c’est que ce film soit un film fait de l’intérieur de la jeunesse, pas un regard sur la jeunesse, que ça vienne de la jeunesse »
LVSL – Si on prend votre définition du nouveau, à savoir quelque chose qui est là mais dont on a jamais parlé, on peut remarquer que le film donne beaucoup la parole à des intervenants féminins, chose à laquelle on n’était pas forcément habitués par le passé. Est-ce que c’était une volonté personnelle ou est-ce que c’est venu spontanément ?
MB – C’est intéressant, un spectateur l’a remarqué à la première au Forum en me disant que c’était un film très féminin. Ce n’était pas du tout un trait d’époque, c’est très personnel je pense. J’ai grandi dans un univers très féminin, je m’entends mieux, depuis toujours, avec les femmes qu’avec les hommes. Il y a très peu d’hommes avec qui je m’entends bien donc spontanément je pense que je vais davantage vers des femmes.
De plus, on apprend beaucoup plus aux femmes à jouer avec leur image, leur apparence. Pour moi, les hommes sont très austères, très sérieux, très guindés, très bloqués, je les sens verrouillés partout, notamment vestimentairement, ils ne se maquillent pas. Très peu de gens s’intéressent à ce qu’ils renvoient comme image, ils sont très normés. Je ne veux pas dire que la norme ne s’exerce pas sur les femmes, la norme demande, commande aux femmes à diversifier leur apparence. Donc en soi, c’est déjà plus cinématographique que des hommes qui n’aspirent qu’à une seule chose : le costume unique.
Je me sens mieux avec les femmes, il y a un jeu qui est possible, je trouve que souvent les hommes instaurent un rapport de rivalité qui ne m’intéresse pas, peut-être que c’est moi qui l’instaure je ne sais pas. Mais voilà, c’est quelque chose que je n’aime pas, je fuis un peu la rivalité. Et avec les femmes, il ya une suspension de ça, je ne me sens pas rival, et je préfère. Le côté « jouer des coudes », ça m’épuise. Donc oui le film est plus féminin tout simplement parce que c’est comme ça que j’ai été élevé, par des femmes, auxquelles, je pense, je rends hommage d’une certaine manière.
De façon générale, quand on a une caméra dans les mains, on a un petit pouvoir. Et j’aime bien le partager, et j’aime bien le partager avec des gens qui en général n’ont pas ce pouvoir-là. Je ne sais pas si c’est être démocrate, je pense que la raison est beaucoup moins noble que ça. Disons que c’est un plaisir de mettre à mal les pouvoirs institués. Peut être qu’en soit c’est démocrate. En tout cas je sais que ça va faire bouger certaines personnes sur leur socle. Et ça me plaît.