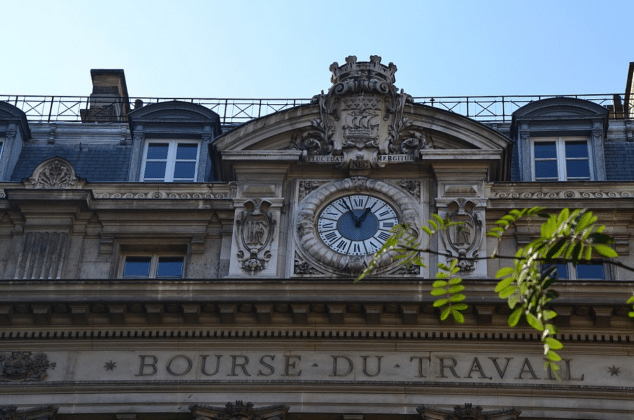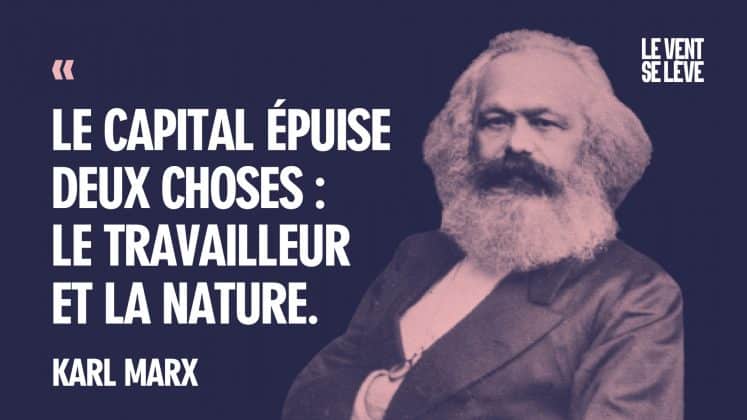Longtemps, une partie de la gauche a cherché à mobiliser autour de la défense de services publics forts et de la justice fiscale. Les récentes défaites citoyennes, politiques et syndicales doivent nous interpeller : malgré la forte mobilisation qu’ont pu susciter tant l’opposition à la réforme des retraites que le mouvement des gilets jaunes ou la grève des cheminots en 2018, ces combats se sont soldés par des défaites. Dès lors, comment analyser ces mouvements sociaux et rebâtir un discours à même de fournir une grille d’interprétation générale, un projet capable de susciter l’adhésion ? Gageons ici que l’enjeu central est le renversement du cœur de nos revendications, qui acceptent à tort de se situer sur le terrain imposé par la classe dominante, à l’origine des réformes. Tout discours émancipateur doit impérativement réinvestir les questions centrales du travail et de l’investissement.
La définition du travail : un enjeu décisif
Enjeu central de la lutte des classes, la définition du travail – qui n’a rien de naturel – n’est jamais neutre. N’est considéré comme relevant du travail que la part de notre activité que des institutions légitimes reconnaissent comme contribuant à la création de valeur économique. Ainsi, ce ne sont jamais les caractéristiques intrinsèques d’une activité qui lui permettent d’être considérée comme du travail, mais bien les conditions dans lesquelles elle est effectuée. L’exemple le plus éloquent est sans doute celui des tâches domestiques. Repeindre ses propres volets ne semble pas relever, dans un cadre capitaliste, de la notion de travail (au sens de contribution à la création de valeur économique). En revanche, une peintre exerçant en auto-entrepreneuse embauchée pour faire la même action verra son activité être reconnue comme du travail (et donc comptabilisée dans le PIB).
L’enjeu de l’émancipation du travail est, précisément, de reconnaître et salarier le travail hors de l’emploi.
Dans un cadre purement capitaliste, les institutions de reconnaissance du travail, que sont le marché des biens et services pour les indépendants et le marché de l’emploi pour les autres, ne retiennent qu’un seul critère : celui de la mise en valeur de capital. Le discours de la bourgeoisie capitaliste vise donc à entretenir la confusion entre le travail et l’emploi – autrement dit la mise en valeur du capital d’un propriétaire. Il ne serait ainsi possible de travailler que dans l’emploi. Au contraire, l’enjeu de l’émancipation du travail est précisément, de reconnaître et salarier le travail hors de l’emploi.
Cette conception capitaliste des personnes comme étant par défaut étrangères au travail se double d’une clause particulièrement scandaleuse : non seulement les détenteurs du capital s’accaparent une part de la valeur créée par les travailleurs au seul motif de leur propriété lucrative de l’outil de production, mais en plus les travailleurs ne peuvent pas décider de leur propre travail. Dès lors, émanciper le travail, et donc les travailleurs, revient à instituer des institutions alternatives qui reconnaissent le travail hors de ce carcan capitaliste de la seule mise en valeur de capital et s’appuient sur d’autres indicateurs.
Le mouvement réel de l’émancipation du travail
Le combat pour l’émancipation du travail, à travers notamment la lutte syndicale, s’est déjà avéré triomphant. Les travaux de Claude Didry [1] contribuent à montrer que l’imposition du salariat en tant qu’institution est une grande conquête ouvrière. Le salariat repose sur la qualification, c’est-à-dire l’abstraction qui permet d’estimer la contribution de chaque activité à la création de valeur économique. En d’autres termes, dans l’institution du salaire, c’est la qualification qui devient le vecteur de transformation de l’activité en travail.
L’imposition de la qualification – et le salaire, qui n’en est que la reconnaissance – est donc un progrès [2] : elle libère une part importante d’aléa dans la rémunération du travail tout en lui assignant un cadre réglementaire ouvrant la voie à un rapport de force collectif pour la définition des niveaux de qualification dans chaque branche et convention collective nationale. Il permet une déconnexion fondamentale entre la rémunération et l’activité concrète : ce n’est pas notre stricte activité – et ses innombrables aléas [3] – qui sont le fondement de notre salaire, mais bien plutôt la qualification nécessaire à la réalisation de ce type de tâches dans le cadre du poste de travail que nous occupons.
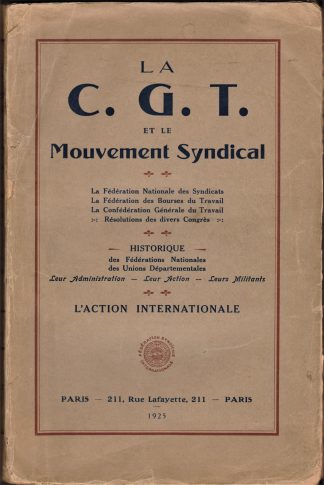
Cependant, cette victoire n’est que partielle et demande à être approfondie. Pour libérer entièrement le travail du carcan capitaliste de l’emploi, il faut que la qualification ne soit pas rattachée au poste de travail, mais à nos personnes mêmes. En les responsabilisant et les reconnaissant ainsi, tous les titulaires d’une qualification pourraient redéployer dans des activités bien plus justes et responsables écologiquement leurs riches savoir-faire, hors du seul champ de l’emploi capitaliste.
Le statut : la sanctuarisation de la libération du travail
Cette extension de la victoire du salariat qui reconnaît les personnes comme étant titulaires de leur qualification (et donc de leur salaire) se déploie déjà dans de larges pans de l’économie. C’est le cas notable du « statut général des fonctionnaires » et du « statut national du personnel des industries électriques et gazières [4] ». Le premier a été rendu possible par une loi d’avril 1946 promulguée par le communiste Maurice Thorez, alors Ministre de la Fonction Publique et vice-Président du Conseil. Le second fut créé en juin 1946 par Marcel Paul, ministre communiste de la production industrielle. Ces deux statuts sont de puissants vecteurs d’émancipation du travail. Ils sont proprement révolutionnaires précisément parce qu’ils changent la définition du travail.
Un fonctionnaire ou un cheminot n’a pas d’employeur et ne met en valeur aucun capital possédé à des fins lucratives par aucun propriétaire lucratif.

Un fonctionnaire ou un cheminot n’a pas d’employeur et ne met en valeur aucun capital possédé à des fins lucratives par aucun propriétaire lucratif. Ces travailleurs ne sont pas reconnus en tant qu’employés sur un poste de travail, mais en tant que titulaires d’une qualification qui ouvre droit à la perception d’un salaire. Ils ne sont ainsi pas payés pour leurs postes, mais pour leurs grades – dont ils sont titulaires – qui expriment leurs qualifications personnelles acquises grâce à des concours, de l’expérience et une évaluation par leurs pairs, entre autres mécanismes. Ce sont là les germes d’un salaire à la qualification personnelle [5].
Dans ce sens, parler de « sécurité de l’emploi » pour les fonctionnaires est tout à fait inexact. Ce que permet leur statut n’est rien d’autre que l’abolition du marché de l’emploi en ouvrant la voie à une reconnaissance du travail hors de l’emploi. Les nombreux projets de réforme contemporains ont d’ailleurs pour objectif de s’attaquer à ce principe. C’est donc au nom de la défense de cette émancipation du travail et de cette extension de la qualification qu’il faut s’opposer à ces réformes. Au lieu de rester cantonnés à des mots d’ordre mobilisateurs souvent vains et qui ne permettent pas d’exprimer une vision profonde des enjeux sous-jacents relatifs au travail, s’appuyer sur cette reconnaissance du travail alternative au marché de l’emploi capitaliste serait un atout important dans nos luttes.
La pension de retraite doit être vue comme une institution qui reconnaît l’activité des retraités comme étant du travail, mais du travail libéré de l’emploi.
La retraite comme émancipation définitive du travail
Les mécanismes de libération du travail du carcan capitaliste dans lequel l’emploi le restreint se jouent aussi dans notre système de retraite. Il suffit de poser la question à n’importe lequel d’entre eux, bénéficiant d’une pension convenable, pour constater que l’immense majorité s’accorde sur un point : « Les retraités n’ont jamais autant travaillé qu’en retraite ». En tout cas, leur éviction du marché de l’emploi ne signifie pas pour eux l’entrée dans l’inactivité. C’est même l’exact contraire. La pension de retraite doit donc être vue comme une institution qui reconnaît l’activité des retraités comme étant du travail, mais du travail libéré de l’emploi.
En fait, la retraite peut être analysée à l’aune de deux conceptions : l’une libère le travail et responsabilise les retraités, l’autre les postule inutiles et improductifs. Qu’un retraité s’engage dans le Conseil municipal de sa ville, garde ses petits-enfants après l’école, s’implique dans une association, entraîne des jeunes le mercredi dans un club de sport ou encore rédige des articles pour une gazette locale, son activité devient du travail dès lors que l’on perçoit sa pension comme un salaire reconnaissant sa qualification pour ces activités.
La vision émancipatrice de la retraite ne voit ainsi dans la pension rien d’autre que la poursuite du salaire des retraités (selon la meilleure qualification qu’ils ont atteinte et dont ils deviennent titulaires) qui leur permet de travailler librement hors de l’emploi, et sans mettre en valeur de capital. Face à cette conception, la classe capitaliste présente la retraite comme un simple différé des cotisations, posant ainsi les retraités comme de vulgaires inactifs représentant un poids pour la société et ayant droit de récupérer ce qu’ils ont cotisé au nom d’une solidarité intergénérationnelle qui leur fait l’affront de les définir par leur manque. La référence à la qualification et au salaire dans la première vision fait des retraités des travailleurs contribuant à la création de valeur. La seconde vision, quant à elle, renforce la définition capitaliste du travail, enserrée dans le carcan de l’emploi.
A l’heure où la bataille contre la réforme des retraites n’est pas terminée, il faut revendiquer avec ardeur la vision de la retraite comme un vecteur de reconnaissance et de rémunération du travail effectué librement par les retraités et hors de l’emploi. Cet enjeu est fondamental et permet d’amorcer lui aussi un changement dans la définition du travail, qui ouvre justement la voie à une maîtrise sur les outils et les fins du travail par celles et ceux qui le font.
Le régime général ou l’institution des possibles
Précisément, ce qui permet que les retraités décident véritablement de leur travail, c’est qu’ils ne sont pas payés par un patron, mais par les caisses du régime général, alimentées par les cotisations sociales.

C’est le cas également des parents reconnus comme titulaires d’une qualification dès lors qu’ils éduquent un enfant. Les allocations familiales ne reconnaissent aucunement le coût d’un enfant, mais bien plutôt le fait que l’éduquer implique une qualification. C’est cette qualification que vient reconnaître le salaire versé par la Caisse des Allocations Familiales, alimentée par les cotisations. Dans une certaine mesure, tous les professionnels de santé conventionnés par l’Assurance Maladie sont également rémunérés par les caisses Maladie du régime général, et le critère du conventionnement de ces professionnels fait office, pour eux, de reconnaissance d’un certain niveau de qualification.
Le travail n’est un coût que pour celui qui l’exploite.
En adoptant cette lecture du régime général, il est ainsi difficile de concevoir les cotisations sociales comme des charges renchérissant le coût du travail. Tout d’abord car le travail n’est un coût que pour celui qui l’exploite. Mais surtout, la cotisation est un moyen d’allouer les fruits de notre travail en outrepassant les circuits capitalistes qui rémunèrent plus le capital que le travail (alors que le capital ne produit rien sans travail vivant).
La cotisation, bien loin d’être un coût, permet donc au contraire de reconnaître le travail partout où il existe et de le rémunérer plus justement. Elle permet aussi d’alimenter des caisses d’investissement qui peuvent subventionner l’investissement pour générer des outils de travail sur lesquels ne s’exerce aucune propriété lucrative, mais bien plutôt une copropriété d’usage. C’est le cas, par exemple, de l’hôpital public financé par subvention des mêmes caisses Maladie à partir des années 1950.
Finalement, tant les statuts que les retraites, ainsi que tous les autres salaires versés par les caisses du régime général, sont des lieux où s’exerce déjà l’idée d’un salaire à la qualification personnelle. Ces travailleurs sont reconnus comme contribuant à la création de valeur économique même sans mettre en valeur aucun capital et peuvent par là-même prétendre à une souveraineté sur leur travail concret. Cette émancipation du travail doit être défendue là où elle existe déjà, afin de pouvoir ensuite se battre pour son extension à d’autres domaines. Le projet – de plus en plus documenté et soutenu – de bâtir une Sécurité Sociale de l’Alimentation s’inscrit dans cette logique qui vise à responsabiliser les travailleurs qui doivent décider de leur travail, libérés des injonctions capitalistes trop souvent écocidaires. C’est là la condition sine qua non d’un retour à la raison de toutes les productions.
Notes
[1] Claude Didry, L’institution du travail. Droit et salariat dans l’histoire, La Dispute, 2016
[2] Comment ne pas lire le salariat comme un progrès quand l’enjeu du capitalisme de plateforme est justement de le contourner en imposant aux exploités la façade d’indépendant, qui leur nie toute qualification, qui ouvre droit au salaire ?
[3] Voir la note de juin 2020 de Jean-Pascal Higelé pour l’Institut Européen du Salariat.
URL : https://ies-salariat.org/index.php/2020/06/29/crise-sanitaire-et-salariat-ce-que-le-confinement-revele-des-formes-dinstitution-du-travail/.
[4] Dans ce statut national, la reconnaissance de la qualification rattachée aux travailleurs se poursuit même en retraite, puisqu’il se prolonge à travers un « salaire d’inactivité de service » : le titulaire de la qualification continue d’être payé et reste actif dans la retraite, à ceci près qu’il déploie sa qualification hors du poste de service qu’il occupait auparavant.
[5] Le salaire à la qualification personnelle, ou salaire à vie, est défendu par Bernard Friot dans nombre de ses ouvrages, à commencer par Vaincre Macron (La Dispute, 2017).