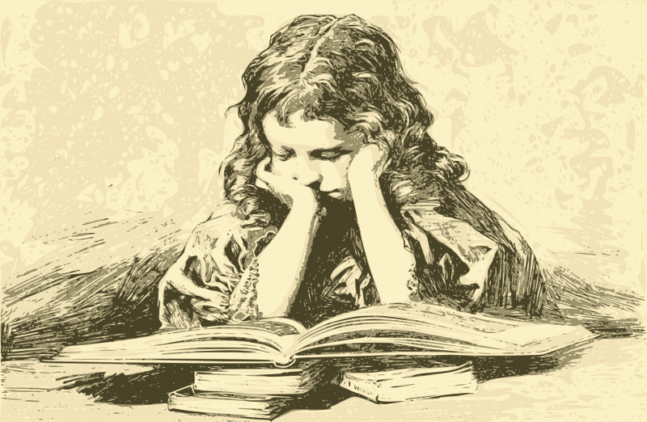Un inédit de Céline, un Prix Nobel qui récompense Annie Ernaux, Anéantir de Michel Houellebecq et Commencements de Catherine Millet – l’année 2022 fut-elle celle du retour des « grands anciens » ? Dans le vacarme des rentrées littéraires, les voix connues éclipsent celles qui, moins familières, sont plus récentes et plus originales. Lassé par la campagne marketing de Cher connard, LVSL se tourne vers la génération ’90, qui frappe aux portes des maisons éditoriales. Ils ont appris les mots « McDo » et « Tchernobyl » avant de commencer l’anglais en CE1, la crise de 2008 a éclipsé celles de leur adolescence, et leurs amours de jeunesse avaient pour toile de fond l’ère de Sarko-Hollande. Pourtant, ce passé plus que difficile leur a quand même permis d’écrire des textes intéressants.
Des Liens artificiels de Nathan Devers, analysant le phénomène du metaverse, à Deux secondes d’air qui brûle de Diaty Diallo, dédié aux violences policières, nombreux étaient les œuvres littéraires qui, cette année, évoquaient l’actualité la plus brûlante. Recette en apparence facile – quoi de plus simple et efficace, pour le succès d’un livre, que de traiter un sujet à la mode ? Pourtant, c’est au moment du choix de thème que les problèmes commencent, car pour écrire sur le présent, encore faut-il comprendre finement ses enjeux spécifiques. Au risque de proposer, comme L’Inconduite d’Emma Becker, une découverte vieille de quelques décennies : on peut être mère tout en ayant le droit de désirer des hommes. Mais d’autres écrivains ont fait l’effort de cerner l’esprit du temps. Derrière leurs personnages et leurs intrigues surgit notre société : nouvelle en ce que les problèmes qu’elle pose sont relativement neufs ; ancienne, parce que, malgré le flux rapide de chansons pop, d’enseignes et de loisirs, ses grandes structures et ses attentes envers l’individu n’ont pas changé.
Avec En salle (Les éditions de Minuit, 2022), la très jeune Claire Baglin montre cette ambivalence comme personne d’autre. Le genre du récit d’usine, dont son roman est proche, semblait passé de mode – L’Établi de Robert Linhart sortait en 1978, suivi de l’Excès-l’usine de Leslie Kaplan (1982). Mais À la ligne (2019) de Joseph Ponthus nous a rappelé que l’ère industrielle durait toujours en France ; fort de son expérience dans les usines alimentaires, l’auteur en dévoilait quelques tableaux glaçants. En salle pose une question encore plus cruciale : notre travail a-t-il changé après la tertiarisation et l’avènement des entreprises transnationales ? Quel autre cadre pour y penser que le McDo, ce lieu où veulent manger tous les enfants des classes moyennes et populaires, et où, plus tard, une bonne partie d’entre eux finit par travailler. La narratrice évoque les réunions de famille autour d’un hamburger – ces souvenirs ne lui donnent pas des larmes de nostalgie – avant de raconter son propre passage derrière les caisses. En décrivant l’embauche, Baglin fera entendre quelques morceaux choisis de la novlangue managériale :
Il veut savoir qui je suis et à quoi je suis prête pour être à l’heure. Il attend que je parle d’honneur d’intégrer une équipe, d’intérêt pour, d’aptitude à. Sur sa feuille, il a commencé une liste à quatre items, c’est moi. […] Je cherche un synonyme de polyvalente et je ne trouve pas. Je ne peux quand même pas dire multifonction.
Claire Baglin, En salle, Les éditions de Minuit, 2022, p. 7.
Ici, le venez comme vous êtes sonne différent : dans le huis clos de la salle, les chefs se livrent aux jeux de petits tortionnaires, les employés s’arrachent les privilèges les plus menus. Mais le noyau de l’intrigue est le rapport au père. Usé par son emploi industriel, cet homme est également un personnage-miroir pour l’héroïne, qu’elle interroge d’un regard inquiet. Font-ils, au fond, un seul et même travail ? De là, n’auraient-ils pas la même identité ? En racontant l’histoire de deux générations, Baglin cherche à savoir ce qu’être un prolétaire dans les années 2000.
La transmission de l’identité – des pères aux fils – n’inquiète pas moins un autre jeune poète et normalien, Victor Malzac. Après Respire (2020), dont l’un des thèmes était le sentiment de la dissociation avec le corps, l’auteur se tourne vers l’adolescence, moment de réaffirmation (ou de rejet) du genre prescrit. Dans l’herbe (Cheyne, décembre 2021) est le récit d’un doute, d’une métamorphose qui peine à se produire : au cours des premières pages, le narrateur confie, non sans angoisse : « maman papa / je ne suis pas, / vraiment pas comme un homme non / rien de moi n’est un homme ». Vous rappelez-vous les fois où vous restiez fumer des clopes à la sortie de votre lycée (collège), en essayant de faire le mec (la meuf) devant les autres ? Dans l’herbe s’ouvre sur un épisode semblable : un groupe d’êtres puérils, poisseux et mous se réunissent pour faire surgir d’eux-mêmes un « moi » qui puisse se conformer à un type social :
voici ma bande à rire, on est douze, on,
on transpire,
voilà. on est devant le collège, on
ne fait rien non. on fume
[…] on aime dire des horreurs à nos mères, fumer,
fumer ce qui se fume, et nous,
et nous mangeons toutes les viandes.
faim de poulet, du poulet dans les dents
tous les jours oui plein de poulet, dans des barquettes
Victor Malzac, Dans l’herbe, éd. Cheyne, 2021, p. 9.
En crise depuis les années 1970, la voix lyrique peinait à s’imposer en poésie française : dans de nombreux cénacles, « le moi », « l’amour » et « la souffrance » étaient des thèmes perçus comme obsolètes. Mais rien ne dure éternellement : on peut s’attendre à ce que, aujourd’hui, le débat sur les identités de genre nourrisse de nouvelles poétiques originales. En héritant de la tradition du XIXème, le texte de Malzac n’échappe pas aux redites : la douleur du poète maudit (« mon corps raté / ne tiendra pas le siècle ») nous convainc moins qu’il y a cent cinquante ans. Pourtant, Dans l’herbe évite avec succès le prêt-à-penser politique, si difficile à esquiver quand on s’attaque aux représentations genrées. Car le problème central ici n’est pas d’être homme ou femme, mais de fixer l’identité instable. Le moi est à la fois fuyant et perméable, sans armature et sans barrières devant le monde ; sa voix bégaie, tentant de s’affirmer, avant de fondre progressivement dans le paysage. « — je suis cette barrière mangée par la rouille / qui délimite l’herbe. dans le parc. on l’enjambe. // à terme il faudra bien la dévisser. »
Le style clinique et plat, parfois trop sec, de Claire Baglin contraste avec la vibration émotionnelle de Dans l’herbe. Pourtant, les deux auteurs proposent des héros proches : étanches, facilement submergés par des conflits et circonstances extérieures. La même intuition traverse Partout le feu (Verdier, 2022) d’Hélène Laurain, long texte fictionnel sans ponctuation ni narration classique, dont la visée est d’exposer le quotidien d’une militante écologiste. Le titre, élégant dans sa polysémie, fait référence à une action réelle : en 2017, un feu d’artifice avait jailli dans les locaux de la centrale française de Cattenom, organisé par une poignée de militants Greenpeace. Comme le racontera Laurain :
ils ont ouvert le premier grillage on est à trois mètres d’eux / avec notre banderole et ça commence à péter au-dessus de // nos têtes bombes prune // bouquets mer // embrasements pers // cascades // soleils // paillettes doré doré doré
Hélène Laurain, Partout le feu, Verdier, 2022, pp. 11-16.
Partout le feu reflète aussi, à l’évidence, les inquiétudes aiguës des 18-35 ans pour des questions de climat et de la nature. Fluide et déconstruit – comme l’existence de l’héroïne elle-même – ce texte n’est pas facile à suivre : il faut du temps pour repérer les personnages, cerner leurs relations, identifier l’intrigue. Pourtant, Partout le feu saisit la vie – humaine et non humaine, celle de la narratrice, de sa famille, des plantes – la vie confuse, brouillonne, complexe, irréductible à un schéma formel.
Riche qu’elle est en soubresauts et crises, la troisième décade du millénaire fait aussi émerger de nouvelles écritures – politisées mais pleinement littéraires. Que l’on soit amateur d’œuvres récentes ou de classiques qui ont tenu l’épreuve du temps, il faut admettre : l’ère de l’image et des réseaux sociaux ne signe pas la fin de la littérature.