L’Atlas de l’Anthropocène est un ouvrage pionnier. Personne ne s’était jusque-là essayé à cartographier et mettre en infographies les grandes données du changement d’époque que nous vivons. Alors que nous avons besoin de tous les outils à notre disposition pour représenter les défis qui sont les nôtres, a fortiori le changement climatique, nous voulions profiter de la parution d’un tel ouvrage pour aborder avec son auteur principal – François Gemenne – tant la définition de l’anthropocène, la méthode selon laquelle on peut le représenter et la manière dont on peut rendre ces représentations vivantes. Chacun d’entre nous est sensible à des choses différentes. Or à l’heure de l’urgence écologique, tous les outils sont bons pour informer et faire prendre la mesure. Les images ont un rôle prépondérant.
François Gemenne est professeur à l’Université de Liège et à Sciences-Po. Il est spécialiste des flux de migration et plus généralement de la géopolitique de l’environnement. Il a notamment co-fondé l’observatoire Défense et Climat à l’IRIS[1]. En août dernier, il a publié un Atlas de l’Anthropocène[2] avec Aleksandar Rankovic et l’équipe de cartographie de Sciences Po.
LVSL – Vous venez de sortir avec votre équipe un atlas de l’Anthropocène, alors qu’est-ce que cet atlas ?
François Gemenne – D’abord c’est un objet, un livre qui rassemble l’ensemble des données, des informations que l’on a sur les différentes crises écologiques ou environnementales qui touchent au climat, à la biodiversité ou la pollution et essaye de toutes les rassembler dans un ensemble cohérent qui puisse parler au grand public, à tous les gens qui se posent des questions sur ces différentes crises. Cet ouvrage montre surtout leurs côtés profondément systémiques, c’est-à-dire à quel point l’accumulation de ces empreintes humaines sur la terre nous a fait entrer dans cette nouvelle époque géologique, l’anthropocène.
LVSL – Qu’est-ce que l’anthropocène ?
FG – Pour le dire facilement, l’anthropocène, c’est l’âge des humains. En tout cas selon un grand nombre de géologues, c’est une nouvelle époque géologique caractérisée par le fait que les humains sont devenus les principaux facteurs de transformation de la planète.
L’histoire de la Terre est divisée en grandes périodes géologiques. Les gens en connaissent certaines comme le Jurassique, le Crétacé ou le Mésozoïque parce qu’il y avait les dinosaures. Celle dans laquelle nous étions jusqu’ici, c’était l’Holocène, puis on estime, en tout cas les géologues estiment, que nous avons tellement transformé, altéré les équilibres fondamentaux de la planète que l’empreinte de l’homme se voit maintenant dans les couches sédimentaires de la planète, et donc qu’il est temps de décréter l’entrée dans une nouvelle période géologique : l’anthropocène. Au-delà de sa signification géologique, il y a aussi une vraie signification politique. L’anthropocène, c’est la collision de l’histoire de la terre avec l’histoire des humains qui l’habitent, c’est l’idée qu’on ne peut plus considérer la Terre et l’humanité comme deux entités séparées comme on l’a toujours fait jusqu’ici, et c’est sans doute la raison pour laquelle nous sommes entrés dans la crise écologique que l’on connaît.
LVSL – Au début de votre atlas il y a une partie qui est justement consacrée à la définition de l’anthropocène, qui mentionne plusieurs points de départ. En fait, les scientifiques ne sont pas forcément d’accord sur la date de début de l’anthropocène. Avez-vous une opinion particulière sur la question ?
FG – Effectivement, c’est un point important. Les scientifiques sont d’accord pour dire que quelque chose de fondamental a changé. Ils ne sont pas encore tout à fait d’accord à la fois sur la date d’entrée dans l’anthropocène mais il y a aussi des controverses, ou plutôt des discussions, sur le nom que cette époque doit porter. L’anthropocène, c’est l’âge des humains mais cela donne aussi un peu l’idée fausse que tous les humains sont également responsables des transformations de la planète alors que la majorité de la population sur la planète est victime bien plus que responsable de cette transformation. Les transformations sont faites d’une petite minorité d’hommes blancs, pour dire les choses assez brutalement…
LVSL – Est-ce qu’on peut la chiffrer cette petite minorité ?
FG – Oui, on hésite à la chiffrer dans l’atlas d’ailleurs. En tout cas, c’est difficile de la chiffrer en terme de nombre d’humains mais on peut dire, par exemple, que quatre entreprises produisent à peu près 25% des émissions de gaz à effet de serre ou que certaines banques fournissent l’essentiel des financements à l’industrie fossile. On peut identifier quelques grandes firmes de pesticides notamment qui ont joué un rôle énorme dans la destruction de la biodiversité et il est donc difficile de donner un chiffre précis du nombre de personnes. On peut identifier assez clairement les responsables qui sont parfois des grandes entreprises, parfois des gouvernements et aussi les personnes qui élisent ces gouvernements et celles qui consomment les produits de ces entreprises.

LVSL – Quand on dit que quatre entreprises produisent 25% des gaz à effet de serre ou que cent entreprises en produisent 70%, il ne faut pas oublier que ces entreprises fournissent des services. Par exemple, ce sont des pétroliers qui vont servir à tout un chacun, c’est de l’énergie dont on a tous besoin…
FG – Absolument, c’est pour cela que je dis que ce sont aussi les consommateurs des produits de ces entreprises. Le problème effectivement et c’est là, le sens profond de l’anthropocène, c’est qu’aujourd’hui nous sommes dans une sorte d’économie qui est tellement enchâssée dans la production et la consommation des énergies fossiles que ce n’est pas évident d’isoler un responsable particulier, et de dire que si on arrêtait cette usine ou cette entreprise, le problème serait réglé. Nous n’avons malheureusement pas de recette miracle pour sortir de la crise et c’est pour cette raison que c’est une transformation qui doit impliquer l’ensemble de la société, y compris les entreprises qui sont parfois vues comme des ennemis mortels de l’environnement. J’ai tendance à dire qu’il faut pouvoir les embarquer là-dedans aussi.
LVSL – Pour vous, quel est le point de départ de l’anthropocène ?
FG – Le point de départ que je mettrais, c’est le début de la deuxième révolution industrielle, c’est-à-dire, le moment où vraiment on voit le début de la grande accélération, bien sûr pour ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour ce qui concerne d’autres types de pollution. Il y a d’autres points de départ possibles qui sont envisagés, potentiellement la dispersion de particules radioactives dans l’atmosphère au moment des essais nucléaires et des bombes d’Hiroshima et de Nagasaki. Une autre possibilité est sur la découverte de l’Amérique, soit le moment où les populations du monde commencent à se mélanger et donc le début d’une sorte de pré-mondialisation. Voilà le point de départ que je retiendrai, c’est la seconde révolution industrielle. Mais il y a encore des débats parmi les scientifiques sur le début exact, tout en sachant qu’on discute ici de variations de quelques centaines d’années à l’échelle de périodes géologiques qui durent plusieurs dizaines de milliers d’années.
LVSL – C’est la définition la plus communément admise puisque, par exemple, le GIEC (le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) calcule la température supplémentaire à partir justement de la deuxième révolution industrielle, vers 1850.
FG – J’ai l’impression que l’hypothèse qui tient la corde, du moins parmi les géologues, est celle de la dispersion de particules radioactives parce qu’en fait, la radioactivité va pouvoir durer des milliers d’années et c’est donc vraiment quelque chose qui va s’inscrire dans les couches de l’atmosphère et de la Terre.
LVSL – Des géologues mais pas forcément des climatologues…
FG – Mais ce sont les géologues qui décident. La question de la définition des périodes géologiques est faite par la Commission internationale de stratigraphie qui est un groupe de géologues spécialement mandaté pour la question. Ce sont donc les géologues qui décident mais en fait, ça touche non seulement les climatologues mais aussi les écologues et toutes les sphères de la science et de la société.
LVSL – Cet atlas représente un travail considérable : il y a des centaines d’infographies, souvent d’ailleurs originales, qui sont réunies au sein de sept chapitres thématiques comme le climat, la démographie ou encore les grandes politiques publiques internationales. Combien de personnes y ont travaillé ? Comment est-ce que vous étiez organisés ?
FG – C’était un réel travail d’équipe. Bien évidemment il y a moi-même et Aleksandar qui avons conçu l’organisation des chapitres, choisi les thématiques et rédigé les textes et puis, il y a eu l’Atelier cartographique de Sciences-Po, soit quatre personnes : Patrice Mitrano, Thomas Ansart, Antoine Rio et Benoît Martin qui ont conçu l’ensemble des documents graphiques et donc l’ensemble des cartes et des diagrammes. On a vraiment travaillé en collaboration très étroite avec eux parce qu’il fallait évidemment que le texte soit aligné sur les cartes, que le texte apporte des éléments supplémentaires par rapport aux éléments graphiques mais souligne aussi et explique les éléments graphiques. Il y avait aussi des éléments de calibrage, c’est-à-dire que la taille du texte devait être en fonction de la taille de l’image, il y a vraiment eu une collaboration très étroite et c’est vraiment un atlas que l’on a co-conçu et co-construit avec l’Atelier de cartographie. En dehors de ces six auteurs, il y a quand même un gros travail qui a été fait au niveau de l’éditeur lui-même, c’est-à-dire qu’il y a eu un énorme travail de relecture, d’harmonisation qui a été fait par toute l’équipe de presse de Sciences-Po et, en particulier par Laurence de Bélizal, qui a vraiment relu planche par planche. Ainsi, nous n’avons pas juste envoyé le manuscrit à l’éditeur qui s’est contenté de l’imprimer, il y a eu un gros travail aussi des presses de Sciences-Po en tant qu’éditeur. Donc au total, ce doit être une petite dizaine de personnes qui ont travaillé sur l’atlas.
LVSL – Pendant combien de temps ?
FG – Pendant à peu-près deux ans. Évidemment, tout le monde n’a pas travaillé pendant deux ans à temps plein. On a aussi beaucoup travaillé avec le maquettiste Alain Chevalier parce que l’atlas n’est pas juste un texte, c’est un objet en lui-même et donc il fallait que l’équilibre des textes etc. soit bien calibré.

LVSL – Quelles ont été les plus grandes difficultés auxquelles vous avez été confrontés pendant l’élaboration de ce travail et comment vous les avez surmontées ?
FG – Il y en a eu beaucoup évidemment. Une première difficulté est de choisir les bonnes données, c’est-à-dire quelles vont être les données les plus parlantes, quelles vont être les socles de données les plus complets et les plus fiables. Très souvent, surtout dans un domaine comme l’environnement où il y a quand même une profusion d’infox, il y a toute une série de données qui sont parfois orientées ou qui sont parfois assez partielles. La première difficulté est donc de choisir des socles de données qui soient les plus neutres – parce que les données ne sont jamais neutres – mais qui soient les plus complètes et les plus robustes méthodologiquement notamment en terme de comparaison historique sur plusieurs années.
L’autre difficulté était d’aligner le texte avec les documents graphiques, c’est-à-dire, comment faire en sorte que le texte soutienne le document graphique et vice versa. Il y a eu aussi tout un travail d’harmonisation des données car celles-ci sont produites par toute une série d’organismes différents avec des méthodologies et des unités de mesure différentes et donc il y a eu tout un travail d’harmonisation. Puis, il y a eu une recherche dans le travail de présentation : comment être le plus percutant possible, comment être à la fois le plus complet tout en ayant quand même quelques informations saillantes que les gens puissent retenir. On a voulu essayer d’éviter l’aspect un peu encyclopédie ou catalogue où finalement on a tout mais on ne retient rien et donc, il fallait avoir à moment donné dans la présentation quelque chose, quelques aspects assez saillants et assez marquants. Le problème est que si on fait quelque chose type « grands moteurs de recherche d’Internet », les gens auront une vue très fragmentée, ils verront les sujets qui les intéressent et l’intérêt de les avoir en livre est qu’ils voient l’ensemble du système et donc l’ensemble des problèmes et des solutions.
LVSL – On peut alors imaginer que vous pourriez potentiellement faire les deux. Par exemple, Drawdown de Paul Hawken qui, avec son équipe de quarante chercheurs, a sorti une vraie encyclopédie avec plus de quatre-vingts solutions pour réguler le réchauffement climatique. En parallèle, il y a un site pour à la fois répertorier les sources et permettre des recherches par mot-clés. Avez-vous en tête un prolongement pour ce travail ?
FG – L’Atelier cartographique a sur son site et mettra sur son site à disposition toute une série de documents graphiques qui pourra être cherchée par les moteurs de recherche et on pense en particulier aux enseignants par exemple, ou aux gens qui ont besoin de ressources pédagogiques sur un sujet particulier. Nous sommes en train aussi de réfléchir à la possibilité de fournir des sortes de fiches thématiques notamment pour les enseignants ou pour ceux qui, dans des formations ont besoin de ressources pédagogiques. C’est quelque chose auquel on réfléchit pour le moment, c’est important que le livre ait sa première vie et on est en train de réfléchir à d’autres développements.
LVSL – J’imagine que si on veut lui donner plusieurs vies, il y aura un travail d’actualisation ?
FG – D’actualisation bien sûr et donc c’est également important que les gens qui ont acheté la première édition puissent trouver, trois ans plus tard ou cinq ans plus tard, une actualisation des cartes.
LVSL – D’où vous est venue l’idée et pourquoi vous vous êtes lancés dans cette aventure ?
FG – C’est une idée de Julie Gazier, la directrice des presses de Sciences-Po. En 2011, on a lancé auprès de Sciences-Po une collection « Développement durable » qui portait sur les sujets d’environnement et à l’époque c’était assez nouveau. C’était un moment où les questions d’environnement n’étaient pas encore considérées par les sciences humaines et sociales, et une maison comme Sciences-Po considérait encore à l’époque les questions d’environnement comme quelque chose d’assez technique dont elle n’avait pas vraiment à s’occuper. Donc, déjà à l’époque, lancer cette collection était un geste fort qui disait que c’était aussi un vrai sujet de sciences humaines et sociales. On a publié toute une série d’ouvrages sur plein de sujets différents, sur les forêts, le climat, la biodiversité, les abeilles, les éoliennes, mais on se disait au moment où ces sujets devenaient de plus en plus importants dans le débat public et dans l’espace public qu’il y avait toujours une vision assez fragmentée de ces sujets. Alors, il y avait le climat d’un côté, la biodiversité de l’autre, les pesticides d’un troisième côté et finalement nous avions une impression un peu éclatée des différents sujets alors qu’il nous semblait important de les rassembler et précisément de montrer le caractère systémique des différents sujets. Quand on regarde les incendies dans la forêt amazonienne, c’est autant une question de climat que de biodiversité, que de souveraineté, de gouvernance, que d’agriculture donc vous comprenez que ces sujets sont profondément liés.
LVSL – Vous avez une longue carrière par rapport à la question de l’environnement en général, vous avez beaucoup travaillé sur les migrations climatiques, notamment sur les liens entre sécurité et climat… Quand on produit un atlas comme ça, on découvre aussi bien évidemment beaucoup de données soi-même à travers son travail, quelles conclusions en tirez-vous sur le plan politique et comment est-ce que, après ce travail-là, vous vivez votre engagement ?
FG – On peut se dire que l’ensemble des données dresse un tableau qui n’est pas joli à voir de notre empreinte sur la planète et qu’en quelque sorte, oui, c’est un atlas de notre époque et donc un atlas de, non seulement notre empreinte sur la planète, mais de la manière dont nous avons organisé notre société et notre économie. On a essayé de ne pas donner seulement le résultat mais de montrer aussi quelles étaient les causes. En montrant à chaque fois les causes et les raisons qui ont fait que l’on est rentré dans l’anthropocène, on donne autant de clés que de solutions. On a découvert qu’il restait encore un énorme chantier scientifique, sur chaque planche, on a essayé de montrer un peu les limites des données et des connaissances en se disant « voilà, ce qu’on ne sait pas encore ». Ce qui me frappe beaucoup, c’est le caractère systémique de ces différentes crises et leur enchâssement les unes dans les autres et la nécessité de mobiliser toute une série de leviers et de solutions qui se répondent mutuellement mais l’impossibilité de régler cette crise par une solution miracle. On a voulu donner des leviers, des pistes pour les gens, non seulement au travers de leurs comportements individuels mais au travers des choix collectifs et de reposer les grandes orientations que nous avons prises et qui caractérisent l’anthropocène.
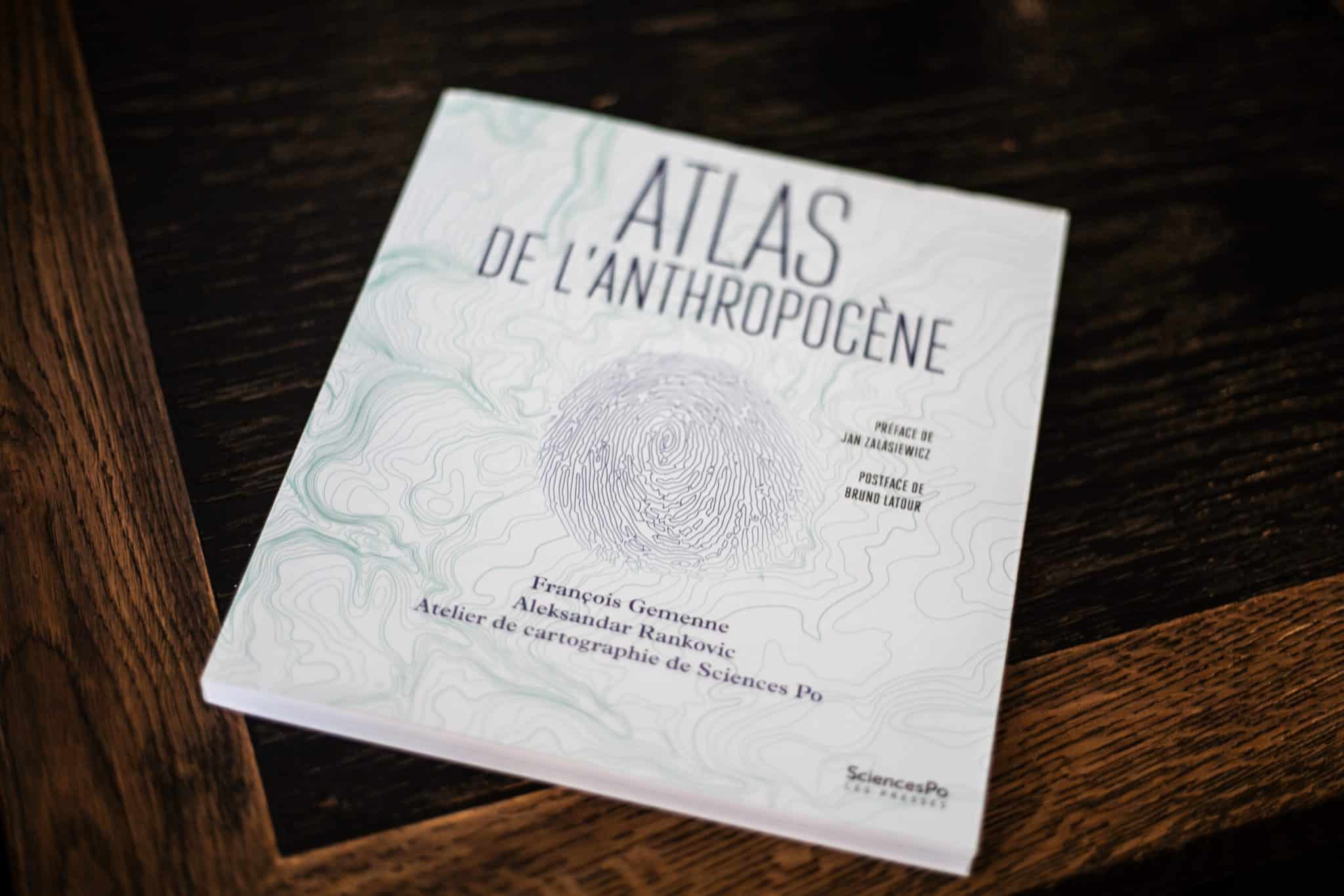
LVSL – Beaucoup de gens s’intéressent à la meilleure façon de mobiliser un maximum de personnes à l’urgence climatique. On se rend compte qu’il n’y a pas de méthode unique puisque chacun est sensible à des choses différentes et donc s’intéresse à l’environnement par des biais différents. C’est un peu la façon de penser de Netflix qui produit des contenus qui sont très différents pour des publics qui sont tout aussi différents et au final, tout le monde est sur la plate-forme et regarde une série par opposition à ce que fait traditionnellement la télévision, c’est-à-dire, des programmes uniques qui essaient de parler au plus grand nombre. Alors vous, à travers votre carrière et je vous pose cette question parce que vous êtes aussi enseignant à Sciences-Po, à Liège, comment on sensibilise alors, notamment des étudiants, à la question de l’urgence climatique, est-ce que cet atlas est suffisant pour cela ?
FG – J’ai envie de dire qu’il est nécessaire mais pas suffisant. Aujourd’hui, il y a un très grand nombre de gens qui sont sensibilisés à la question et on le voit dans les sondages d’opinion, de plus en plus de gens se sentent concernés et réalisent bien et le voient aussi autour d’eux, que quelque chose est en train de se passer. Je pense que beaucoup de gens manquent encore d’informations, d’une sorte de socle de compréhension commun sur ces enjeux. Je suis frappé, par exemple, du nombre de gens, à propos des incendies en Amazonie, qui étaient convaincus que c’était des incendies accidentels. On voit bien que sur chaque sujet, on manque d’un socle de compréhension commun précisément parce que les gens arrivent à ces sujets par différents biais et ne maîtrisent pas forcément peut-être toutes les clés ou toutes les informations.
Je crois profondément que la solution à un problème dépend beaucoup de la représentation qu’on se fait du problème et qu’un des objectifs de cet atlas est de faire progresser cette représentation commune et ce socle de connaissances. Dans la population, on a fait le maximum pour le rendre accessible au plus grand nombre, y compris aux gens qui ne connaissaient rien sur un sujet en particulier. Bien entendu, ce n’est pas suffisant, la question c’est comment est-ce qu’on sort de l’incantation, comment est-ce qu’on sort du slogan « Sauvez la planète, sauvez le climat », là où il est facile d’avoir un consensus social mais quand il va falloir poser les questions des choix collectifs, là, on ne va plus avoir de consensus social. On voit bien déjà aujourd’hui dans les mouvements de mobilisation et surtout les mouvements de jeunes qu’il y a toute une série d’options différentes, c’est-à-dire que l’on prône des modes d’action radicaux. D’autres disent qu’il faut construire ça avec l’ensemble de la société, des gouvernements et des entreprises, qu’il faut être dans une logique de construction et c’est évidemment normal.
Je pense que c’est une bonne chose que les questions d’environnement, d’écologie deviennent des questions contradictoires. Cela signifie qu’elles sont maintenant au centre du débat démocratique. La difficulté maintenant est comment faire et comment est-ce qu’on fait des choix collectifs. Pour le moment, on le voit bien, nous sommes dans une logique où personne n’ose encore véritablement poser ses choix et ses grandes orientations et que même dans le gouvernement, un peu plus que les autres sur l’environnement, on peut les compter sur les doigts d’une main mais il y en a quand même quelques uns qui sont dans une logique d’essayer de contenter les intérêts divergents et qui ont du mal à s’engager vraiment dans une direction. Donc, ce que l’on a voulu montrer, ce sont les différents leviers et ce qu’il fallait transformer. Évidemment, ce n’est pas à nous de prendre la décision politique mais je pense que notre rôle de chercheur est d’informer afin que chacun ait les clés de compréhension pour faire ses choix.
[1] Institut de Relations Internationales et Stratégiques
[2] Atlas de l’Anthropocène, de François Gemenne, Aleksandar Rankovic, Thomas Ansart, Benoît Martin, Patrice Mitrano, Antoine Rio. Préface de Jan Zalasiewicz, postface de Bruno Latour, éditions Presses de Science Po, août 2019, 160 p., 25 €.










