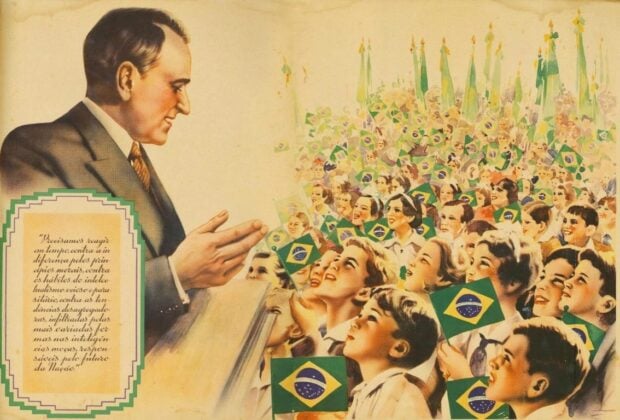Une multiplication par 112 en à peine dix ans. Alors que la France ne comptait que 6 méthaniseurs injectant du gaz dans le réseau national en 2014, GRDF en dénombre aujourd’hui pas moins de 674. Une croissance exponentielle qui touche toutes les campagnes et est promue par les pouvoirs publics comme un complément de revenu pour les agriculteurs et un moyen de développer une énergie certes polluante, mais renouvelable. Si la filière du biogaz peut en effet être un atout écologique et économique, son développement prolifique pose question : ne sommes-nous pas en train de reproduire l’erreur des biocarburants et de favoriser la production d’énergie au détriment de la production alimentaire ?
La méthanisation est un processus biologique consistant à dégrader des matières organiques par fermentation pour les transformer en biogaz énergétique ou en digestat. Ce processus est apparu dans les années 1940 mais ne s’appliquait alors qu’aux déchets agricoles (principalement les parties non consommables des végétaux) et effluents d’élevage (fumier et lisier des animaux). En laissant fermenter ces matières premières dans certaines conditions de température et de pression, dans un milieu sans oxygène, on obtient alors plusieurs gaz, notamment du dioxyde de carbone et du méthane. Ce dernier, dès lors qualifié de « biogaz » peut servir à produire de l’électricité et de la chaleur ou, après épuration (biométhane), être utilisé comme carburant dans les réseaux de gaz naturel, les bouteilles à usage domestique et tous les véhicules adaptés. Le digestat, c’est-à-dire le résidu de ce « compost » peut quant à lui être épandu dans les champs comme fertilisant.
Peu à peu, les exploitations agricoles ont adopté ce processus pour valoriser leurs déchets agricoles. L’Allemagne a une longueur d’avance sur ce terrain : nombre de ses agriculteurs se sont transformés en véritables producteurs de méthane, grâce à un généreux système de subvention de l’électricité produite mis en place par une loi sur les énergies renouvelables en 2000. En France, le développement de cette technologie est bien plus récent et prend une échelle industrielle seulement depuis quelques années. Perçue initialement comme une idée intéressante pour répondre aux enjeux de transition écologique, la méthanisation fait aujourd’hui débat dans l’opinion publique et politique en se situant à la croisée de questionnements techniques et sociétaux : écologie, économie, industrie et agriculture.
La méthanisation, une solution écologique ?
Si la méthanisation connaît un intérêt croissant, c’est notamment car elle est régulièrement présentée comme une solution écologique durable et un moyen de garantir la souveraineté énergétique française, permettant ainsi une plus grande liberté en matière géopolitique. La production de biogaz (fermentation de matières organiques végétales ou animales) a connu en France une très forte croissance entre 2007 et 2019. Pour ce qui est du biométhane, c’est-à-dire du biogaz purifié injecté dans le réseau de distribution de gaz de GRDF, le dynamisme est plus récent et plus rapide. Fin 2020, 1075 installations de production de biogaz sont en fonction, d’après un rapport d’information du Sénat, principalement dans la moitié nord du pays (Bretagne, Grand Est, Hauts de France). Ces installations sont de nature agricole, à hauteur de 86 % pour l’injection et de 79 % pour celles produisant de l’électricité.
Renouvelable, non intermittente et stockable, la production de biogaz présente des atouts importants pour la transition énergétique et la décarbonation.
Renouvelable, non intermittente et stockable, la production de biogaz présente des atouts importants pour la transition énergétique et la décarbonation. Le bilan carbone du biométhane injecté est en effet 5 à 10 fois moindre que celui du gaz naturel selon GRDF. La France a donc fixé un objectif ambitieux pour 2030 : que ce biogaz représente 10 % de la consommation de gaz d’ici seulement six ans. Au début de la décennie 2020, nous en étions encore loin : seuls 0,5% de la consommation de gaz naturel était issu d’une production renouvelable.
La production nationale de gaz naturel a diminué entre les années 1980 et 2010 puisque le gisement de gaz naturel de Lacq (Pyrénées Atlantiques) a cessé d’être exploité et celui de gaz de mines des Hauts-de-France étant marginal. La France est donc tributaire de ses importations depuis la Norvège (36 %), la Russie (20 %, en forte baisse depuis 2022), les Pays-Bas (8 %), le Nigéria (8 %), l’Algérie (7 %) et le Qatar (4 %). Dans ce contexte, le biogaz est apparu comme une source d’énergie particulièrement intéressante pour, d’une part, décarboner la consommation de gaz et, d’autre part, relocaliser sa production en France.
Toutefois, ce « gaz bio » pose de nombreuses questions. Si son bilan carbone global est effectivement bien plus faible que le gaz naturel directement extrait de forages, le processus de méthanisation induit tout de même des émissions de gaz à effet de serre, notamment des émissions de protoxyde d’azote et de méthane au moment du stockage des intrants ainsi qu’au moment du stockage et de l’épandage du digestat. A ces émissions directes, il faut ajouter des émissions de CO2 indirectes notamment à l’occasion du transport des intrants et du digestat. Présenté comme solution verte et durable, la méthanisation est donc loin d’un bilan carbone neutre.
En réalité, étant donné que le méthaniseur est multifonctionnel, les scientifiques rencontrent certaines difficultés d’analyse découlant de la pluralité des paramètres. Le bilan carbone peut en effet varier selon le type d’unité et de modèle de méthanisation développés. Des critiques sont donc formulées à l’égard des études existantes à ce sujet, notamment par France Nature Environnement (FNE). En effet, FNE conteste l’approche méthodologique des études qui considèrent l’essentiel des intrants de la méthanisation comme des déchets. Or, le développement rapide de la méthanisation et la nécessité de rentabiliser des installations de plus en plus grosses conduit parfois à alimenter les installations avec des cultures plantées spécifiquement pour produire de l’énergie. Ce changement d’affectation des sols a à la fois des effets directs en matière de bilan carbone (émissions agricoles) et des effets indirects puisque le remplacement d’une culture alimentaire par une culture énergétique est de nature à entraîner par rebond une modification d’affectation du sol dans une autre zone géographique, où une prairie ou une forêt seraient par exemple remplacées par une culture alimentaire.
Une solution pour les revenus des agriculteurs ?
Initialement, la méthanisation est une idée intéressante pour soutenir l’activité agricole. En effet, plusieurs travaux de recherche ont tenté de quantifier et de caractériser comme le projet « Métha’revenu » ou encore le programme CASDAR « MéthaLAE » mené entre 2015 et 2018. Selon ces études, les revenus courants calculés avant impôt perçus par les porteurs de projet de méthanisation sont très majoritairement positifs, malgré l’hétérogénéité des formes de méthanisation. En effet, dans les cas où l’unité est portée par des agriculteurs uniquement, individuellement ou collectivement, et pour lesquelles la production de kilowatt électrique est comprise entre 100KWe et 3MWe, le revenu brut tiré d’une unité en injection peut varier de l’ordre de 50 000 euros à 1,5 million d’euros par an. Ces études démontrent donc que la méthanisation permet une certaine stabilité des revenus dans le temps. Naturellement, étant donné la faiblesse des revenus des agriculteurs – 18 % d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté – et leur volatilité en raison des fluctuations du marché et des aléas climatiques, la stabilité apportée par la méthanisation constitue une grande motivation pour les agriculteurs.
Étant donné la faiblesse des revenus agricoles et leur volatilité en raison des fluctuations du marché et des aléas climatiques, la stabilité apportée par la méthanisation constitue une grande motivation pour les agriculteurs.
La méthanisation apparaît alors également comme un moyen de moderniser son activité et de créer une activité d’« énergiculteur ». Dès lors, les études mettent en exergue la méthanisation comme un facteur favorisant la transmission des exploitations agricoles, en offrant des perspectives aux jeunes générations qui ne souhaitaient pas nécessairement reprendre l’exploitation familiale. Enfin, il ressort également de ces études que ce processus permet la création et la consolidation d’emplois salariés puisqu’il faut plus de main-d’oeuvre pour le fonctionnement du méthaniseur ou pour le développement d’activités induites par la méthanisation, comme le maraîchage sous serres chauffées par du biogaz.
Mais ce modèle a été radicalement transformé depuis 2015, laissant de nombreux agriculteurs sur le carreau. En 2010, la France ne comptait que 44 installations utilisant des ressources agricoles, avec 38 unités à la ferme et 6 centralisées. Encore méconnu, le procédé restait à l’initiative des agriculteurs. Mais à partir de 2015, la filière change de visage. Le gouvernement favorise les unités qui produisent directement du biométhane à injecter dans le réseau, ce qui nécessite des installations plus grosses et plus chères que les agriculteurs ne peuvent pas forcément s’offrir : il faut compter environ 5 millions d’euros pour une installation de ce type. À la fin 2021, plus de mille unités de méthanisation agricole fonctionnaient. Aussi, entre 2015 et 2021, la capacité installée en injection a été multipliée par 22 ! En outre, les 940 projets en cours multiplieraient encore cette capacité par quatre. Cette ambition aiguise alors les appétits chez les industriels qui s’accaparent les bénéfices de la production du gaz, reléguant les agriculteurs à la place de simples fournisseurs de déchets.
TotalEnergies a par exemple racheté début 2021 la principale entreprise du secteur, Fonroche Biogaz, et ses sept méthaniseurs, acquérant ainsi une capacité de production de 500 GWh par an, presque 8 % de la capacité nationale. Les petits méthaniseurs à la ferme sont donc beaucoup moins intéressants puisqu’avec ces unités, les industriels comme TotalEnergies produisent pour deux fois moins cher. Cela engendre des inégalités socio-économiques importantes. En effet, au-delà des coûts liés à la matière première, s’ajoutent ceux liés à la maintenance du méthaniseur, à l’embauche d’un technicien spécialisé et dédié à cette tâche. Aussi, la facture pour faire fonctionner un méthaniseur au quotidien, entre l’approvisionnement en déchets et la maintenance, s’allonge lourdement.
Le gouvernement favorise les unités qui produisent directement du biométhane à injecter dans le réseau, ce qui nécessite des installations plus grosses et plus chères que les agriculteurs ne peuvent pas forcément s’offrir.
Pour être rentable, chaque installation en injection doit consommer au minimum 10.000 à 15.000 tonnes de matières par an, soit plus de 30 tonnes de déchets par jour. La méthanisation par cogénération, qui consiste à convertir le gaz en chaleur et en électricité sans se raccorder au réseau de gaz, représente elle un investissement moyen de 2 millions d’euros et permet de se contenter de plus petits volumes, autour de 5.000 tonnes de matières premières par an. L’injection, plus chère mais plus productrice, a pris le dessus. Elle exclut alors les agriculteurs, notamment les éleveurs, qui ne peuvent pas investir 5 millions d’euros et assumer des charges d’approvisionnement et de maintenance.
Même si l’Association des agriculteurs méthaniseurs de France souhaite que la méthanisation reste aux mains des agriculteurs pour leur permettre de diversifier leurs sources de revenus, ce sont des exploitations de plus en plus grandes qui structurent le paysage et l’économie française : Total, Engie et les autres opérateurs lorgnent sur la campagne qui s’ouvre à eux. Les agriculteurs ont du mal à résister à la concurrence des énergéticiens et risque de devenir un outil au service de la production gazière.
Un système dangereux pour l’environnement et les populations
Face aux volumes de plus en plus considérables requis par les méthaniseurs créés par les multinationales, de nombreuses questions se posent aussi sur les quantités de digestat produites comme résidus de la méthanisation. Là encore, le tableau est contrasté. D’une part, le digestat peut réduire le besoin en engrais azotés de synthèse, eux aussi très largement importés, tout en favorisant l’augmentation des rendements agricoles en agriculture biologique. La méthanisation favorise également le développement des cultures intermédiaires dont les externalités positives sont nombreuses (protection des sols, captation de l’azote, préservation de la biodiversité…). Toutefois, les études sur les bienfaits du digestat comme engrais sont assez controversées.
Une enquête du média breton indépendant Splann ! montre ainsi que le risque d’avoir des agents pathogènes dans les champs est très élevé puisque les méthaniseurs engloutissent des déchets de natures et de provenances diverses, parfois dangereuses. Les déchets utilisés au sein des méthaniseurs peuvent en effet contenir des résidus de médicaments, de métaux lourds et de pesticides (notamment dans les restes animaux des abattoirs). Ce risque de pollution des sols s’accroît d’autant plus que la provenance des déchets dépasse largement le périmètre de l’exploitation initiale : plus les déchets alimentant les méthaniseurs viennent de loin, plus il est difficile d’en tracer l’origine et de contrôler les risques sanitaires qu’ils occasionnent.
Réduire le risque de contamination des sols implique de mettre en place un processus d’hygiénisation des matières avant de les mettre dans le méthaniseur. Ce traitement consiste à chauffer les déchets à 70°C pendant une heure, afin de réduire les agents pathogènes à des niveaux indétectables, bien que certains produits peuvent certes résister à cette opération. Surtout, l’hygiénisation n’est obligatoire que pour les méthaniseurs consommant plus de 30.000 tonnes par an de matières, animales et végétales ou si plus d’une dizaine de fermes fournissent des déchets. Pour des raisons financières, afin d’éviter ces coûts de chauffage des matières, la plupart des méthaniseurs ne pratiquent pas l’hygiénisation, selon l’enquête de Splann ! en Bretagne.
En septembre 2021, le service de suivi des risques industriels du ministère de la Transition écologique a publié une synthèse des accidents dans la filière de la méthanisation recensait 130 accidents en France entre 1996 et 2020, en forte augmentation ces dernières années. Dans 74 % des cas, il s’agit de rejets de matières dangereuses ou polluantes, le reste correspondant à des incendies ou des explosions. Mais ces chiffres ne représentent pas la totalité des accidents survenus à cause des méthaniseurs. Par exemple, sur les cinq pollutions du méthaniseur d’Arzal dans le Morbihan (déversement du contenu de ses cuves dans le cours d’eau de Kerollet), seulement deux ont été recensées par le rapport ministériel. Selon le Conseil Scientifique National sur la méthanisation (CSNM), le nombre d’incidents en France s’élève à 350, soit trois fois plus que le chiffre donné par les services de l’État.
Les conséquences de ces accidents peuvent être sérieuses. Par exemple, en 2020 le méthaniseur industriel de Châteaulin avait déversé 400 m3 de digestat dans l’Aulne, affectant l’eau distribuée au robinet, privant les populations d’eau potable durant une semaine. Un incident similaire s’est aussi produit dans le Sud-Ouest de la France, dans les Landes, six mois plus tard. Cette fois, 850 m3 se sont déversés dans les cours d’eau. En juin 2019, un méthaniseur qui n’est pas encore en fonctionnement explose à Plouvorn, dans le Finistère, mobilisant une quarantaine de pompiers.
En 2021, la Cour des comptes démontrait que les services d’inspection ne sont même pas informés de la création d’un nouveau méthaniseur et que le contrôle ponctuel des installations n’est pratiquement jamais fait.
Alors que les méthaniseurs se multiplient dans nos campagnes, les services de l’Etat apparaissent dépassés. En outre, la réglementation qui encadre les projets de méthanisation ne cesse de s’assouplir depuis dix ans. L’Etat joue sur la simplification des installations en misant notamment sur la confiance et l’auto-contrôle des porteurs de projets qui ne sont pas forcément formés à ce genre de système. Ce manque de contrôle et d’investissement des services de l’Etat participe à l’augmentation des risques d’accidents. Dans un rapport publié en 2021, la Cour des comptes témoigne de cette absence puisqu’elle démontre que les services d’inspection ne sont même pas informés de la création d’un nouveau méthaniseur, et que le contrôle ponctuel des installations n’est pratiquement jamais fait. Par exemple, les directions départementales de la protection des populations ont mené en 2021 une série de contrôles dans 14 établissements sur les plus de 150 installations existantes en Bretagne à l’époque et ont démontré que dans 85% des cas, les aménagements prévus dès le début du projet n’ont pas été réalisés (cuves de rétention évitant des déversements accidentels dans le milieu naturel, systèmes d’évacuation d’eaux pluviales, alerte incendie…).
Tension entre production alimentaire et production énergétique
Outre les pollutions directes que peut causer la méthanisation, celle-ci engendre un risque environnemental plus large, à savoir que les agriculteurs ne se transforment en producteur d’énergie. Les cas d’abandon de l’activité principale d’élevage au profit de la méthanisation sont avérées, en particulier en Bretagne. Cela fait sens dans la mesure où produire de l’énergie rapporte bien plus qu’élever des vaches, de produire du lait ou des céréales pour le marché alimentaire. Dès lors, les agriculteurs tendent à vendre leur culture au plus offrant, c’est-à-dire aux unités de méthanisation.
Produire de l’énergie rapporte bien plus qu’élever des vaches, de produire du lait ou des céréales pour le marché alimentaire.
Les cultures sont en effet bien plus intéressantes que les déchets agricoles pour produire du gaz. Les effluents ont un potentiel énergétique faible, a contrario des cultures qui sont bien plus méthanogènes, c’est à dire qu’elles produisent plus de méthane. La fermentation du fumier est par exemple moins efficace que celle du maïs. Présentée comme un moyen de compenser les faibles revenus agricoles et permettant d’avoir un prix fixe pendant quinze ans pour les agriculteurs, la méthanisation fait aujourd’hui des agriculteurs des producteurs d’énergie. Les dérives de ce modèle entraînent alors de grandes tensions entre production alimentaire et production énergétique qui tendent à se confondre en allant vers une agriculture industrielle.
Au lieu d’être utilisées pour nourrir humains et animaux, des denrées et cultures sont englouties en masse dans les méthaniseurs, mettant en péril la sécurité et la souveraineté alimentaire. Le risque est donc une utilisation abusive des cultures alimentaires au profit de la production énergétique et de dériver vers un modèle à l’allemande, où d’immenses surfaces de maïs sont plantées uniquement pour produire du biogaz.
Pour l’heure, l’ampleur du phénomène reste limitée en France. Selon les estimations de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), les cultures ne représenteraient que 5% des intrants en 2020. Toutefois, lorsque les prix des cultures principales baisse sur le marché, il existe un risque important de valorisation énergétique de ces dernières, un risque amené à croître du fait de la concurrence étrangère encouragée par la multiplication des accords de libre-échange signés par l’Union européenne. De plus, depuis la loi sur la transition énergétique de 2015, un nouveau type de culture apparaît : les cultures intermédiaires à vocation énergétique. Représentant 29 % des intrants, ces cultures sont plantées et récoltées entre deux cultures principales et jouent un rôle de couvert végétal pour protéger les sols puis sont utilisées comme intrant dans les unités de méthanisation. Cela peut néanmoins varier facilement selon l’Association française du gaz, puisque l’utilisation de ces cultures peut permettre de répondre à des situations transitoires, notamment lors de mauvaises récoltes. Cependant, aucune limite n’est fixée dans l’introduction de ces cultures intermédiaires dans les méthaniseurs, contrairement aux cultures principales qui ne peuvent dépasser 15 % des intrants par an.
Toutefois, contourner la loi pour laisser place au « maïs énergétique » est de plus en plus fréquent, puisque le pourcentage des ressources agricoles réellement utilisées est inconnu malgré les études identifiant le volume du gisement disponible de chaque culture. Avec les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) à l’horizon 2028 qui fixe une cible de production de biogaz à 103 TWh, la production d’énergie va privilégier les cultures nobles plutôt que les déchets de culture pour répondre à ces objectifs. L’entreprise Margaron SAS, à Roybon (Isère) fournit par exemple des pommes de terres aux méthaniseurs. Le tubercule ici ne s’apprécie plus seulement pour son intérêt nutritionnel, mais aussi selon ses capacités à produire du méthane. Et il en va de même pour le maïs, dont l’arrivée en Bretagne correspond à l’avènement de l’élevage intensif.
Si ces risques sont connus par les services de l’Etat, la nécessité de faire tourner les méthaniseurs en continu nécessite un approvisionnement 24 heures sur 24. La tentation d’utiliser des cultures en principe destinées à l’alimentation humaine ou animale est donc forte. Pour contourner la loi, il suffit d’ailleurs de déclarer une céréale, habituellement culture principale, comme « culture dérobée » ou CIVE, tandis que les contrôles sont presque inexistants. Si la méthanisation présente donc de vrais atouts pour la transition énergétique et le revenu des agriculteurs, un scénario à l’allemande est loin d’être impossible. Un tel système ne bénéficierait guère aux agriculteurs, mais plutôt aux grands groupes comme Engie et TotalEnergies, ravis de pouvoir continuer à vendre du gaz repeint en vert.