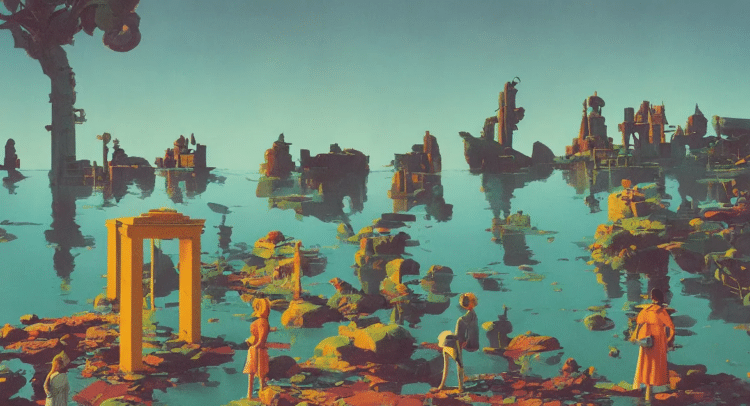Nous vivons sous un « Nouveau Régime Climatique », qui impose de repenser notre rapport à la politique et à la nature. Celle-ci n’est plus une ressource passive, c’est un système qui réagit à nos actions. Les agents non-humains cessent d’être des choses inertes : ils contestent à l’homme son statut prédominant. Cette rupture avec les fondements de la « modernité » (caractérisée par un « Grand Partage » entre nature et culture) implique d’abandonner les « classes sociales » traditionnelles, fondées sur le concept étroitement matérialiste de la « production ». Il faut leur préférer la notion de « classe écologique », qui englobe l’ensemble des agents souhaitant œuvrer à l’habitabilité de la Terre. Ces leitmotivs, développés par Bruno Latour, ont été relayés dans la sphère médiatique avec une complaisance surprenante. Derrière cette ontologie politique, on trouve autre chose qu’une énième attaque contre la sociologie au nom de l’environnement – ou une nouvelle manière d’édulcorer la critique écologique du capitalisme.
Partons d’un constat sommaire mais révélateur. Latour, absent du numéro sur les « penseurs de l’écologie » de la revue Sciences humaines en 2010, est devenu omniprésent dans la pensée écologiste contemporaine. On compte une multiplicité de publications et de collections (parfois elles-mêmes critiques envers Latour) qui s’inspirent de ses thématiques.
Repenser notre « condition terrestre » et rejeter les classes sociales ?
« Habiter la terre en commun », définir une « nouvelle condition terrestre » dans un monde où « nous ne sommes pas seuls », « penser avec la terre » en se réappropriant « la part sauvage du monde » : de quoi ce foisonnement d’expressions est-il le nom ? On pourrait ajouter à ces expressions une liste (non exhaustive) d’ouvrages : « penser comme un iceberg », « être un chêne », « être forêts », et même « s’enforester » au point de « suivre la piste animale »… autant de tentatives pour tenter de « vivre dans un monde abîmé », tout en cueillant « les champignons de la fin du monde ».
Cette nouvelle manière d’être est censée tracer les contours d’un nouvel horizon d’émancipation. Un exemple parmi d’autres : « Nous avons la sensation d’être pris en étau. Entre d’un côté un héritage […] révolutionnaire mais très anthropocentrique, qui éprouve la plus grande difficulté à déplacer ses cadres de pensée, du fait d’un attachement à une tradition de lutte humaniste ou classiste. Et de l’autre, une sensibilité au vivant, où l’humain n’est plus au centre ».
La sortie de cet étau préfigurerait l’émergence « d’un nouveau camp politique à part entière », celui des « Terrestres », qui refuserait de rabattre le politique sur le social et tiendrait compte de « l’agentivité » de toutes les formes de vie1. Cette littérature en plein essor se caractérise par un rejet des sciences sociales qui la conduit à disqualifier comme « marxiste » toute théorie privilégiant la puissance d’agir du « peuple » à celle des « choses ». Voyons alors les transformations que ce « récit de l’Anthropocène » entend apporter.
Bruno Latour se fonde sur le postulat suivant : la sociologie, telle qu’elle s’est développée chez les Modernes, serait incapable de comprendre les basculements du monde et ses multiplicités. Penchons-nous sur la « classe écologique » théorisée par Latour et Schultz dans leur Mémo sur la classe écologique, qui a suscité de nombreux débats. S’il peut paraître futile de s’intéresser à une notion dont ses concepteurs avouent qu’elle est « fictionnelle et spéculative » – au point de se demander : « est-ce qu’elle existe, cette classe écologique ? » –, elle fait apparaître les principales impasses du raisonnement de Latour et ses procédés argumentatifs 2.
Le productivisme a des caractéristiques bien précises qui ne tiennent pas à la « modernité ». Elles tiennent à l’accumulation illimitée du capital.
Latour et Schultz s’interrogent : pourquoi la thématique écologique ne donne-t-elle pas lieu à un large mouvement social ? Leur réponse consiste à mettre en cause le cadre de pensée des Modernes, prisonniers d’un décentrage issu de Galilée, qui aurait versé dans un universalisme abstrait et une conception géométrique de la nature empêchant de prendre en compte la spécificité de la « condition terrestre ». Ils prennent conjointement pour cible la sociologie, dernier avatar de cette modernité, qui entérinerait l’idée d’un monde culturel distinct de la nature et qui se rendrait coupable de raisonner à partir de concepts obsolètes comme les « classes sociales ». Ils rejettent celles-ci, « profondément liées à la notion et à l’idéal de la production3 ». Au matérialisme de la lutte des classes, ils substituent une « nouvelle matérialité » propre au « Nouveau Régime Climatique », qui se définirait non par la production et la reproduction des conditions matérielles d’existence, mais par « les conditions d’habitabilité de la planète Terre4 ».
Citons-les in extenso : « Ce n’est plus la même matérialité ! […] La survie et la reproduction humaine étaient pour Marx le principe premier de toutes les sociétés et de leur histoire. […] Or nous nous trouvons aujourd’hui dans une tout autre configuration historique. […] La production ne définit plus notre seul horizon. Et surtout ce n’est plus la même matière à laquelle nous nous trouvons confrontés5 ». Face aux classes sociales définies par les rapports de production, la classe écologique, « classe pivot », serait à même de « réorganiser la politique autour d’elle » et de redéfinir « l’horizon politique6 ». Elle se caractériserait par le fait qu’elle conteste la « notion de production » pour créer les conditions de l’émancipation autour de « l’habitabilité » de la Terre.
Le problème ici n’est pas seulement que Latour et Schultz ignorent la vaste littérature sociologique qui documente les mobilisations écologistes existantes, mais surtout que cette ignorance leur permet d’affirmer, sans autres preuves, que l’enjeu écologique n’est aucunement lié aux classes sociales traditionnelles. La « classe écologique » découle de ce postulat anti sciences sociales (et anti marxiste, le marxisme étant la cible la plus explicite des auteurs)7. Mais peut-on réellement penser l’écologie en-dehors des rapports de domination du capitalisme ? Si l’écologie ne mobilise pas davantage, n’est-ce pas parce qu’elle est dominée par les classes dominantes et qu’elle en promeut une vision « bourgeoise8 » ou un « environnementalisme des riches9 »?
« La situation écologique est extraordinairement dure pour tout le monde »
Latour et Schultz doivent affronter une objection de taille : les préoccupations écologiques, sur le climat, l’énergie ou la biodiversité, sont omniprésentes, au point que « les conflits prolifèrent » à propos de la nature. Et de citer les protestations des jeunes ou des Gilets Jaunes en France, des agriculteurs en Inde, des communautés autochtones contre la fracturation hydraulique en Amérique du nord, etc. Leur argument pour expliquer l’absence de mobilisation écologique est le suivant : la multitude des conflits ne prend pas la forme d’une « mobilisation générale10 » car cette diversité « empêche de donner à ces luttes une définition cohérente » et de ramener les conflits « en une unité d’action compréhensible pour tous11 ».
Sur ce point, l’argumentation reste impressionniste : des personnes appartenant à une même classe comprendraient différemment l’écologie, tandis que des activistes que tout sépare se reconnaîtraient dans les mêmes luttes12. On cherchera en vain une référence aux travaux sur les inégalités sociales face à l’environnement, aux différenciations sociales en matière d’appropriation de l’écologie13 ; on cherchera tout autant une analyse un peu précise de la construction de la « question climatique » ou des déterminants sociaux des mobilisations sociales en faveur de la « cause écologique14 ». De nombreuses enquêtes abordent pourtant ces thématiques, avec des résultats qui ne sont pas négligeables15.
Jean-Baptiste Comby et Sophie Dubuisson-Quellier ont ainsi montré dans quelle mesure les mobilisations écologiques, auparavant accusées de dépolitisation pour se centrer plus sur la défense de la nature que des groupes sociaux, se rapprochent désormais de la conflictualité des luttes sociales16. La « démultiplication des collectifs et engagements écologistes » depuis les années 2010 déplace en réalité les clivages, entre écologies compatibles avec le capitalisme (souvent qualifiées de « bourgeoises »), et écologies critiques porteuses de rupture avec le capitalisme (et elles qualifiées de « populaires »).
L’ignorance des problématiques soulevées par les travaux existants conduit à une forme de prétention intellectuelle qui consiste soit à ignorer soit à réinventer, à partir de rien, des thèmes qui ont pourtant déjà fait l’objet d’une importante attention sociale et sociologique. De nombreuses enquêtes sur les conflits environnementaux, qui représentent un domaine d’étude à part entière, ont par exemple documenté « l’exposition disproportionnée des populations défavorisées17 » aux risques occasionnés par les activité industrielles, forestières, minières, etc., et les rapports coloniaux ou néocoloniaux de domination dont elles relèvent.
Tout en inscrivant les principes de justice sociale dans les luttes écologiques, ces travaux montrent la politisation ambivalente sur laquelle la problématique environnementale débouche : dans le cas des activités extractives des pays du sud, il n’y a ainsi ni soutien inconditionnel des populations aux projets miniers, ni adhésion spontanée à la cause écologique. Les leviers des mobilisations résident dans des thématiques de danger au travail ou de rémunérations18 ; de même, les inégalités urbaines d’accès à l’eau suscitent des mobilisations qui relèvent plus d’une « politisation par nécessité » liées à des enjeux de reconnaissance des quartiers périphériques que de la défense d’une ressource considérée comme un bien commun19.
Ainsi, les injustices environnementales n’apparaissent pas seulement dans la différenciation sociale des contributions à la dégradation du monde, mais aussi dans les inégales capacités à se mobiliser pour faire face à cette dégradation. La sociologie des mobilisations écologiques révèle ainsi l’ancrage des dispositions à agir dans une pluralité de rapports au monde et de significations, inégalement distribués socialement. Ce n’est qu’au prix de la réduction de cette complexité sociale à une unique condition terrestre qu’il est possible de parler de « classe écologique ». Ou plus précisément, c’est le refus – ou le déni20 – de toute sociologie des enjeux écologiques qui permet d’en formuler l’idée.
Le mérite d’une perspective sociologique – que rejettent précisément Latour et Schultz – réside dans le fait qu’elle permet de comprendre qu’un problème public ne devient politique que s’il affecte les puissants. Or Latour se caractérise par son insensibilité à cette dimension de classe, qui est invisibilisée par sa mise en accusation générale et englobante de la modernité21. Son analyse de la catastrophe en cours le conduit à affirmer que « la situation écologique et sociale dans laquelle nous sommes est extraordinairement dure pour tout le monde 22». Il ne lui vient pas à l’idée que la situation n’est pas également « dure pour tout le monde ». On ne trouvera, sous la plume de Latour, pas une seule occurrence du terme « injustices environnementales », pas davantage que le mot « capitalisme » à propos de qu’il qualifie pourtant d’« énorme machine du développement et du progrès23 ».
Les philosophes Paul Guillibert et Frédéric Monferrand font une analyse incisive et précise de la critique latourienne de Marx, et de ses contresens. Ils prennent au sérieux la question selon laquelle le maintien de l’habitabilité de la Terre nécessite de rompre avec le développement productiviste, mais ils questionnent le diagnostic de Latour : « les écologistes sont-ils voués à devenir la nouvelle classe dominante ou bien doivent-ils lutter avec les autres dominés pour abolir les classes ?24 »
Comme caractéristique du capitalisme, le productivisme, orienté non seulement vers la satisfaction des besoins mais vers « la valorisation de la valeur investie en salaires et en moyens de production », a des caractéristiques bien précises qui ne tiennent pas à la « modernité ». Elles tiennent à l’accumulation illimitée du capital. Ainsi « une formation sociale peut être “capitaliste” sans être totalement “moderne” au sens ici esquissé : c’est le cas de l’Inde ou du Japon », notent les deux philosophes, qui rappellent combien l’analyse marxiste de la reproduction élargie montrait les logiques impérialistes d’épuisement de la terre et des travailleurs.
Au-delà de la simplification qui consiste à ramener « la pensée occidentale » au « naturalisme », la réduction de l’idée de « nature » à celle de Galilée ignore à peu près deux siècles de recherche en sciences du vivant. Ils poursuivent : « Si l’on ajoute alors que cette ruine perpétuelle s’accompagne notamment d’une émission exponentielle de CO2 dans l’atmosphère, on conclura qu’à la différence de ce que suggère Philippe Pignarre25, il n’est pas trivial d’affirmer que le capital détruit les natures humaines et non-humaines par l’extractivisme ou l’agriculture intensive, la pollution atmosphérique ou l’accumulation de déchets. C’est même ce qu’exige un minimum de réalisme intellectuel et politique, tant les conditions d’habitabilité de la planète sont directement menacées par la continuité de la production, c’est-à-dire de l’injustice et de l’exploitation. Il n’y a donc pas d’alternative entre préserver les premières et interrompre la seconde : les deux luttes doivent être menées de front. “L’écosocialisme” dont Latour et Schultz ne disent pas un mot n’a jamais rien dit d’autre26 ».
Ces dynamiques d’accumulation et ces luttes sont absentes du Mémo sur la classe écologique, et plus généralement de l’œuvre de Latour, qui ignore ainsi les revendications de ceux que les problèmes écologiques affectent en premier lieu, qui souhaiteraient avant tout que l’on combatte les injustices environnementales. Il accorde peu d’importance au rapport à l’écologie que l’on observe chez les plus fortunés, en dépit de quelques pages quelque peu caricaturales sur le « séparatisme social » des élites dans Où atterrir27 ? Peut-on réellement penser que l’on renforcera les mobilisations en faveur de l’environnement en posant un voile sur cette conflictualité fondamentale ?
De « l’ontologie des non-humains » à « l’hypothèse Gaïa »
Ce rejet des classes sociales se fonde sur une critique du « Grand Partage » entre nature et culture, et justifie pour Latour la réhabilitation des « non-humains » comme acteurs à part entière. Ce « Grand Partage » découlerait d’une vision mécaniste de la nature développée à partir du XVe siècle, solidaire de l’émergence du productivisme. Citons Latour : « Un Moderne en développement se sentait à l’aise dans la nature. Son modèle cosmologique, si l’on voulait prendre un exemple canonique, ce serait le plan incliné de Galilée. »28
Ainsi, le diagnostic délaisse l’analyse politique, pour entrer de plein pied sur des considérations à la fois épistémologiques et ontologiques. Selon Latour, les gauches avaient une vision trop abstraite du monde matériel pour pouvoir résister aux logiques capitalistes : elles n’ont pas vu la « métamorphose de la définition même de la matière, du monde, de la terre sur laquelle tout reposait », au cours de leurs luttes où étaient opposés conflits sociaux et conflits écologiques.
Pour expliquer pourquoi le lien ne se fait pas entre « les vieux briscards de la lutte des classes » et « les nouvelles recrues des conflits géo-sociaux », Latour invoque le « rôle que les uns et les autres ont prêté à la “nature” ». « Voilà l’un des cas où, littéralement, les idées mènent le monde », ajoute-t-il : « une certaine conception de la “nature” a permis aux Modernes d’occuper la Terre d’une façon telle qu’elle a interdit à d’autres d’occuper autrement leur propre territoire »29. Ainsi, il faudrait prendre le tournant inauguré par les zadistes et leur « slogan génial » : Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. À l’encontre des gauches traditionnelles qui auraient adopté une vision trop abstraite de la nature (comme ressource) et trop mécaniste du « progrès », ceux-ci remettraient en cause le « Grand Partage » entre nature et culture.
Latour fonde cette ontologie sur une épistémologie spécifique. Faisant appel à la sociologie des sciences, il affirme que la vision d’une nature extérieure et objective « n’est pas une donnée de l’expérience mais le résultat d’une histoire politico-scientifique très particulière qu’il convient d’examiner brièvement pour redonner à la politique ses marges de manœuvre »30. Or l’épistémologie ordinaire emprisonnerait la science dans « une conception de la “nature” impossible à politiser puisqu’elle a été justement inventée pour limiter l’action humaine grâce à l’appel aux lois de la nature objective qu’on ne saurait discuter ». Il évoque ici sa critique du « Grand Partage », entre nature et culture, nécessité et liberté, dont il reprend les principes à l’anthropologie de Philippe Descola.
Citons celui-ci : « Le naturalisme a été la condition de possibilité du capitalisme, son soubassement »31. Son ouvrage Par-delà nature et culture (2005) vise à faire état de la variété des ontologies prémodernes, études ethnographiques à l’appui : animiste (communautés amazoniennes), totémisme (tribus australiennes), analogisme(sociétés sibériennes). Cette multiplicité est brutalement restreinte lorsqu’il aborde la « pensée occidentale », réduite, dans son ensemble, au seul naturalisme.
Une telle simplification donne lieu à une sorte de lieu commun sur un supposé « Grand Partage nature/culture » dont on trouve désormais de nombreuses formulations routinisées : « L’idée de nature telle qu’elle nous est léguée par le langage et l’histoire, s’attache plutôt à un ordre régulier et fixe, à la répétition invariable des mêmes causes et des mêmes effets. La Terre tourne autour du soleil, les pommiers font des pommes, les renards chassent les poules, le Gulf Stream apporte de l’eau chaude dans l’Atlantique nord-est. Or, dans les interstices de ces grandes régularités apparaissent des grandes nouveautés : des cours d’eau disparaissent, des plantes génétiquement modifiées se défendent contre leurs prédateurs, des ours polaires vont chercher refuge hors de leur banquise, l’activité cyclonique est exacerbée. Il ne faut pas en déduire que la nature n’est plus ce qu’elle était, mais que sous notre influence grandissante, les arrangements infiniment complexes entre le vivant et son milieu ont dévié d’une trajectoire que l’on croyait inaltérable32. »
Au-delà de la simplification qui consiste à ramener « la pensée occidentale » (depuis le XVe siècle !) ou la « modernité » au « naturalisme », la réduction de l’idée de « nature » à un corps mobile sur plan incliné étudié par Galilée ignore à peu près deux siècles de recherche en sciences du vivant, des écosystèmes, de la biosphère, etc. D’où la « redécouverte » par Latour de « l’hypothèse Gaïa » présentée comme une révolution, à partir des travaux du physicien James Lovelock, pourtant fortement critiquée parmi les biologistes33.
D’inspiration cybernétique, cette « hypothèse » vise à penser la Terre comme un système complexe géant et auto-régulé, une entité non mécanique, habitée d’une multitude d’êtres qui tendent vers une harmonie essentielle. Elle fait intervenir les « vivants » et leur agency, en rompant avec une vision anthropocentrique qui pose une coupure entre nature et culture : « avec des objets galiléens comme modèle, on peut bien prendre la nature comme “ressource à exploiter”, mais avec des agents lovelockiens, c’est n’est pas la peine de se bercer d’illusions : ils agissent, ils vont réagir34 ».
Un tel refus de la sociologie n’est ni si étonnant, ni très nouveau. Comme le remarque J-L Fabiani, « dès l’origine, l’environnement comme question épistémologico-politique a porté le fer au cœur de la forteresse sociologique ».
Cette révélation de « Gaia » permet à Latour de poser une égalité ontologique entre les vivants, faisant ainsi sortir la question écologique de la question sociale et déniant la prévalencedes rapports sociaux – notamment économiques – et leur action sur la nature. Contre une vision mécaniste de l’univers, « Gaïa » permet de saisir, pour Latour, « la chaude activité d’une terre enfin saisie de près35 » – sans préciser en quoi cette appréhension se différencie d’une vision vitaliste qu’il critique par ailleurs…
Repeindre de vert une critique ancienne de la sociologie
Même si elle ne concerne pas de prime abord l’écologie, la critique de la sociologie faite par Latour fait apparaître une cohérence en matière de questions ontologiques et épistémologiques. Dans son entreprise de réhabilitation de la pensée de Gabriel Tarde contre la sociologie d’Émile Durkheim36, il remet en cause la distinction entre les deux niveaux « micro » et « macro » que les sociologues utiliseraient, au profit d’une étude des « associations »37. Il vise en particulier, l’approche allant du micro au macro, qui serait « la plus fréquemment utilisée de nos jours », et qui partirait d’entités atomiques pour en étudier les règles d’interaction dont la stabilisation constituerait une structure – ce qui correspond très grossièrement à une approche « individualiste méthodologique ». Il n’envisage pas le cheminement inverse (qualifié parfois de « holiste » ou « structuraliste »), dont il ignore de toute évidence l’épistémologie, et qui pose la primauté analytique d’un système social dont les relations entre les éléments définissent la valeur prise par chaque élément.
Selon Latour, la théorie alternative de Tarde n’aurait pu être développée faute « d’outils empiriques adéquats », et les « traces numériques » laissées par les « acteurs » dans les bases de données pourraient désormais résoudre le problème : les nouvelles techniques numériques et l’analyse des réseaux permettraient une approche « par un niveau » de l’ordre social. Un « acteur » serait défini par son « réseau » et l’étude de son « profil » permettrait de naviguer parmi les données sans faire appel à une réalité ontologique supérieure. L’activité de collecte des données ferait apparaître un phénomène collectif, celui des « monades » qui se chevauchent et partagent des attributs. Il n’y aurait donc pas de différence ontologique entre individus, groupes et institutions.
Les institutions ne seraient que des trajectoires de monades circulant dans les bases de données : « les “totalités” ne sont rien de plus que d’autres moyens de traiter les profils entrecroisés. C’est ce type de navigation auquel Tarde a donné le nom ambigu d’imitation38 ». Il n’est pas difficile de voir pourquoi Latour peine à comprendre les fondements sociaux des mobilisations (et en particulier des mobilisations écologiques), s’il ne dispose pour cela que de la très sommaire idée « d’imitation ». Il y a pourtant de nombreux débats (et théories) sur l’action collective et les mouvements sociaux (au-delà des mobilisations écologiques déjà évoquées), que Latour se garde bien de mentionner.
Plus que le caractère ici également très impressionniste de cette vision « monadique » des « associations », le problème concerne l’épistémologie mobilisée : l’assimilation de la société à un réseau numérique permettant la saisie immédiate des « données » renvoie à une mécompréhension de ce que signifie construire un « fait social » – et ce que signifie le saisir à travers un ensemble d’indicateurs ou de variables. Il ne s’agit pas seulement ici du refus de la « construction d’objet » et de la « coupure épistémologique », mais d’une analyse des sciences qui est bien une « associologie », pour reprendre l’expression de Frédéric Vandenberghe, et qui s’avère tout à fait compatible avec le développement du « techno-capitalisme39 ».
Sur ce point on peut noter, à la suite de Jean-Marie Harribey, que le rejet de la notion de la vision dialectique des classes sociales au profit d’une définition d’une classe écologique définie par sa finalité (l’habitabilité), se situe non seulement dans un « hors-sol social » mais profile aussi « un monde apaisé où le souci du climat, de l’énergie et de la biodiversité, mettra les humains sur un même bateau, sans aucun conflit entre eux ». « On le sait », ajoute-t-il, « le “même bateau” est la métaphore des intérêts communs si souvent répandue par l’idéologie dominante40 ».
Un tel refus de la sociologie n’est au final ni si étonnant, ni très nouveau. Comme le remarque Jean-Louis Fabiani, « dès l’origine, l’environnement comme question épistémologico-politique a porté le fer au cœur de la forteresse sociologique, en mettant en question le présupposé de l’autonomie du social41 ». Cette « méfiance à l’égard de l’instance sociale » a déjà donné lieu à des tentatives pour rendre obsolète la représentation de la société en classes au profit des mouvements sociaux écologistes, mais l’originalité du Mémo de Latour et Schultz est de l’inclure dans la quête d’un nouveau paradigme et d’une nouvelle articulation entre nature et société.
La logique du double-sens et du sous-entendu permet à des mots du langage ordinaire de fonctionner dans deux registres savamment unis et séparés : « mettre en forme philosophique, c’est aussi mettre des formes politiquement ».
On pourrait disqualifier l’entreprise latourienne d’un revers de main, en soulignant combien est grossière, et approximative, sa réduction de la « modernité occidentale » à un pur naturalisme42 ; on pourrait aussi, avec davantage d’indulgence, relever les quelques « fulgurances », que l’auteur lance souvent par pure provocation, ce qui est souvent invoqué pour expliquer le « charme » du personnage. On défendra ici une autre ligne interprétative : la connexion établie par Latour entre sa sociologie et une nouvelle ontologie exprime bien plutôt un état du champ intellectuel, dans lequel il trouve un contexte favorable à son déploiement comme entreprise éditoriale, politique et académique.
L’ontologie politique de Bruno Latour : éléments pour un programme de recherche sur le champ intellectuel français
Si le « saut ontologique » défendu par Latour connaît un tel succès, c’est sans doute parce qu’il se trouve à la confluence de trois courants théoriques, dont il faudra explorer l’articulation, et les modalités d’importation, dans le champ intellectuel français : le tournant ontologique en anthropologie, avec, en France, Philippe Descola comme tête de proue ; la critique de la rationalité occidentale d’un point de vue « décolonial » développée par plusieurs ontologies politiques issues d’Amérique Latine, à travers Viveiroz de Castro (souvent cité par Descola), mais aussi Mario Blazer, Marisol de la Cadena, Arturo Escobar, etc. ; le réalisme spéculatif et les « nouveaux matérialismes » (expression employée par Latour), qui réhabilitent l’ontologie contre l’épistémologie et le néo-kantisme43.
Reste désormais à comprendre les ressorts de cette ontologie politique latourienne. Si l’ontologie est une partie de la philosophie (la métaphysique) dédiée à l’étude de l’être et de ses propriétés générales (existence, possibilité, durée, etc.) indépendamment de ses déterminations particulières, on peut reprendre l’expression oxymorique « d’ontologie politique », utilisée par Pierre Bourdieu dans un ouvrage dédié à l’analyse de Martin Heidegger44, pour désigner le travail d’euphémisation à l’œuvre dans le champ philosophique qui dévoile en les voilant des pulsions politiques.
La logique du double-sens et du sous-entendu permet à des mots du langage ordinaire de fonctionner dans deux registres savamment unis et séparés : « mettre en forme philosophique, c’est aussi mettre des formes politiquement ». La spécificité de Latour est d’être moins dans la dénégation de la politique (comme Heidegger) que dans la perspective de faire advenir une autre politique (le « Terrestre » dans un « Nouveau Régime Climatique ») face à l’épuisement supposé du projet de transformation sociale, autrefois porté par une gauche de lutte des classes. Dans un champ intellectuel français où s’entremêlent fortement les logiques académiques, politiques et éditoriales45, la promotion des idées latouriennes constitue une véritable entreprise collective, relativement bien organisée sur les plans institutionnel et scientifique.
Ce processus de retraduction dans le champ considéré donne lieu à un « travail d’euphémisation » très spécifique, dont la mise en forme philosophique46 permet de comprendre les fondements sociaux du « succès » intellectuel et éditorial de Latour, au moins dans le domaine de l’écologie depuis le milieu des années 2010. Car si les critiques de la sociologie latourienne des sciences ne manquent pas (du sociologue des sciences David Bloor, pourtant défenseur du programme fort, au philosophe Paul Boghossian en passant par Pierre Bourdieu et Yves Gingras47), il n’en va pas de même en matière d’écologie politique, et il s’agit de comprendre comment il peut désormais être présenté (après s’être lui-même présenté) à la fois comme le penseur de la catastrophe environnementale, et son prophète.
Dans un entretien pour la revue Tracés (2006), Latour déclare que « la controverse est le grand moyen pour entrer à l’intérieur de la science qui se fait (…) C’est important aussi dans des questions classiques, dont on nous rebat les oreilles, mais qui restent importantes, comme le réchauffement global. L’écologie est d’ailleurs arrivée pour moi comme un don du ciel : c’est la controverse non plus à l’intérieur du laboratoire, mais étendue à la planète ! ». Quelques années plus tard, dans un autre entretien, il surenchérit : « il y a un moment où j’ai voulu être le Marx de l’écologie ! Mais ça a été un échec parce que les Verts ne lisent pas contrairement aux anciens communistes. (…) Les écologistes ignorent même les fondateurs de leur propre domaine. Le pedigree est, il est vrai, assez compliqué : les grands auteurs de l’écologie politique vont de l’extrême droite à l’extrême gauche, donc ce n’est pas forcément facile. Mais je ne considère pas que ma démarche a échoué parce que c’est un projet qui continue et que nous poursuivons avec Richard Descoing en visant à construire enfin un grand Institut d’études politique de la Terre48 ». Richard Descoing, l’ancien directeur de Sciences po Paris, dont le soutien a été déterminant dans la diffusion mondaine des idées latouriennes49.
Ces quelques éléments permettent de comprendre d’où vient la force de conviction de Latour. Elle réside dans le fait d’opérer à plusieurs niveaux à la fois, et de naviguer de l’un à l’autre, en maniant en virtuose l’art de l’amphibologie : 1) une régression épistémologique (le « réel » contre les catégories néo-kantiennes et la construction d’objet), qui par ailleurs économise le détour par de véritables confrontations théoriques au profit d’une posture esthète et délibérément désinvolte ; 2) une réduction ontologique de l’écologie (la nature comme plan incliné), dépolitisée et débarrassée de ses ancrages sociaux ; 3) une vision politique apparemment ouverte mais en réalité très conservatrice, nourrie par une hostilité non dissimulée à l’égard de « la Science » des Modernes – dans un entretien avec François Ewald, Latour affirme ainsi qu’il pense « le monde, mais pas la nature… C’est sans doute ce en quoi je suis catholique50 ».
En jouant sur ces différents registres, au gré des objections qui lui sont opposés, Latour exprime à son insu, quelque chose d’essentiel dans les transformations en cours du champ intellectuel : un brouillage généralisé des prises de position théoriques et politiques, sous couleur de subversion. Il a beau jeu, dès lors, de se demander « où atterrir ? ». Car il s’agit surtout d’occuper un point de vue se prétendant au-delà de tous les points de vue – la radicalité toute rhétorique et polysémique des « Terrestres » n’autorise-t-elle pas de « s’égailler dans toutes les directions51 » ?
On ne peut dissocier les réflexions et la posture prophétique de Latour d’une entreprise de restauration politique qui fait feu de tout bois, de l’anthropologie des sociétés prémodernes à une ontologie qui réhabilite à la fois un vitalisme à la Henri Bergson et une monadologie à la Gabriel Tarde – ces étendards de tous les conservateurs depuis que la sociologie existe. Ce faisant, Latour peut ainsi se poser contre la science, contre les classes sociales et, finalement, contre toute tentative d’élaborer une science sociale digne de ce nom. Son succès, qui est au fond davantage éditorial, commercial et politique que proprement scientifique, tient alors au caractère peu subversif des perspectives d’émancipation qu’il dessine au sujet de l’écologie. Son œuvre constitue moins une boussole, comme certains l’ont cru, que le symptôme d’une écologie déboussolée.
Notes :
1 Léna Balaud, Antoine Chopot, Nous ne sommes plus seuls, Paris, Seuil, 2021, p. 17-19.
2 Bruno Latour et Nicolaj Schultz, Mémo sur la nouvelle classe écologique, Paris, Les empêcheurs de penser en rond/La Découverte, 2022, p.9 et 35. Bruno Latour, Habiter la terre. Entretiens avec Nicolas Truong, Paris, Éditions LLL/Arte Éditions, 2021.
3 B. Latour et N. Schultz, Mémo…, op.cit., p.18.
4 B. Latour et N. Schultz, Mémo…, op.cit., p.20-23.
5 B. Latour et N. Schultz, Mémo…, op.cit., p.21.
6 B. Latour et N. Schultz, Mémo…, op.cit., p.9 et 35.
7 Pour une critique de cette vision, voir Paul Guillibert et Frédéric Montferrand, « Camarade Latour » Terrestres, 16 juin 2022. Daniel Tanuro, L’impossible capitalisme vert, Paris, La découverte, 2012. Ou encore Jean-Marie Harribey, « De quoi la classe écologique de Bruno Latour est-elle le nom ? », Alternatives économiques, 20 janvier 2022.
8 Jean-Baptise Comby, La question climatique. Genèse et dépolitisation d’un problème public, Paris, Raisons d’agir, 2015
9 Franck Poupeau, « Ce qu’un arbre peut véritablement cacher », Le Monde diplomatique, septembre 2020
10 B. Latour et N. Schultz, Mémo…, op.cit., p.11-12.
11 B. Latour et N. Schultz, Mémo…, op.cit., p.12.
12 B. Latour et N. Schultz, Mémo…, op.cit., p.15.
13 Voir par exemple Jean-Baptiste Comby et Hadrien Malier, « Les classes populaires et l’enjeu écologique », Sociétés contemporaines, 124, 2021, p.1-30 ; et aussi le volume coordonné par Philippe Coulangeon et al., La conversion écologique des Français. Contradictions et clivages, Paris, PUF, 2023.
14 Voir par exemple Sylvie Ollitrault, Militer pour la planète, sociologie des écologistes, Rennes, PUR, 2008 ; Jean-Baptise Comby, La question climatique. Genèse et dépolitisation d’un problème public, Paris, Raisons d’agir, 2015 ; Johanna Siméant-Germanos, « Penser les ingénieries de l’environnement en Afrique à l’aune des sciences sociales du développement », Zilsel, 6/2, 2019, p. 281-313 ; Jean Foyer y David Dumoulin Kervran, « ¿ Ambientalismo de las ONG versus ambientalismo de los pobres ? », in Paul Almeida, Allen Cordero Ulate (eds), Movimientos sociales in América Latina. Perspectivas, tendencias y casos, Buenos Aires, Clacso, 2017, p. 391-412.
15 On citera, entre autres travaux récents non pris en compte dans le Mémo : Joan Martinez Alier, L’Écologisme des pauvres. Une étude des conflits environnementaux dans le monde, Paris, Les Petits Matins, 2014 ; Dorceta Taylor, Toxic Communities. Environmental Racism, Indus- trial Pollution and Residential Mobility, New York, New York University Press, 2014; Luke Yates, « Rethinking Prefiguration: Alternatives, Micropolitics and Goals in Social Movements », Social Movement Studies, 1/1, 2015, p. 1-21; Édouard Morena, Le Coût de l’action climatique. Fondations philanthropiques et débat international sur le climat, Paris, Éditions du Croquant, 2017 ; Sylvaine Bulle, Irréductibles. Enquête sur des milieux de vie, de Bure à Notre-Dame-des-Landes, 2020, Grenoble, UGA Éditions ; Margot Verdier, Le Commun de l’autonomie. Une sociologie anarchiste de la ZAD de Notre-Dame-Des-Landes, Vulaines-sur-Seine, Éditions du Croquant, 2021 ; Hadrien Malier, « No (Sociological) Excuses for not Going Green: How do Environmental Activists Make Sense of Social Inequalities and Relate to the Working-class? », European Journal of Social Theory, 24/3, 2021, p. 411-430 ; Flaminia Paddeu, Sous les pavés, la terre. Agricultures urbaines et résistances dans les métropoles, Paris, Seuil, 2021. Pour des recherches encore plus récentes que Latour et Schultz ne pouvaient pas connaître, voir la note suivante.
16 Voir Jean-Baptiste Comby et Sophie Dubuisson-Quellier, Mobilisations écologiques, Paris, PUF, 2023. Ce livre contient une bibliographie actualisée et commentée, ainsi que des textes faisant état de recherches récentes.
17 J.-B. Comby et S. Dubuisson-Quellier, Mobilisations écologiques, op.cit., p.12.
18 Voir entre autres travaux, Doris Buu-Sao, « Face au racisme environnemental : Extractivisme et mobilisations indigènes en Amazonie péruvienne », Politix, 131, 2020, p. 129-152.
19 Franck Poupeau, Altiplano. Fragments d’une révolution (Bolivie, 1999-2019), Paris, Raisons d’agir, 2021.
20 Sur ce déni, voir Paul Cary et al., Pour une sociologie enfin écologique, Paris, Érès, 2022.
21 Bien qu’il fasse succinctement état dans Où atterrir ? (2006) avec l’idée de classes « géo-sociales », dont la définition n’est jamais vraiment donnée.
22 B. Latour et N. Schultz, Mémo…, op.cit., p.34.
23 B. Latour et N. Schultz, Mémo…, op.cit., p.46.
24 Paul Guillibert et Frédéric Monferrand, « Camarade Latour ? », Terrestres, 18/07/2022 : https://www.terrestres.org/2022/07/18/camarade-latour/ Sauf précision, les citations suivantes sont tirées de ce texte en ligne.
25 Philippe Pignarre, « La Terre, notre camarade. Lettre ouverte à mes amis marxistes », Terrestres, 26 janvier 2022. Pour le détail des références, se reporter à l’article cité : https://www.terrestres.org/2022/07/18/camarade-latour/
26 Il faudrait mentionner deux autres critiques de la classe écologique, qui ne peuvent être développées ici faute de place : d’une part, la dépendance commune à des infrastructures ne crée pas d’intérêt commun; d’autre part définir une classe écologique en soi ne fait pas sens dans la mesure les classes sociales se définissent de manière relationnelle et oppositionnelle.
27 J-B Comby…, op.cit.
28 B. Latour et N. Schultz, Mémo…, op.cit., p.52.
29 Bruno Latour, Où atterrir ? Paris, La Découverte, 2017, p. 68.
30B. Latour et N. Schultz, Mémo…, op.cit., p.85.
31 Philippe Descola, « Une petite partie de l’humanité, par sa gloutonnerie, remet en cause la possibilité d’habiter sur Terre », Basta, novembre 2022 (entretien avec Barnabé Binctin).
32 Pierre Charbonnier, Culture écologique, Paris, Les Presses de Sciences Po, 2022, p.8.
33 Frederic Neyrat en a analysé les ambiguïtés dans La part inconstructible de la terre (Paris, Seuil, 2016).
34 B. Latour et N. Schultz, Mémo…, op.cit., p.99.
35 B. Latour et N. Schultz, Mémo…, op.cit., p.95.
36 Voir la participation de Bruno Latour à la table-ronde « Le débat Tarde Durkheim », CRASSH, Cambridge, 2007 : http://www.bruno-latour.fr/fr/node/435.html
37 Bruno Latour et al., « ’’Le tout est toujours plus petit que ses parties’’. Une expérimentation numérique des monades de Tarde », Réseaux, 177, 2013, p.197-232. Sur les associations, voir aussi B. Latour, Changer de société, refaire de la sociologie, Paris, La découverte, 2006.
38 B. Latour et al., « ’’Le tout est toujours plus petit que ses parties’’… », art. cité.
39 Frédéric Vandenberghe, Complexités du posthumanisme. Trois essais dialectiques sur la sociologie de Latour, Paris, L’Harmattan, 2006, p.16.
40 J-M Harribey…, op.cit.
41 Jean-Louis Fabiani, « Rural, environnement, sociologie », Ruralité, nature et environnement, p. 111-132, 2017.
42 Pour une vision un peu complexe de ces sujets, on peut se référer à la monumentale Histoire des sciences et des savoirs (Paris, Seuil, 2015, 3 tomes) co-dirigée par Dominique Pestre et al.
43 B. Latour, Où atterrir ?… op. cit., p. 79.
44 Pierre Bourdieu, L’Ontologie politique de Martin Heidegger, Paris, Minuit, 1988.
45 Boris Attencourt, « Badiou vs. Finkielkraut. Débat du siècle ou débat dans le siècle ? » Zilsel, 2017/1, p.117-152.
46 L’analyse de champ évite de comparer les auteurs terme à terme, comme le fait Søren Riis qui, dans « The Symmetry Between Bruno Latour and Martin Heidegger: The Technique of Turning a Police Officer into a Speed Bump » (Social Studies of Science, 28/2, 2008, p.285-301), affirme qu’ontologiquement parlant, Latour et Heidegger convergent dans l’analyse de l’articulation des êtres.
47 David Bloor, « Anti-Latour », Studies in History and Philosophy of Science, 30/1, 1999, p. 81–112 ; Alan Sokal et Jean Bricmont, Impostures intellectuelles, Paris, Odile Jacob, 1997 ; Yves Gingras, « Un air de radicalisme », Actes de la recherche en sciences sociales, 108, 1995, p. 3-18 ; Pierre Bourdieu, Science de la science et réflexivité, Paris, Raisons d’agir, 2001 ; Paul Boghossian, La Peur du savoir. Sur le relativisme et le constructivisme de la connaissance, Marseille, Agone, 2009.
48 Bruno Latour et al, « Bruno Latour : une pensée politique exégétique », Raisons politiques, p. 115-148, 3, 2012, p.139.
49 Paul Pasquali, Héritocratie, Paris, La découverte, 2021. François Denord et Paul Lagneau-Ymonet, Concert des puissants, Paris, Raisons d’agir, 2016.
50 Bruno Latour, entretiens avec François Ewald, Un monde pluriel mais commun, Paris, Éditions de l’Aube, 2003, p.64.
51 Bruno Latour, Où suis-je ? Leçons du confinement à l’usage des terrestres, Les empêcheurs de penser en rond, 2021, p.153.