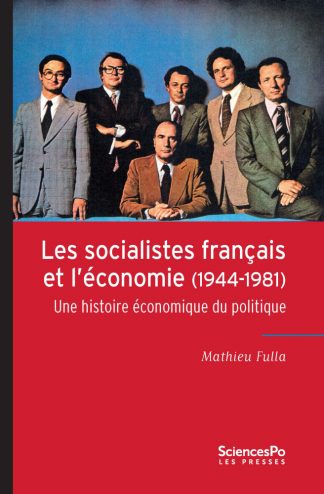Le présent texte est une introduction à une histoire du CERES écrite par Didier Motchane, disparu le 29 octobre 2017. Si l’ouvrage historique relatif au CERES reste à écrire, ce texte fournira néanmoins des clés de compréhension. Didier Motchane a été l’un des fondateurs du CERES, le Centre d’Etudes, de Recherche et d’Education Socialiste, avec Jean-Pierre Chevènement, Alain Gomez, Pierre Guidoni ou Jacques-Arnaud Penant et quelques autres qui les rejoignirent au fil des années. Il en a été le charismatique théoricien, auteur en 1972 de Clés pour le Socialisme. Au fil des années 1970, il anima évidemment le CERES et ses revues (Frontière, Repères…) et fut en charge des relations avec le tiers-monde au PS.
On sait le rôle déterminant du CERES dans le Congrès d’Epinay de juin 1971. On sait aussi sa place dans la construction de l’Union de la Gauche à partir de 1972. Didier Motchane fut ainsi, avec Pierre Joxe, le co-rédacteur de la motion de synthèse d’Epinay, c’est-à-dire du véritable texte fondateur du PS, celui qui consacrait l’Union de la Gauche comme objectif stratégique en vue de la transition au socialisme. La pensée de Didier Motchane et celle du CERES sont ainsi incontestablement à verser à l’actif du socialisme français, tant la puissance conceptuelle et le caractère visionnaire qui sont alors les siennes frappent l’esprit de l’observateur. Entrés à la SFIO, vieille machine bureaucratique, les animateurs du CERES réussirent à susciter l’étincelle qui révéla la social-démocratie française à elle-même. De la vieille SFIO engluée entre FGDS et « dialogue idéologique » avec le PCF on passait à un PS doté d’une stratégie nouvelle, dont l’Union de la Gauche était le vecteur. Le dessein du CERES n’était pas « d’assumer la condition humaine du socialisme » mais bien d’instaurer « la condition socialiste de l’humanité ». Au fil des années 70 dans la majorité du PS ou dans la minorité, le CERES demeura fidèle à l’esprit d’Epinay, menant la bataille sur l’Europe ou l’autogestion, suscitant une effervescence militante qui a propulsé le courant à 26% du parti. En articulant le « mouvement d’en haut » et le « mouvement d’en bas », le CERES fut aussi un efficace pont entre la bouillonnante société des années 1970 et l’appareil en construction du Parti Socialiste. Promoteur de l’autogestion (et de la très volontariste 16ème thèse), le CERES apparaissait comme « l’aile gauche » du PS tout en revendiquant de vouloir en être « l’axe ».
Avec François Mitterrand, les relations furent marquées par l’accord politique initial puis, chemin faisant, par des désaccords mineurs puis majeurs, dont la Guerre du Golfe et le traité de Maastricht furent le paroxysme qui a provoqué la rupture. François Mitterrand dit un jour à Didier Motchane que s’ils n’avaient pas fait de politique ils auraient été amis. A partir de 1983, ils cessèrent néanmoins de se voir personnellement, considérant – du point de vue de Didier Motchane – avoir épuisé tous les sujets. L’Europe avait alors remplacé le socialisme comme grand récit mobilisateur, ce qui équivalait dans l’esprit de Didier Motchane à accepter le caractère indépassable d’un capitalisme voué à la financiarisation, dont le contenu de l’action de la CEE n’était qu’une méthodique codification. A partir de 1990, les relations se dégradant avec la majorité du PS, les amis de Didier Motchane et de Jean-Pierre Chevènement – réunis au sein de Socialisme et République – s’éloignèrent progressivement jusqu’à fonder un nouveau parti – le Mouvement des Citoyens – dont l’identité était de « gauche républicaine », ligne promue depuis 1983 et le tournant de la rigueur, et qui visait à se substituer à la ligne de normalisation européenne.
L’aventure du CERES ne saurait évidemment être rééditée à l’identique. Ne serait-ce que par la situation actuelle du PS, bien plus périlleuse que celle de l’antique SFIO. Trop de facteurs ont changé. Cependant, il manque assurément aujourd’hui un « nouveau CERES », c’est-à-dire d’abord une ligne politique, une vision qui permette de forcer le destin. Cette ligne devrait s’incarner de nouveau dans un groupe d’hommes et de femmes qui, forts d’une analyse méthodique des mutations du capitalisme mondial, imprégné par le mouvement de la société, aptes à mettre en œuvre une stratégie cohérente pourrait être la force qui ravive ce corps mort qu’est la gauche française.
Le CERES fut aussi une méthode. Cette méthode n’est, quant à elle, aucunement démodée. C’est pourquoi, en 2018, le CERES a, par la plume de Didier Motchane, encore à nous dire. Ces lignes de Didier Motchane éclaireront le lecteur sur ce que fut le CERES. Sans doute inspireront-elles quelques-un(e)s. Elles donnent une idée de ce qu’est une authentique pensée politique. – Gaël Brustier.
Avant-propos à une histoire du CERES, par Didier Motchane
Ne rien écrire sur soi qu’au présent. Béaba-tificateur de son impuissance romanesque, l’autobiographe pontifiant ou pénitent ne se fait jamais que le souverain veuf d’une mémoire épuisée. Cependant des souvenirs toujours inégalement partagés, mais pour peu qu’ils le soient, appellent clairement l’honneur du récit, s’ils perpétuent le bonheur d’une commune présence, parce qu’ils sont les témoins d’un éternel espoir, fut-il éternellement cantonné aux demeures du futur antérieur.
Dans le cours ordinaire du temps, l’espoir – et le désespoir – de changer la vie, afin de – ou faute de – changer sa vie, gisent côte à côte. Ils se raniment l’un l’autre à partir de la banalité de la condition humaine. C’est la trace d’un mouvement de ce genre que l’histoire du CERES pourrait nous avoir laissé.
N’importe quel âge de la vie peut faire de sa jeunesse son horizon mental. La jeunesse elle-même y vit le rêve de son éternité. D’autres temps de l’existence s’y marient ; ils assaisonnent une rétrospection douce – amère à la saveur des revanches posthumes. Telle aurait été la jeunesse du CERES, jeunesse d’espoir d’une renaissance du socialisme.
***
L’Europe, comme d’ailleurs l’ensemble du monde des années 60, porte la marque d’une mutation des héritages de la guerre.
Sur le fond d’une conscience accélérée, toujours plus impatiente, de l’activité économique, soutenue par la diffusion planétaire d’une pensée technicienne ingénument distribuée selon la préséance des rentes, le cloisonnement des savoirs et la puissance militaire. L’acuité des conflits qui opposent les nations et les divisent elles-mêmes s’est revissée d’un quart de tour. Sous l’emprise d’un capitalisme dont l’empire tend à égaler l’ambition jusqu’à toucher son horizon planétaire, la mondialisation départage plus profondément désormais le Nord et le Sud du monde que l’Est et l’Ouest qui sont les apostats du socialisme déclaré des renégats de la Révolution.
Les Trente Glorieuses auront été l’épopée du Nouveau Scientisme Historique où les idées du Progrès, fondées sur la conviction de la permanence d’une Croissance majuscule, d’une croissance économique ininterrompue se réinventèrent. L’Europe, ou plus largement ce que l’on appelait l’Occident, semblait faire l’expérience du régime durablement stabilisé d’une marche à l’abondance sans autres à coups que ceux des – relativement – légers coups de lancette de ponction monétaire qui, comme ceux des médecins de Molière, venaient de loin en loin maintenir la circulation bien étagée de la richesse. Dans ce cours tranquille, les entrepreneurs – capitalistes de la dette – et leurs héritiers – capitalistes de la rente – se sont partagé le haut du pavé avant de le céder à ces piétons du ciel atterris sur les tapis volants de la finance : « gnomes de Zurich » et d’ailleurs, spermatozoïdes distillateurs de l’Argent Roi.
Ce fut le moment où l’avènement d’une fin de l’histoire, c’est-à-dire son accomplissement, put s’entendre proclamer aux pauvres des pays riches à l’unisson des riches de tous les pays, comme le règne spirituel d’un social-libéralisme étendant la main sur le monde de la misère et de la peur pour s’en faire le bénisseur définitif.
Ainsi n’était-il plus question de mettre en cause l’abîme d’inégalités des revenus, des patrimoines et des savoirs, mais d’en pérenniser la légitimité. L’histoire accomplie, sanctuarisée par le temps, éloigne au Royaume de l’Au-delà la république de l’égalité des chances, l’urgence et le lieu d’un repartage du passé par le présent. Telle est l’intime contradiction que porte la financiarisation de l’économie spéculaire : prise entre les murs du capital accumulé, la spéculation ne peut sans se détruire soustraire l’ordre de ses raisons au calcul, l’avenir au passé, la vie à la mort.
Sans doute l’Ange Gardien des Trente Glorieuses – la Croissance – a-t-il déplacé vers le haut les failles de l’intégration sociale par son œuvre et par son mythe ; mais celle-ci s’approfondit : telle est la pente de la société bourgeoise qu’aucun tempérament de protection sociale, aucun placebo, ne saurait redresser à peine d’en détruire le ressort. Ce fut un train qui, en déplaçant plus vite des wagons de plus en plus nombreux et de mieux en mieux suspendus, laissait une proportion croissante des voyageurs en gare, ou sur les bas-côtés de la voie.
Les petits cailloux de la pauvreté blessent davantage au fond d’une botte d’éboueur qu’à un va-nu-pieds les graviers de sa misère. Sans ralentir le pas du peuple trottinant qui reste à l’aise à côté des petits souliers de sa bonne conscience. Cette portion bouillonnante du produit de la machine d’un capitalisme désangoissé tournant à plein régime dans la candeur –ou le cynisme refoulé du Nouveau Scientisme Historique – était moins un objet de scandale que de compassion ; en raison peut-être du fait que ce que l’on pourrait nommer l’humeur installée du siècle, son « idéologie dominante » devenait, suprême illusion, celle de la mort des idéologies. Raymond Aron venait détrôner Jean-Paul Sartre dans le magistère du Grand Maître Penseur pour prononcer, avec le geste de l’étalonneur des certitudes et du donneur de diapason, l’éloge funèbre et réjouie du marxisme ; au-delà de l’extinction célébrée de celui-ci, c’était l’éthique de l’engagement avec l’ensemble des engagements existentiels de l’Après Libération qui s’en trouvaient plus ou moins nettement récusés.
Qui aurait pu attendre de l’esprit du Nouveau Scientisme Historique que s’en gonflassent les voiles d’une « Grande Cause » ? Au travers de la titillation obsédante des processus d’évaporation inéluctable de ses révoltes, l’humanité chercherait l’apaisement de ses anxiétés archaïques dans sa « modernité » ; les petites voix chevrotantes de cette fin de siècle ne se lassent pas d’invoquer chacune la leur. Ce ne sont pas celles de Rimbaud.
Comme un vaste ressac des élans de la Libération dont le 10 mai (1958) fut sans doute dans le désarroi de la République, avec le retour du Général de Gaulle, un dernier et combien ambivalent soubresaut, les années 50 – 60 auront été celles de la décolonisation, dans la douleur des guerres d’Indochine et d’Algérie. Elles portent la marque d’une démoralisation croissante de l’esprit public, que les déferlements libertaires de mai 68 tentaient pathétiquement de régénérer.
La Cinquième république a couvert comme d’une burqua les déhanchements d’une société française violemment arraisonnée par un capitalisme qui n’en avait jusque là caressé que les bords : à preuve l’exode rural, diffus en France depuis le Second Empire, brutalement torrentiel après 1950. Le capitalisme de la dette subjugue le capitalisme de la rente dont il est issu sans le remplacer. Notre visage national lui doit ses grimaces d’aujourd’hui.
En bref, l’efflorescence du social-libéralisme envahit l’air du temps ; un ninisme politique, qui prenait naguère le masque de la « Troisième Force » berce le peuple dans une balançoire dont les partis politiques tirent les quatre bouts ; de la Gauche à la Droite, même mélopée ; des paroles différentes font refrain. Elles changent un peu de rythme mais jamais de ton ; de Delors en Sarkozy, de Juppé en Hollande le débat public s’englue dans une à peu près même rhétorique social-démocrate, au point de s’en faire entendre comme une langue commune.
Gauche, Droite, droite, gauche ; que ne cessiez-vous, vieilles et jacassantes ennemies complices, de vous serrer chaleureusement la « main réciproque » (selon l’expression rescapée d’une copie de baccalauréat recueillie par un ami) ; que ne cessez-vous de tenter perpétuellement de vous définir l’une par l’autre, plutôt que d’assumer la vérité de votre regard sur le monde, le choix des points de vue pris pour le dévisager ; mais tout de même, quoiqu’il en soit, faire votre monde des miettes de l’univers que vous pourrez recueillir. Ce que vous manquerez à tous les coups ma Gauche, tant que vous vous résignerez à n’être que l’espace rétréci de l’âme renoncée du siècle, errant infiniment au désert élargi de sa passivité. Celle la même où la troupe remuante de toutes nos droites nourrit d’angoisse le troupeau de vos béatitudes.
La démystification des communismes déclarés, dont la Chute du Mur marque la débâcle, la fin de la guerre froide puis le saut américain de Bush à Obama, l’exténuation accélérée des utopies tiers-mondistes et du mythe de l’accomplissement démocratique de l’histoire, laissent désormais, et semble-t-il pour un long moment, l’Europe sans utopie, au fur et à mesure que s’en dégonfle lentement la baudruche – sauf sans doute pour quelques instants encore, aux yeux des peuples est-européens fraîchement émancipés de l’emprise soviétique, le Saint–Graal du capitalisme lui-même dont ils sont toujours en quête. Leur reste encore pour ce faire l’Europe elle-même, inaccessible parce qu’indéfinissable idéologie de rechange offerte à des sociaux-libéraux non déclarés. L’européisme, cette idolâtrie douce, verse à ces exilés du capitalisme la plus romantique des sublimations possibles, celle de l’économisme indéfectiblement social-libéral des bourgeoisies contemporaines.
Telle était la toile de fond sur laquelle le CERES a voulu inscrire son destin. Mieux vaut maintenant laisser parler les textes qui en ont scandé les intentions et les efforts plutôt que les empaqueter d’une glose rétrospective. Ne s’agit-il pas aujourd’hui, plus que toujours, de rénover et de réunir une gauche capable, du fond de son marasme actuel, de rendre aux orphelins du socialisme le sens de mots trop souvent perdu ?
Rappelons encore que cette gauche ne doit pas chercher à se définir par rapport à ses adversaires, ou ses partenaires sur un échiquier politique, mais par la détermination de sa raison d’être : dans les conflits de classe qui traversent l’épaisseur sociale dont l’expérience, selon le mot de Fernand Pelloutier, « donne aux dominés la science de leur malheur ». Cette gauche s’éprouve dans une prise de conscience de la République dont l’effort même constitue celle-ci ; transcendant les clivages qui opposent justement la Gauche et la Droite, elle nomme un peuple à l’existence à partir de sa population et selon l’essence métaphysique de celle-ci.
Ainsi la République le fait de la nation, dont l’indépendance, brique de base d’un internationalisme républicain, pétri au four d’une souveraineté populaire authentique, sauvegarde de la démocratie contre les emprises du capital et l’atteinte des empires.
Egalement éloignés des romantismes et des cynismes contemporains le CERES s’est voulu le radiesthésiste des sources profondes du socialisme républicain, s’efforçant en cela de faire grandir une troupe fidèle, soucieuse d’offrir aux enfants du siècle la générosité et la sobriété en partage. Tel est le sens de la République moderne dont il cherche à ranimer l’esprit à partir d’une commune ferveur ; héritage contrasté, mais poursuivi de Babeuf en Marx, de Robespierre à Jaurès, de Saint Just à Clémenceau, De Gaulle et Mendès France.
Crédits photos : ©Communautés européennes 1985