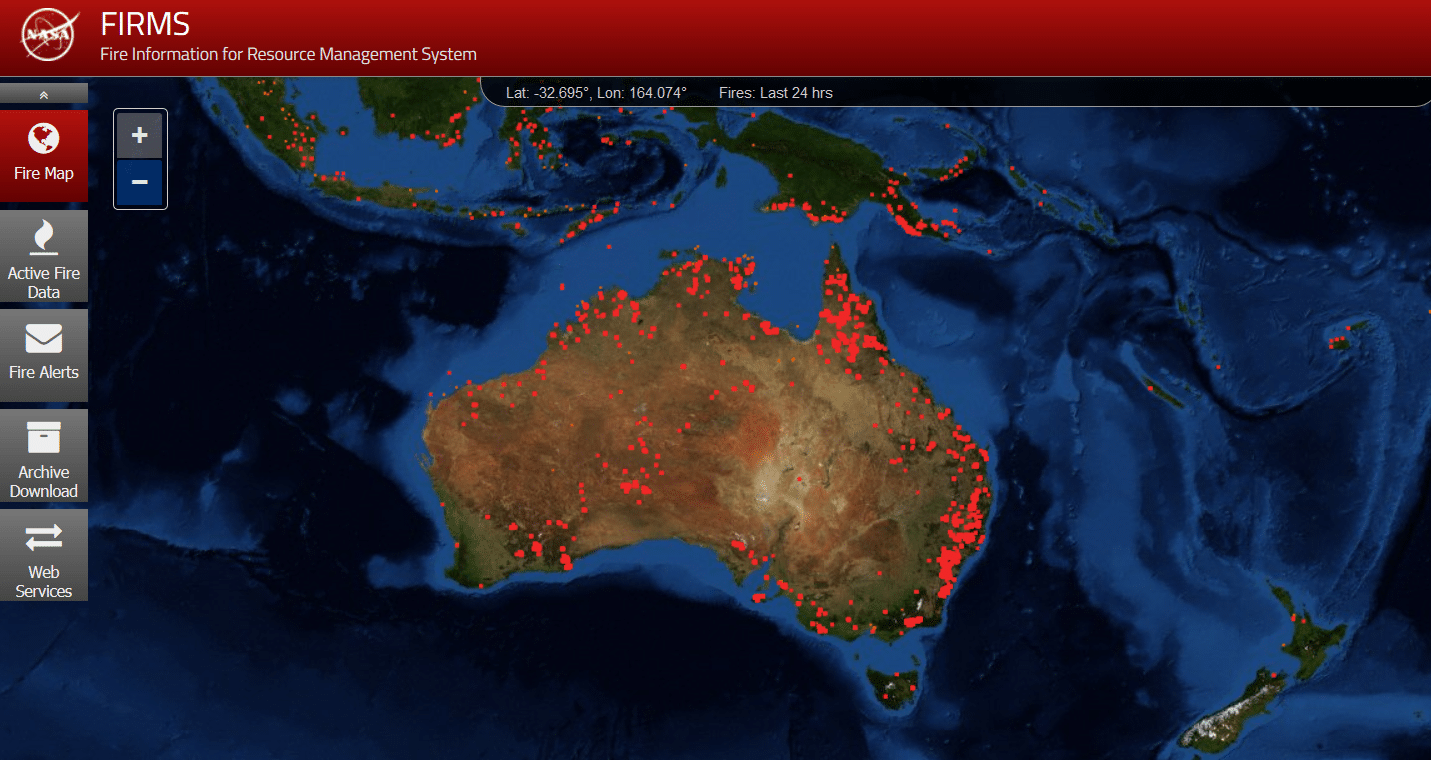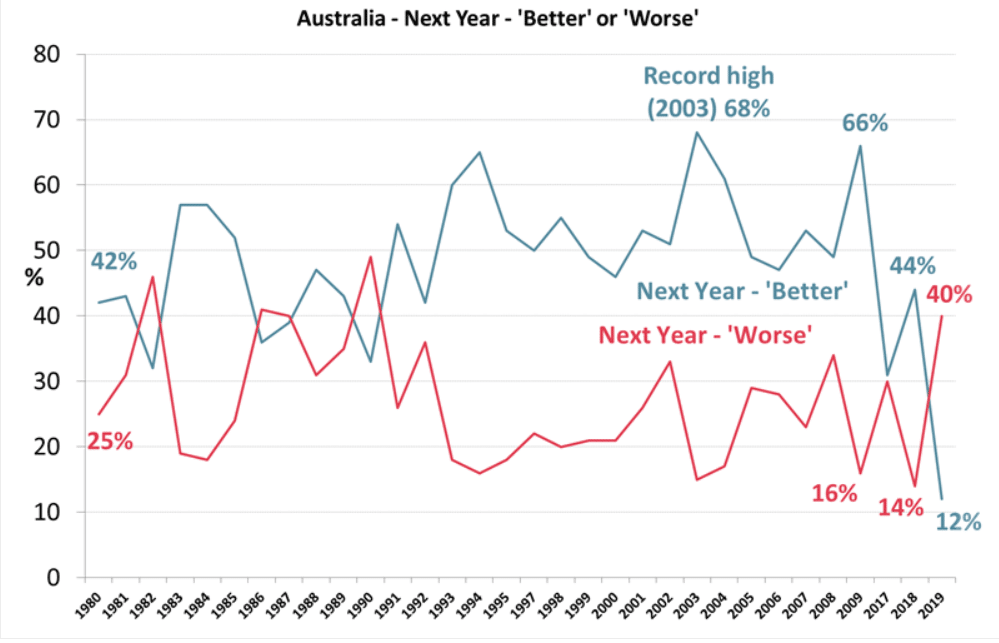Damien Carême, depuis peu eurodéputé Europe Écologie Les Verts, s’est fait connaître en tant que maire de Grande-Synthe, une banlieue de Dunkerque de plus de 23 000 habitants ayant grandement souffert de la désindustrialisation. Ce qu’il y a initié, en matière de transition sociale et environnementale, depuis son premier mandat en 2001, inspire beaucoup, a fortiori à la veille des municipales. Nous revenons avec lui sur cette expérience riche d’enseignements, et sur le prolongement qu’il en donne depuis le Parlement européen. Entretien réalisé par Manon Milcent et Pierre Gilbert.
LVSL – Vous avez été maire de Grande-Synthe de 2001 à 2019. Comment un écolo a-t-il réussi à gagner dans une ancienne ville industrielle du Nord ?
Damien Carême : En 2001, il fallait arriver au pouvoir. C’était une ville stigmatisée, une ville de banlieue où il y avait une délinquance importante, un sentiment de malaise, des difficultés sociales présentes depuis un certain nombre d’années et pas de solutions concrètes. Nous n’étions pas d’accord avec les politiques locales donc nous avons fait une contre-proposition en présentant une liste aux élections municipales de 2001. Le slogan était « Autrement la ville, autrement la vie ». Sans proposer quelque chose de révolutionnaire, nous exposions notre vision de la société sur le plan culturel, social, de l’aménagement urbain, de la circulation automobile. Et nous avons gagné, même si ce n’était que de 114 voix sur 14 000 électeurs.
Une fois que nous sommes arrivés au pouvoir, nous sommes allés plus loin dans nos préconisations. Nous avons eu l’opportunité de réaliser de gros programmes de renouvellement urbain en 2004. C’est à ce moment-là que nous avons lancé les débats sur le monde dans lequel nous vivions, mais aussi que nous avons proposé d’apporter des réponses aux problématiques sociales, notamment grâce à des financements pour des logements sociaux de qualité. Nous avons exigé la construction de logements au minimum de basse consommation, voire passifs. Pour certains, cela a engendré une baisse du prix de leur facture énergétique par 8 ! Nous avons aussi créé une université populaire, où il y avait des conférences sur la possibilité de la mise en place d’une autre société, sur le plan des retraites, de l’énergie, du lien social, sur le fonctionnement de la société, de l’écologie ou des ressources. Nous avons notamment reçu des gens comme Philippe Bihouix, qui était venu nous faire une conférence sur son livre l’Âge des low-tech. En fait, nous avons fait venir des gens que l’on voit peu dans le système médiatique parce qu’ils sont légèrement en opposition avec le modèle de développement que nous avons mis en avant pour montrer aux gens qu’un autre monde est possible. Nous les avons accompagnés, notamment avec des jardins partagés en bas des immeubles. Un peu plus tard, nous avons réfléchi à comment mettre en place la cantine bio. C’est comme ça que l’on a déroulé, jusqu’au dernier programme de 2014, pour ma deuxième réélection où nous sommes allés vraiment beaucoup plus loin en termes d’écologie, du développement de l’économie de la fonctionnalité, l’économie du partage, la récupération de la chaleur d’Arcelor, la diminution des émissions de CO2 des industriels…
Dans le programme nous parlons rarement de développement durable, de transition écologique, etc. parce que cela ne veut rien dire dans ces classes populaires, ce ne sont que des concepts flous. En revanche, à chaque fois que nous faisons quelque chose nous expliquons ce qu’est la transition. Il faut expliquer aux gens qu’un jour, nous atteindrons les limites de notre système de production, avec un pic pétrolier. Il faut que cela permette de réfléchir à comment vivre sans pétrole par exemple.
Nous avons vraiment montré l’exemple en allant vers les gens, par exemple par une fabrique de l’autonomie, en apprenant à fabriquer des produits ménagers, des cosmétiques à base de produits naturels. C’est bénéfique pour le corps, puisqu’il n’y a pas de perturbateurs endocriniens ni de dérivés pétroliers. C’est également bon pour l’environnement, puisqu’on ne met rien dans le réseau d’eau, et les gens adhèrent à ces projets. En plus, cela allège les factures, un litre de lessive revient à 40 centimes. Et à chaque fois, nous poussons plus loin dans leur champ du quotidien, et du coup, ils deviennent demandeurs, ils prennent eux-mêmes des initiatives. Ce qui a fait la spécificité de la ville en 2015, c’est que l’on a eu 2500 Syriens qui sont arrivés. Nous avons créé un camp de réfugiés qui était le premier et le seul en France et je n’ai du faire face à aucune opposition, aucune manifestation, pas un seul mouvement s’opposant à leur arrivée ou à l’argent dépensé, puisque les habitants connaissaient bien ma transparence. Cela fait aussi partie de la société que nous leur narrons lorsque nous parlons de transition, de notre modèle de développement, de la solidarité, de la géopolitique. Quand nous parlons d’une nouvelle société, il faut que tout aille dans ce sens.
LVSL – Pendant votre mandat, vous avez mis en place de nombreuses initiatives en faveur de la préservation de l’environnement et dont un « revenu de transition écologique ». Qu’est-ce donc ?
D.C. – C’est un concept qui a été développé par Sophie Swaton, économiste à l’Université de Lausanne, qui n’est pas en accord avec l’idée d’un revenu de base, sans être dans l’opposition totale. Selon elle, il convient de mettre en place des mécanismes pour assurer un revenu aux gens qui s’orientent vers des activités avec un impact environnemental bas, comme pourrait le faire un agriculteur passant d’une activité conventionnelle à une exploitation bio. Il convient alors d’anticiper sa perte de revenu, en lui apportant une aide. On peut également prendre l’exemple d’un salarié travaillant dans un secteur polluant comme le pétrole qui souhaite se convertir dans la menuiserie. La question est de savoir comment le soutenir afin qu’il puisse payer sa formation. C’est un accompagnement financier, que cela soit sous forme de salaire, soit le paiement de la formation, pour que les personnes puissent se reconvertir dans des métiers à faible impact environnemental. À Grande-Synthe, six personnes bénéficient de ce genre d’aides, dont trois maraîchers bios que l’on a implanté sur des terres, au sein d’une coopérative. Après, chacun des membres qui arrivera à gagner sa vie grâce à son activité reversera un pourcentage pour auto-alimenter cette coopérative pour que cela aille à d’autres. C’est une forme de revenu que nous assurons, mais sur une transition économique et professionnelle. C’est une forme de caisse d’allocation.

LVSL – Mais à l’heure où les dotations de l’État en faveur des mairies diminuent d’année en année, comment arriviez-vous à mettre en place et financer ces initiatives ?
D.C. – Parce que cela ne coûte pas tant d’argent. Nous avons revu tout le plan d’éclairage public, cela a été un investissement, nous avons fait des emprunts sur vingt ans, mais cela ne coûte pas cher. Cela nous a même fait économiser 500 000 euros. Quant au réseau de chaleur, grâce à des logements de basse consommation, nous avons pu économiser 250 000 euros de chauffage des bâtiments et cela évite l’émission de 6 500 tonnes de carbone dans l’atmosphère. Planter des arbres fruitiers en ville, ça ne coûte pas d’argent, faire des jardins partagés en bas des immeubles, faire la fabrique de l’autonomie, non plus. Développer l’économie du partage ou de la fonctionnalité, comme on peut le faire en se disant que l’on n’a pas tous besoin d’avoir une perceuse (sachant que les gens s’en servent en moyenne entre six et treize minutes avant d’en changer). C’est la société de consommation dans laquelle on est. C’est de l’usage dont on a besoin, pas de la possession. C’est tout le mécanisme qu’il faut démonter dans l’inconscient de tout le monde, parce que l’on nous a tellement mis dans un conditionnement que l’on a du mal à s’en sortir. En réponse, nous avons fait une grainothèque, une outil-thèque, qui s’est développée au-delà de simples outils, avec la mise à disposition de sièges autos dont les parents ne se servaient plus par exemple. Nous avons développé une économie différente, ce qui ne coûte pas d’argent en réalité. C’est simplement de la rencontre entre les gens, ce qui crée un lien social extraordinaire. Finalement, l’écologie n’est pas chère, elle peut même être rentable financièrement. Par exemple, tous les bâtiments de la ville sont maintenant nettoyés avec des produits que l’on fait nous-mêmes, et cela nous a fait économiser de l’argent. Le personnel avait moins d’allergie aux produits d’entretien, et la qualité de l’air dans les écoles s’est considérablement améliorée puisqu’il y a moins de solvants. C’est donc vertueux sur toute la chaîne, même financière. Effectivement l’État ne nous donne plus autant d’argent depuis dix ans, nos recettes stagnent, mais il faut trouver des marges de manœuvre, et on peut même mettre de nouveaux régimes sociaux, en les finançant avec des économies d’énergie. Nous déployons l’argent que l’on a économisé ailleurs.
LVSL – Vous avez récemment quitté votre poste de maire pour devenir parlementaire européen. Est-ce que, pour vous, cela signifie que la préservation de l’environnement passera forcément par l’échelle européenne plutôt que du local ?
D.C – Non. C’était mon troisième mandat en tant que maire et je suis pour le non-cumul dans le temps et dans le nombre, donc j’avais annoncé que cela serait le dernier. Je pense qu’au bout d’un certain temps, il faut passer la main, même si j’adore ce que je fais et que je pense que les gens étaient attachés à mon rôle puisque j’ai été élu au premier tour la dernière fois. J’avais encore beaucoup d’idées pour aller plus loin, mais il faut changer. J’étais donc prêt à ne pas me représenter en mars 2020 et Yannick Jadot est venu me voir pour me proposer d’être sur sa liste, c’était l’opportunité de poursuivre les combats que je menais au niveau local et ramener mon expérience au niveau européen. Cela a raccourci mon mandat de quelques mois. Si les élections européennes avaient eu lieu deux ou trois ans avant, je n’aurais peut-être pas accepté, afin de finir mon mandat de maire, car il y avait encore beaucoup de choses en cours. En revanche, je pense que c’est important que des maires poursuivent ce combat, parce que l’expérience du terrain est extrêmement importante. Par exemple, dans les domaines sur lesquels je travaille au Parlement européen, comme les migrations, ce que j’ai vécu au niveau de Grande-Synthe et du coup au niveau national me sert dans les argumentaires politiques pour défendre un peu les politiques européennes. Dans la commission innovation, technologie et recherche, mon expérience dans un territoire industriel devant opérer sa mutation écologique et environnementale, est extrêmement importante pour défendre des orientations sur l’énergie, sur des politiques d’énergie, ou sur les politiques non-carbones. Enfin, dans la commission économie et finance, il me paraît important de défendre un modèle de protection de notre industrie qui doit être vertueuse dès l’entrée sur le territoire européen de produits qui ne sont pas fabriqués de la même manière sur le plan environnemental, comme les aciers turcs, chinois ou russes, qui émettent 2,2 tonnes alors que nous on émet 1,5 tonne pour les produire. Il faut que l’on protège notre industrie, mais aussi notre environnement, notre climat, en mettant des conditions de normes environnementales à l’importation. Ce sont des mécanismes que l’on peut mettre en place à l’Europe et je m’appuie sur mon expérience de terrain avec des industriels locaux qui me sollicitent pour cela, qui m’expliquent qu’ils voudraient changer leur manière de fabriquer, mais que cela engendre des coûts de production supplémentaires, qui engendrent une concurrence déloyale avec d’autres pays.
LVSL – Est-ce que vous vous sentez plus utile à Bruxelles qu’à Grande-Synthe ?
D.C – La grosse différence c’est qu’un maire peut tout faire. C’est vrai qu’il peut avoir une idée le matin et le faire l’après-midi, alors qu’au niveau européen, ça pourra peut-être voir le jour dans 15 ans, parce que la procédure est longue. Maintenant, les députés européens sont là pour faire des lois, des textes législatifs, pas de la mise en place concrète. Mais, l’expérience de terrain permet d’anticiper des conséquences que les technocrates ne peuvent pas voir. Ce qui est également important, c’est que l’on fasse exploser la bulle de Bruxelles telle qu’elle existe. Les fonctionnaires européens sont dans leurs bureaux, alors que moi, je me déplace en France deux jours par semaine pour me confronter à la réalité du terrain, rencontrer des personnes et créer le lien entre l’Europe et les citoyens.
LVSL – Récemment, dans un article du Monde, puis dans des propos réitérés sur LVSL, François Ruffin a appelé à une alliance rouge-verte, sous la forme d’un « front populaire écologique », projet soutenu par des personnalités comme le maire de Grenoble Éric Piolle. Pensez-vous que la victoire de la gauche, mais surtout la défaite du parti gouvernemental, aux prochaines municipales, passera obligatoirement par une union de la gauche ?
D.C. – François est venu aux universités d’été des Verts, fin août à Toulouse, suite à mon invitation pour débattre sur ce sujet. Nous sommes d’accord sur le fond. Pour moi, la gauche et la droite, ce n’est pas que cela ne représente plus rien, notamment sur le plan social, démocratique, mais sur le plan environnemental, aujourd’hui, cela ne veut plus rien dire. Quand on a une gauche pro-nucléaire, pour continuer le mode de développement, qui soutient l’industrie pétrolière, je considère que cela ne peut plus fonctionner. Cette gauche-là, ce n’est plus possible. Elle est là la grosse différence, même si on est peut-être autant attaché à la question sociale. Mais je considère que le modèle social que l’on a aujourd’hui, ne pourra plus être défendu demain, puisque l’on n’aura plus de vie sur Terre. Donc l’urgence est de trouver un accord sur un projet de société écologique qui remet à plat le modèle de développement, et arrêter la mainmise de l’économie sur le politique. C’est là où il faut que l’on reprenne le pouvoir. Le problème c’est qu’en politique, un et un ne font pas deux. Par exemple, Éric Piolle disait que Marine Le Pen et le Rassemblement National sont arrivés en tête aux Européennes parce que l’on n’a pas fait d’alliance. Je ne suis pas sûr que si l’on s’était allié avec la France Insoumise, on aurait fait un 19%. Ce n’est pas comme cela que ça fonctionne. Il faut que l’on travaille tous, à notre niveau, pour un même objectif, et à un moment, nous nous retrouverons sur le chemin. Il faut une société plus sobre, ce qui permettra de ne plus avoir ces écarts de richesse. La richesse qui sera créée devra obligatoirement être limitée pour être redistribuée, avec des mécanismes de redistribution pour avoir une société plus égalitaire, avec moins de concurrence entre les individus. C’est vers ce mode de développement qu’il faut tendre, et non plus répondre à une idéologie de gauche ou de droite.

LVSL – Est-ce que 2022 est la dernière chance pour le climat ? Si les libéraux ou l’extrême droite arrivent au pouvoir, est-ce que ce n’est pas définitivement faire une croix sur toute possibilité de sortie de crise ?
D.C. – Je ne fais pas partie des collapsologues, mais il y a un réel danger. C’est simple, nous avons cinq ans. En 2022, il ne restera plus que 3 ans. Il y a des décisions qui doivent être prises dès aujourd’hui, à tous les niveaux; européen, national et même international. 2022 est effectivement la dernière chance. D’ailleurs, certains disent que 2020 est le dernier mandat pour entamer cette transition. Nous n’avons plus le temps pour penser la transition, il faut agir. Quand on regarde le gouvernement français actuel, il n’est pas du tout sur la bonne voie. J’ai d’ailleurs déposé une plainte contre lui pour son inaction en matière de changement climatique. Le dernier rapport du GIEC, sorti en septembre, me donne raison puisqu’il dit que Grande-Synthe sera sous l’eau en 2100, ce qui confirme encore plus mes inquiétudes. Au niveau européen, nous avons déposé avec Karima Delli, un projet de résolution pour instaurer l’état d’urgence climatique. S’il passe, cela voudra dire que toutes les décisions qui sont prises par le Parlement européen devront être regardées, analysées à l’aune de l’Accord de Paris. Les élus issus de la majorité française ne veulent pas signer ce texte, parce que trop engageant. Il faudrait arrêter de critiquer Trump qui s’est retiré de l’accord de Paris, et appliquer ce que l’on a signé à soi-même. Il faut arrêter avec la communication politique et passer aux actes avec un texte contraignant. (Ndlr : Le vote a eu lieu jeudi matin et a été accepté par les députés européens)
LVSL – Vous êtes fortement mobilisé sur la question des migrants, notamment au parlement européen. Vous vous êtes d’ailleurs récemment rendu sur l’île de Samos, en Grèce. Dans une vidéo Twitter, vous vous êtes exprimé en faveur d’une nouvelle stratégie en matière d’accueil et prise en charge des migrants. Quelle est-elle ?
D.C. – Déjà, c’est que l’on arrête d’employer la rhétorique de l’extrême droite. Il faut arrêter de parler de « raz de marée migratoire », de « tsunami », de « problème migratoire ». Je suis d’ailleurs très en colère contre le gouvernement et Macron, qui relancent un débat sur l’immigration alors que dans le Grand Débat qu’il y a eu sur les Gilets Jaunes, la migration n’apparaissait pas. C’est une utilisation politique d’une thématique qui n’est pas dans le viseur des Français. Certes la France est le premier pays en termes de demandes d’asile, mais rapporté au nombre d’habitants, c’est le 8e pays européen. Il faut parler et débattre de migration, mais en parlant réellement de ce qu’il se passe. Il y a quelques millions de personnes qui sont arrivées en Europe. Nous sommes 500 millions. N’est-on pas capable d’accueillir ces gens qui fuient la guerre, le terrorisme, la misère sur notre continent européen, première puissance économique du monde ? En France, entre 2009 et 2018, nous avons donné l’asile à l’équivalent de 0,025% de la population. On parle toujours de la migration économique, mais elle ne constitue que 12%. Il faut remettre tout ça en perspective et se dire que ce n’est pas un problème de migration, mais d’accueil. Nous ne sommes pas à la hauteur, en France comme en Europe, en ce qui concerne l’accueil de ces personnes dans de bonnes conditions. Sur l’île de Samos, en Grèce, il y a 6 100 personnes dans un camp qui était prévu pour 647 personnes. Il y a donc 5 500 personnes qui vivent dans des conditions déplorables, sans accès à des douches, aux toilettes, à l’alimentation. C’est le cas sur cinq îles, ce qui fait qu’il y a 35 000 personnes qui vivent là, dont 5 000 mineurs isolés. Ce n’est rien à l’échelle européenne ! Le ministre grec a d’ailleurs envoyé un courrier aux ministres européens pour les prévenir de la catastrophe des enfants et leur demander de l’aide, il n’a reçu qu’une seule réponse. La réalité de la migration, ce sont des États qui se recroquevillent, avec des gouvernements comme celui de Macron qui visent toujours un duel entre les libéraux et l’extrême droite. Plusieurs études ont d’ailleurs montré que le coût de la non-gestion de cette migration est plus élevé que si l’on mettait l’argent dans un accueil correct, la formation, l’éducation et l’intégration sociale et professionnelle de ces personnes. Très concrètement, c’est Frontex, qui coûte 10 milliards d’euros, des opérations policières qui ont des conséquences budgétaires, mais aussi économiques, sur le tourisme comme à Samos.