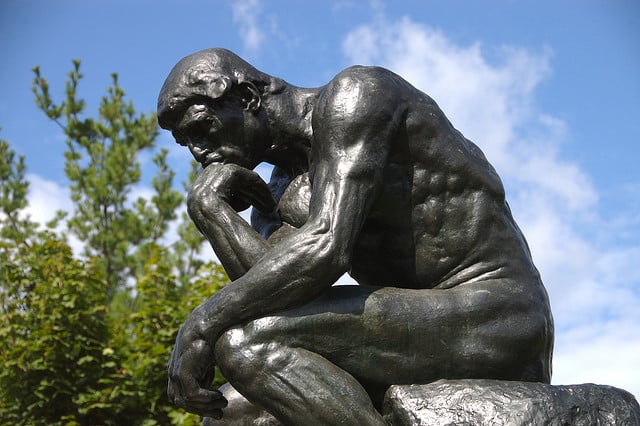Le mois de mars 2020 a été marqué par de nombreuses victoires pour la cause féministe : la journée internationale pour les droits des femmes a donné lieu à de puissantes manifestations partout dans le monde, tandis que le réalisateur Harvey Weistein, reconnu coupable de multiples viols et agressions sexuelles, a été condamné à 23 ans de prison. Pourtant, en France, le bilan est loin d’être aussi positif. Alors que la cérémonie des Césars a distingué Roman Polanski “Meilleur réalisateur”, de nombreuses voix se sont élevées dans l’espace public pour prendre la défense du cinéaste accusé de viol par douze femmes différentes. Parmi ces voix, l’on peut s’étonner que des femmes aient aussi choisi de se désolidariser de la cause féministe pour prendre parti en faveur du réalisateur. Ainsi, comment expliquer que certaines femmes relaient la domination masculine ?
Le sexisme, la posture dominante
Si le sexisme est autant ancré, c’est qu’il reflète une posture dominante : il est avant tout un ciment social pour les hommes. Isabelle Clair, sociologue et chargée de recherche au CNRS, l’explique ainsi : “Le sexisme créé de la sociabilité, du plaisir et le discours sexiste créé de l’appartenance.” Cette sociabilité commence très tôt, avec des oppositions entre les activités catégorisées comme féminines ou masculines, avec des manières de parler ou des hexis corporels différenciées. L’enfant et l’adolescent vont se construire autour de ces normes. Cette différenciation devient par la suite partie intégrante des rapports sociaux. Dans un contexte de sociabilité, le sexisme s’exerce avec ou sans la présence de femmes et, si des femmes sont présentes, elles sont fréquemment touchées par des formes de mises à distance du groupe. Les rapports de domination vis-à-vis des femmes, mais aussi entre hommes, s’exercent parfois de manière violente.
Le sexisme est donc un enjeu structurel et systémique, il est omniprésent. Les violences qu’il engendre peuvent être physiques, verbales mais aussi virtuelles. Sur les réseaux sociaux, pouvoir s’exprimer sans risque de représailles permet aux discours violents d’être encore plus présents. Ils permettent ainsi de perpétuer des postures ayant été légitimées pendant très longtemps sur la question du rapport à la femme, à ses vêtements, à son attitude. Selon Isabelle Clair, l’une des idées ancrées dans l’image de la féminité, est que la femme devrait être dans la réserve, dans la retenue. Si dénoncer le sexisme entraîne un rappel à l’ordre, la femme, elle, risque d’être rattrapée par le stigmate en voulant le révéler. On peut donner à titre d’exemple certains cas de décrédibilisation de la parole des femmes lors du mouvement MeToo : les femmes qui dénonçaient des violences subies étaient alors accusées de vouloir se mettre en valeur, de faire cela pour que l’on parle d’elle. Pourtant, comme le rappelle la chercheuse, le fait d’être prise pour une “fille facile”, pour une “salope”, est un éminent catalyseur de violence sexiste.
Les femmes ne sont pas un groupe social homogène
Avant d’expliciter les différents mécanismes relayant le sexisme, il convient de s’intéresser aux femmes en tant que groupe social. Pour reprendre Simone de Beauvoir dans son ouvrage fondateur Le Deuxième Sexe : “Les prolétaires disent « nous ». Les noirs aussi. Se posant comme sujets ils changent en « autres », les Blancs. Les femmes – sauf en certains congrès qui restent des manifestations abstraites – ne disent pas « nous » ; les hommes disent « les femmes » et elles reprennent ces mots pour se désigner elles-mêmes ; mais elles ne se posent pas authentiquement comme Sujet”. À l’image de la société toute entière, les femmes constituent un groupe social hétérogène, traversé par des rapports de domination propre à tout ensemble social. Toujours selon Isabelle Clair : “Les femmes sont en conflit entre elles. Elles appartiennent à des classes sociales différentes, n’ont pas le même âge, pas la même couleur de peau.”
“Les femmes sont en conflit entre elles. Elles appartiennent à des classes sociales différentes, n’ont pas le même âge, pas la même couleur de peau”.
En s’inspirant du terrain de ses recherches, l’universitaire constate que “les filles les plus insultées, qui subissent l’opprobre publique, sont des filles qui n’ont pas de père, de petit-ami attitré, de frère. Il n’y a pas d’homme qui consolide leur statut social.” C’est ce qu’elle appelle la “ressource de genre”.
Cette nécessité de posséder des ressources de genre renvoie à l’imaginaire diffus qui définit le statut même de la femme et sa place au sein de la société. Dans les années 1970, la sociologue Colette Guillaumin fait émerger la notion d’appropriation. Selon cette dernière, le corps des femmes doit toujours subir une forme d’appropriation, notamment par le biais d’un nom de famille, ou la présence d’un homme à ses côtés. Isabelle Clair approfondit cette idée, en expliquant qu’une fille “non appropriée”, ou “privatisée”, est perçue par la société comme une “fille publique”, une “pute”. Selon la chercheuse, il est nécessaire de relier cette idée d’appropriation à la croyance selon laquelle “les femmes sont le sexe et sont dévorées par celui-ci”. Ce préjugé millénaire rend nécessaire le contrôle des corps des femmes dans les sociétés patriarcales.
Les femmes ne sont pas toutes égales devant le sexisme et les violences sexuelles. Isabelle Clair observe notamment que les femmes jeunes sont plus susceptibles d’être agressées dans l’espace public et privé. Le sexisme peut également revêtir des formes diverses en fonction de l’appartenance sociale ou de la couleur de peau de la personne ciblée. En effet, le sexisme touche différemment les femmes suivant les ressources en leur possession, mais il n’en épargne aucune. Les formes d’oppression et l’identité des personnes touchées par le sexisme sont plurielles. Toutefois, cette hétérogénéité se retrouve aussi chez les femmes relayant ce sexisme, de manière plus ou moins conscientisée.
Un sexisme invisibilisé, ou simplement mis à distance
Comme le rappelle Isabelle Clair : “Certaines femmes n’ont parfois pas conscience d’appartenir à un groupe social en tant que tel. Celles-ci n’ont pas conscience de la domination qui s’exerce sur elles ou même parfois du sexisme.” Toujours selon la chercheuse, l’intériorisation du sexisme entraîne l’exercice de cette violence sur autrui. Résister au sexisme appelle forcément une autre forme de violence, ou un rappel à l’ordre. A l’inverse, en rejouant ce rapport de domination de genre, on apparaît comme un sujet appartenant au groupe dominant. On se met donc à l’abri, et à distance, du groupe social auquel on appartient de fait.
En rejouant ce rapport de domination de genre, on apparaît comme un sujet appartenant au groupe dominant.
Par-delà le fait de relayer cette forme de violence, on observe que certaines femmes peuvent nier cette violence en “invisibilisant” c’est-à-dire en niant les logiques sociales qui sous-tendent les violences sexistes. Le sexisme est alors nié en tant que fait social. Ainsi, suivant Isabelle Clair, beaucoup d’individus pensent que “les individus sexistes se limitent aux seules personnes qui se comportent mal, et ne voient les violences sexistes que comme des actions individuelles nécessitant un rappel à l’ordre”. Cette propension à individualiser les comportements empêche de relier des formes de violence plus diffuses, et de comprendre le sexisme comme un fait social.
Reconnaître une violence comme sexiste est aussi parfois quelque chose de brutal. Décrire une situation et la définir comme violente peut entraîner une prise de conscience difficile. Si le sexisme est aujourd’hui dénoncé et traité comme un véritable phénomène de société, cela n’a évidemment pas toujours été le cas, et peut entraîner une levée de bouclier de la part de certains groupes sociaux et de générations précédentes. Par exemple, lorsque le mouvement MeToo battait son plein, une centaine de femmes avec Catherine Deneuve à leur tête, ont publié une tribune défendant “la liberté d’importuner” des hommes. Il est à noter qu’il est toujours plus facile de juger d’un groupe social qui n’est pas le sien. On met à distance les personnes jugées, et on les juge d’autant mieux qu’elles représentent une forme d’altérité. Isabelle Clair évoque ainsi l’exemple des journalistes à la télévision qui “voient le sexisme dans le 93 mais pas dans leur quartier “, quand il n’est pas simplement invisibilisé. Dénoncer une certaine forme de sexisme peut aussi être un moyen d’exercer une violence envers un autre groupe social.
Une révolution par toutes les femmes
Le sexisme est toujours intégré au discours politique, et les actes pour lutter contre ces violences sont peu nombreux. Il est aussi, pour certains, bien présent au coeur des institutions. À titre d’exemple, la député Danièle Obono a souligné les liens observés, à l’Assemblée nationale, entre domination masculine et lieux de pouvoir. Elle remarque que la violence peut être perçue comme plus banale dans les lieux de pouvoirs à cause du caractère conservateur de l’institution et d’une norme indexée sur un modèle réactionnaire. Les lieux de pouvoir sont par excellence des lieux de reproduction de la domination, il est donc logique que ceux-ci servent de support à l’exercice d’une domination masculine. La députée observe aussi l’aspect social et hiérarchique des personnes touchées par les violences sexuelles au sein de l’Assemblée nationale. Elle évoque les assistantes parlementaires, mais aussi les agents d’entretien qui sont les premières victimes de harcèlement sexiste. Néanmoins, selon ses termes “la matière sociale, culturelle et politique n’est pas figée, de même que les rapports de force”. Ainsi, le Tumblr “Chair Collaboratrice” a été ouvert afin de permettre aux victimes de harcèlement sexiste ou sexuel de témoigner sur une page publique.
Les femmes se désolidarisant de la cause féministe ne la décrédibilisent pas, mais montrent avant tout la nécessité de ce combat.
Si les mobilisations peuvent faire évoluer les choses, les prises de conscience sont aussi nécessaires. Pour comprendre la profondeur du sexisme comme fait social, LVSL s’était auparavant entretenu avec Alice Debauche afin de questionner les violences sexuelles au sein des universités françaises. En admettant que les violences sexistes sont un fait social et que les femmes en tant que groupe social cristallisent ces violences, il sera alors enfin possible de faire tomber les derniers bastions de conservatisme internes à ce groupe. Les femmes se désolidarisant de la cause féministe ne la décrédibilisent pas, mais montrent avant tout la nécessité de ce combat, en révélant la profondeur des mécanismes de domination. C’est donc avant tout le signe qu’il nous faut continuer d’avancer vers une réelle révolution féministe, incluant toutes et tous.