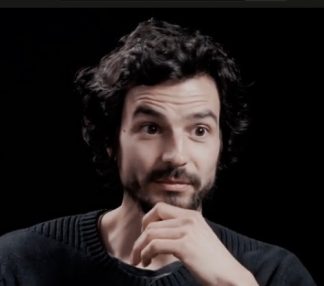Dominique Bourg est philosophe, et l’un des premiers à s’être intéressé aux bouleversements environnementaux que nous traversons. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, enseigne à l’Université de Lausanne et dirige la revue La pensée écologique, pour ne citer qu’une petite partie de ses activités. Nous avons choisi de débuter notre série avec son témoignage, car la transition écologique exige avant tout un changement profond de philosophie.
Dans cette série de grands entretiens, nous avons choisi de poser les mêmes questions à des personnalités du monde de l’écologie ayant chacune une approche, un métier, différents. Un tel projet est inédit, et son but est de donner à voir comment chacun se complète pour esquisser les grandes lignes de l’urgente transition écologique. Chacun détient une partie de la solution, une partie des armes de la transition. La transdisciplinarité doit devenir une norme de travail, pas une exception.
La série Les Armes de la Transition existe aussi en format vidéo :
LVSL : À quoi sert un philosophe pour la transition écologique et pourquoi avez-vous choisi cette discipline-là pour apporter votre pierre à ce combat ?
Dominique Bourg : La philosophie existait bien avant qu’on ne parle de transition écologique. À quoi sert-elle ? Elle existe depuis 25 siècles, elle naît avec les sciences. Aujourd’hui on a d’autant plus besoin de philosophie qu’on observe une explosion des disciplines universitaires. Dans les années cinquante, il y avait peut-être une cinquantaine de disciplines. Aujourd’hui il y en a plus de 2000 estampillées comme telles. On a donc affaire à une espèce d’hyper fragmentation du savoir, surproduite d’ailleurs par le néolibéralisme. Mes amis universitaires sont très dociles, ça leur plaît beaucoup d’avoir tous leur chapelle. Du coup, on a une énorme fragmentation du savoir.
Dans un contexte comme celui-là, la philosophie est d’autant plus utile parce qu’elle appelle une démarche réflexive à partir d’autres savoirs. La philosophie c’est revenir sur les choses et mailler, faire des croisements, interpréter les savoirs. C’est d’autant plus utile et important à une époque où on est un peu écrasé par le savoir analytique et cette division à l’infini des problèmes.
À quoi sert la philosophie dans le cadre de la transition écologique ? La première chose, c’est peut-être qu’il faut être philosophe pour s’interroger là-dessus. Quand j’étais jeune étudiant, la transition écologique n’avait évidemment aucun sens. Au tout début des années 2000, on a commencé à parler de développement durable et même de décroissance, etc. Pourtant il y avait eu le rapport Meadows trente ans avant – le rapport du club de Rome dont un des scénarios nous montre que les courbes de croissance de tous les indicateurs s’inversent entre 2020 et 2040 ; attention, il s’agissait d’une projection et non d’une prédiction. Mais à la fin des années 1990, on baignait dans une sorte d’optimisme.
Au fond, on n’avait pas une conscience aussi aiguë de l’irréversibilité des difficultés qu’on a aujourd’hui. On pensait que la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère aurait des effets au court terme – un peu plus d’un siècle – et on se projetait à la fin du siècle, pas avant.
Je ne sais pas si le mot transition est toujours aussi utile et intéressant parce qu’il subit le sort de bien des mots. Le développement durable, c’était un peu une tarte à la crème dès le départ, mais il y a aussi des choses intéressantes dedans. De fait on reste dans un schéma de croissance avec des courbes qui s’envolent quand même. À partir du moment où tout le monde se réapproprie le terme transition, il perd de son tranchant et on s’en sert paradoxalement pour ne pas transiter.
Lorsqu’on parle de philosophie, on parle de réflexion, et donc de réflexivité, c’est-à-dire à la fois revenir sur un savoir déjà présent, et revenir sur son savoir et sa propre démarche. Très souvent, on est en contradiction totale entre ce que l’on dit, avec le fait de le dire ; et le fait d’assumer sous une autre forme, à un autre endroit, ce qu’on dénonce. La méthode philosophique est souvent généalogique. C’est-à-dire que lorsqu’on a un problème, on cherchera à savoir d’où ça vient, à savoir pourquoi. Si on ne fait pas cette généalogie, on ne peut pas donner de vraies solutions, au contraire. C’est le travail du philosophe d’essayer de comprendre pourquoi on est dans ce degré de destruction par rapport à ce qu’on appelle la nature, le milieu qui nous entoure et nous englobe.
LVSL : En quoi consiste concrètement votre activité ? À quoi ressemble une journée de travail type de Dominique Bourg ? Quelle est votre méthode de travail ?
DB : La démarche d’un philosophe est toujours à mi-chemin entre les lectures, l’écriture, et puis ce qu’on voit, ce qu’on repère, ce qu’on essaie de sentir dans le cours des choses. Il faut faire une alchimie de tout cela.
LVSL : Quel est votre objectif ?
DB : En ai-je un et un seul ? Je ne suis pas sûr… Comme je vous l’ai dit, j’ai vu comment ces trente dernières années, on est passé d’une certaine forme de légèreté sur les questions environnementales à un discours beaucoup plus dur et tragique.
On se rend compte du caractère irréversible de ce qu’on a fait. Et si la destruction qu’on a opérée collectivement a un caractère irréversible, le travail ne va pas être de revenir en arrière. C’est fichu ! Le travail, c’est d’essayer de comprendre et ça, c’est fondamental. Et puis à partir de la compréhension, en reliant des savoirs différents, essayer d’avoir une vision assez claire, notamment sur le côté scientifique des choses. Il faut pour cela ingérer chaque jour une bonne petite quantité de littérature scientifique.
Cela m’amène par exemple à revenir sur la notion de risque, car quand on emploie exclusivement cette notion de risque, on ne se fait pas une idée juste de ce qu’on est en train de faire aujourd’hui, c’est-à-dire compromettre les conditions d’habitabilité de la Terre. Si vous raisonnez en matière de risques, vous allez raisonner comme un économiste néoclassique et vous n’allez rien comprendre. C’est par exemple Nordhaus qui vous dit que l’optimum de l’augmentation de la température serait de 6,2 degrés sur Terre par rapport à l’avant révolution industrielle. C’est qui est une absurdité totale, à cette température-là, on ne serait plus que quelques millions d’êtres humains à habiter au Groenland habillés en tenue légère.
Il faut aussi comprendre les raisons pour lesquelles on a lentement évolué vers un gouvernement représentatif, et pourquoi ce gouvernement représentatif ne peut pas prendre en compte les problèmes que l’on connaît. Benjamin Constant avait bien compris les raisons pour lesquelles nous sommes dans un gouvernement représentatif. Si vous prenez par exemple la France, il y a à peu près 2000 décisions législatives par an. Vous imaginez bien que si on fait un RIC, un Référendum d’initiative citoyenne, et si on veut que ça se substitue à la représentation, et bien on va faire pire que les Grecs d’autrefois. On va passer sa vie sur l’Agora sans jamais prendre une seconde pour se nourrir.
Comment essayer de corriger les défauts du gouvernement représentatif ? Quelles institutions mettre sur pied pour l’aider et nous aider à mieux prendre en compte les problèmes gravissimes auxquels on est confrontés ?
Il faudrait peut-être essayer de produire des visions sur le futur. On est vraiment sur un moment de bascule en termes de civilisation. Nous étions une civilisation très mécaniste depuis la fin du XVIème siècle. On s’imaginait que la nature n’était qu’un agrégat de particules matérielles, donc que les animaux étaient des machines pour reprendre Descartes, mais que nous autres êtres humains nous étions étrangers à la nature. Du coup, le progrès était de s’éloigner au maximum de la nature, de l’artificialiser, de la détruire. Si vous n’avez pas compris l’héritage de cette façon de penser, vous aurez des problèmes pour comprendre ce qui se passe aujourd’hui.
Depuis Darwin et le XIXème siècle, on commence à comprendre qu’on appartient vraiment au vivant. Darwin a replacé l’espèce humaine au cœur de la nature. L’étude du comportement des animaux dans la seconde moitié du XXème siècle nous a montré qu’entre eux et nous, c’est finalement une différence de degrés. Aujourd’hui, c’est la biologie végétale qui nous montre que les plantes sont pleinement vivantes. Elles exercent les mêmes fonctions que les animaux, mais évidemment pas de la même manière. On prend conscience du vivant et on voit dans la société émerger des courants qui en sont la conséquence. Le rôle du philosophe ça va être de les déceler, de les traduire et de voir ce que pourrait donner leur développement. C’est aussi tout cela le travail du philosophe.
LVSL : Dans le champ de la philosophie et de l’écologie politique en France, vous écrivez depuis longtemps, vous faites même partie des pionniers. Pourriez nous livrer deux ou trois concepts que vous avez forgé au cours de vos travaux ?
DB : Je vous ai parlé tout à l’heure de risques. J’essaie d’opposer à cette notion de risque la notion de dommage transcendantal. Le mot est un peu ronflant, mais cela veut simplement dire que ce qui est affecté aujourd’hui par nos activités, ce n’est pas telle ou telle partie de notre territoire, ce n’est pas telle ou telle catégorie de personnes, c’est le fait même de pouvoir habiter la Terre. Imaginez par exemple qu’on aille vers une augmentation moyenne de la température de 4 degrés – et malheureusement c’est tout sauf impossible – et bien vous auriez de nombreuses régions au monde où vivent des milliards de personnes où l’accumulation entre la chaleur et l’humidité saturerait les capacités de régulation thermique du corps humain et on meurt en quelques minutes. Donc en d’autres termes, cette région ne serait plus habitable. Donc, quand je parle de dommage transcendantal voyez bien ce que cela veut dire : notre façon d’habiter la Terre est en train de changer et il y a des endroits sur Terre qui vont devenir proprement inhabitables. On ne va donc pas parler de risque, parce que ça n’a plus de sens.
J’ai essayé de trouver comment faire pour que les problèmes du long terme soient mieux pris en compte et je me suis intéressé au mot spiritualité pour lui donner deux sens très différents, mais liés. Le premier sens est ontologique : toute société est en relation avec ce qui l’entoure, le milieu naturel ; elle le reçoit avec un style particulier. L’autre sens, c’est qu’il n’y a pas de société au sein de laquelle on ne propose pas aux êtres humains des modèles de réalisation de soi.
Très concrètement, dans la manière dont on conçoit les êtres vivants à la fin du XIXème siècle, il n’y a pas de vivant. Le vivant est une matière première, dépourvue de valeur : on va écraser les poussins pour en faire des nuggets, c’est l’horreur ! Dans la spiritualité d’un moderne, se réaliser c’était accumuler des biens matériels. La nature c’était ce qu’on doit consumer, ce qu’on doit détruire. Si vous voulez consumer votre nature, il faut que de votre côté vous consommiez, et donc que réaliser son humanité soit le fait de consommer. On voit aujourd’hui que ce sens-là est en train de changer. Si effectivement on commence à se comprendre comme appartenant au vivant, le vivant n’est plus une matière première. Il va exiger une forme de respect. Et à partir de ce moment-là, on voit bien que les spiritualités sont en train de changer, l’empathie avec le vivant croit. J’essaye de comprendre ces moments de fond et en quoi ils dessinent un avenir un peu différent, plus séduisant. Peut-être que pour atteindre cet avenir il faut probablement passer par des choses moins drôles, ce qu’on va appeler effondrement, et caetera.
LVSL : Est-ce que vous avez déjà réfléchi à une traduction possible de vos conclusions en politiques publiques très concrètes ?
DB : Si on veut que l’effondrement potentiel de notre société soit moins violent, il faudrait dès maintenant se donner un objectif à l’échelle d’une société. Par exemple, on pourrait se dire que grâce à un référendum d’initiative populaire, on vote en France le fait de revenir à une empreinte écologique d’une planète – si tout le monde vivait comme un Français, il faudrait plus de trois planètes. Comment pourrait-on faire ça ? Comment pourrait-on y arriver ? Quels seraient les instruments en termes de politique publique qui permettraient quelque chose comme ça ? J’ai essayé de répondre ailleurs à ces questions.
LVSL : Quelle devrait être la place de la philosophie dans la planification de la transition ? À quel moment la philosophie intervient-elle par rapport à la décision politique et quelle structure pourrait porter cela ?
DB : Donner un sens à la transition, c’est la tâche du philosophe, mais aussi de l’artiste, du cinéaste, de l’écrivain, c’est la tâche de multiples types de fonctions dans la société. Si vous n’avez aucune vision de ce que pourrait être l’avenir, vous ne pouvez pas transiter, ou alors votre transition sera purement technocratique. Si revenir à une empreinte écologique d’une seule planète est une fin en soi, ça ne va pas être très motivant. Cela peut même devenir une espèce d’expertocratie assez effrayante. Ce qu’il faut bien comprendre dans ce moment où on est, c’est que toutes les choses doivent changer en même temps, mais avec une certaine synergie. Elles doivent converger vers un but et la philosophie est une des disciplines qui peut y contribuer, mais elle n’est évidemment pas la seule.
LVSL : Admettons qu’un candidat à la présidentielle vous donne carte blanche pour réaliser son programme en matière de transition écologique. Dans le cadre de votre champ, la philosophie, quelles propositions concrètes pourriez-vous faire pour rendre ce programme à la fois attractif et réaliste ?
DB : Le problème des défis qui sont les nôtres aujourd’hui, c’est que ce n’est pas quelque chose qu’un président peut décider. Pour changer, il faut changer ses modes de vie, ses façons de faire, etc., c’est assez intime. Ça ne veut pas dire qu’un président n’aurait aucun rôle. Imaginons précisément qu’un président se fasse élire sur un programme tel que je le décrivais tout à l’heure, celui de l’objectif d’une France à une empreinte écologique d’une planète en 2050. Il faudrait déjà que cet objectif soit accepté par quelque chose comme un référendum. Si vous n’avez pas plus d’une moitié de la population qui est décidée à y aller, qui a compris, qui le veut, et bien on ne peut pas.
Ensuite c’est extrêmement difficile un objectif pareil, on ne sait pas forcément comment on va faire. Du coup, le rôle de l’État c’est d’organiser le consensus autour de l’objectif, de mettre sur pied les indicateurs qui vont nous permettre de contrôler qu’on va bien vers cet objectif, mais en même temps il doit laisser la pluralité des moyens de parvenir à cet objectif. L’État doit permettre que la société tâtonne, qu’elle fasse des erreurs, des essais. Il faut qu’on soit ferme sur les objectifs et en même temps qu’on facilite cette liberté d’initiative. C’est pourquoi je tiquais un peu sur l’histoire du président. Ce n’est pas avec un : « Ça y est c’est décidé tout le monde me suit » qu’on va arriver à une empreinte écologique d’une planète.
Par ailleurs, j’ai souvent évoqué l’idée d’une troisième chambre. À peu près tous les systèmes politiques mondiaux démocratiques sont bicaméraux, c’est-à-dire où il y a deux chambres. On a en général une chambre comme l’Assemblée nationale en France où siègent les représentants de la nation. Leur rôle sera de trouver les moins mauvais compromis entre les partis et les intérêts associés à ces partis. Du coup, le temps présent domine tout.
Ensuite, il y a généralement la deuxième chambre. C’est plutôt la chambre qui va incarner les États dans une fédération, les régions, les territoires, etc. En France, si les territoires ruraux sont très représentés au Sénat, c’est parce qu’on imaginait que la ruralité allait apaiser en quelque sorte les conflits du travail. On reste encore sur les objectifs de conflits d’intérêts au présent.
En 2017 les émissions françaises de gaz à effet de serre ont augmenté de 3 %. A l’échelle internationale, elles augmentent tous les ans d’à peu près 2%. Ces chambres sont incapables de planifier et de réduire nos émissions. Et en même temps, on n’a pas grand-chose à mettre à la place du principe de représentation, même si on le conteste. Mais en le contestant, on le reconnaît. On déteste seulement quelqu’un qui ne nous représente pas. Tous les problèmes de ce pauvre Macron tiennent du fait qu’il est complètement différent. Les gens ont vraiment l’impression qu’il est à 180° différent d’eux et qu’il ne les incarne en rien.
Donc il y a besoin d’une chambre beaucoup plus spécialisée, axée sur les grands enjeux à long terme. Le problème de ces enjeux de long terme c’est que souvent, on ne les voit pas. Ça devient un peu moins vrai pour le climat maintenant, mais on ne les ressent pas suffisamment. Si vous n’avez pas un savoir scientifique, il est difficile d’avoir une idée précise du fait que le vivant s’effondre autour de nous. Sans le savoir scientifique, le changement climatique passe pour un changement de météo. On a besoin d’avoir un lieu où ces savoirs peuvent pénétrer l’espace social et où des gens se focaliseront sur les conséquences à long terme de nos actions. Qu’on le veuille ou non, tout ce qui nous tombe sur la tête aujourd’hui est le fruit de décisions antérieures.
Donc cette chambre doit être vraiment focalisée là-dessus, sans pour autant être composée uniquement de scientifiques, sinon on serait dans une espèce d’épistémocratie. Ce sont plutôt des citoyens connus pour leur engagement qui vont être pris dans cette chambre, avec pour mission d’essayer de discerner ce qui bouge dans la société. Cette chambre est là simplement pour opposer un veto momentané, pour contraindre les deux chambres classiques à rediscuter. On peut aussi s’en saisir pour s’opposer à des lois dont on sait qu’elles vont avoir un effet très destructeur. C’est un instrument certes insuffisant, mais qui pourrait permettre au Parlement de changer sa manière de faire les lois, d’être plus attentif, de façon plus expérimentale et systématique, à ce qui se passe sur les territoires. Avec une troisième chambre, on ne regarderait pas forcément les ZAD de la même manière par exemple, parce que dans certaines ZAD, il y a de véritables expérimentations. Par exemple sur le développement de lowtech, de mode d’organisation, etc.
C’est un instrument, qui en aucun cas ne suffirait. C’est un instrument qui peut permettre de changer la façon dont on fait la loi, en tenant compte des savoirs scientifiques et en regardant ce qui se fait dans les territoires.
LVSL : Est-ce que vous êtes en lien au quotidien avec des experts d’autres disciplines ? Comment travaillez-vous ensemble ?
DB : Ça m’arrive dans les conseils scientifiques, par exemple ceux des fondations. Par définition ce sont des conseils scientifiques pluridisciplinaires. C’est vraiment génial pour un philosophe parce que quand vous avez des questions à poser sur un certain sujet ou quand vous voulez voir comment certains scientifiques appréhendent leur propre savoir. Quand vous voulez réfléchir sur les questions d’environnement, il est absolument nécessaire d’avoir un savoir scientifique positif à disposition. Ça a vraiment été très important pour moi d’appartenir à de telles structures.
LVSL : Êtes-vous plutôt optimiste quant à la faculté de l’humanité à relever le défi climatique ?
DB : Alors il faut faire très attention, car il n’y a pas que le défi climatique. Le climat, ce n’est jamais que les conditions optimales d’épanouissement d’un certain type d’espèces. On le voit bien dans le rapport SR 15 du GIEC qui nous parle d’émissions négatives et de production électrique de masse avec de la biomasse, etc. En fait, ces solutions peuvent être très destructrices en termes de biodiversité. Donc c’est vraiment important de raisonner avec ce qu’on appelle les limites planétaires. Effectivement, les deux limites planétaires les plus importantes sont celles qui concernent l’évolution de la vie, avec d’un côté le taux d’érosion des espèces et ce qui menace l’intégrité des écosystèmes, et puis de l’autre côté, le climat.
Ce sont deux paramètres qui sont liés comme le recto et le verso d’une feuille de papier. Ce qu’on ne comprend pas toujours, et c’est assez grave, c’est que le basculement de l’un appelle celui de l’autre et réciproquement. Que ce soit en matière de climat ou en matière de vivant, on est malheureusement déjà dans une certaine forme d’irréversibilité. Donc si votre optimisme consiste à dire que ce n’est pas grave, qu’on va s’en tirer et que finalement on va surmonter tous nos problèmes, c’est totalement faux.
Ce n’est pas une question d’être optimiste ou d’être pessimiste : on est déjà entré dans l’anthropocène. Qu’on le veuille ou non, l’habitabilité de la Terre sera notablement fragilisée dans les décennies qui viennent. En revanche, le degré de fragilisation est encore en partie dans nos mains. Mais pour un temps très court, pour une dizaine d’années. Donc est-ce que je peux être optimiste dans les dix ans qui viennent ? Je crois qu’être optimiste ce serait tout simplement être mal informé.
Aujourd’hui vous avez partout des peuples qui choisissent ce qu’on appelle le populisme. Ce qu’ont en commun tous ces populistes – Trump, Bolsonaro, Salvini, les Polonais, Le Pen en France, les Hongrois, l’AFD en Allemagne – c’est le climatoscepticisme. Quand on nous dit : « Ouh là là si on écoute les écologistes on va avoir un régime autoritaire » je pense que les gens se trompent : on entre dans des régimes autoritaires, mais qui eux vont empirer et qui peut-être vont nous empêcher d’utiliser cette dernière décennie qui nous reste pour empêcher le plus grave. Alors attention, ça n’est pas fait : en même temps qu’il y a ces menaces populistes, il y a des forces dans la société qui sont en train de se lever.
Je dirais que l’année 2018 a été une année tout à fait particulière parce que c’est la première année au sein de laquelle le changement climatique est devenu sensible. Les gens l’ont touché, ils l’ont ressenti, ils ont été profondément affectés. En ce moment on est tout début février et en Australie c’est l’été austral. Les vagues de chaleur sont telles que dans certaines villes on avoisine les 50 degrés. Entre 40 et 45 degrés, toutes les plantes arrêtent la photosynthèse. Dans certains endroits en Australie vous avez des chauves-souris qui tombent de déshydratation et de chaleur. Donc là on commence à voir des choses, et du coup il y a un seuil de mobilisation. En 2018 et début 2019, des dizaines de milliers de gens se déplacent lors de mobilisation pour le climat. Avant ce n’était que des centaines et j’espère que demain ce sera partout des centaines de milliers. Donc là on est à un moment de changement très profond. On a franchi un seuil de mobilisation. Donc on voit bien qu’on a ces deux forces-là : des populistes qui sont très forts, qui font tout pour que les gens ne sachent pas, ne voient pas, et puis vous avez cette partie agissante plutôt jeune de la population qui, elle, a compris qu’il en va de sa propre vie. Je ne sais pas ce qui va en découler, mais je garde vraiment espoir que cette mobilisation d’aujourd’hui nous fasse agir à temps. Mais ce n’est pas de l’optimisme, c’est un souhait volontaire.
Retrouvez l’ensemble des épisodes de Les Armes de la Transition dans le dossier suivant (écrit) :
Et sur YouTube (vidéo) :