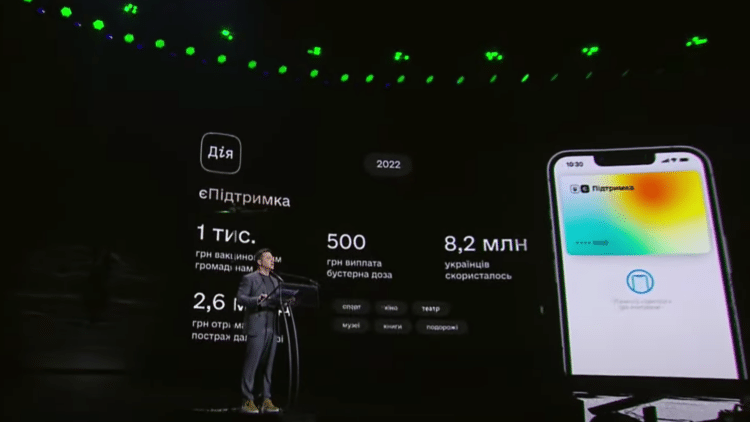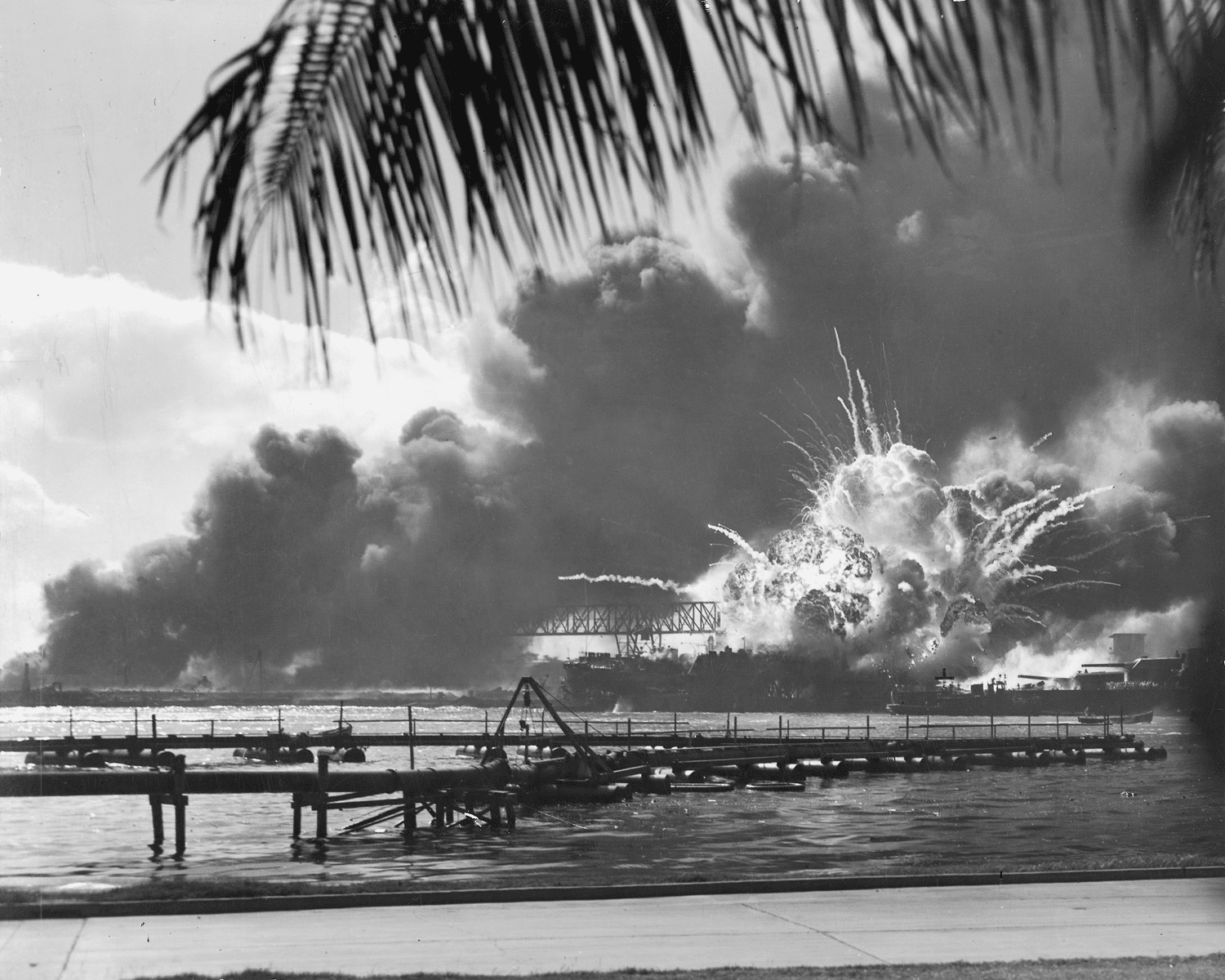Alors que près de trois ans se sont écoulés depuis le début de la guerre avec la Russie, l’État ukrainien n’a toujours pas procédé à des nationalisations généralisées ou à une conscription de la main-d’œuvre. Contrairement aux mobilisations totales du siècle dernier, l’effort de guerre de l’Ukraine repose largement sur les mécanismes du marché et les dons civils. Par Davide Maria de Luca, traduction Alexandra Knez [1].
Si vous vous baladez dans le centre-ville de Kiev un soir de panne d’électricité, pendant les fêtes de fin d’année, vous finirez tôt ou tard par tomber sur Tsum, un grand magasin haut de gamme de plusieurs étages, dont le portier porte un pardessus à capuchon et un chapeau haut de forme. Lors des coupures d’électricité programmées qui durent désormais de quatre à huit heures par jour, un quart de la population de Kiev et des millions d’autres en Ukraine sont plongés dans l’obscurité et beaucoup d’entre eux n’ont pas de chauffage. Pourtant, la façade de Tsum brille de mille feux, éclairant de somptueux étalages de Noël présentant une multitude de marques de luxe.
On serait tenté de voir dans ce spectacle une énième démonstration criante de la corruption et de l’inégalité sociale qui règnent sur ce pays. Surtout si l’on sait que ces lumières ne sont pas alimentées par le générateur privé du centre commercial – qui ne fonctionne que lors des coupures d’électricité exceptionnelles – et que Tsum appartient à Rinat Akhmetov, l’un des oligarques les plus riches d’Ukraine, qui contrôle également DTEK, le plus grand fournisseur privé d’énergie du pays. Mais continuez à marcher et vous découvrirez que de nombreux autres magasins sont également très éclairés. Tsum est l’une des nombreuses exceptions aux règles prétendument égalitaires du rationnement de l’énergie.
En Ukraine, de nombreux économistes, hommes politiques et citoyens ordinaires pensent que ces décorations de Noël scintillantes ne sont pas uniquement la conséquence de l’accaparement de l’État par de riches intérêts. Ils affirment qu’il existe des raisons économiques rationnelles de maintenir ces lumières allumées, même lorsque des millions de personnes sont quotidiennement plongées dans l’obscurité. En restant ouverts et attrayants, avec des devantures aux lumières festives et de luxueuses décorations de Noël, les magasins haut de gamme de la rue principale de Kiev génèrent de précieuses recettes et paient des impôts – des fonds qui soutiennent directement la défense du pays.
Après avoir vécu plus d’un an en Ukraine et visité de nombreuses régions et presque toutes les lignes de front, j’ai souvent été surpris de découvrir combien d’Ukrainiens partagent ce point de vue et combien la mentalité consumériste et les mécanismes de marché sont souvent au cœur de l’effort de guerre de l’Ukraine.
La privatisation de la guerre
L’un de mes premiers entretiens en Ukraine fut avec Artem Denysov, le fondateur de Veteran Hub, la plus grande ONG privée qui vient en aide aux anciens militaires. Psychologue militaire portant un regard lucide sur le conflit, Denysov ne semblait pas être étonné qu’après une décennie d’opérations militaires à l’est du pays et des années de guerre à grande échelle, les efforts publics pour soutenir les anciens combattants relevaient de la plaisanterie – avec des lois héritées de l’ère soviétique offrant des connexions téléphoniques et des radios neuves aux soldats blessés revenues du front. « Les États sont intrinsèquement incapables », m’a-t-il dit. « Il vaut mieux laisser les choses entre les mains d’individus qui ont des ressources. »
C’est dans les stations de métro de Kiev que l’on retrouve l’un des exemples les plus frappants de la privatisation de l’effort de guerre. Il s’agit d’une campagne de marketing de la troisième brigade d’assaut, la principale branche militaire du mouvement d’extrême droite Azov. Le contenu des publicités est très explicite : on y voit de belles jeunes femmes qui s’enlacent ou regardent avec envie des soldats costauds en tenue opérationnelle. Si la campagne a été critiquée pour sa représentation sexiste des femmes, ce qui est encore plus surprenant, c’est qu’elle ait été financée par des fonds privés et produite par l’unité militaire elle-même. Le site web auquel cette publicité renvoie n’appartient ni à l’armée ni au ministère de la défense ; il s’agit du portail privé de la troisième brigade d’assaut, utilisé pour recruter des membres, collecter des fonds et partager des vidéos et d’autres supports promotionnels.
Étant donné que les volontaires peuvent choisir l’unité qu’ils souhaitent rejoindre et que les conscrits peuvent demander leur transfert via l’application militaire officielle en quelques clics, les unités ukrainiennes se livrent une bataille féroce pour attirer les meilleurs éléments. La troisième brigade d’assaut n’est que l’exemple le plus marquant d’une unité militaire qui a su tirer efficacement parti d’une stratégie marketing. Presque toutes les unités tentent de faire de même.
Les mécanismes du marché influencent également le recrutement. Plus le salaire habituel d’un civil est élevé, moins il est susceptible d’être recruté, en raison d’exemptions formelles et informelles. Les salaires sont souvent considérés comme un baromètre de l’utilité d’un individu pour l’économie et, par extension, pour l’effort de guerre. Dans une certaine mesure, les impôts qu’une personne génère sont considérés comme plus précieux que sa contribution potentielle sur le champ de bataille. En Ukraine, plusieurs propositions ont déjà été faites au parlement pour formaliser cette approche liant explicitement les exemptions de mobilisation à l’échelle des salaires. Ces initiatives ont été critiqués, mais cette vision des choses – ceux qui gagnent plus ne devraient pas être mobilisés – reste largement approuvée par les élites et les économistes.
Neuf drones sur dix sont soit offerts par des civils, soit achetés grâce à leurs contributions. Un moyen efficace d’en obtenir davantage est de démontrer que l’unité a réussi à les utiliser efficacement.
Les unités militaires sont également en concurrence pour l’obtention de dons. Presque toutes les brigades ukrainiennes couvrent une partie de leurs besoins grâce à des dons citoyens ou par d’autres moyens, en mettant par exemple à profit les salaires privés des soldats et même leurs économies personnelles. Quant aux magasins militaires, qui fournissent un large éventail de produits, des vestes d’hiver aux gilets pare-balles, ils sont en plein essor en Ukraine. Les gens installent ainsi des tentes-magasins temporaires aux carrefours et dans les villages proches de la ligne de front.
Pour le soldat, l’argent est nécessaire pour tout, des vêtements aux drones en passant par le loyer. Les soldats doivent souvent prendre en charge leurs propres frais de logement, et les habitations saturées situées près des lignes de front peuvent être aussi chères que celles du centre-ville de Kiev. Tuareg, un lieutenant de quarante-quatre ans commandant une compagnie de drones dans la 92e brigade, que j’ai rencontré à Kupyansk sur le front nord-est, m’a dit que neuf des dix drones de son unité sont soit offerts par des civils, soit achetés grâce à leurs contributions. Un moyen efficace d’en obtenir davantage, a-t-il expliqué, est de démontrer que l’unité a réussi à les utiliser efficacement. Une seule vidéo de drone frappant un char russe, partagée sur le compte Telegram de la brigade, peut générer des milliers de dollars de nouveaux dons. Les unités militaires ukrainiennes sont donc fortement incitées à mener des actions qui peuvent être filmées et présentées au public.
La plupart des brigades sont composées d’hommes mobilisés âgés d’une quarantaine d’années, qui reçoivent une formation minimale et disposent de moyens matériels limités pour s’équiper.
Une unité composée de pilotes de drones bien entraînés et équipés du matériel le plus récent court également moins de risques d’être sacrifiée en tant que tirailleurs dans les tranchées. Cependant, la troisième brigade d’assaut – avec son site web élégant, ses centres de recrutement privés bien aménagés et ses soldats entièrement équipés – est une exception. La plupart des brigades sont composées d’hommes mobilisés âgés d’une quarantaine d’années, qui reçoivent une formation minimale et disposent de moyens matériels limités pour s’équiper. Ces unités peuvent à peine se permettre de faire de la publicité et dépendent souvent fortement des œuvres de charité. Certaines ne peuvent même pas y recourir, car elles n’ont pas le personnel nécessaire pour franchir les obstacles bureaucratiques requis pour obtenir des contributions.
J’ai visité une telle unité au printemps, près de l’axe de Vovchansk dans le nord – une compagnie d’artillerie de la 57e brigade. Les soldats m’ont expliqué qu’un seul membre de la compagnie était plus âgé que leur équipement, un obusier automoteur construit en 1976 dans la ville voisine de Kharkiv. Ils ont dû acheter la plupart de leurs vêtements et collecter des fonds pour couvrir les frais d’essence et de réparation des véhicules de la compagnie.
Les limites de l’intervention étatique
Dans une telle situation, on pourrait s’attendre à ce que l’État racle désespérément les fond de tiroirs pour trouver les ressources nécessaires en première ligne. Des coupes budgétaires sévères ont en effet été opérées dans tout ce qui pouvait être sacrifié, l’éducation en faisant les frais, tandis que les impôts indirects ont été revus à la hausse. Pour le reste, le gouvernement a adopté une approche strictement néolibérale de la guerre, bien qu’elle soit largement subventionnée par les pays étrangers, qui couvrent désormais près de la moitié du budget total de l’Ukraine.
Il n’y a pas eu de nationalisation généralisée, ni de conscription des travailleurs, ni de rationnement des biens de consommation, comme cela a souvent été le cas dans le passé lors de conflits longs et éprouvants, lorsque les États se transformaient en gigantesques machines de planification de guerre dotées de vastes pouvoirs d’intervention. En Ukraine, le secteur de la défense est passé d’environ 120 000 employés en 2014 à 300 000 aujourd’hui – une augmentation considérable, même si elle n’est pas particulièrement remarquable après une décennie de guerre. Le secteur se compose d’environ cinq cents entreprises, dont cent appartiennent à l’État et représentent environ la moitié de la production totale. Cependant, les entreprises privées occupent souvent le devant de la scène, comme la marque de vêtements militaires M-TAC, qui habille le président Volodymyr Zelensky de son emblématique treillis vert olive.
Entre-temps, et dans le but de rendre l’Ukraine plus attrayante pour les investisseurs internationaux, le gouvernement a poursuivi ses plans de privatisation amorcés en temps de paix et a continué à réduire la bureaucratie – ou du moins a prétendu le faire. Le système fiscal n’a été réformé qu’il y a quelques mois. Pendant près de trois ans d’une guerre largement décrite comme existentielle pour le pays, le système des impôts continue à refléter le paradis fiscal d’avant-guerre. Les économistes de Kiev, comme beaucoup d’autres, affirment que des interventions plus intrusives ne feraient que pousser une plus grande partie de l’économie vers la clandestinité ou à l’étranger, sapant ainsi les efforts de génération de revenus.
Plus qu’une simple application de la fameuse courbe de Laffer, le véritable souci est que, compte tenu des contraintes nationales et surtout internationales actuelles, il se pourrait bien que cette approche de laisser-faire soit la seule option viable. Si l’État augmente trop les impôts, s’il commence à obliger les magasins de luxe à éteindre leurs lumières ou à nationaliser leurs générateurs au nom de l’effort de guerre, les ventes chuteront et les entreprises et leurs clients se délocaliseront tout simplement à l’étranger, privant ainsi l’État de recettes fiscales essentielles. Dans le même temps, les investisseurs étrangers et les partenaires internationaux pourraient critiquer ces mesures en les qualifiant d’autoritaires ou d’anti-marché, ce qui risquerait de nuire aux relations internationales dont dépend la survie de Kiev. Nombreux sont ceux qui partagent cette inquiétude.
Il n’y a pas eu de nationalisation généralisée, ni de conscription des travailleurs, ni de rationnement des biens de consommation, comme cela a souvent été le cas dans le passé.
À l’époque moderne, la guerre a souvent été menée par les pauvres, tandis que les classes supérieures ont toujours trouvé des moyens pour échapper au service militaire. Cependant, ce qui se passe avec la guerre en Ukraine est différent à la fois en termes d’échelle et d’intention. Le système actuel est défendu comme rationnel et volontaire, plutôt que d’être simplement accepté comme un mal inévitable.
La corruption gangrène l’armée et les services d’approvisionnement. Les riches profiteurs de guerre impliqués dans des scandales notoires font l’objet de critiques. Toutefois, les médias et de nombreux Ukrainiens ont tendance à blâmer le gouvernement et l’« héritage soviétique » bien plus souvent que le système actuel.
Des contraintes communes
La Russie reste moins dépendante des réseaux internationaux et est beaucoup plus autoritaire que l’Ukraine, ce qui laisse une plus grande liberté aux dirigeants politiques pour remodeler l’économie et la société. Le sociologue ukrainien Volodymyr Ishchenko a évoqué un « keynésianisme militaire » russe, dans lequel la volonté de l’État de financer la guerre a conduit à une véritable redistribution, en déplaçant les ressources du haut de la société vers le bas, en particulier vers les travailleurs du secteur de la défense et ceux employés dans ce que l’on appelle les « opérations militaires spéciales ».
Pourtant, les différences entre les méthodes de guerre des deux pays sont plus quantitatives que qualitatives. Les brigades russes organisent également des campagnes publicitaires, rivalisent pour obtenir des dons et cherchent à commercialiser leurs actions militaires. C’est une unité militaire privée russe, le groupe Wagner, qui est allée jusqu’à se mutiner contre le gouvernement, brisant brièvement – mais seulement temporairement – le monopole de l’État sur la violence.
Entre-temps, l’économie russe est soigneusement gérée pour rester aussi axée sur la société civile et la consommation que possible. Elvira Nabiullina, gouverneur de la banque centrale russe, et les principaux dirigeants économiques russes répondent de la même manière que les économistes de Kiev lorsqu’ils discutent de la façon de gérer l’économie en temps de guerre. Les élites russes qui prônent une mobilisation totale de la société et la mise en œuvre d’une économie de guerre totale ont été largement mises à l’écart, du moins pour l’instant. Même si Vladimir Poutine présente la guerre comme une lutte existentielle et civilisationnelle contre l’Occident dans sa totalité, les lumières doivent rester allumées dans le Tsum de Moscou, tout comme elles le sont dans son homologue de Kiev.
S’il fallait une preuve supplémentaire, en voici une : la guerre en Ukraine, selon des études préliminaires, est la première depuis un siècle où les soldats d’origine russe sont sous-représentés dans la liste des victimes, alors que les groupes ethniques minoritaires plus pauvres et moins éduqués sont surreprésentés. Si ce conflit est, à bien des égards, plus « russe » que la Seconde Guerre mondiale ou le conflit en Afghanistan, c’est aussi celui où les Russes ethniques, comparativement plus prospères, s’impliquent le moins, proportionnellement. Ou, comme me l’a dit le gardien d’un camp de prisonniers de guerre ukrainien, « Ici, personne ne vient de Moscou ».
La vérité est que la Russie et l’Ukraine opèrent sous des contraintes et des contextes partiellement communs. Qu’il s’agisse des moyens de financer des unités sous-équipées, des efforts pour empêcher les capitaux de fuir le pays ou du pouvoir des sanctions pour bloquer l’exportation de biens quasi-militaires, aucun des participants ne peut échapper complètement à la loi d’airain du capitalisme tardif et de la mondialisation.
Cette guerre, qui a débuté avec l’invasion massive de l’Ukraine par Poutine, constitue une première historique. Il ne s’agit ni d’une opération de contre-insurrection face à une milice rebelle, ni d’un conflit entre des nations pauvres aux institutions fragiles. Il s’agit du premier véritable affrontement de l’ère capitaliste tardive, entre deux léviathans presque semblables.
La dernière fois que nous avons assisté à un conflit d’une telle ampleur, les États impériaux et totalitaires de la première moitié du XXe siècle ont mené des guerres globales qui ont mobilisé des populations entières, amené de nouveaux groupes sur le marché du travail et suscité d’immenses attentes quant au changement du modèle social. Cependant, ces luttes pour la vie ou la mort ont également entraîné des destructions sans précédent, poussant les nations au bord de l’effondrement.
En revanche, les sociétés néolibérales et capitalistes tardives, lorsqu’elles sont confrontées pour la première fois à des nations homologues, font la guerre en s’efforçant de préserver autant que possible leurs structures économiques et sociales civiles. Elles se battent avec un œil sur le champ de bataille et l’autre sur le moral des investisseurs et les marchés de capitaux. Au risque d’être taxé de cynisme, on peut dire que cette approche explique que la guerre, bien que terrible et sanglante, ait été beaucoup plus limitée que d’autres conflits similaires dans le passé.
Notes :
[1] Article de notre partenaire Jacobin, traduit par Alexandra Knez.