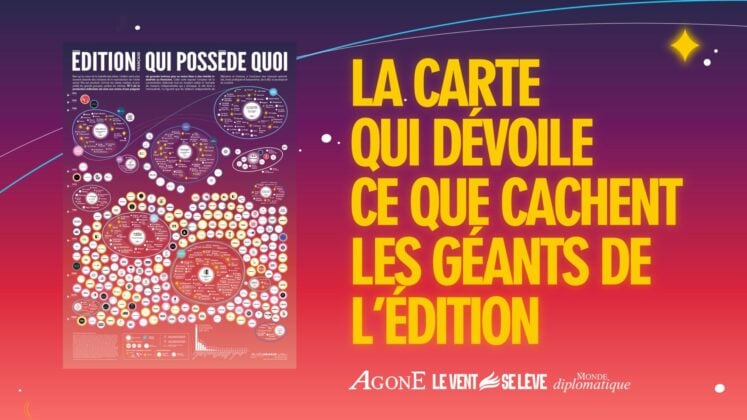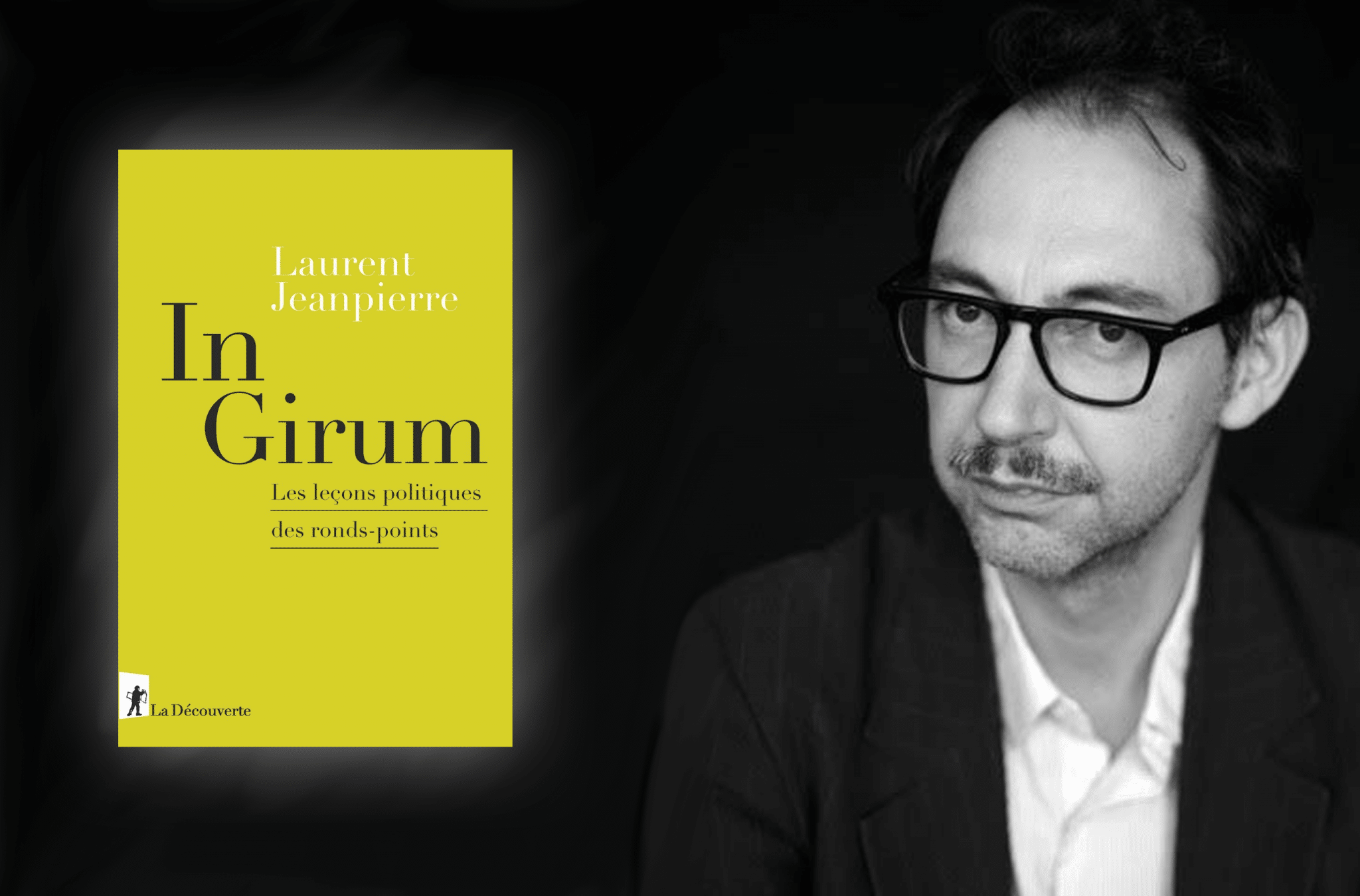Marina Simonin a repris en 2018, avec Clara Laspalas et Alexis Cukier, l’animation des Éditions sociales à la suite de Richard Lagache. Un renouveau générationnel qui marque le début d’un autre chapitre de l’histoire de cette maison désormais presque centenaire. La conjoncture actuelle, caractérisée par un affaiblissement de l’antimarxisme et la demande croissante de repères théoriques de la part d’une jeunesse aussi politisée qu’orpheline de son passé politique, ouvre des perspectives fécondes pour les Éditions sociales. Transmettre, former et faire débattre, telles sont les missions que Marina Simonin attribue à son travail aux Éditions sociales. Un optimisme à la fois intellectuel et organisationnel qui s’illustre à travers la relance d’un ambitieux projet de traduction française de l’intégralité des textes de Marx et Engels et l’élaboration de collections grand public. À rebours de la dynamique du siècle précédent où le marxisme de parti a conditionné la réception du marxisme scientifique, les années qui s’annoncent pourraient bien tracer le chemin inverse. Marx et les marxismes ont tout à y gagner : plutôt que des fétiches obsolètes et démobilisateurs, ce sont désormais des armes critiques et transformatrices qui sont à reconquérir. Entretien réalisé par Laëtitia Riss.
LVSL – Les Éditions sociales ont une longue histoire derrière elles : d’abord liées au parti communiste au cours du XXe siècle, engagées à partir des années 50 dans la publication de nouvelles traductions de Marx et Engels proposées par des universitaires militants, finalement indépendantes depuis 1997 avec néanmoins comme slogan affiché « Make marxisms great again »... pourriez-vous revenir sur cette trajectoire ?
Marina Simonin – L’histoire des Éditions sociales est effectivement assez singulière. La maison, presque centenaire, est fondée en 1927 par le Parti communiste français, à l’origine sous le nom des Éditions sociales internationales. En tant qu’organe éditorial officiel du PCF, la maison produit alors essentiellement des « classiques » du marxisme ou des brochures militantes, contrôlés d’assez près par l’Internationale communiste. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Éditions sociales internationales sont interdites mais maintiennent une partie de leur activité clandestinement. À l’issue de la guerre, elles sont renommées Éditions sociales et connaissent une période assez faste – augmentation du nombre de titres et des tirages – dans un contexte de politisation de l’édition.
Dans les années 1970 Lucien Sève, philosophe communiste, prend la direction éditoriale et cherche à transformer les Éditions sociales en « vraie » maison d’édition. Il faut imaginer qu’avant ce tournant important, les Éditions sociales étaient encore pleinement dépendantes du PCF : la direction du parti disposait d’un droit de regard sur ce qui était publié, ce qui donnait parfois lieu à des conflits avec les éditeurs. Je renvoie celles et ceux que cette période intéresse aux deux livres de référence sur le sujet1. En 1982, un coup d’arrêt est porté à l’ouverture avec le départ de Lucien Sève, entraînant celui de Richard Lagache et de Nicole Chiaverini qui s’étaient engagés avec lui dans cette bataille.
Pendant les années 1980, le Groupe Messidor, auquel appartiennent les Éditions sociales, connaît une série de crises, avant de faire définitivement faillite en 1993. Quelques années plus tard, une petite équipe, composée d’anciens des Éditions sociales (auteurs, salariés, etc.), animée par Chantal Gazzola, Alain Debernard, Richard Lagache et Lucien Sève, crée La Dispute et fait renaître les Éditions sociales en décidant de racheter le fonds ainsi que la marque des Éditions sociales au liquidateur judiciaire. Tout cela se passe en pleine tempête politique à la direction du PCF, contre laquelle il faut résister pour sortir les Éditions sociales de son emprise, et, surtout, dans une conjoncture idéologique particulièrement difficile pour l’édition marxienne et marxiste – c’est encore le cauchemar des années 1980, des discours triomphalistes sur la « mort de Marx ». Mais Richard Lagache, Lucien Sève et les autres tiennent tête : le fonds des Éditions sociales, qui représente à ce moment-là près d’une centaine de titres, peut continuer à vivre. Rien n’est encore gagné et les Éditions sociales ne publieront aucune nouveauté pendant presque dix ans, mais la bataille pour la sauvegarde de la maison a été menée.
C’est en 2006 que les nouvelles Éditions sociales publient leur première nouveauté : La critique du programme de Gotha, dans une traduction de Sonia Dayan-Herzbrun et dans une édition établie avec Jean-Numa Ducange. Le projet d’une grande édition des textes de Marx et Engels en français est également lancé : la GEME, dirigé par Isabelle Garo, philosophe et spécialiste de Marx. Jusqu’en 2014, les Éditions sociales conservent un rythme éditorial modéré (un à deux titres par an). Il faut attendre les années qui suivent pour que ce dernier s’accélère. Depuis 2019, nous avons, je crois, trouvé notre rythme, autour d’une douzaine de titres par an. Ce renouveau éditorial est soutenu par le renouvellement de l’équipe : depuis quelques années Richard Lagache a laissé sa place à deux nouvelles éditrices, Clara Laspalas et moi-même, qui dirigeons au quotidien l’ensemble de nos activités éditoriales et commerciales, en lien avec Alexis Cukier, avec qui nous animons aussi les éditions La Dispute.
Nous travaillons également avec un bureau éditorial, composé d’une quinzaine de membres avec qui nous élaborons notre programmation éditoriale et nos différentes collections. Ce cadre collectif joue un rôle très précieux dans l’animation et le renouveau de la maison. Nous y avons la chance de faire travailler ensemble différentes disciplines et différents horizons politiques, ce qui est suffisamment rare pour être souligné ! Cette volonté de travailler sans exclusive théorique ou politique était, au départ, la préoccupation de Richard Lagache lorsqu’il a relancé les éditions. Aujourd’hui, cette conception continue d’infuser notre pratique éditoriale. On y tient beaucoup et je crois que c’est une condition sine qua non pour parvenir à reconstruire, à notre échelle – c’est-à-dire à l’échelle éditoriale – un espace de débats autour de Marx, des « mille » marxismes et des différentes traditions du mouvement ouvrier. Et si, pour l’instant, tous les auteurs et autrices marxistes ne sont pas représentées au catalogue des Éditions sociales, c’est un souhait de les y faire entrer. C’est le sens de notre formule, légèrement provocatrice, Make marxisms great again… (le s est important !).
« Cette volonté de travailler sans exclusive théorique ou politique est une condition sine qua non pour participer à reconstruire un espace de débats autour de Marx, des « mille » marxismes et des différentes traditions du mouvement ouvrier. »
Un dernier mot, sur le rapport que les nouvelles Éditions sociales entretiennent avec leur passé. Je crois qu’il n’y a aucune contradiction à revendiquer notre indépendance économique et notre autonomie éditoriale actuelles tout en assumant de façon décomplexée notre histoire. Les Éditions sociales ont fait partie de ces éditeurs politiques qui ont marqué le XXe siècle – aux côtés de Maspero, bien sûr, mais aussi d’autres projets comme les éditions Anthropos. C’est d’abord une richesse et une fierté. D’ailleurs, je suis sûre que toute lectrice ou lecteur qui a déjà entendu parler de Marx ou du marxisme (toutes tendances confondues !) peut se reporter à sa bibliothèque pour constater que les Éditions sociales sont présentes dans ses rayons.
Et si tous les titres du vieux fonds n’ont pas le même intérêt aujourd’hui, beaucoup ont néanmoins marqué les débats marxistes ou les sciences humaines – qu’on pense à Michèle Bertrand, Solange Mercier-Josa, Henri Lefebvre, Lucien Sève, Albert Soboul, André Tosel, et bien d’autres. Parmi ces derniers, nombreux mériteraient d’être réédités, d’une façon ou d’une autre. C’est une réflexion que nous avons entamée et nous allons par exemple permettre au texte de Maurice Godelier, Sur les sociétés précapitalistes, publié pour la première fois dans les années 1970 avec le CERM (Centre d’études et de recherches marxistes) de reparaître en 2022 dans une édition augmentée. J’espère que nous pourrons rapidement accélérer ce travail de réédition.
L’indépendance éditoriale est aussi à ce prix : aucune mécène n’a la main sur nos éditions, le capital est entièrement réparti entre les gens qui ont créé cette maison mais notre capacité de financement est encore bridée par nos résultats. C’est une question que nous comptons aborder dans les prochaines années, tout en conservant la même conception rigoureuse de notre indépendance économique. Quant à l’autonomie, qui est essentiellement éditoriale, elle ne consiste pas seulement à refuser la loi d’une puissance extérieure, mais avant tout à construire notre propre ligne éditoriale, à la partager et à la faire vivre avec l’ensemble des personnes qui contribuent à notre maison.
LVSL – Le projet éditorial des Éditions sociales s’incarne aujourd’hui à travers plusieurs collections : « Les essentielles », « Les propédeutiques », « Les éclairées », « Les irrégulières », etc. Ces dernières semblent s’adresser à un public qui n’est pas nécessairement familier du corpus idéologique défendu par les Éditions sociales. Est-ce une manière de perpétuer les objectifs d’éducation populaire que se fixait le Parti communiste et de répondre au regain actuel de curiosité envers le marxisme ?
M. S. – On assiste depuis 2008 à un certain « retour de Marx », constaté empiriquement par une augmentation des ventes sur les livres de Marx (et pas seulement sur les ventes du Capital). Mais cela est également perceptible, je crois, à travers le fait que les idées marxistes suscitent à nouveau un intérêt chez une partie, certes encore minoritaire, des jeunes générations, que ce soit dans le milieu universitaire ou militant. Évidemment, c’est une opportunité pour les Éditions sociales et nous avons tout à gagner à nous montrer sensible à cette plus grande disponibilité idéologique. Du point de vue de notre ligne éditoriale, je résumerais nos orientations comme telles : transmettre, former, faire débattre. Ces trois lignes directionnelles sont déclinées à travers nos collections mais aussi à travers différents types de livres qui structurent notre catalogue.
Transmettre. Je pense qu’avant même de transmettre des idées, ce qu’on transmet, en tant qu’éditeur, ce sont des textes. Les textes qu’on veut diffuser, ce sont d’abord ceux de Marx, mais aussi ceux d’Engels. Deux collections accueillent leurs ouvrages aux Éditions Sociales : la GEME, lorsqu’il s’agit de nouvelles traductions, et « Les Essentielles », une collection animée avec Alexandre Féron et Victor Béguin, qui republient des classiques ou des textes importants (Grundrisse, La Sainte famille ou encore L’Idéologie allemande et la correspondance). Mais, comme je le disais un peu plus tôt, il y a, au-delà de Marx et Engels, de nombreux textes qui ont marqué l’histoire du débat marxiste tout au long des XIXe et XXe siècles et qu’il serait utile de rendre à nouveau disponibles. Notre collection « Essentielles » sert également à cela. Je crois que cette entreprise de transmission est fondamentale pour rouvrir certains débats plus contemporains mais aussi plus directement politiques. Je pense par exemple à notre livre récent Sur la Commune de Paris. Textes et controverses. Ce recueil propose une large sélection de textes de Marx et Engels sur la révolution parisienne, donnant à lire leurs principales élaborations sur la question, et il est assorti d’un inédit de Stathis Kouvélakis, « Évènement et stratégie révolutionnaire », dans lequel il rouvre le débat sur des questions stratégiques aussi brûlantes que celles du rapport à l’État ou au pouvoir. Cette forme éditoriale montre qu’il serait erroné d’opposer la lecture serrée et rigoureuse des textes de Marx et Engels et la reprise de certaines controverses politiques. Leur conciliation peut au contraire donner lieu à un travail fécond tant d’un point de vue conceptuel que militant. Elle nous a semblé particulièrement pertinente, si bien que nous nous apprêtons à renouveler l’exercice à travers un recueil de textes de Marx autour de la question du parti révolutionnaire, dirigé par Jean Quétier qui a récemment soutenu sa thèse sur le sujet.
Enfin, nous travaillons à renouveler une tradition importante des Éditions Sociales : la publication d’ouvrages d’histoire issus des recherches les plus fines. Nous avons d’ailleurs au catalogue de nombreux textes en particulier sur la Révolution française. Nous ne sommes pas encore au bout de nos réflexions mais je ne doute pas que cette collection « Histoire », animée avec Alexia Blin et Antony Burlaud, sera le lieu de prochaines publications importantes.
« Avant même de transmettre des idées, ce qu’on transmet, en tant qu’éditeur, ce sont des textes. »
Former. En 2020, nous avons relancé notre série de « Découvrir », qui participent, avec les « Pour lire » à notre collection « Les Propédeutiques », une collection de pédagogie animée avec Antony Burlaud, Guillaume Fondu et Quentin Fondu. Ce qui singularise cette collection et ce qui distingue nos titres d’autres « introductions », c’est d’abord notre priorité accordée au texte, puisque les livres sont organisés autour d’extraits commentés et remis dans leur contexte, mais également notre effort pour trouver un point d’équilibre entre l’académique et le politique. On approche aujourd’hui la dizaine de titres dans cette série (Marx, Engels, Gramsci, Luxemburg, La Commune de Paris, mais aussi Bourdieu, Beauvoir, Weber), et l’idée est d’atteindre la cinquantaine de livres d’ici quelques années, en élargissant le corpus à des auteurs ou à des événements qui sortent du corpus marxien classique. En ce moment, on travaille sur des Découvrir Hugo, Découvrir le programme du CNR, Découvrir Fanon, Découvrir Durkheim, Découvrir Trotsky, pour n’en citer que quelques-uns – mais nous avons d’ores et déjà de nombreux projets pour la suite ! Derrière ces petits livres, il y a un choix éditorial simple mais fort. On voit déjà que la formule convainc lecteurs et lectrices mais aussi libraires. Je ne sais pas si ce qu’on fait s’apparente à de l’éducation populaire, personnellement ce n’est pas un terme que j’emploie spontanément. Mais l’intention générale reste sensiblement la même : remettre à disposition des jeunes ou des étudiants, et plus largement d’un public non-savant, des ouvrages de découverte, une histoire et des outils théoriques dont on constate tous les jours qu’ils ont été oubliés ou sous-estimés ou réservés aux universitaires – et ce d’autant plus que les organisations qui assuraient dans le passé ce travail de formation ne sont aujourd’hui plus en état de le faire.
Faire débattre. C’est cohérent avec le fait de ne trancher a priori pour aucune des interprétations de Marx et des marxismes, mais surtout, cela encourage à se confronter à des problématiques théoriques et politiques contemporaines. Deux collections charpentent ce travail aux Éditions Sociales : « Les Éclairées » et « Les Irrégulières ». La première, animée avec Yohann Douet, Vincent Heimendinger et Marion Leclair, a déjà publié plusieurs contributions majeures à la recherche marxienne contemporaine. Je pense au projet de biographie monumentale sur Marx entrepris par Michaël Heinrich dont le premier tome, consacré aux années de première jeunesse de Marx jusqu’à la soutenance de sa thèse de philosophie en 1841 (qu’on connaissait peu !), est paru en 2020 ; ou au commentaire systématique du livre 1 du Capital réalisé par Ludovic Hetzel, qui constitue un instrument de premier ordre pour tout lecteur de Marx mais aussi pour les enseignants de terminales et de l’université.
D’autres projets sont en cours qui permettront de travailler des thématiques plus directement politiques. On prépare par exemple un livre de synthèse sur l’écomarxisme dirigé par un jeune chercheur, Timothée Haug, mais également une étude sur le rapport de Marx à la question féministe par Saliha Boussedra ou encore à une contribution sur la question de la planification par Guillaume Fondu. La collection a aussi pour vocation d’accueillir des ouvrages importants qui n’ont jamais été traduits en français, comme le livre de Lise Vogel, Marxisme et oppression des femmes, dont la traduction sera enfin disponible début 2023, celui de Raymond Williams, Marxisme et littérature, ou encore un recueil de textes d’Herbert Marcuse, pour la plupart inédits en français, sous le titre Marxisme et révolution.
« Les Irrégulières », enfin, dont l’ambition est sans doute plus modeste mais aussi plus spécifique, publient des petits livres, dont le principe est simple : il s’agit de mettre par écrit des conférences qui sont données et au cours desquelles les auteurs développent leur lecture et/ou leur rapport à Marx, donnant du même coup une idée du paysage marxien et marxiste actuel. Nous travaillons de façon privilégiée avec le séminaire « Lectures de Marx » de l’École Normale Supérieure – mais nous sommes volontaires pour explorer et engager le dialogue avec d’autres séminaires ! – et avons déjà publié plusieurs ouvrages : Ce que j’entends par marxisme, d’Alain Badiou, Travail vivant contre Capital, de Toni Negri, Deux lectures du Jeune Marx, de Judith Butler…
LVSL – Vous avez mentionné la Grande Éditions Marx Engels (GEME), qui est une entreprise très ambitieuse, dans la mesure où l’œuvre de Marx et Engels comporte une somme vertigineuse de textes. Par-delà la dimension volumineuse, se posent aussi des problèmes de traductions, qui ont souvent fait l’objet de querelles politiques. Comment les Éditions sociales comptent-elles relever ces deux défis ?
M. S. – La GEME – Grande édition Marx-Engels –, c’est en effet un projet éditorial monumental. L’objectif est de parvenir à une édition complète et scientifique en français de la totalité de l’œuvre de Marx et d’Engels, en travaillant à partir de l’édition des œuvres complètes de Marx en allemand, appelée la MEGA (Marx-Engels-Gesamtausgabe). Comme je le précisais, c’est autour de cette ambition que les Éditions se relancent en 2006 ; on peut dire que la GEME constitue d’une certaine manière notre colonne vertébrale. Pour comprendre la démesure d’un tel projet, il faut rappeler qu’il n’existe pas et qu’il n’a jamais existé d’édition complète des œuvres de Marx et Engels en français, et que les embûches sur cette voie sont énormes. D’une part, car leur œuvre est vaste et très hétérogène : ils ont publié des livres, ils ont écrit dans de très nombreux journaux, ils ont échangé une vaste correspondance, qui est très riche pour comprendre le cheminement de leur pensée, sans parler de la masse de brouillons, de manuscrits jamais publiés ou qui sont restés inachevés et dont l’importance n’a jamais été démentie depuis la publication de L’Idéologie allemande dans la première MEGA en 1932… D’autre part, car nous sommes tributaires de l’avancée de l’édition des textes en langue originale d’écriture dans la MEGA 2.
La traduction et l’édition des textes de Marx sont également restées très longtemps surdéterminées par des enjeux politiques, que ce soit dans l’établissement des priorités d’édition, dans les choix de traduction ou, surtout, dans l’élaboration des appareils de notes ou des introductions qui accompagnent le texte lui-même. De ce point de vue, les problèmes ne sont pas toujours là où on pourrait les imaginer : ainsi, par exemple, les textes de Marx établis par Maximilien Rubel pour la prestigieuse collection de « La Pléiade » sont quasiment inutilisables tant les choix qui ont été faits par ce dernier répondent à un agenda particulier. Maximilien Rubel aspirait à faire une édition « non marxiste » de Marx et cela l’a amené à procéder à des réaménagements des textes de Marx qui ne sont pas explicités. À l’inverse, les Éditions sociales ont toujours fait l’effort de proposer des éditions fiables des textes de Marx : dès les années 1950, avec les traductions d’Emile Bottigelli, encore utilisables aujourd’hui, puis, à partir des années 1970, avec de nouvelles traductions importantes comme celles dirigées par Gilbert Badia (Le livre 3 du Capital, L’Idéologie allemande, 12 tomes de la correspondance, avec Jean Mortier) ou Jean-Pierre Lefebvre (Les Grundrisse, et la traduction de la quatrième et dernière édition allemande du livre 1 du Capital dont on peut dire qu’elle ouvre la voie à une traduction moderne de ce texte essentiel).
« On ne le dira jamais assez : lorsqu’il s’agit de Marx et d’Engels, c’est primordial de regarder d’où viennent les traductions que nous avons entre les mains, et de soutenir celles et ceux qui prennent en charge ce travail et les investissements conséquents qu’il réclame. »
La GEME, c’est donc un projet global, et heureusement, nous ne travaillons pas seuls ! La MEGA joue de ce point de vue un rôle structurant à l’échelle internationale. Elle aussi a une longue histoire : le projet est lancé une première fois par David Riazanov dans les années 1920, avant d’être avorté lorsque ce dernier est démis de ses fonctions par le Parti communiste de Staline, puis assassiné. Il faut attendre la fin des années 1960 pour que la MEGA 2 soit relancée. L’ensemble des traductions ou des retraductions que nous publions dans le cadre de la GEME sont donc basées sur les textes originaux nouvellement établis par la MEGA. Les traducteurs et traductrices de nos ouvrages travaillent collectivement sur les textes et réfléchissent, en lien avec l’éditeur, à fournir les outils nécessaires pour faciliter la lecture. Autrement dit, la GEME c’est aussi la création d’un appareil critique d’ensemble, d’une bibliographie, d’un lexique, d’un index qu’il nous faudra mettre sur pied dans les prochaines années, et un souci constant d’information sur la vie des textes de Marx et d’Engels.
Pour mener à bien la GEME, nous sommes également liés à l’association du même nom, dont les activités sont encadrées par Alix Bouffard, Alexia Blin, Jean-Numa Ducange, Quentin Fondu, Isabelle Garo et Jean Quétier, qui font un travail remarquable. L’association, qui est soutenue par la Fondation Gabriel Péri – et que vous pouvez encourager ici ! –, permet de regrouper plus largement, d’organiser le travail éditorial en lien avec la maison, d’animer des séminaires autour des travaux de traduction en cours et de faire connaître au public ces publications. À ce jour, la GEME a publié neuf ouvrages, dont plusieurs textes importants comme la Critique du programme de Gotha, la Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, ou la Contribution à la critique de l’économie politique. Certains sont disponibles pour la première fois en français : c’est le cas notamment des Annales franco-allemandes, qui vient de paraître en 2020. Il s’agit d’un projet de revue initié par Marx et Arnold Ruge lors de leur arrivée à Paris en 1843, qui occupe une place décisive dans la trajectoire marxienne, et qui regroupe, outre les contributions de Marx (Sur la question juive, Introduction dite de 44) et d’Engels (Esquisse d’une critique de l’économie politique) des contributions de Heinrich Heine ou Moses Hess.
Parmi les chantiers en cours, on peut mentionner l’édition des articles rédigés par Marx et Engels pour le New York Daily Tribune – pas moins de 500 articles rédigés entre 1851 et 1862 dont une première partie paraîtra à la fin de l’année 2022 grâce au travail d’Alexia Blin, Yohann Douet, Juliette Farjat, Alexandre Feron et Marion Leclair. Certains de ces articles sont bien connus, comme « Révolution et contre-révolution en Allemagne » par exemple, mais beaucoup sont restés confidentiels où sont tout simplement inédits en français. Or, on se situe au lendemain de l’échec des révolutions de 1848 et en pleine préparation des travaux économiques du Capital ; c’est dire combien le moment est passionnant. Nous préparons également une nouvelle édition du Livre II du Capital, dont la traduction est établie par Alix Bouffard, d’Alexandre Feron et de Guillaume Fondu et qui devrait sortir tout début 2023, puis du Livre III.
J’espère que ce tour d’horizon permettra à celles et ceux qui nous lisent de mesurer les enjeux d’un tel projet. On ne le dira jamais assez : c’est primordial de regarder d’où viennent les traductions des textes que nous avons entre les mains, mais aussi de soutenir celles et ceux qui prennent en charge ce travail et les investissements conséquents qu’il réclame.
LVSL – Parmi vos récentes publications, deux ouvrages sont dédiés à Gramsci (Découvrir Gramsci en 2020, « Une nouvelle conception du monde » – Gramsci et le marxisme en 2021). La grammaire gramscienne est pourtant déjà sur toutes les lèvres : hégémonie, bataille culturelle, guerre de position, bloc historique… Quels éclairages souhaitiez-vous apporter avec ces deux textes ?
M. S. – Comme souvent, lorsqu’un auteur marxiste est repris par la mode, cela a des bons et des mauvais côtés. Cela redonne une certaine attractivité à des penseurs qui ont été oubliés. Ce n’est d’ailleurs pas anodin que Gramsci revienne sur le devant de la scène dans un contexte de crise. Cependant, cela réduit leur tranchant voire transforme leur pensée en quelque chose qui peut être récupéré à moindre frais pour servir n’importe quels objectifs. Le cas de Gramsci est en ce sens paroxystique : son nom est repris aussi bien par la gauche radicale que par l’extrême droite, ce qui est quand même un comble lorsqu’on connait l’histoire de Gramsci, emprisonné dans les geôles fascistes. Dans ce contexte, Découvrir Gramsci de Florian Gulli et Jean Quétier a l’avantage d’offrir un cadre conceptuel fiable et pédagogique pour celles et ceux qui s’intéressent à Gramsci. Il était urgent d’avoir ce type d’introduction qui n’existait pas jusqu’à présent ; d’autant plus que Gramsci est un auteur dont l’œuvre est imposante et qu’il n’est pas aisé de savoir par où commencer.
L’autre livre que vous mentionnez, « Une nouvelle conception du monde ». Gramsci et le marxisme, répond à d’autres types d’enjeux. C’est un livre collectif, qui propose les contributions de certains principaux chercheurs et chercheuses contemporaines sur Gramsci à l’international, et qui fait le point sur l’avancée de la recherche. On revisite une série de notions clés chez Gramsci : l’hégémonie, la crise organique, le bloc historique… Elles sont ainsi réétudiées dans leur contexte et rendues à toute leur complexité, contre les simplifications auxquelles on nous sommes habitués aujourd’hui. C’est aussi un livre qui avance une hypothèse : dans son introduction, Yohann Douet, jeune spécialiste de la pensée gramscienne, propose d’ancrer Gramsci au sein de la tradition marxiste, contre les interprétations qui cherchent à le présenter comme aspirant à un dépassement du marxisme, à l’instar par exemple des lectures d’Ernesto Laclau et Chantal Mouffe. Il revient notamment sur le rapport qu’a entretenu le révolutionnaire italien avec le marxisme de la Deuxième et de la Troisième internationales mais aussi sur les apports singuliers sa « philosophie de la praxis ».
« Cette resignification de la pensée de Gramsci comme partie prenante du marxisme permet d’appréhender plus rigoureusement certaines notions gramsciennes. »
Cette resignification de la pensée de Gramsci comme partie prenante du marxisme permet du même coup d’appréhender plus rigoureusement certaines de ses notions. Par exemple, la notion d’hégémonie, y compris à gauche, est souvent ramenée à sa dimension exclusivement culturelle. C’est le fameux : « Moi, je suis dans la bataille des idées, comme a dit Gramsci. » Yohann Douet démontre au contraire qu’il s’agit d’une lecture superficielle et biaisée, qui n’est pas sans conséquences politiques. L’idée n’est bien sûr pas d’interdire d’employer les concepts de Gramsci ou de s’en inspirer. Mais un concept n’est pas une fleur que l’on cueille dans un jardin et que l’on place dans un vase. Un concept ne vit que dans un mouvement et dans des relations avec d’autres concepts.
LVSL – Lors de notre premier entretien avec Nicolas Vieillescazes, directeur éditorial des Éditions Amsterdam, nous évoquions la jonction entre marxisme intellectuel et marxisme politique et la possible reconstruction contemporaine d’une « culture marxiste ». Quel rôle pourrait jouer les Éditions sociales dans cette conjoncture ?
M. S. – Je précise que je parle ici en mon nom, dans la mesure où les autres membres des Éditions Sociales envisageraient peut-être les choses différemment. Je dirais qu’il y a trois éléments à prendre en compte pour comprendre où nous en sommes et ce qu’il est possible de faire aujourd’hui. Tout d’abord, nous commençons seulement à sortir d’une période très forte d’antimarxisme. À l’échelle internationale, c’était déjà le cas depuis plusieurs années mais en France, l’antimarxisme était d’autant plus virulent que son influence au XXe siècle était conditionnée par des organisations politiques, notamment par le stalinisme, dont on sait le rôle qu’il a joué dans l’imposition d’une doxa orthodoxe mortifère d’un point de vue théorique et politique. Lorsque ces organisations sont entrées en crise, le marxisme a souffert de sa faible implantation à l’Université et s’est retrouvé d’autant plus acculé que les organisations qui l’avaient porté pendant des décennies se sont vues largement discréditées.
Aujourd’hui, je crois que nous avons une occasion à saisir car cet antimarxisme est en train de se fissurer : c’est à nouveau possible de se dire marxiste, pas forcément à l’Université (même si là aussi, on voit fleurir à nouveau des initiatives intéressantes dans plusieurs endroits) mais dans nos milieux militants. Si ce retour de la référence marxiste dans le champ politique reste timide, il faut prendre la mesure de notre situation : nous sommes face depuis déjà plusieurs années à une crise rampante, une crise de l’hégémonie néolibérale, et, plus récemment, on constate un nouveau cycle de luttes des classes, en France mais aussi à l’international. Il me semble qu’on ne peut pas comprendre le regain d’intérêt pour le marxisme, ni dialoguer avec, si on ne comprend pas cette nouvelle situation. D’une certaine manière, la pandémie aussi a joué dans ce sens : les métiers invisibilisés ont occupé le devant de la scène, un sentiment de classe recommence à infuser, et on voit que les gens cherchent les moyens d’imaginer un « monde de demain » différent de cette réalité capitaliste que Marx critiquait déjà. Tout cela me semble décisif pour comprendre où nous en sommes du côté du « marxisme politique ».
Deuxièmement, le centre de gravité du « marxisme intellectuel » à l’international s’est déplacé vers les pays anglophones – pays qui sont pourtant restés longtemps hostiles au marxisme. À partir des années 1960, la situation se retourne tendanciellement et, depuis une vingtaine d’années, il est devenu impossible d’ignorer la vitalité du marxisme anglophone – anglo-saxon et étasunien – qui est aujourd’hui largement hégémonique. Il faut saluer le rôle structurant joué par des initiatives comme Historical Materialism, qui organise un véritable espace de débat et de diffusion à l’international, à travers ses revues, ses colloques et ses collections de livres. Cet ancrage universitaire ou para-universitaire favorise un certain dynamisme et permet une légitimité académique, qui tranche beaucoup par rapport au champ académique français. Cela implique pour nous, éditeurs français, de ne pas nous cantonner à un travail franco-centré mais de chercher au contraire à se tenir informés de ce qui se fait et d’introduire de nouveaux thèmes ou auteurs et autrices. Beaucoup de textes ont été publiées sur des questions très stimulantes comme le féminisme ou l’écologie, mais également à propos de passionnants débats historiques – la social-démocratie de la fin du XIXème et du début XXe et sur son héritage au sein du mouvement ouvrier, pour ne donner qu’un exemple.
« Faire émerger à nouveau quelque chose comme une “culture théorique et politique marxiste” au XXIe siècle, ne pourra se faire qu’à plusieurs, et chacun sur sa partition propre. »
Troisième constat : cette nouvelle configuration du marxisme international est contradictoire. Nous sommes face à un marxisme qui est, pour reprendre les mots de Stathis Kouvélakis, « théoriquement productif mais politiquement impuissant ». D’une certaine manière, cela approfondit le constat que faisait déjà Perry Anderson à propos du marxisme occidental dans les années 1970 et de la rupture entre la théorie et la pratique. Concrètement, on a parfois l’impression de deux mondes qui ne se parlent pas : d’un côté, les références théoriques savantes et sophistiquées mais déconnectées de toute pratique politique, de l’autre une pratique dictée par un agenda politique qui peine à s’articuler à un travail théorique soutenu. Or, ce rapport de la théorie à la pratique est constitutif même de la démarche marxienne et du marxisme. En France, la situation est plus critique encore parce qu’on ne peut pas encore parler d’une véritable dynamique théorique et que le renouvellement générationnel des auteurs et autrices marxistes n’est pas encore assuré. Néanmoins, nous avons mentionné précédemment la plus grande disponibilité idéologique et la recherche d’outils théoriques, non seulement pour interpréter le monde mais aussi pour le changer, qui pourrait ouvrir d’autres perspectives. Il s’agit bien d’opérer à nouveau une certaine jonction entre des enjeux théoriques et des préoccupations politico-militantes. Je dois dire que je suis plutôt optimiste, même si les obstacles existent.
Pour répondre plus explicitement à la question initiale : je pense que nous avons un rôle à jouer pour participer à (re)construire un espace de débat marxiste en France. Toutefois, faire émerger à nouveau quelque chose comme une « culture théorique et politique marxiste » au XXIe siècle, ce n’est pas un travail que nous pouvons faire seuls. Cela ne peut même se faire qu’à plusieurs, et chacun sur sa partition propre. Notre tâche d’éditeur est de publier des auteurs marxiens ou marxistes sans exclusive théorique ni politique, comme je le disais, et de confronter le marxisme à des problématiques et questions contemporaines : la question féministe, la reproduction sociale, l’anti-impérialisme, le rôle structurant joué par le racisme dans le développement capitaliste, la question écologique, le travail, etc.
Par ailleurs, il ne suffit pas de publier des livres, encore faut-il savoir les défendre. Nous avons du travail devant nous pour rendre à nouveau le marxisme attractif – j’ai même envie de dire : sexy ! – et pour le débarrasser de son image poussiéreuse. C’est une des raisons qui nous a poussés à retravailler presque intégralement les maquettes des couvertures de nos différentes collections, grâce notamment au travail de Clara Laspalas, mais, plus généralement, c’est qui nous motive à explorer différents modes de communication autour de nos livres. Nous sommes par exemple en train de relancer notre chaîne de podcasts, « Les Émissions sociales », comme un moyen de faire vivre nos titres et de les discuter.
Au-delà de ces questions de forme – qui sont importantes – je crois que notre travail en tant qu’éditeur marxiste ne consiste pas à publier Marx pour rendre disponible un héritage comme on conserverait des antiquités précieuses dans un musée. Notre rôle, tel que je me le figure, est de faire vivre au présent ce qui fait la vitalité des interprétations qui ont été celles de Marx et qui ont marqué de façon décisive l’ensemble des courants du mouvement ouvrier. Il faut être capable de démontrer l’actualité du marxisme pour le XXIe siècle. Et ce n’est pas seulement en raison de l’actualité des thèmes qu’elle aborde que l’on n’en finit pas de se confronter à la théorie de Marx, mais, plus fondamentalement, parce que Marx est devenu une « clé d’interprétation », selon une expression de Michael Heinrich dans sa biographie de Marx, pour comprendre le développement de la société moderne et les évolutions politiques et intellectuelles. D’ailleurs, les « nouvelles pensées critiques » ne cessent d’entretenir un rapport (qu’il soit ou non conflictuel) avec le marxisme, démontrant une fois de plus sa centralité, comme l’a très bien souligné Razmig Keucheyan.
Ce n’est pas inintéressant d’essayer de se représenter celles et ceux qui participent de ce même combat pour refaire du marxisme une référence pertinente et partagée. Je pense à d’autres éditeurs (Agone, Amsterdam, La Dispute, La fabrique, Syllepse) ou à des initiatives éditoriales plus jeunes et modestes comme les éditions Communard.e.s auxquelles je participe, mais aussi aux libraires, qui font un travail précieux et nécessaire pour défendre nos livres, alors que ce n’est pas toujours facile au regard des contraintes qui pèsent sur eux. Les initiatives para-universitaires qui structurent des cadres d’échanges et de discussions autour de Marx, des marxismes ou de l’histoire du mouvement ouvrier ont aussi leur part à prendre ; de même que les médias et revues qui contribuent à la production théorique et politique – Actuel Marx, Cause commune, Contretemps, La Pensée, Mouvement ouvrier, luttes de classes et révolution, Révolution Permanente, pour n’en citer que quelques-uns parmi d’autres. Derniers sur la liste, Hors-série qui lancera prochainement une émission autour de Marx et Spectre qui accueille plusieurs podcasts sur ces mêmes thématiques. Si je prends le temps de nommer tout le monde, c’est parce que cela me semble essentiel d’identifier quelque chose comme un pré-champ en (re)construction. Tous ces acteurs existent et nouent des liens avec les réseaux et organisations politico-militants, qui œuvrent sur un plan distinct et différent mais absolument décisif et à mon sens complémentaire.
Il y a donc des interlocuteurs ! Je crois d’ailleurs que nous gagnerions à aller plus en avant dans le travail collectif, par exemple en élaborant un agenda commun qui pourrait prendre la forme d’une journée marxienne et marxiste annuelle, regrouper différents acteurs, réseaux, et horizons. Ce n’est certainement pas la première fois qu’une telle initiative verrait le jour, mais j’ai le sentiment qu’aujourd’hui les forces sont plus nombreuses et mieux structurées.
LVSL – Au sujet de l’actualité du marxisme à l’étranger, vous avez récemment publié Pour un marxisme sociologique d’Erik Olin Wright et de Michael Burawoy. Une approche moins connue en Europe, qui doit davantage à Max Weber et Émile Durkheim qu’à Friedrich Hegel et Auguste Comte. En quoi pourrait-elle être féconde pour « reconstruire » le marxisme comme l’écrivent ces deux auteurs ?
M. S. – La spécificité de la proposition d’Erik Olin Wright et de Michael Burawoy est qu’elle recoupe à la fois un programme de recherche pour des sciences sociales émancipatrices et une proposition politique forte. Ils défendent un rapport au marxisme qui ne soit pas seulement entretenu sur le mode de l’éclectisme : il ne s’agit pas de prendre un peu du marxisme comme on prend un peu du reste. Au contraire, il convient selon eux de réassumer le marxisme dans son intégralité mais dans une version analytique, non dogmatique et qui cherche à élaborer des « utopies réelles ».
C’est une approche en effet encore peu travaillée en France, même si quelques textes d’Erik Olin Wright ont récemment été traduits. Dans l’ouvrage que nous publions, établi en lien avec le séminaire « Lectures de Marx » à École Normale Supérieure, la conférence donnée par Michael Burawoy est intéressante du point de vue de l’histoire des idées, car elle permet d’identifier « trois vagues du marxisme » et d’ouvrir ce dernier à son devenir actuel. La troisième vague, qui s’est constituée en 1973 pour Michael Burawoy, afflue toujours et se caractérise par la contradiction croissante au sein du capitalisme entre l’impératif de production et l’impératif environnemental. Comment affronter cette dernière, c’est l’objet du marxisme sociologique, qui cherche dans le « déjà-là » toutes les alternatives qui empêchent de courir à la catastrophe.
Quant à savoir si cette proposition pourrait permettre de « reconstruire » le marxisme : je répondrais en disant qu’être éditeur ce n’est pas publier des auteurs et autrices avec lesquels il s’agit d’être forcément d’accord, mais alimenter un débat qui ne peut se passer de l’apport de chacun de nos livres.
[1] Le Parti communiste français et le livre. Écrire et diffuser le politique en France au XXe siècle, dirigé par Jean-Numa Ducange, Julien Hage et Jean-Yves Mollier, et Lire en communiste, de Marie Cécile Bouju.