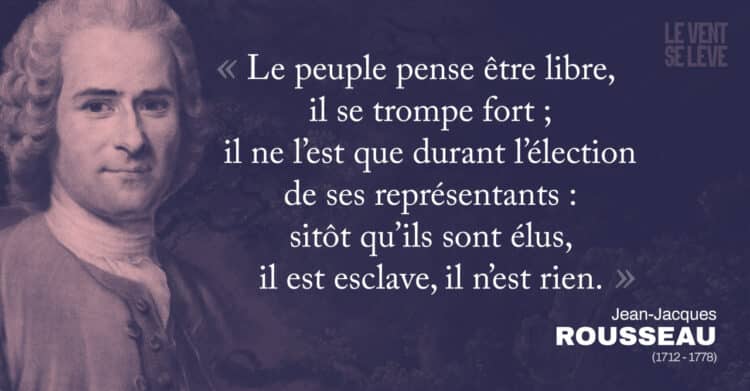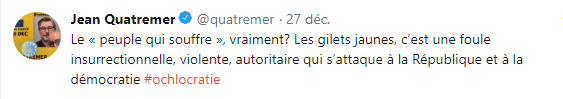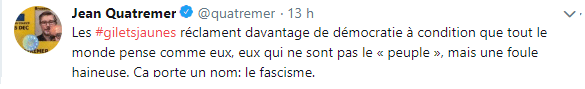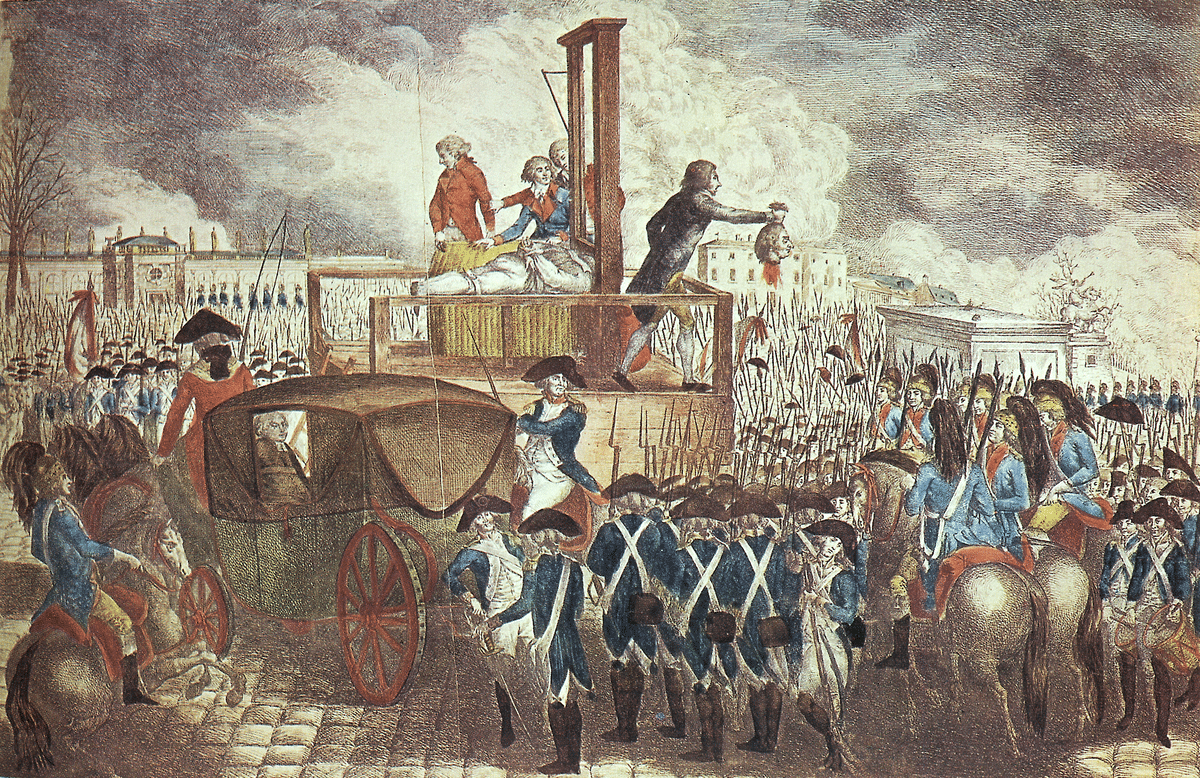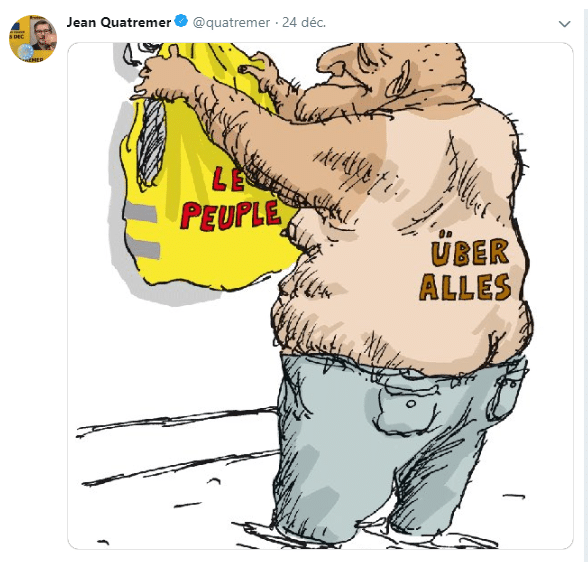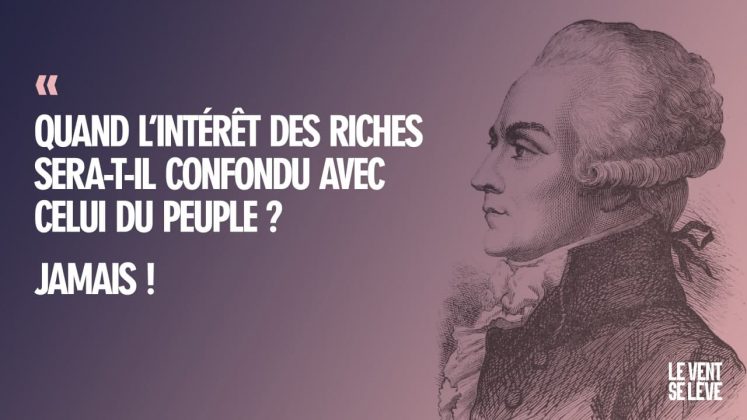Les violences policières depuis le début du mouvement des gilets jaunes ont atteint des proportions aussi inimaginables qu’intolérables. Alors que le Conseil d’État vient de rejeter le recours en urgence de la Ligue des droits de l’Homme pour l’interdiction du LBD, le bilan des blessés graves ne cesse de s’alourdir. Dans ce climat de violence perpétuelle, brouillé par l’usage abusif des tirs lacrymogènes, la dérive autoritaire du gouvernement se confirme de semaine en semaine. Pourtant, ce tournant dans les méthodes de maintien de l’ordre s’inscrit dans un durcissement plus global, comme nous l’expliquent Gilles Da-Ré et Pascal Gassiot, membres actifs et bénévoles de l’Observatoire des pratiques policières (OPP). Ce collectif, né à Toulouse en 2017, à l’initiative de la Ligue des Droits de l’Homme et de la Fondation Copernic est présent dans toutes les manifestations. L’observation sur le terrain, associée à une analyse pointue des données, se donne pour mission de rendre compte des pratiques des forces de l’ordre et de leur évolution.
LVSL – Pouvez-vous nous en dire plus sur l’émergence de l’Observatoire des pratiques policières ? Comment ce collectif s’est-il créé ?
Gilles Da-Ré et Pascal Gassiot – L’observatoire des pratiques policières est né suite aux mouvements sociaux de ces dernières années, en particulier en lien avec le mouvement contre la loi Travail de 2016 et les manifestations autour de la mort de Rémi Fraisse à Sivens. L’Université populaire de Toulouse et la Fondation Copernic ont alors décidé d’organiser une conférence-débat sur La criminalisation du mouvement social. Diverses organisations étaient présentes, notamment l’ACAT, qui a pu y présenter un rapport sur les violences policières et les défaillances des enquêtes judiciaires à ce sujet. Alors que nous pensions en être pleinement conscients, la présentation de leur inventaire des violences policières nous a littéralement scandalisés. C’est de là qu’est venue l’idée de mettre en place une initiative à Toulouse. L’idée de l’observatoire a germé très rapidement, à mesure que les déploiements policiers se faisaient de plus en plus impressionnants, notamment lors de la manifestation contre le projet de centre commercial Val Tolosa dans l’ouest toulousain le 17 décembre 2016, puis lors de celle Contre le racisme, les violences policières, pour Théo, Adama et les autres victimes du 25 février 2017. Ainsi, le 4 mars 2017, la Fondation Copernic et la LDH ont officialisé le lancement de l’Observatoire toulousain des pratiques policières (OPP). Nous avons un peu plus tard été rejoints par le Syndicat des avocats de France.
LVSL – Vous insistez sur le terme « pratique » lorsque d’autres usent explicitement du terme de « violence » pour décrire les agissements des forces de l’ordre. Pouvez-vous nous expliquer ce choix ?
GDR et PG – Nous avons choisi de ne pas nous focaliser uniquement sur les violences policières, qui existent bien évidemment en tant que telles, mais qui se révèlent être des conséquences du déploiement de masse des différentes forces de police, de leur occupation de l’espace, de la coordination des tâches entre les différents corps et de leurs méthodes d’action. Pour l’usage du terme « pratique », nous avons choisi en tant qu’observateurs de ne pas nous focaliser sur l’incident final, qui peut être plus ou moins dramatique, mais d’essayer de saisir les logiques des acteurs et leurs modes d’action à chaque instant.
LVSL – Dès lors, comment cet observatoire a-t-il été accueilli par les forces de l’ordre ? Avez-vous dû faire face à des réactions hostiles ?
GDR et PG – Il y a eu très rapidement des réactions, notamment des communiqués de leurs syndicats, ce qui peut se comprendre. Il y a aussi eu quelques tentatives d’intimidation verbale puis physique de la part de certains policiers lors des manifestations. Le gazage ciblé d’un observateur par des policiers de la BAC le 22 mars 2018 lors de la dispersion un peu lente d’une manifestation a été l’une d’entre elle. Suite à cette agression nous avons demandé un rendez-vous avec la préfecture et un courrier a été adressé aussi à l’IGPN (Inspection générale de la police nationale). Nous avons été reçus par le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) en personne, auquel nous avons présenté notre collectif et ce que nous désirions faire. Suite à cet entretien, nous nous sommes engagés à déclarer systématiquement la veille des manifestations notre présence à la préfecture. Depuis l’acte VI de la mobilisation des gilets jaunes, nous rajoutons dans cette déclaration une demande pour que notre matériel de protection personnel, c’est-à-dire les casques, lunettes et sérum physiologique, ne nous soient pas confisqués avant, pendant et après les manifestations. Jusqu’ici, à part quelques incidents mineurs de temps à autre avec certains agents, nous sommes désormais bien identifiés par les policiers et nous arrivons à mener correctement notre travail.
« Tous les éléments étaient déjà réunis pour assister aux erreurs accidentelles comme aux brutalités intentionnelles que l’on voit aujourd’hui »
LVSL – Venons-en alors au cœur de votre travail justement. Quelles sont vos observations quant aux pratiques policières qui ont été adoptées pour encadrer le mouvement des gilets jaunes aujourd’hui ?
GDR et PG – Notre première observation à l’OPP remonte à la manifestation du 1er mai 2017. Notre premier constat a été le déploiement policier disproportionné : jamais moins de 100 policiers et quelques fois plus de 150, une présence de grilles anti-émeutes et de canons à eau, des policiers à l’époque non équipés de LBD, mais plutôt de gazeuses à main. Un autre constat a été le fonctionnement du dispositif policier lui-même. Nous avons pu observer la pratique du glissement le long des grands boulevards, qui consiste à suivre la manifestation en bloquant les ruelles permettant d’accéder au centre-ville, pratiqué par des dispositifs regroupant des policiers des CDI (Compagnie départementale d’intervention) et des BAC (Brigades anti-criminalité). L’origine de cette interdiction d’accéder au cœur de ville est due à une demande du maire de Toulouse lors du premier trimestre 2015 suite aux manifestations liées à la contestation contre le barrage de Sivens fin 2014. Notre constat sur les violences policières actuelles est donc le suivant : tous les éléments étaient déjà réunis pour assister aux erreurs accidentelles comme aux brutalités intentionnelles que l’on voit aujourd’hui. Il y a quatre grands corps de policiers qui interviennent sur les manifestations de nos jours. Il y a des policiers dont c’est le métier : les Compagnies républicaines de sécurité (CRS) et les escadrons de gendarmes mobiles, qui relèvent de la police administrative et d’autres, qui ne sont pas ou peu formés au maintien de l’ordre, comme les CDI et les BAC, qui relèvent de la police pénale. L’un des problèmes les plus importants est selon nous celui-ci : certains effectifs de police déployés lors des manifestations ne sont pas à leur place.
LVSL – Quels changements avez-vous pu observer depuis le 17 novembre et les manifestations de gilets jaunes dans Toulouse ? Quelles pratiques policières inédites notez-vous autour de ce mouvement singulier ?
GDR et PG – Certains distinguent deux périodes dans les manifestations du mouvement : l’une du 17 novembre à la fin du mois de décembre et une autre depuis début janvier. Il est vrai que la période des fêtes a marqué un peu le mouvement au niveau du nombre, mais l’évolution générale a montré une montée en puissance constante des dispositifs policiers d’un côté et du niveau d’équipement de protection des manifestants de l’autre. Sur le premier point, le nombre de policiers déployés est considérable : jusqu’à 600 policiers selon la préfecture. Mais voir dans une ville comme Toulouse des blindés, des canons à eau et des hélicoptères avec prise de photo et transmission instantanée au sol pour interpellation, un usage massif de tout l’arsenal militaire disponible, gaz lacrymogène, grenades GLI-F4, grenades de désencerclement, lanceurs de balles de défense (flash-balls) : tout cela est éloquent quant à la répression qui est désirée et sommée en haut lieu contre les gilets jaunes. Tout cet arsenal aurait de quoi repousser plus d’un manifestant. Pourtant, sur le deuxième point, à Toulouse, il ne semble pas que la présence policière atteigne la motivation des manifestants, quels qu’ils soient. Il est en effet tout aussi impressionnant de voir l’ampleur des cortèges qui grossissent encore de semaine en semaine, et ce dans une désorganisation relativement grande par rapport aux rassemblements syndicaux plus ordinaires. Les équipements des manifestants ne sont que des équipements de protection et certains d’entre eux prennent ce qu’ils ont sous la main à un instant T pour se défendre en affrontement direct ou bien quelquefois, pour les plus virulents, s’en prendre à trois cibles symboliques : les banques, les promoteurs immobiliers et les compagnies d’assurance.
LVSL – Quelle est l’évolution plus précise que vous constatez depuis le début du mois de janvier ?
GDR et PG – Lors des quatre dernières manifestations sur Toulouse, les policiers ont d’abord laissé les manifestants déambuler dans le centre-ville. Les gilets jaunes sont mieux organisés, avec une tête de manifestation avec banderole, ce qui structure mieux le cortège. Les policiers sont visibles, encadrent simplement, mais sont peu présents puis arrive une heure fatidique, toujours la même : 16h30. D’ailleurs, les manifestants attendent avec curiosité mais aussi beaucoup d’inquiétude cette heure-là. À 16h30 donc, un hélicoptère arrive et survole le mouvement et alors, sans que rien ne le justifie selon nous, les premiers tirs de grenades lacrymogènes commencent et sont lancés assez loin dans la foule pour disperser les manifestants ou bien faire repartir le cortège en mouvement, surprenant ainsi des familles avec enfants et des personnes âgées.
Si le cortège arrive souvent à repartir, c’est évidemment aussi le lancement des hostilités et des affrontements qui durent ensuite jusque tard dans la soirée à plusieurs endroits de la ville où sont situés les manifestants. En général, ces tirs sont provoqués par quelques jets de peinture ou d’œufs, voire de canettes de bière, mais rien de très violent pour des forces de l’ordre équipées et formées. Là où il convient de pousser un peu plus loin notre dénonciation, c’est sur le mélange de la BAC et des CDI, souvent en première ligne. Parfois même, nous avons vu des agents municipaux équipés pour le maintien de l’ordre. Comment se fait-il que ces corps policiers non formés au maintien de l’ordre se trouvent en première ligne ?
Nous l’avons dit tout à l’heure, certains ne sont pas à leur fonction officielle, ils remplissent un rôle qui est un vrai métier et qui demande un savoir-faire pour ce genre de situations, acquis dans une formation spécifique ; ce que les BAC et les CDI n’ont pas. La répartition des rôles nous paraît anormale dans le cadre du maintien de l’ordre. Or, tout ceci est connu par la direction de la police et par l’exécutif et c’est souvent le comportement indiscipliné et quelque fois provocateur de ces non-formés qui font dégénérer les choses. Dès lors, nous affirmons désormais en toute assurance qu’il y a des ordres donnés en haut lieu pour faire en sorte que les manifestations dégénèrent. Suite à nos observations, nous estimons notamment que le retrait des BAC ramènerait sans aucun doute plus de calme dans les manifestations.
LVSL – Le gouvernement a fait l’achat pour la police de lanceurs multi-coups (PGL-65) qui font polémique. Lors des manifestations toulousaines, est-ce que votre observatoire a pu constater l’utilisation des lanceurs multi-coups que ce soit pour l’utilisation de gaz lacrymogènes ou de flash-ball ?
Oui, nous avons des photos de ces armes (présence de LBD multi-coups et poly-munitions PGL-65) dans les manifestations toulousaines et si nous n’avons pas constaté par nous-même l’utilisation de cette arme, plusieurs témoignages fiables et concordants indiquent leur utilisation lors des deux dernières manifestations. Il n’y a rien à ajouter, si ce n’est que de rappeler que ces armes sont des armes de guerre.
« Nous sommes donc en présence d’un échec du gouvernement à faire rentrer les choses dans l’ordre par la violence policière »
LVSL – À la suite de vos observations, est-ce que l’observatoire remarque un tournant majeur dans la doctrine française du maintien de l’ordre comme beaucoup semblent l’évoquer ?
GDR et PG – Il y a une volonté de la part du gouvernement de faire des manifestations un lieu dangereux. Le comportement des forces de police a pour objectif de dissuader les gens de participer aux mobilisations. Il est difficile d’en évaluer l’efficacité ; cela doit certainement fonctionner. Nous pouvons affirmer, sans nous tromper, que s’il y avait un maintien de l’ordre plus classique, les manifestations seraient très certainement encore plus massives. L’objectif de la préfecture et du gouvernement, dès le 1er décembre, a été d’utiliser massivement les forces de police avec la manière forte (grenadages massifs de toutes natures, charges, interpellations et chasse aux manifestants) pour faire peur – une stratégie du choc en quelque sorte – en espérant dissuader les gilets jaunes de manifester. C’était sous-estimer la colère profonde des manifestants dont le nombre a doublé à chaque manifestation. Selon les chiffres officiels à Toulouse, on comptait 1 500 manifestants le 1er décembre, 3 000 le 8 décembre, et entre 10 000 et 15 000 aujourd’hui, malgré la montée en intensité de la répression et le matraquage médiatique. Nous sommes donc en présence d’un échec du gouvernement à faire rentrer les choses dans l’ordre par la violence policière. Néanmoins, de leur côté, cela ne semble toujours pas acté et la conflictualité risque de continuer à augmenter.
LVSL – Quel regard portez-vous donc sur la police ? Certains considèrent les policiers comme n’importe quels travailleurs et scandent « la police avec nous ! », quand d’autres crient plutôt « tout le monde déteste la police ». Comment vous situez-vous par rapport à tout cela ?
GDR et PG – Tous les services de police, qui ne sont pas de même nature, n’ont pas le même comportement. Il faut faire preuve d’une approche complexe au regard des actes. Nous avons déjà expliqué les différences qu’il y a entre ceux dont le métier est le maintien de l’ordre (CRS et gendarmes mobiles) et ceux dont le maintien de l’ordre n’est pas le métier premier (BAC et CDI). Ce que nous avons constaté chez ceux qui ne sont pas directement concernés par le maintien de l’ordre est un manque d’assurance, pour les CDI particulièrement, dont la pratique conduit à mettre les manifestants à distance par des grenadages puissants. S’agissant des BAC, il est tout à fait compréhensible qu’ils provoquent un tel rejet. Les BAC font du flagrant délit dans les manifestations et interpellent. Ils vont chercher violemment, principalement à l’aide de leurs matraques, un manifestant au cœur du cortège en se protégeant avec des LBD et des grenades.
Les agents de la BAC à motos sont probablement les plus dangereux car ils agissent toujours pareillement mais avec plus de vitesse, et donc de violence. Ils sont pour un certain nombre de manifestants ceux qu’ils rêvent de faire tomber. Ils ont inventé un jeu dangereux. Nous n’avons pas de discussions avec les différents corps qui nous permettent de répondre précisément à ces questions. Comme tout le monde, nous avons noté dans la police les suicides, le recours aux congés de maladie, etc. Mais nous n’avons pas noté globalement de la part de ces policiers le moindre geste qui aurait pu signifier simplement de la sympathie pour les gilets jaunes. Le seul indice, mais qui est loin d’être un détail pour nous, se traduit par les quelques tensions que nous avons observées entre services, notamment un certain mépris des CRS et des gendarmes mobiles à l’encontre de la BAC. C’est sur cela qu’il faut appuyer pour revendiquer dans un premier temps la sortie des BAC des manifestations. Des situations où un vrai professionnalisme est demandé, sans quoi des conséquences gravissimes sont possibles.
LVSL – Que comptez-vous faire prochainement ? Hormis la poursuite des observations, comment voyez-vous la suite de l’observatoire inédit que vous avez initié sur Toulouse et l’utilité dont il pourrait faire œuvre ?
GDR et PG – L’intérêt est le développement de nos pratiques citoyennes dans un maximum de villes. Il semble qu’il y ait des velléités à Montpellier, Bordeaux et Nantes. Nous avons maintenant une expertise solide que nous pouvons mettre en commun et nous allons entrer en contact avec les différents collectifs qui le voudront bien pour partager notre expérience. Les atteintes aux libertés, au droit de manifester, se développent et il faut selon nous encourager une coopération toujours plus étroite entre les organisations traditionnelles (LDH, SAF, SM) et les citoyens le désirant, pour construire des outils de travail et des formes d’actions unitaires. Le mouvement des gilets jaunes a fait voler en éclat certaines approches classiques du maintien de l’ordre à la française qui s’étaient sédimentées depuis de nombreuses années. Nous travaillons à la rédaction d’un rapport qui englobe toutes nos observations et nous espérons que celui-ci saura avoir l’écho qu’il mérite du point de vue de son efficacité.
—
Entretien co-réalisé et retranscrit par Simon Berger