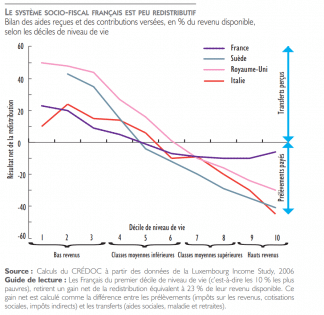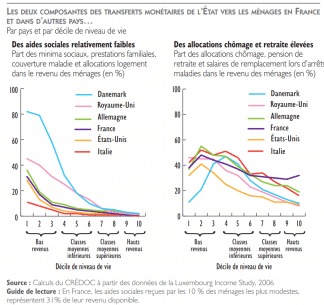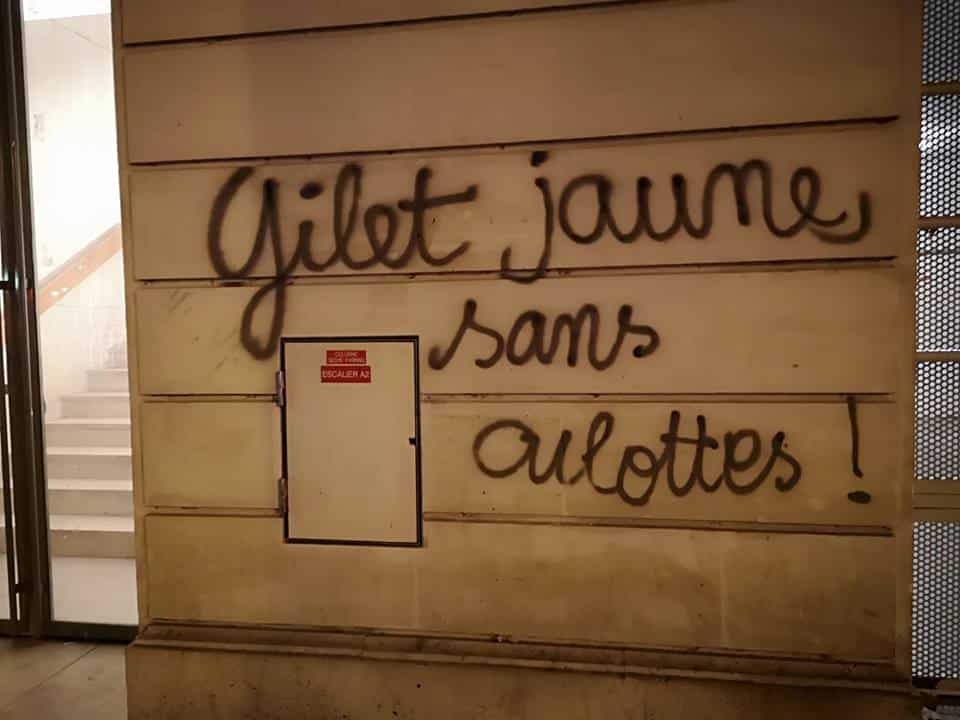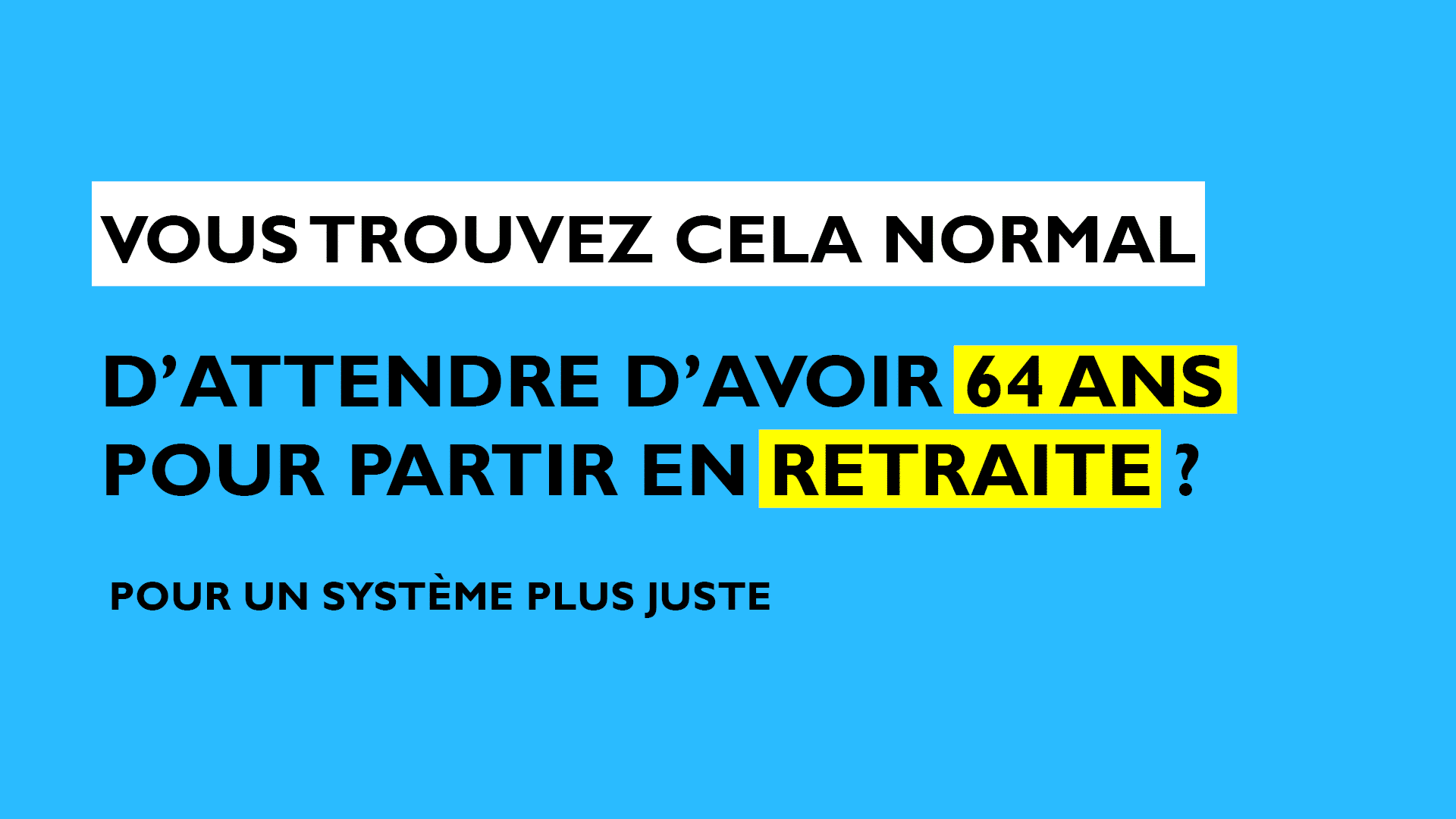Au mois de mai dernier, Édouard Louis publiait Qui a tué mon père. Dans cet ouvrage ramassé et poignant, l’écrivain rappelle que la politique est toujours in fine une question de vie ou de mort, qu’elle s’exerce sur les corps. Si le corps usé du père d’Édouard Louis « accuse l’histoire politique », c’est que les classes dominées subissent dans leur chair la violence sociale qui leur est faite, c’est que le corps cassé, épuisé de l’ouvrier incarne et résume l’injustice de l’ordre capitaliste. Six mois plus tard, le mouvement des gilets jaunes redouble sur la scène politique ce qui a eu lieu sur la scène littéraire.
Le gilet jaune… et le corps qui le revêt
Édouard Louis commente ainsi l’irruption des corps populaires à la faveur du mouvement des gilets jaunes : « J’ai du mal à décrire le choc que j’ai ressenti quand j’ai vu apparaître les premières images des gilets jaunes. Je voyais sur les photos qui accompagnaient les articles des corps qui n’apparaissent presque jamais dans l’espace public et médiatique, des corps souffrants, ravagés par le travail, par la fatigue, par la faim, par l’humiliation permanente des dominants à l’égard des dominés, par l’exclusion sociale et géographique. Je voyais des corps fatigués, des mains fatiguées, des dos broyés, des regards épuisés. » L’irruption des corps dominés passe d’abord par l’emblème que les manifestants se sont choisi : le gilet jaune est un signal. Signal d’un corps vulnérable qu’il s’agit de faire apparaître, de mettre en évidence. Signal d’un corps en danger qu’il faut rendre visible, signaler à l’attention et à la vigilance d’autrui. Les gilets jaunes sont le signal du retour du corps des pauvres en politique.
Les très nombreux blocages de ronds-points et de péages, ou simplement la présence en ces lieux, manifestent l’importance du corps dans le mouvement. Les gilets jaunes font physiquement obstacle – souvent avec bienveillance – à la circulation des personnes et des marchandises, ils sont autant de grains de sable dans la fluidité rêvée de l’économie néo-libérale. Leurs corps sont ce qui coince, ce qui grippe, ce qui achoppe. Le gilet jaune, porté par un automobiliste en panne ou un travailleur sur un chantier d’autoroute, est aussi le signal d’un corps immobile au milieu du mouvement général et incessant. Voilà pourquoi tout commence avec le prix de l’essence : les gilets jaunes, grands perdants d’une société qui exalte et exige la mobilité de tous, sont le symbole de la France immobile, non pas en ce qu’elle serait rétive au progrès ou repliée sur elle-même et fermée au monde, mais parce qu’elle n’a tout simplement pas les moyens de la mobilité qu’on lui impose, ou parce qu’elle refuse la mobilisation des corps dans le grand déménagement du monde néo-libéral. Le gilet jaune est la formidable métonymie de ces corps en détresse, de ces corps immobilisés dans et par leur condition sociale.
Corps à corps
La spectaculaire irruption des corps populaires se joue ensuite sur les plateaux de télévision : le contraste éloquent entre gilets jaunes, députés et ministres ne réside pas seulement dans les discours mais aussi dans les attitudes, les postures, les vêtements, les manières de se tenir, d’intervenir. Si bien qu’en une telle arène, les corps des gilets jaunes apparaissent toujours déplacés, dans le sens le plus littéral du terme. Ces corps ne sont plus à leur place, c’est-à-dire à la place – souffrante, soumise, réifiée – que leur a assignée le capitalisme néo-libéral. Ils ne sont plus à leur place d’objets : objets de reportages, de commentaires ou de statistiques savamment décryptées. Le scandale vient de ce que les corps des pauvres sont désormais « invités » à la table des experts et des éditorialistes. Et les pauvres, hélas, se tiennent souvent mal, obligeant parfois les journalistes à leur donner quelques leçons de maintien. L’entre-soi feutré et le jeu bien réglé des discussions entre belles personnes s’en voient singulièrement perturbés. La confrontation des habitus fut, avant même celle des idées, la démonstration la plus flagrante de ce corps à corps entre classes sociales que les gilets jaunes ont imposé.
Le corps à corps recherché dès les premières expressions du mouvement lui confère un caractère indéniablement insurrectionnel. Le corps à corps occupe le vide inquiétant laissé par des « corps intermédiaires » méprisés et disqualifiés, parfois par le pouvoir lui-même[1]. C’est que les gilets jaunes, lassés des formes galvaudées d’une démocratie représentative qui ne tient plus ses promesses, ont d’emblée souhaité s’approcher directement du corps et du cœur du pouvoir, tout particulièrement de son incarnation présidentielle. Dès le 17 novembre, les chaînes d’information en continu diffusent à l’envi les images des manifestants attroupés devant l’Élysée. Ce désir de confrontation physique, qui s’assouvit parfois en simulacres d’exécution d’Emmanuel Macron, a quelque chose de troublant. Il explique l’obstination des gilets jaunes à manifester sur les Champs-Élysées, place de la Madeleine ou de la Concorde, jamais très loin du Palais. Corps contre corps : la violence qui se déchaîne certains samedis rappelle à tous, comme l’explique Juan Branco[2], que la politique n’est pas un simple jeu, une lutte des places ou une partie d’échecs entre gens de bonne compagnie. Les tenants de l’ordre sociopolitique qui défait les corps, les marque et parfois les détruit, comprennent alors que la violence qu’ils imposent, lorsqu’elle devient trop insupportable, risque de se retourner contre eux.
Le corps dérobé d’Emmanuel Macron
Mais dans ce corps à corps, l’un se dérobe. Les gilets jaunes exhibent des corps maltraités ou épuisés, traversés d’affects et de soubresauts. Aux convulsions du corps social, ils attendent que le pouvoir réponde de manière incarnée. Non pas seulement par les mots et les concepts, mais par l’action et le geste, quelque chose qui montrerait que le pouvoir lui-même est touché, dans son corps, par ce qui se déploie sous ses yeux. Or, le pouvoir continue de lui présenter un corps sur papier glacé. La théorie des deux corps du roi élaborée par Kantorowicz est bien connue : le roi est doté d’un corps physique, terrestre, mortel et d’un corps mystique et immortel symbolisant la communauté politique. Emmanuel Macron a surinvesti le corps mystique dès le soir de son élection et son apparition dans l’obscurité de la cour du Louvre, au risque de se couper de la réalité du corps social. Lorsque le président va « au contact », comme aiment le dire les conseillers en communication, les gestes et les mots sont souvent maladroits, perçus comme hautains et méprisants.
La réception de l’allocution du 10 décembre est de ce point de vue très intéressante. Les signes physiques de fatigue ou de nervosité, les indices d’un trouble qui pouvaient manifester l’émotion du corps touché, ont été scrutés avec autant d’attention que les annonces politiques. Les mains du président, ostensiblement posées à plat sur la table, ont suscité l’interrogation et la raillerie. Le geste, quelle que soit son intention, rate son objectif, semble faux et affecté. L’été dernier, Emmanuel Macron a pourtant lui-même mis en scène un corps à corps avec le peuple (« qu’ils viennent me chercher ») exposant, du moins verbalement, son corps physique mais en le dérobant dans le même temps puisqu’un tel défi, opportunément filmé et diffusé sur les réseaux sociaux, était lancé depuis la cour de la maison de l’Amérique latine devant un aréopage de ministres. Paradoxalement, le corps du président s’exposait faussement pour protéger son propre garde du corps… C’est sans doute dans ce double retranchement du corps présidentiel, dans cette inaccessibilité jupitérienne et bravache qu’une partie du mouvement des gilets jaunes prend ses racines.
Un épisode apparemment anodin et superficiel de cette crise politique majeure révèle la mesure de ce qui se joue au niveau du corps présidentiel et de sa difficulté à s’incarner. Un article du Monde daté du 22 décembre rapporte les paroles d’un député de la majorité affirmant qu’Emmanuel Macron « ne sort plus sans se maquiller tellement il est marqué » et ajoutant : « il se maquille même les mains ». Si l’information fut reprise par la presse people comme par la presse la plus sérieuse, c’est que l’on sent bien qu’elle est grosse d’une vérité plus profonde qu’il n’y paraît et qu’elle dépasse de loin l’anecdote de communicant. Ce maquillage permanent et intégral qui recouvre « même les mains », soit l’outil de travail des classes les plus modestes, est l’ultime signe d’un corps présidentiel faux et lisse incapable d’être touché ou de toucher. Isabelle Adjani, dans un article qui là encore a largement débordé les pages de la presse légère, parle d’une « impossibilité tactile […] avec le corps du pauvre »[3]. Alors que les gilets jaunes exposent sans fard des corps que l’on a longtemps voulu enfermer dans la honte, « se met[tent] à nu »[4] selon les mots de l’une des figures du mouvement, le pouvoir continue d’exhiber le corps artificiel et distant qui a pourtant miné sa légitimité et qui « accuse », pour reprendre le terme d’Édouard Louis, la distance glacée de sa politique au service des dominants. Il y a peu, le président a prononcé ses vœux debout face aux Français, optant pour une verticalité frontale qui met en scène un corps inébranlable, qui ne fléchit pas. Alors que les gilets jaunes, physiquement et métaphoriquement, exhibent marques et empreintes, blessures et fêlures, le pouvoir s’en tient à l’apparente impassibilité, aux illusions de la surface. La révolte des gilets jaunes est fondamentalement une protestation contre cette négation toute néo-libérale de ce qui est fragile et précaire et qui s’inscrit à même la peau, celle qu’on essaie de sauver quand tout semble perdu, celle qu’on laisse parfois quand on n’en peut plus.
[1] Sur ce point, voir la tribune de Guillaume Le Blanc (« Les deux corps de la manifestation ») parue dans Libération le 6 décembre 2018.
[2] “Là-bas si j’y suis”, 21 décembre 2018, https://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/Juan-Branco-desosse-Macron.
[3] Interview donnée dans Elle, paru le 28 décembre 2018.
[4] Ingrid Levavasseur, aide-soignante, intervenait dans La Grande explication le 29 novembre 2018.