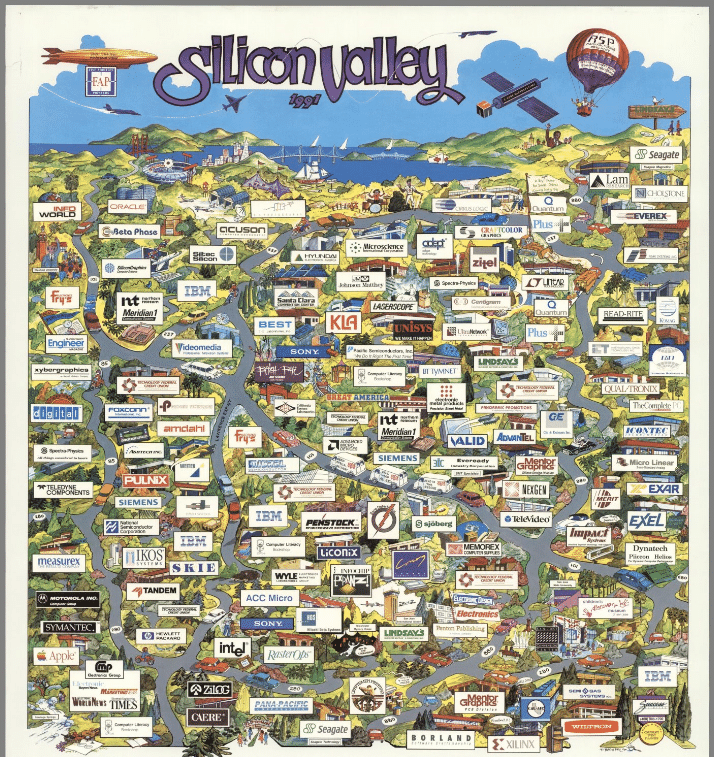Auteur de nombreux ouvrages sur le national-socialisme traduits en une dizaine de langues, récompensé en 2015 par le prix Yad Vashem international, Johann Chapoutot a publié en janvier 2020 Libres d’obéir – le management, du nazisme à aujourd’hui (Gallimard). Il y détaille les théories et pratiques managériales qui avaient cours sous le IIIème Reich, ainsi que les continuités que l’on peut observer avec celles qui se sont développées sous la RFA. Deux ans après notre premier entretien pour LVSL, nous avons souhaité l’interroger sur son dernier ouvrage. Par Martin Saintemarie, Eugène Favier Baron et Vincent Ortiz, retranscrit par Dany Meyniel.
LVSL – À travers le cas de l’ancien officier SS Reinhard Höhn et de son académie où il a enseigné le management, vous mettez l’accent sur la manière dont le nazisme participe de notre modernité. Qu’est-ce que les réactions à votre ouvrage nous apprennent sur la place de la notion de « modernité » dans l’espace médiatique ?
Johann Chapoutot – Il y a un malentendu fondamental sur l’adjectif moderne et la notion de modernité. Dire que le nazisme est un phénomène qui participe, qui procède de notre modernité, donc un phénomène moderne, peut apparaître comme une forme d’évidence ou de truisme. Autrement dit, pour les historiens comme pour les praticiens des sciences humaines et sociales en général, la modernité est un concept purement descriptif : il y a des phénomènes qui sont modernes, qui se veulent modernes, qui sont en tension vers la modernité et d’autres qui ne le sont pas, qui ne la revendiquent pas, qui la contestent… Les nazis, eux, ne cessent de répéter qu’ils sont en tension dans et vers la modernité ; ils pratiquent une modernité de rattrapage : rattrapage industriel pour armer l’Allemagne, l’équiper, rattrapage également sur le plan de la consommation qui reste à développer. Ils veulent motoriser l’Allemagne, équiper les ménages en appareils de consommation courante, atteindre un bien être qui soit comparable à celui des Etats-Unis. Le modèle américain est une obsession pour les nazis – Adam Tooze l’a très bien montré, entre autres historiens, dans Le Salaire de la destruction –, c’est le référent synchronique des nazis là où Rome est leur référent diachronique.
On ne dit pas autre chose en qualifiant le nazisme de moderne. Mais du fait d’une dissonance sémantique qui prédomine dans l’espace public, certains journalistes, lorsqu’ils entendent « moderne », pensent réformes nécessaires, eschatologie et bonheur du genre humain. Dire que le nazisme est un phénomène moderne produit un court-circuit dans les esprits de certains. Cela produit un scandale moral parce que la modernité est positive : c’est la 5G, le nouvel iPhone, les réformes nécessaires pour transformer le pays… On vous soupçonnera d’être un affreux militant, un odieux bolchévique, un atroce passéiste qui voudra discréditer l’œuvre nécessaire de modernisation des rapports sociaux, via une reductio ad hitlerum. Dire que le nazisme est un phénomène moderne est d’une banalité effarante et n’a rien de novateur dans l’historiographie du nazisme.
L’exemple de Reinhard Höhn me semble être une pièce supplémentaire, une étude de cas à verser dans ce dossier. Ce général SS, qui a fait une carrière administrative et universitaire remarquables sous le IIIe Reich, est un modernisateur. Après la guerre, ce même Reinhard Höhn devient le fondateur de la plus importante école de commerce allemande, le théoricien principal du management au moins jusqu’aux années 1980. Cette école recycle des SS, condamnés comme génocidaires, à des postes de professeurs de droit commercial ou de développement personnel : Justus Beyer, condamné à Nuremberg, devient professeur de droit commercial ; Franz Alfred Six, commandant d’Einsatzkommando, condamné à Nuremberg, devient professeur de marketing… Il m’a semblé important de rappeler ces faits, d’abord parce que cela relève tout simplement du travail de l’historien, ensuite parce qu’ils me semblaient propres à stimuler ou à nourrir une réflexion sur notre temps et notre lieu, c’est-à-dire l’Occident du XIX et XXème siècles qui, aujourd’hui comme hier, est nourri par l’imaginaire de la rareté, de la lutte pour la maîtrise des ressources et de la performance. C’est ce monde-là que nous avons en commun avec eux.
LVSL – Que nous apprennent les réactions médiatiques à votre livre sur la place de l’histoire du nazisme et de la Shoah dans le débat public et dans l’imaginaire ?
JC – Il y a deux malentendus qui ont été effectués. Le premier concerne la notion de modernité, et la connotation positive qui lui est associée. Le second a trait à l’assimilation entre nazisme et Shoah. Guillaume Erner, qui juge mon livre « moralement scandaleux », confond et assimile totalement les deux phénomènes, sans doute pour des raisons d’écrasement de la perspective chronologique – le nazisme est un phénomène tellement lointain que l’on écrase la perspective : 1919 [fondation du Parti ouvrier allemand, prédécesseur du NSDAP ndlr] c’est déjà 1933, 1938, 1941, et 1945. Cet intentionnalisme naïf, qui consiste à penser que « tout est dans tout », qui veut que tout soit écrit dans Mein Kampf, que tout petit déjà Hitler rêvait d’assassiner onze millions de personnes, peut expliquer cette confusion [les historiens « intentionnalistes », qui estiment que la Shoah est l’aboutissement d’une décision longuement préméditée par les dirigeants nazis, s’opposent aux « fonctionnalistes », selon lesquels elle est davantage le produit des circonstances propres aux années 1940, en particulier la guerre sur le front de l’Est ndlr].
Elle s’explique également par le fait que depuis la fin des années 70, on a assisté à un phénomène de rattrapage mémoriel qui a mis la Shoah – pour des raisons assez évidentes – sur le devant de la scène médiatique et historiographique avec un développement remarquable des travaux sur le génocide, qui se sont intensifiés depuis l’ouverture des archives soviétiques et du bloc de l’Est dès 1990. Rien de tout cela ne doit nous conduire à oublier que la Shoah commence à l’Est à l’été 1941 – avec des modalités et des procédures que les historiens ont très bien documentées – et à l’Ouest entre l’hiver et le printemps 1942.
Avant la Shoah, il y a huit ans de nazisme au pouvoir et vingt-trois ans de nazisme partidaire, militant et idéologique : la Shoah vient donc tard. Auparavant, il y a une ambition idéologique de régénération biologique de l’Allemagne et à partir de 1933 la mise en œuvre de cette politique de régénération biologique par une activité d’ingénierie sociale très brutale. Elle commence dès février 1933 avec la répression extrêmement violente de toute opposition politique, franchit une nouvelle étape avec la loi d’avril 1933 sur l’exclusion des allogènes de la fonction publique et, surtout, le 14 juillet 1933 avec le décret-loi qui impose la stérilisation obligatoire aux malades – quatre cent milles stérilisations à partir de 1933. Les nazis répètent d’ailleurs, comme on peut le lire sur une affiche de propagande à l’été 1933 : wir stehen nicht allein, « nous ne sommes pas seuls », avec une carte du monde détaillant l’ensemble des lieux où se pratique la stérilisation obligatoire des dégénérés, des ratés, des tarés, des faibles, des malades, des inutiles productifs…
Il y a une confusion sur ce qu’est le nazisme : le nazisme ce n’est pas la Shoah et réciproquement la Shoah ce n’est pas que le nazisme. Les gendarmes, les préfets français qui prennent part à la Shoah ne sont pas des nazis, pas plus que les antisémites polonais, les Oustachis croates, les policiers roumains et hongrois, les nationalistes baltes et ukrainiens qui y participent tout autant. Est-ce que les Trawnikis, ces Ukrainiens des centres de mise à mort sont des nazis ? Non, ce sont des ultranationalistes ukrainiens, ultra-antisémites, par ailleurs opportunistes, qui participent à l’entreprise de mort, et qui y voient une belle occasion de se débarrasser des juifs, de sauver leur propre peau, voire de faire carrière.
« Il semble évident que le darwinisme social pave notre monde depuis sa naissance dans les années 1860 (…) La loi de la race, la loi du marché s’imposent de manière nécessaire, infrangible, apodictique, aux hommes qui seront de toutes manière écrasées par la roue de l’histoire s’ils s’y opposent »
LVSL – Dans votre livre, vous soulignez l’existence d’un continuum idéologique entre certains éléments du libéralisme économique et les leitmotivs du national-socialisme. On découvre par exemple que les grandes figures du IIIème Reich étaient hantées par un imaginaire de la rareté, en vertu duquel le monde est un jeu à somme nulle régi par les lois de la compétition – un imaginaire qui prévaut dans la science économique libérale depuis la moitié du XIXème siècle. Comment faut-il comprendre ce continuum idéologique ?
JC – Il n’est pas difficile à comprendre dans la mesure où les nazis ne sont pas des extraterrestres ; ils sont d’un temps et d’un lieu qui n’est pas l’Indonésie du XIVème siècle mais l’Europe du XXème siècle. Nous insistons toujours sur la radicale extranéité des nazis en les ramenant à leur essence germanique supposée, à leur folie ou au démon qui les possédait, mais une fois que l’on a évacué ces inepties, le fait demeure : ils sont bien de chez nous, d’ici et de maintenant. Ce chez-nous, cet ici et ce maintenant, ce lieu et ce temps que nous habitons, s’appelle l’Occident et l’Europe des XIXèmes et XXèmes siècles. L’Occident, depuis les années 1850, est un monde culturel spécifique, caractérisé par une appréhension du temps, de l’espace, de l’homme et de la diversité des hommes, des races également. Toutes ces catégories ont accouché de pratiques : le capitalisme d’exploitation, l’exploitation des ressources naturelles, humaines et infrahumaines ou subhumaines – puisqu’on a affaire à des « sous-hommes » avec les populations coloniales. Les nazis n’ont absolument rien inventé, ils procèdent de ce lieu et de ce temps. Ils conçoivent par exemple très clairement l’espace à l’Est de l’Europe jusqu’à l’Oural comme les Français universalistes et les Britanniques démocrates conçoivent l’Afrique et l’Asie, c’est-à-dire une terra nullius, un lieu qui n’appartient à personne, où l’homme européen est le seul capable de faire culture, de mettre en culture des terres et de les exploiter. La terra nullius que les nazis revendiquent à l’Est est un concept de droit qui existe depuis le XVIIIème siècle et qui a servi à légitimer la colonisation.
Aux fondements de ce capitalisme et de ce colonialisme, on trouve l’idée que l’on vit dans un monde fini, gouverné par la rareté. Qui dit monde fini et rareté dit aussi concurrence pour l’accès aux biens, aux ressources et aux aliments : autrement dit, un jeu à somme nulle avec des gagnants et des perdants ; c’est malheureux, mais le monde de la rareté est nécessairement un lieu d’affrontements, un lieu de guerre, un lieu de combat pour ces individus ou ces espèces qui sont en lutte pour des espaces. Ces espèces, ce sont les races, et dans ce monde de rareté, de combat pour la maîtrise des ressources et notamment la première d’entre elles, la ressource alimentaire, la vertu cardinale qui permet la survie est la performance : performance démographique – faire des enfants de bonne qualité et en nombre suffisant –, performance sportive – pour s’aguerrir – et guerrière, performance productive pour disposer de ce qui est nécessaire au combat et à la survie. C’est le monde commun dont les nazis procèdent, participent, et portent les caractères jusqu’à incandescence.
LVSL – Vous mentionnez l’héritage (indirect) du darwinisme social de Herbert Spencer dans les réflexion antiétatistes des nazis. Dans « Il faut s’adapter » (Seuil, 2019), Barbara Stiegler étudie la postérité de l’évolutionnisme de Spencer aux États-Unis, qui survit selon elle à travers Walter Lippmann, pionnier du « néolibéralisme ». Elle analyse notamment l’opposition que Lippmann dresse entre le « flux » – des échanges, des capitaux, des informations – et la « stase » – l’ensemble des habitudes mentales prises par les habitants, qui les empêche de « s’adapter » aux réquisits du capitalisme mondialisé, en fluctuation permanente. Dans une perspective évolutionniste, Lippmann déplore « l’inadaptation » des sociétés contemporaines, et le « retard » qui est le leur. Selon Barbara Stiegler, les crimes commis sous le IIIème Reich ont rendu tabou les références explicites à la biologie pour parler des sociétés humaines ; pourtant, les concepts et l’imaginaire déployés par Lippmann ont – selon elle – largement survécu, mais de manière diffuse. Partagez-vous cette intuition ? Peut-on lire votre livre comme une tentative de montrer que malgré la condamnation unanime des crimes de guerre des nazis, quelque chose du darwinisme social commun aux nazis et aux néolibéraux de la conférence Lippmann a survécu à la chute du IIIème Reich ?
[Lire ici notre entretien avec Barbara Stiegler : « Le néolibéralisme est imbibé de catégories darwiniennes »]
JC – Le tabou de la biologisation sociale saute en réalité dès les années 1970. L’idée selon laquelle les inégalités humaines, c’est-à-dire sociales et productives, ont des racines biologiques, est quelque chose qui est acquis dans de très larges parties du monde intellectuel ou scientifique, notamment aux États-Unis depuis les années 70, via une étiologie biologique et notamment génétique. Le tabou a été davantage européen, parce que l’Europe a été le lieu du crime, le lieu de la découverte physique, scopique, phénoménologique du crime ; aux Etat-Unis, on s’embarrasse un peu moins de tout cela, en Amérique latine on peut trouver des memorabilia du IIIe Reich en vente libre dans la rue, de même qu’en Asie.
Il semble évident que le darwinisme social pave notre monde depuis sa naissance dans les années 1860 [Darwin publie l’Origine des espèces en 1859 et Spencer son premier ouvrage consacré à la théorie de l’évolution, Le progrès, ses lois et ses causes, en 1857 ndlr] ; à partir de la seconde moitié du XIXème siècle la géographie, l’histoire, l’économie se pensent dans et par les catégories de la biologie, de la zoologie, de l’éthologie, d’une part parce que ce sont les sciences naturelles qui donnent le « la » dans la découverte scientifique, d’autre part parce que cette naturalisation du social a une fonction bien connue de légitimation. Si l’on estime que les hiérarchies sont naturelles que peut-on y faire ? Si elles sont voulues par la biologie, on peut bien contester, manifester, faire des tracts : il y aura une nécessité à l’œuvre, irréductible à notre liberté. Les nazis ont participé de cet imaginaire, celui de la nécessité biologique et scientifique, contre celui de la liberté. Ils affirmaient qu’il n’y avait pas le choix, comme d’autres diraient « qu’il n’y a pas d’alternative » (there is no alternative), et partageaient ce leitmotiv avec les libéraux les plus radicaux. La loi de la race, la loi du marché s’imposent de manière nécessaire, infrangible, apodictique, aux hommes qui seront de toutes manière écrasés par la roue de l’histoire s’ils s’y opposent parce que c’est la roue de la nécessité, qu’elle soit théologique, biologique, mercatique ou économique.
Cela ne veut bien évidemment pas dire que Madame Thatcher était une nazie, c’était une femme qui vivait dans une mystique de la liberté individuelle, de l’individu-roi, de l’absence de société, une ultralibérale assumée, à la fois anticommuniste et antinazie, mais qui partageait un terreau commun avec les nazis : l’imaginaire de la nécessité, du combat et de la performance nécessaires pour s’imposer dans la lutte pour la vie.
Les analyses de Barbara Stiegler, qui oppose le « flux » à la « stase » de Lippmann, posent la question de la signification de l’œuvre des néolibéraux des années 1930 : Walter Eucken, Wilhelm Röpke, etc. En termes sociaux et politiques, il s’agissait d’antinazis, qui estimaient que les nazis étaient trop dirigistes donc presque soviétiques. Mais ils partagent avec les nazis, étant eux aussi les enfants de leur temps et de leur lieu, cette opposition entre le « flux » et la « stase », entre le flux et l’obstacle. Le « flux », pour les nazis, est tout autant un flux de marchandises, de biens et de services qu’un flux vital, un flux biologique : c’est le sang. Le « flux », ce sont également les migrations germaniques qui conquièrent et qui colonisent ; contre cela, on trouve la « stase » dont ils ne veulent pas, le status qui est l’État. De la même manière, aujourd’hui, on oppose du côté du « flux » la dynamique, le mouvement, l’innovation, l’initiative, et du côté de la « stase » la rente, les acquis, les statuts sociaux, le conservatisme de ceux qui refusent que l’on détruise l’État-providence.
LVSL – Vos ouvrages se distinguent par leur étude approfondie de la « vision du monde » nazie. Un pan de l’historiographie considère pourtant que l’on ne doit pas – ou ne peut pas – prendre le corpus théorique nazi au sérieux, car il ne serait que l’expression d’une vision du monde délirante ou maléfique, qu’il ne ne s’agirait pas d’une production intellectuelle comme une autre. D’où vient ce refus ?
JC – Il y a plusieurs raisons à cela. Dire que les actes nazis procèdent d’un non-sens – qu’il soit démoniaque, animal, pathologique ou barbare – protège notre humanité, car être humain signifie vivre dans un univers de sens et de valeurs. Rabattre le nazisme du côté du non-sens est la manière la plus commode, sous ses différentes déclinaisons, de vivre avec, de se dire que nous n’avons rien à voir avec lui. C’est la première raison, que l’on peut considérer comme un mythe nécessaire, qui nous permet de nous accommoder de ce phénomène.
La seconde raison, liée à la première, tient à la domination de l’histoire sociale dans l’historiographie du nazisme. Par « histoire sociale », j’entends une méthode qui accorde une attention particulière aux acteurs et aux pratiques, aux acteurs en tant qu’ils sont acteurs de pratiques et non pas titulaires ou producteurs de discours. Cela découle d’une structuration de la corporation historienne qui, singulièrement en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, est passée d’une domination de l’histoire culturelle, voire intellectuelle, à celle de l’histoire sociale ; elle a notamment connu un fort développement via l’école de Bielefeld, qui provient du fait qu’il était urgent et moralement indispensable d’établir des faits, face à l’immensité inédite des crimes nazis. Face aux négationnistes, qui sont présents depuis le départ – les premiers négationnistes étant les nazis eux-mêmes, qui espéraient que personne ne croirait à la réalité de leurs crimes parce qu’ils étaient littéralement incroyables –, il fallait compter les camions, mesurer les fosses, sonder la faisabilité technique des crimes ; établir ainsi les faits, c’est la première mission de l’historien, d’autant plus impérative ici. C’est déjà une tâche titanesque et on peut comprendre qu’une grande partie de la corporation, pour des raisons à la fois épistémologiques, techniques, morales, ait estimé que l’on pouvait se contenter de cela, et que la question du sens ne la concernait pas. Ce partage des tâches est caractéristique de l’université allemande mais aussi des universités de langue anglaise, toutes deux ultra-dominantes : à nous le décompte des camions et aux collègues de philosophie la question du sens.
Ajoutons à cela qu’aux yeux des historiens allemands qui travaillent sur ce sujet, envisager que les crimes commis puissent avoir eu un « sens » aux yeux des acteurs pose problème d’un point de vue psychologique et moral, notamment au regard de l’histoire familiale et sociale du pays dans lequel ils vivent et dont ils sont issus. C’est un faisceau de raisons qui aboutit à ce que l’on ne s’intéresse pas au sens des pratiques pour les acteurs parce qu’il brûle les doigts…
LVSL – Les manuels d’histoire du secondaire ont tendance à renvoyer dos à dos « nazisme » et « stalinisme » sous la catégorie de « totalitarisme », solidaire d’un État omnipotent. L’analyse que vous délivrez dans votre dernier livre met au contraire l’accent sur la dimension antiétatiste du nazisme et établit qu’aux yeux de nombreux hiérarques du IIIème Reich, l’État est une entité à pulvériser car elle constitue un frein à l’émancipation raciale. Comment expliquez-vous cet écart ?
JC – Le totalitarisme est un concept intéressant, forgé par les antifascistes contre les fascistes, récupéré immédiatement par ces derniers pour exalter leurs propres ambitions historiques. En clamant « nous sommes les totalitaires », ils ont retourné le stigmate à leur profit. Ce terme, partagé entre les fascistes et les antifascistes, est devenu un concept de guerre froide lorsque Carl Joachim Friedrich et Hannah Arendt s’en sont emparé ; ils n’en ont pas seulement fait une catégorie heuristique au service des sciences politiques, de la philosophie politique et de l’histoire : ils s’en sont également servi comme une arme polémique au service d’un combat idéologique. La vertu polémique de ce concept consistait justement à mettre, sinon sur un pied d’égalité, du moins dans une même catégorie les trois manifestations de ce concept quelque peu platonicien de « totalitarisme », qui se serait réalisé dans le fascisme, le stalinisme, le nazisme…
« Les nazis repentis qui ont mis en scène leur reconversion sont difficiles à trouver, quasiment inexistants (…) les anciens communistes, eux, sont légion »
Les trois sont éminemment comparables, de la même manière que l’on peut les comparer au New Deal de Franklin Roosevelt, à la démocratie française des années 1930, au Portugal de Salazar, à la Hongrie de Miklos Horthy ou à l’Autriche de Dollfuss. L’histoire, dans son essence même, repose sur la comparaison, du simple fait que j’écris en février 2020 sur des réalités passées ; un historien compare sans arrêt les choses, même sans le savoir. Ce qui pose problème, c’est l’assimilation ; de fait, des sciences politiques nord-américaines des années 1950-60 aux programmes scolaires français depuis les années 1990, on assiste à une dégradation de cette comparaison vers l’assimilation sur la base de critères tels que « le chef », « l’État », « la propagande », « la répression », le « parti unique », « l’homme nouveau »… Dans le cas du nazisme, cela ne marche pas.
Prendre au sérieux le discours des nazis est important. Les nazis refusent de se considérer comme « totalitaires », parce que le Reich est conçu comme le lieu de la liberté, mais aussi parce que le « totalitarisme » repose sur un « État total », et que les nazis, contrairement aux fascistes – italiens, donc latins et romains, héritiers d’une tradition étatiste – rejettent le concept d’État. De la même manière, les nazis vomissent « l’homme nouveau », autre critère définitionnel du « totalitarisme » : ils ne veulent pas se projeter dans l’avenir mais revenir à l’origine ; la régénération n’est pas pour eux la projection vers le nouveau mais le retour aux temps inauguraux, ceux de la naissance de la race. Autrement dit, l’archétype est pour eux l’archaïque. La catégorie de « totalitarisme », si elle peut être intéressante, n’est absolument pas heuristique, et les historiens du nazisme ne l’emploient pas – elle est l’apanage de vulgarisateurs de deuxième ou troisième main. Lisez également Nicolas Werth, meilleur spécialiste mondial du stalinisme : vous aurez du mal à trouver cette catégorie ; lorsqu’on fait de l’histoire, on ne manie pas des concepts platoniciens qui couchent une réalité historique sur un lit de Procuste.
LVSL – Vous écrivez que Reinhard Höhn n’a jamais complètement cessé d’être nazi. De fait, comme une partie importante de l’élite du IIIème Reich, il a rapidement trouvé un nouveau statut au sein de la RFA sans jamais avoir eu à faire son mea culpa. Y a-t-il d’anciens nazis ?
JC – Les repentis qui ont mis en scène leur reconversion sont difficiles à trouver, quasiment inexistants. L’exemple le plus emblématique est celui de Melita Maschmann, cette haute responsable des BDM, les jeunesses féminines hitlériennes qui a rédigé un livre dans les années 60 qui s’intitule Fazit (« Bilan »), où elle évoque son expérience. On trouve quelques maigres exemples, mais ils sont extrêmement rares par rapport aux anciens communistes qui, eux, sont légion.
Cela vient peut-être de la différence dans la manière dont les staliniens, bolchéviques et communistes d’une part, nazis de l’autre, concevaient l’identité. Pour les premiers, l’identité est culturelle : vous êtes bourgeois, mais vous pouvez devenir communiste, vous êtes communiste et vous pouvez trahir – c’est ce qui permet à la terreur stalinienne de frapper n’importe où, n’importe qui, à n’importe quel moment parce que l’identité n’est pas fixe, elle est culturelle et fondée sur la liberté. Vous pouvez donc changer, renier, vous repentir.
Sous le IIIème Reich, en revanche, les identités sont fixes et c’est la biologie qui les définit. Si vous êtes juif et que vous vous convertissez au protestantisme, vous restez juif ; si vous êtes allemand et communiste, on pourra peut-être, à force de coups – c’est à cette fin que les camps de concentration sont ouverts en 1933 – vous rééduquer et vous faire revenir à votre essence biologique, à votre identité, mais si vous êtes d’une autre race c’est impossible. Peut-être cette idée est-elle demeurée fortement ancrée dans le for intérieur des partisans du nazisme, qui s’estimaient confondus biologiquement, corporellement, existentiellement avec leur idée, leur mission. Écoutez les témoignages des anciens combattants du Front de l’Est, qu’ils soient allemands ou volontaires français nazis de la division Charlemagne : ce sont des gens qui ne vont jamais rien renier. Ils estiment au contraire que l’on doit ériger des statues à leur gloire puisque qu’ils ont sauvé l’Europe du bolchevisme.
Reinhard Höhn n’a jamais eu un mot sur le passé nazi de son pays, de ses collègues (ceux mêmes qu’il emploie dans son école de management) et du sien propre. Après 1945, il n’a certes plus affirmé qu’il fallait réduire les Slaves en esclavage ou se débarrasser des juifs, il n’a pas d’ailleurs dit le contraire : pas un mot de regret, de remord ou de retour, sinon critique, du moins réflexif. Il reste en revanche obsédé par l’idée que la vie est un combat, que la performance est la valeur ultime de l’individu, celui-ci n’ayant pas de valeur absolue. Le droit allemand, depuis 1945, affirme que « la dignité de l’homme est intangible » (article 1 de la Loi Fondamentale de 1949) mais, pour Höhn, la valeur de l’individu n’est pas essentielle, elle est relative, référée à sa capacité productive dans ce combat qu’est la vie et qu’est le monde pour la maîtrise des ressources, l’approvisionnement et la survie de l’espèce.