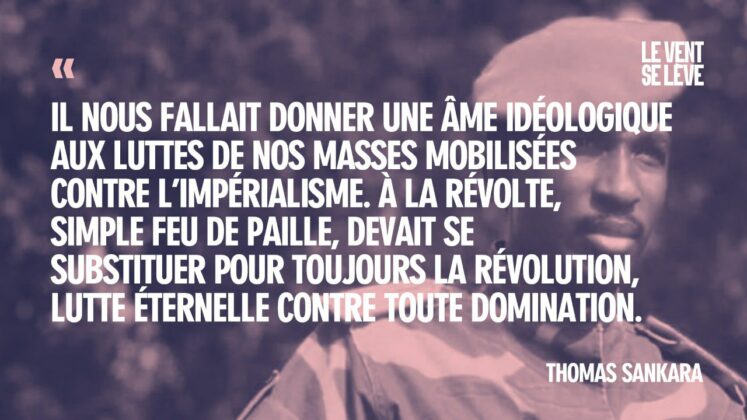Alors que l’ensemble des pays sahéliens continue de s’enfoncer dans la crise sécuritaire, le Burkina Faso vient de franchir la barre du million de déplacés internes – pour environ 20 millions d’habitants. Les groupes « djihadistes » [1] semblent y gagner du terrain, comme en témoigne l’attaque d’humanitaires français et nigériens à proximité de Niamey le 9 août ou celle d’un poste-frontière entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire le 11 juin dernier. Comment comprendre l’extension des espaces contrôlés par les « djihadistes » ? Faut-il y voir le succès d’une idéologie politico-religieuse ? Le résultat de conflits ethniques ? L’expression d’une simple criminalité organisée ? Ce sont surtout des facteurs structurels qui expliquent l’attrait d’une partie de la population pour ces organisations funestes : l’appauvrissement des campagnes, les tensions foncières et la crise de légitimité de l’État.
Pauvreté rurale, tensions foncières
Les campagnes burkinabè connaissent une situation de pauvreté durable pour trois raisons principales : la croissance démographique, la désertification, et le manque d’investissements, notamment de la part de l’État. Dans ce contexte, l’Union africaine estime : « Malgré les efforts de libéralisation de l’espace politique, la lutte pour l’accès à la terre et aux ressources naturelles demeure l’un des principaux facteurs qui alimentent l’instabilité en Afrique. [2] »
Bien que le Burkina Faso subisse, comme la plupart des pays d’Afrique, un fort exode rural, la population des campagnes continue de croître : elle a doublé entre 1985 et 2019, passant d’environ 7 à 14 millions de personnes. Conséquence immédiate : plus d’hommes pour moins de terres. Dans un contexte où les moyens de faire croître la productivité de l’agriculture sont quasi inexistants, les communautés villageoises disposent de peu de solutions pour permettre à chacun de subvenir à ses besoins : partager les terres, en mettre de nouvelles en culture, pousser les jeunes à en trouver une dans un autre village ou à aller vivre en ville. De surcroît, contrairement à l’idée selon laquelle l’élevage pastoral – qui concerne essentiellement les Peuls, ethnie présente dans toute l’Afrique de l’Ouest – serait un archaïsme en voie de disparition et que tous les peuples seraient destinés à se sédentariser, le nombre de pasteurs demeure croissant [3].
La disponibilité des terres diminue non seulement par rapport à la population, mais aussi de manière absolue du fait de la désertification [4]. Les sols des régions arides et semi-arides – c’est-à-dire presque tout le territoire burkinabè – sont particulièrement fragiles et se dégradent rapidement. Certes, le changement climatique y est pour beaucoup, mais la surexploitation des terres agricoles, les défrichements et le surpâturage représentent des pratiques très néfastes.

Si la dégradation des sols touche surtout le nord du pays, d’autres espaces, comme le sud-ouest et le centre, connaissent une forte pression foncière. Depuis une dizaine d’années, les « nouveaux acteurs » – cadres administratifs, personnel politique, entrepreneurs, etc. – investissent en se rendant acquéreurs de parcelles relativement grandes (plusieurs dizaines ou centaines d’hectares). La spéculation côtoie l’agrobusiness, avec la culture notamment du coton ou de la noix de cajou destinés à l’exportation. Le processus de « titrisation » des parcelles, c’est-à-dire la transformation des droits coutumiers en droits de propriété privée exclusifs, initié sous le régime de Blaise Compaoré (1987-2014) [5], facilite les acquisitions par ces « nouveaux acteurs ».
Le pays se rapproche ainsi de plus en plus d’une situation de saturation foncière, où toutes les terres arables ou dédiées au pâturage sont exploitées. Cette situation engendre des conflits entre éleveurs pastoraux et agriculteurs du fait des empiétements des troupeaux sur les champs et de la destruction des cultures. Le chercheur Alexis Gonin identifie plusieurs sources de tension : la concurrence dans l’accès aux points d’eau ; l’augmentation du nombre d’agriculteurs qui se lancent également dans l’élevage et menacent le droit de vaine pâture des pasteurs (droit de faire paître ses troupeaux sur les restes des cultures après la récolte) ; la tendance des « nouveaux acteurs » à clôturer leurs parcelles pour s’en assurer la jouissance exclusive [6] ; les couloirs de circulation des troupeaux qui se réduisent à mesure que les espaces cultivés s’étendent, obligeant les pasteurs à empiéter sur les cultures [7].
Pourtant, l’État est censé garantir l’accès aux pâturages pour les éleveurs pastoraux, comme le stipule la loi 034/2002 portant loi d’orientation relative au pastoralisme. Dans le sud-ouest du pays, les éleveurs ont été encouragés à s’installer après les sécheresses des années 1970-1980 en bénéficiant de zones aménagées et réservées. Mais aujourd’hui, face à la pression des agriculteurs cherchant à s’approprier ces espaces, les autorités coutumières remettent en cause les droits des éleveurs.
Comment, dès lors, se résolvent les conflits qui éclatent régulièrement entre pasteurs et agriculteurs ? C’est l’autorité coutumière qui s’en charge [8] à travers la commission de conciliation foncière villageoise. Lorsqu’elle ne parvient pas à accorder les parties en présence, ou que les enjeux sont trop importants, c’est la justice qui est saisie. En pratique, l’autorité coutumière, traversée par les rapports de force qui se jouent entre pasteurs et agriculteurs, est plutôt favorable aux seconds. Quant à la justice, elle est critiquée pour sa lenteur, son inefficacité, voire sa corruption.
À tout cela s’ajoute une autre source d’insécurité foncière pour les éleveurs : les aires protégées. Patrice Akiam, auteur d’un mémoire [9] sur la question, explique : « Il s’agit notamment des deux plus grands complexes écologiques du pays qui regorgent en leur sein d’aires de faune, de ranchs, de parcs, de corridors ainsi que de zones villageoises d’intérêt cynégétique. Le premier et le plus important est le complexe W-Arly-Pendjari situé à l’est, à cheval entre le Burkina Faso, le Bénin et le Niger ; le second est le complexe Pô-Nazinga-Sissili, situé dans le centre-sud. Ces différents espaces contiennent plusieurs zones correspondant à différents niveaux de protection, certaines étant interdites aux éleveurs (les ranchs, les Parcs, etc.), d’autres accessibles (les zones tampon, les zones de pâtures, etc.). Bien que ce zonage soit en partie négocié avec les chefs coutumiers locaux et les représentants des pasteurs, les tensions entre agriculteurs et éleveurs demeurent. Cela est dû aux empiétements des zones tampons et de pâtures par les agriculteurs, toujours en quête de nouvelles terres à défricher, entraînant une réduction considérable des espaces de pâturage pour les pasteurs. La conséquence est l’empiétement sur les cultures et d’autres espaces protégés par les éleveurs, dû au manque de pâturages. »
Aux problèmes agricoles s’ajoute la situation préoccupante touchant aux mines d’or. La forte hausse du cours de l’or depuis le début des années 2000 a aiguisé les appétits, entraînant une concurrence toujours plus forte pour accéder aux mines artisanales et aux sites d’orpaillage. Les groupes « djihadistes » trouvent là un moyen de se financer, notamment au nord et à l’est du pays, où les attaques sont devenues fréquentes. Ces groupes profitent soit de l’absence de l’État, soit du comportement prédateur de ses agents ou des milices qu’il utilise et qui poussent les orpailleurs à les rejoindre [10].

Crise de l’État social, crise de l’État régalien
Troisième facteur de pauvreté dans les campagnes : la crise de l’État social et le manque d’investissements publics. Concrètement, tout manque : eau, électricité, écoles, dispensaires, routes, etc. Le chercheur Ra-Sablga Ouédraogo va jusqu’à analyser les mouvements « djihadistes » comme une insurrection – prenant les formes les plus détestables qui soient – des marges contre le pouvoir central qui les abandonne à la misère, tandis que les conditions de vie dans les villes sont relativement meilleures [11].
Encore plus grave que la crise de l’État social est celle de l’État régalien. Dans le nord du pays, les fonctionnaires et les forces de sécurité, qui souvent ne sont pas issus de ces localités et ne parlent pas le fulfuldé – la langue des Peuls –, sont plus souvent perçus comme des étrangers cherchant à s’enrichir que comme des agents chargés de fournir des services [12]. Les forces de sécurité commettent de nombreuses exécutions extrajudiciaires dans le cadre de la lutte antiterroriste et le recrutement de civils volontaires dans l’armée augmente le risque de dérives. À Djibo, dans le nord du pays, 180 corps ont été retrouvés. Ces exécutions, « justifiées » par des soupçons de complicité avec les « djihadistes », fonctionnent comme des « prophéties autoréalisatrices » [13] : les proches des victimes finissent par chercher protection ou vengeance auprès des groupes « djihadistes ».
Le banditisme et les « coupeurs de routes » se sont développés ces dernières années et l’État n’est pas en mesure de les réprimer du fait de la faible couverture territoriale des forces de sécurité. Face à cela et à la montée du « djihadisme », il a laissé et même encouragé le développement de milices d’autodéfense appelées « koglweogo », qui se sont rendu coupables d’exactions, voire de massacres [14]. Censées assurer la sécurité des populations, ces milices aggravent les tensions en entretenant un cycle de violences et de vengeances. Ce fut en particulier le cas le 1er janvier 2019 lors des massacres de Yirgou quand, en réponse à une attaque « djihadiste » survenue la veille, les koglweogo ont assassiné plusieurs dizaines [15] de pasteurs peuls, accusés de complicité avec les assaillants.
L’inefficacité et le manque de moyens de la justice poussent à la surenchère violente. La lenteur des procédures, malgré la création d’un pôle antiterroriste en 2017, conduit des militaires à exécuter des suspects. Le massacre de Yirgou, comme de nombreux autres règlements de compte, est survenu aussi en raison du manque de confiance dans la justice de l’État : les populations préfèrent se faire justice elles-mêmes. De plus, les pasteurs peuls ont de grandes difficultés à faire respecter leurs droits en raison du climat de méfiance réciproque entretenu avec l’administration ; un an après le massacre de Yirgou, seules douze personnes ont été arrêtées et leur jugement se fait toujours attendre.

La crise de légitimité de l’État procède aussi de la corruption qui existe en son sein. En témoigne une vaste affaire d’acquisitions illégales de parcelles urbaines. Le rapport de la commission d’enquête parlementaire sur le foncier urbain paru en 2016 pointe « la forte ingérence du politique dans la gestion du foncier. C’est ainsi que dans l’activité de promotion immobilière, des promoteurs liés aux milieux politiques ont pu bénéficier d’énormes facilités qui ne sauraient prospérer dans un contexte de bonne gouvernance et de respect de l’éthique en la matière. [16] » Au total, plus de 100 000 parcelles acquises illégalement et faisant l’objet de spéculations ont été saisies.
Si les conflits peuvent s’expliquer par les différentes causes structurelles identifiées ici, la dynamique des violences tend à s’autonomiser [17]. Chaque attaque – qu’elle vienne des « djihadistes » ou des milices – encourage un peu plus les populations à s’organiser et à s’armer pour se défendre et se venger. Et ceci entretient un cercle vicieux de violences et de contre-violences, prenant de plus un caractère ethnique.
C’est sur ce terreau que prospère le « djihadisme ». Les conflits ouverts ou larvés avec les agriculteurs accentuent la marginalité sociale des pasteurs peuls, liée à leur mode de vie. C’est ce qui amène une partie d’entre eux à collaborer avec les « djihadistes ». L’International Crisis Group analyse : « La surreprésentation présumée de la communauté peule parmi les djihadistes traduit moins une prédisposition au djihad que l’exposition particulière des éleveurs et des propriétaires fonciers peuls à des situations d’injustice et leur plus faible intégration aux institutions étatiques, à commencer par l’école publique. [18] » Et la stigmatisation des Peuls conduit à la « prophétie autoréalisatrice » identifiée plus haut. Donc bien loin d’une lecture culturaliste, il est nécessaire de comprendre les motivations des « djihadistes » à partir du contexte socio-économique.
C’est également ce qui explique les alliances conjoncturelles de bandits et de « coupeurs de routes » avec les « djihadistes ». La situation d’extrême pauvreté facilite grandement le recrutement de ces organisations, il suffit parfois de quelques dizaines de milliers de francs CFA [19] pour attirer des combattants. De ce point de vue, la situation des jeunes ruraux est particulièrement préoccupante : un accès à la terre de plus en plus difficile, un faible niveau d’éducation – quand ils ne sont pas illettrés – qui leur enlève la possibilité de s’intégrer au secteur formel en ville, et les voici réceptifs aux propositions de groupes armés qui leur garantissent des revenus et un statut social. De ce fait, bien qu’on suive l’hypothèse selon laquelle les cadres des formations « djihadistes » auraient des ambitions politico-religieuses – contrôler des territoires et imposer leur vision de la « charia » –, la plus grande part des combattants intègre en réalité ces organisations par opportunisme ou par détresse. L’armée ne peut résoudre ces problèmes, la réponse se doit d’être politique.
[1] Il existe un débat sur le caractère ou non religieux de ces groupes armés. Bien que le terme « djihadisme » soit répandu dans la presse et les diverses publications, il a le défaut de donner la prééminence aux motivations religieuses. La Banque mondiale ou le PNUD préfèrent l’expression « groupes extrémistes violents », en mettant l’accent sur leur caractère criminel et les trafics qu’ils opèrent. Par ailleurs, ces groupes sont nombreux et divers (Katiba Macina, Al-Qaida au Maghreb Islamique, Front de libération de l’Azawad, etc.) ; ils affichent des motivations et des modes d’actions différents, se font concurrence ou coopèrent ponctuellement. Tout ceci complexifie beaucoup l’analyse. Dans cet article, le terme « djihadiste » sera employé entre guillemets pour mettre ce débat en évidence. Cf. Giovanni Zanoletti, « Sahel : pourquoi prendre les armes ? Une revue de la littérature », Papiers de recherche, n°134, Agence française de développement, juillet 2020.
[2] Union africaine, Banque africaine de développement, Commission économique pour l’Afrique, « Cadre et lignes directrices sur les politiques foncières en Afrique », 2010.
[3] Comité scientifique français de la désertification, « Pastoralisme en zone sèche. Le cas de l’Afrique subsaharienne », Les Dossiers thématiques, n°9, 2012.
[4] On estime qu’à l’échelle de l’Afrique, environ 4% des terres sont menacées de dégradation irréversible. A fortiori, ce chiffre doit être bien supérieur au Sahel. Cf. « La désertification, un constat alarmant », Groupe de travail désertification, 2017.
[5] Notamment avec la loi portant réorganisation agraire et foncière de 1996 et la loi de 2009 portant régime foncier.
[6] On peut rapprocher ce phénomène au « mouvement des enclosure », qui a eu lieu en Angleterre entre le XVIe et le XVIIe, marquant le passage d’un système de propriété communautaire à un système de propriété privée. Cf. Giovanni Zanoletti, « Mali : le “jihad de la vache” », Libération, 12 juin 2019.
[7] Alexis Gonin, « Concurrences spatiales, libre accès et insécurité foncière des éleveurs (sud-ouest du Burkina Faso) », Les Cahiers du Pôle Foncier, n°21, 2018.
[8] Ceci a été formalisé avec la loi 034/2009 portant régime foncier et ses décrets d’application.
[9] Patrice B. Akiam, « Dynamiques des systèmes agraires et conservation d’une aire de faune en pays Kasséna : analyse sociologique du cas du « couloir des éléphants » dans le complexe dit PONASI dans la province du Nahouri au Burkina Faso », Mémoire de master en Sociologie, Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou, 2019.
[10] International Crisis Group, « Reprendre en main la ruée vers l’or au Sahel central », Rapport Afrique n°282, novembre 2019.
[11] Panel de l’Institut Free Afrik, « Burkina Faso : comment faire nation face à l’insécurité terroriste, sanitaire et socio-économique ? », avec Aziz Diallo, Fidèle Ouoba et Ra-Sablga Seydou Ouédraogo, 7 juin 2020.
[12] International Crisis Group, « Nord du Burkina Faso : ce que cache le jihad », Rapport Afrique n°254, 2017.
[13] International Crisis Group, « Burkina Faso : sortir de la spirale des violences », Rapport Afrique n°287, 2020.
[14] Rémi Carayol, « Les milices prolifèrent au Burkina Faso », Le Monde diplomatique, mai 2020.
[15] Le bilan officiel mentionne une soixantaine de morts, mais certaines estimations vont jusqu’à 210.
[16] Commission d’enquête parlementaire sur le foncier urbain au Burkina Faso, Rapport général, 2016.
[17] Giovanni Zanoletti, « Sahel : pourquoi prendre les armes ? Une revue de la littérature », op. cit.
[18] International Crisis Group, « Burkina Faso : sortir de la spirale des violences », op. cit.
[19] 1 euro = 656 francs CFA, donc 10 000 francs CFA = 15,20 euros.