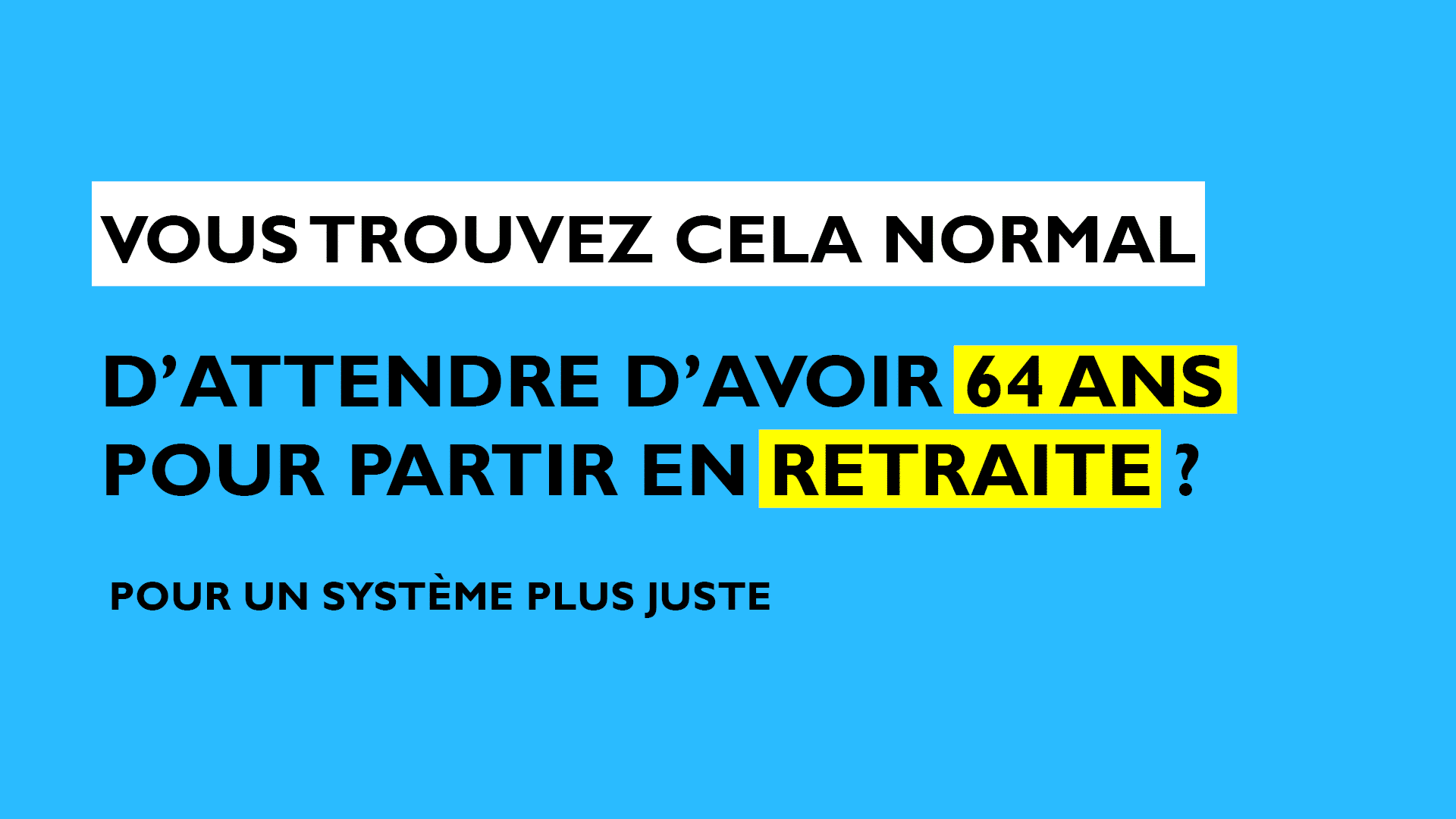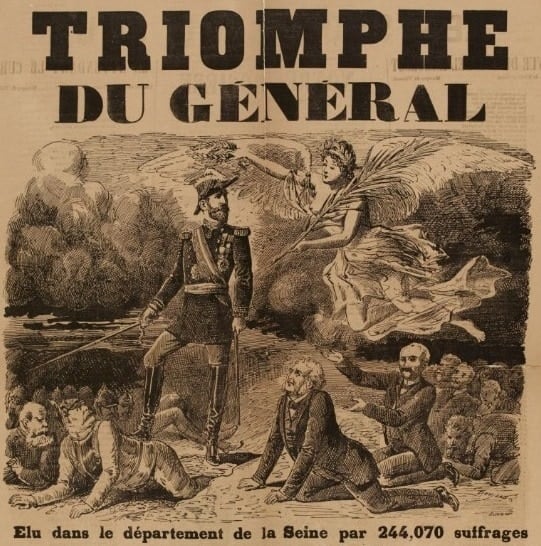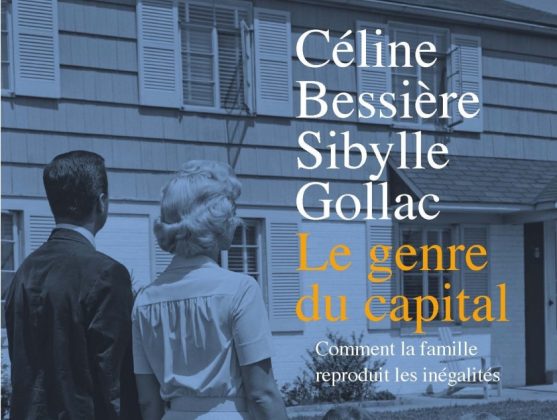Gérald Darmanin était déjà ministre. Le 6 juillet 2020, il a été promu ministre de l’Intérieur, en remplacement de Christophe Castaner. Cette promotion ne passe pas et pour cause. Nommer chef de la police quelqu’un accusé de viol alors que l’enquête est en cours pose problème à plusieurs niveaux. Quid du respect de la présomption d’innocence ? Que veut dire cette promotion ? C’est ce que cet article va tenter de décrypter.
Pour qu’une enquête puisse être menée, il faut que la hiérarchie ne soit pas impliquée dans l’affaire. Le capital symbolique qui auréole la fonction et son statut direct de chef de la police ne poserait aucun problème si l’on suivait la logique gouvernementale qui a présidé à sa nomination…
Des mobilisations sur l’ensemble du territoire
Ces dernières semaines, les mobilisations se sont multipliées pour dénoncer les nominations d’Éric Dupond-Moretti et de Gérald Darmanin. Le premier, devenu garde des Sceaux est critiqué pour différentes sorties très critiques à l’égard du mouvement MeToo. Si ces propos semblent naturels pour certains observateurs du point de vue de la situation de son discours – celle d’un avocat qui déplore que Twitter se soit un temps apparenté à un tribunal, position qui revêt en effet une certaine cohérence – il n’avait pas non plus manqué de donner son avis. Selon lui, certaines femmes apprécieraient ainsi le fait de se faire siffler dans la rue… Les femmes remercieront le nouveau garde des Sceaux qui, s’il a en effet donné à la France de très beaux plaidoyers, pourrait s’abstenir de dire ce qui plaît aux femmes ou non.

© Marion Beauvalet
Un article publié le 7 juillet sur le site de France Inter intitulé « Éric Dupond-Moretti, l’anti-MeToo » recense les prises de position du nouveau ministre : concernant DSK et le Carlton, « n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une affaire de copains qui s’offrent du bon temps » (2015), sur MeToo « Le mouvement #MeToo a permis de libérer la parole et c’est très bien. Mais il y a aussi des ‘follasses’ qui racontent des conneries et engagent l’honneur d’un mec qui ne peut pas se défendre car il est déjà crucifié sur les réseaux sociaux » et enfin pour ne pas plus étendre la liste « il y a aussi des femmes que le pouvoir fait bander » à propos de #BalanceTonPorc. Si l’opinion n’est pas un délit, il paraît ici difficile de considérer la colère des personnes mobilisées comme illégitime.
De très nombreux rassemblements ont ainsi été organisés le vendredi 10 juillet, l’un des plus impressionnants en termes d’images étant celui du parvis de l’Hôtel de Ville à Paris. Des pancartes, des chansons, des chorégraphies et surtout une place plus que remplie. Le Gouvernement affirmait que la cause des femmes serait la grande cause du quinquennat, qu’en est-il aujourd’hui ?
https://www.instagram.com/p/CC1ATvHgky_/
Marlène Schiappa : quel bilan ?
Passons tout d’abord au crible le bilan de Marlène Schiappa. Son féminisme est un féminisme revisité par le macronisme : éminemment libéral et dépourvu de structuration idéologique. Ses grands repères sont ceux que nous avons toutes et tous en tête, pour autant il n’y a aucun projet, aucune vision politique qui en découle. Et pour cause, quand on ne met pas de moyens dans des sujets pour lesquels la tâche est immense, la prophétie se réalise : rien ne change, tout continue comme avant. Son secrétariat d’État a été celui du storytelling, des effets d’annonce avant tout.
La seule avancée notable est celle de l’allongement du délai de prescription de vingt à trente ans pour les crimes sexuels commis sur des mineurs, avec pour bémol le fait que cela ne concerne que les mineurs. Pour dresser un bilan honnête de son action, regardons du côté des coupes budgétaires. Celles-ci avaient été actées dès 2017 avec le rapport relatif au décret n° 2017-1182 du 20 juillet 2017 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance. Dans un article pour Marianne, Floriane Valdayron analysait : “La réserve de précaution permet de rendre une fraction de crédits indisponible dès le début de la gestion d’un budget, une façon de mettre de côté en cas d’urgence. Cette partie est totalement rognée. Restent 4,2 millions à chercher ailleurs”.
Dans une allocution à l’Assemblée nationale, Clémentine Autain déclarait que “le tissu associatif de proximité est aujourd’hui en danger en raison de votre choix de l’austérité pour les comptes publics. De la même manière, les femmes victimes de violences conjugales sont confrontées au défaut de places en hébergement d’urgence. En Seine-Saint-Denis, je viens de l’apprendre, l’État a annoncé, pour 2018, une coupe sèche de 9 % du budget réservé à l’hébergement d’urgence”.
Espérons donc que le bilan d’Élisabeth Moreno sera davantage porteur d’avancées pour les femmes, quitte à ce que sa communication soit moins flamboyante. On peut en douter au regard du discours de la nouvelle secrétaire d’État lors de sa prise de fonction, qui évoque la « complémentarité entre les sexes ». Son féminisme est tout aussi libéral que celui de sa prédécesseure, centré sur la réussite sans questionner les conditions qui créent des situations d’inégalité. Un discours fade et potentiellement dangereux car il intègre les logiques d’austérité au détriment de la possibilité immédiate dont pourraient disposer des femmes en danger de quitter par exemple le domicile conjugal pour fuir des actes de violence.
En réalité, son féminisme est assurément conservateur, la complémentarité impliquant une forme d’essentialisation du féminin et du masculin. Cela naturalise les rapports sociaux et inscrit dans le marbre des rapports de domination, des habitudes qui doivent être combattues, déconstruites ou dépassées.
Très inquiète du féminisme qu'annonce Elisabeth Moreno. Clairement libéral mais aussi conservateur. La "complémentarité entre les sexes" qu'elle évoque est une notion directement inspirée de la doctrine catholique, la négation du principe de la déconstruction des rôles de genre. pic.twitter.com/Dp6K58Rutm
— Camille Froidevaux-Metterie (@CFroidevauxMett) July 8, 2020
Outre ces deux nominations ministérielles, c’est toute la promesse de ce quinquennat (si certains y croyaient encore) qui se trouve une fois de plus malmenée et oubliée. Revenons maintenant au nœud de cette affaire, une fois les éléments du décor fixés.
Le cas Darmanin, au-delà de la présomption d’innocence
L’Élysée a fait savoir très rapidement que les enquêtes en cours ne faisaient pas obstacle à sa nomination. Il est juridiquement incontestable que le respect de la présomption d’innocence s’impose au justiciable Darmanin. En revanche, la situation politique et morale a cependant considérablement changé depuis les précédents quinquennats : lorsqu’un des ministres de François Hollande voyait une enquête ouverte contre lui, il quittait sa fonction par principe pour ne pas entacher l’ensemble du Gouvernement ou voir sa légitimité affaiblie et par la même sa tâche plus dure à accomplir.
Lors du précédent quinquennat, ce sont cinq ministres qui avaient fait le choix de laisser leur portefeuille après l’ouverture d’enquêtes : Kader Arif, Thomas Thévenoud, Yamina Benguigui, Bruno Le Roux et Jérôme Cahuzac. Sans remonter plus loin, François Bayrou, Sylvie Goulard et Marielle de Sarnez, les ministres issus du MoDem avaient également quitté leurs fonctions au début du mandat d’Emmanuel Macron pour que l’instruction puisse se mener librement.
La défense de Gérald Darmanin au plus haut de l’État est donc un choix tout sauf évident, et entraîne des conséquences politiques graves que le gouvernement actuel ne pouvait pas ne pas anticiper. Doit-on comprendre ici que des accusations de viol sont moins graves ou moins compromettantes que des détournements de fonds ou des emplois fictifs ? Chacun est libre de son interprétation mais force est de constater que le choix de renoncer à une fonction pour des raisons d’intégrité éthique et politique face à la justice est une coutume républicaine qui aurait pu être invoquée en la présente circonstance.
C’est en ce sens qu’a réagi Ségolène Royal : « Est-ce qu’une enquête judiciaire sur un ministre pour emploi fictif aurait empêché à la nomination de ce ministre ? C’est évident. Donc une enquête judiciaire pour soupçon de viol est considérée moins grave qu’une enquête judiciaire pour emploi fictif ? ». Elle n’est pas la seule à avoir souligné cela : après des semaines de tribunes appelant à l’union de la gauche, les colonnes se sont remplies de tribunes pour ou contre la nomination de Gérald Darmanin. Sans étonnement, les défenseurs du ministre sont essentiellement, si ce n’est exclusivement issus des rangs de la majorité présidentielle.

« On ne combat pas une injustice par une autre injustice. Nous sommes engagés pour les droits des femmes et nous avons pleinement confiance dans ce nouveau gouvernement pour continuer à œuvrer comme nous le faisons depuis le début du quinquennat » : voilà la grande idée des signataires de cette tribune co-signée par des parlementaires qui affirment leur confiance dans le gouvernement. S’ils estiment cette mandature satisfaisante concernant l’action en faveur du droit des femmes, il ne faut pas s’étonner qu’ils ne voient aucun souci à nommer Gérald Darmanin ministre de l’Intérieur.
Face à ce texte, deux autres tribunes : la première portée par 91 intellectuelles et militantes féministes, notamment Svetlana Alexievitch, Prix Nobel de littérature : « Le remaniement ministériel en France est une expression supplémentaire de la recrudescence des attaques dont nous faisons l’objet partout dans le monde. Il appelle à une union de nos voix et de nos efforts. Nous ne tolérerons ni reculs ni marginalisation de nos luttes. Notre colère ne faiblira pas car nos droits et notre dignité ne sont pas négociables. Face au backlash, la solidarité internationale doit s’intensifier aux quatre coins du monde. Nous nous y employons », peut on lire.
La seconde est née sous la plume de l’ancienne ministre et maire du 7ème arrondissement Rachida Dati. Elle accuse directement Emmanuel Macron d’instrumentaliser les questions sociétales à des fins électorales tout en franchissant allègrement des « lignes rouges ».
Dans cette seconde tribune, Rachida Dati ne manque cependant pas de ré-affirmer qu’elle est une femme de droite : « J’ai toujours assumé que l’on puisse se poser des questions sur les sujets liés à la famille, à la procréation, à la fin de vie. Ils appellent une réflexion éthique, philosophique, parfois spirituelle et religieuse ». Son texte, partagé sur Twitter par Valérie Pécresse dessine ainsi un front des femmes qui dépasse les clivages politiques.
Comme @datirachida, je refuse la banalisation des plaintes pour viol et qu’on minore la parole des femmes. Bien sûr @GDarmanin a pleinement droit à la présomption d’innocence, mais le nommer Ministre de l’intérieur, maintenant, c’est une marque de mépris pour toutes les victimes https://t.co/62igMtSw8o
— Valérie Pécresse (@vpecresse) July 15, 2020
Pour autant, lorsque les contours des combats sont flous, il convient de se rappeler que si dans la période un grand nombre de femmes font bloc contre cette nomination, la conquête de l’égalité est plus le fait de la gauche que de la droite, si on entend la gauche comme le camp des luttes sociales et du progrès.
Aussi, s’il faut collectivement se féliciter de l’ampleur de la réaction à l’égard de cette nomination, il ne faut pour autant être dupe sur les raisons qui poussent certaines personnes à prendre position : défense de son propre camp politique, peinture féministe à peu de frais dans des organisations en recomposition et dans une période un peu creuse en termes de scrutin. Pour certains, la prise de position peut également être le fait d’un certain opportunisme ou tout du moins ne pas faire oublier que si La République En Marche ne défend pas la cause des femmes, ce n’est pas non plus chez Les Républicains qu’elle est servie.
Rappelons-les ici : les chiffres concernant les violences et agressions sexuelles sont incroyablement élevés. Sur France Culture (émission du 16 janvier 2018), la psychiatre Muriel Salmona expliquait que « c’est jusqu’à 16 % de femmes qui subissent des viols et des tentatives de viols ». Elle précisait ensuite qu’en 2017, 93 000 femmes avaient été violées. Pour autant, 10 % d’entre elles portent plainte et 10 % de ces plaintes déposées atteignent la cour d’assises. Ces données sont souvent très proches d’enquêtes réalisées par des instituts de statistiques publiques.
De même, le pourcentage de condamnations a considérablement diminué entre 2007 et 2016 et 70 % des plaintes pour viol ont été classées sans suite en France en 2016. Alors oui, la proportion de femmes qui a été agressée ou se fera agresser est incroyablement élevée et la traduction devant la justice de ces actes est incroyablement faible. Pour cause ? La difficulté de témoigner et de fournir des preuves, la peur, le jugement, l’attitude des policiers lors d’un dépôt de plainte. Le harcèlement au travail touche quant à lui une femme sur cinq selon un rapport du Défenseur des Droits (2015).
On ne trouve finalement que peu de crimes aussi banalisés que le viol et qui soient si faiblement punis. Chaque année ce sont des dizaines de milliers de femmes qui le subissent et qui ne pourront pas emmener leur agresseur devant la justice. C’est ici qu’il faut agir pleinement en continuant à travailler les mentalités, en facilitant les procédures.
Rendre la parole aux victimes pour changer les comportements
Un des moyens de changer cela serait qu’un nombre plus important de personnes agressées sexuellement parvienne à porter plainte, en changeant notamment la manière dont les questionnaires et l’enquêtes sont menés. La méthode de Philadelphie a permis d’améliorer de manière drastique cela dans les espaces où elle est appliquée.
En quoi consiste cette méthode ? Elle a été mise en place par l’avocate Carol Tracy : depuis l’année 1999, des groupes de défense des droits des femmes et des enfants révisent chaque année des plaintes d’agressions sexuelles qui ont été faites auprès de la police pour évaluer la qualité des enquêtes. Il s’agit d’une collaboration entre les policiers et les associations de défense des droits des femmes afin que les autorités fassent évoluer leur comportement et gagnent la confiance des victimes.
Dans une interview , Carole Tracy indique qu’un tiers des plaintes pour crimes sexuels « ne faisait pas l’objet d’une enquête ». Depuis, un groupe constitué de dix avocats et travailleurs sociaux de groupes de défense des droits des femmes révise plusieurs centaines de cas (entre 400 et 500) en moins d’une semaine. Il s’agit de regarder si les témoins ont été interviewés, si les victimes ont vraiment été interrogées et quelle était la nature des questions posées (notamment si elles contenaient des préjugés sexistes comme des questions concernant la tenue de la victime), si les preuves ont été recueillies…
Quand un problème est détecté, un capitaine de police est informé et des recommandations sont effectuées. Avec cette méthode, le taux de plaintes pour viol jugées non fondées par la police est passé de 18 % en 1998 à 6 % en 2016. Le nombre de plaintes déposées a quant à lui augmenté de 50%.
La Sûreté de Québec a également adopté cette méthode. À Montréal et à Québec, il s’agit de policiers et non de civils qui mènent les enquêtes, ce qui avait été déploré par les organismes d’aide aux victimes. Pour résumer, cette méthode consiste en une inversion du paradigme qui recentre l’enquête sur l’accusé et non sur la victime.
Tant que des solutions concrètes qui dépassent le storytelling et les grandes déclarations d’intention ne seront pas proposées, tant que 90% des victimes n’iront pas porter plainte, tant que le nombre d’agressions demeurera aussi haut alors oui, il peut sembler indécent de nommer un homme ministre sous le coup d’une enquête pour laquelle lui-même ne nie pas l’enjeu d’abus de position.
Cela est d’autant plus violent pour les personnes concernées ou non par des agressions que le traitement médiatique de la situation fait la part belle aux défenseurs de l’ordre établi. C’est encore une fois la parole des femmes qui se trouve diminuée, dé-légitimée dans la parole publique par l’exacerbation ces derniers jours d’une parole masculiniste.
De la solidarité masculine
“J’ai eu une discussion avec lui parce que c’est un responsable politique qui est intelligent, engagé, qui a été aussi blessé par ces attaques. Donc, il y a aussi une relation de confiance d’homme à homme, si je puis dire” : voilà ce que répondait Emmanuel Macron à Léa Salamé et Gilles Bouleau concernant la nomination de Gérald Darmanin.
Doigt d’honneur aux femmes mobilisées ou manifestation d’un inconscient pétri des codes de la masculinité ? La journaliste Laure Breton écrit dans Libération à ce propos : « La violence des mots présidentiels ne s’arrête pas là : décrédibilisant la victime présumée du désormais ministre de l’Intérieur (elle aurait tardé à faire éclater l’affaire, ce qui prouverait l’instrumentalisation politique), Emmanuel Macron confie que Gérald Darmanin a été «blessé» par les attaques de celles et ceux qui contestent sa promotion. C’est l’inversion du fardeau de la preuve, la victimisation de l’accusé, la confiance accordée sur le genre. Soit la triste routine dans les affaires de violences faites aux femmes, routine que des policiers et des magistrats de mieux en mieux formés essaient de faire mentir chaque jour sur le terrain ».
À cette analyse très juste vient tristement s’ajouter le lamento de Gérald Darmanin : celui-ci se dit victime d’une « chasse à l’homme », une déclaration allant dans le sens de ce que Laure Breton analyse en inversant la position du suspect et de la victime. Que le ministre de l’Intérieur ne s’en fasse pas, l’ensemble de l’exécutif vole à son secours : « Nous assistons à des dérives qui sont inadmissibles » a quant à lui répondu Jean Castex à la sénatrice socialiste Murielle Cabaret.
Cette défense pose un énorme problème puisqu’être accusé de viol implique qu’une enquête soit ouverte. Si une enquête est ouverte, alors un juge d’instruction doit être nommé et celui-ci aura à charge de commander des actes d’enquête à des policiers qui même dans le cas de la police judiciaire travailleront sous l’autorité de Gérald Darmanin. Comme l’explique Ugo Bernalicis dans une émission d’Arrêt sur Images à propos de l’affaire Fillon, « toute information sensible ayant une tendance irrépressible à ”remonter” la chaîne hiérarchique, ces informations remonteront à Gérald Darmanin ».
Si la présomption d’innocence existe, ce cas exceptionnel où il est probable que malgré la confiance « d’homme à homme » (rectifié en d’homme à femme par Elisabeth Moreno) entre le Président et son ministre l’enquête ne pourra pas se dérouler correctement, devrait à elle seule justifier de ne pas nommer cet homme à ce poste. En faisant ce choix, celles et ceux qui justifient la place de Gérald Darmanin font soit preuve d’une méconnaissance de la Justice soit d’un mépris pour une institution de plus en plus fragilisée et défaillante quand il s’agit des questions d’agressions ou de viols.
À celles et ceux qui pensent que défendre un ministre accusé de viol est une attitude subversive et un peu punk, entendons-nous : il n’y a rien de subversif à être du côté des dominants, qu’il s’agisse du pouvoir en place ou des hommes qui font front contre les « féministes ». Quand on voit la difficulté à porter un viol devant la justice, défendre un ministre au prétexte du respect de la procédure judiciaire témoigne avant tout d’une forme de cynisme qui – sous-couvert d’être une opinion marginale (à gauche peut-être) – ferait de ceux qui la proclament de meilleurs citoyens, capable de dépasser l’émotion et les affects pour respecter la justice, avec tout ce qu’elle a de sacré.
Cependant, c’est une institution qui dans le cas des viols et des agressions est clairement dysfonctionnelle. À quoi bon dès lors l’encenser, la défendre et que rien ne change ? Depuis quand le manteau de Créon est devenu plus dur à porter que celui d’Antigone ?
Jouer la mesure comme s’il y avait une posture qui n’était pas respectable dans le cadre de combats qui peinent à s’imposer, ce n’est pas être un meilleur citoyen, c’est défendre l’ordre établi sans le dire, en préférant se ranger du côté des dominants plutôt que des personnes mobilisées en faveur du changement. Dans Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Karl Marx écrit : « Pendant les Journées de juin, toutes les classes et tous les partis s’étaient unis dans le ”parti de l’ordre” en face de la classe prolétarienne, du ”parti de l’anarchie”, du socialisme, du communisme. Ils avaient ”sauvé” la société des entreprises des ”ennemis de la société” […] La société est sauvée aussi souvent que le cercle de ses maîtres se rétrécit et qu’un intérêt plus exclusif est défendu contre un intérêt plus large ». Ce mouvement permet à l’ordre de se maintenir en agrégeant autour de lui différents groupes face à une forme perçue comme subversive et ce qui était vrai avec les sujets économiques se re-dessine aujourd’hui avec les luttes dites sectorielles.
À l’opposition manichéenne de deux camps vient s’ajouter le relativisme de Gérald Darmanin qui expliquait le 18 juillet aux journalistes de La Voix du Nord qu’il “faut quand même mesurer ce que c’est que d’être accusé à tort, de devoir expliquer à ses parents ce qu’il s’est passé parce que, c’est vrai, j’ai eu une vie de jeune homme”. Ces propos n’ont pas manqué de faire à nouveau réagir les militantes féministes et personnalités qui ont dans l’ensemble pointé du doigt le décalage entre la gravité de ce qui se joue et la désinvolture de son propos.
Cela ne semble pas déranger, Claude Askolovitch s’interrogeant dans un papier publié sur Slate à propos de la jeunesse de Gérald Darmanin renommé pour l’occasion “le jeune D.” : « Je ne sais pas les circonstances du jeune D., quand une femme d’expérience vint lui solliciter une faveur politique qu’il échangea contre du sexe. Était-il, bambin cravaté, un heureux séducteur, ou un demi-puceau attardé et d’autant plus anxieux de goûter à la chair? Était-il collectionneur de bonnes fortunes ou bien confiné en misère sexuelle et y échappant d’une occasion bienvenue? Quel garçon fut cet homme dont des militantes féministes exigent la démission ? ». Dans cet article encore, la légèreté du propos peut surprendre si ce n’est choquer, Askolovitch nous rappelant là le “troussage de domestique” de Jean-François Kahn il y a quelques années.
Continuons la lecture attentive de cette tribune : “Au-delà même d’un viol dont je doute, et donc de l’infamie que porte ce mot s’il est mal employé, ce sont des complaisances mâles qui se trouvent éventées. L’escapade de Gérald D. me rappelle de pauvres ruses. Elle m’évoque le début d’un vieux roman de Bernard Frank, cet écrivain qui inventa l’expression ”les hussards” pour Nimier et Blondin. La scène est pénible de crudité. Un homme a levé une fille patraque et l’enrobe de mots jusqu’à sa jouissance ».
Claude Askolovitch, grand enquêteur sur l’enquête, se complaît à esthétiser les accusations dont le ministre fait preuve en faisant référence à un bref extrait du roman Les Rats de Bernard Frank (1953). L’extrait dont nous nous passerons ici décrit un viol et le plaisir qu’en tire celui qui le commet.
Dans les lignes qui suivent, le journaliste associe l’abus de position qui est au coeur de cette affaire avec la puissance. Tout ici est bon pour un scénario d’une série Netflix : le lien entre le pouvoir, la sexualité et les abus que cela peut engendrer, le tout sous la plume d’une personne reconnue qui dédramatise, explique et excuse en évacuant sous couvert de sublimation la dimension criminelle du viol, des rapports non-consentis et (ce qui serait peut être trop demandé) de la dimension problématique de rapports sexuels obtenus dans le cadre de rapports de domination évidents. Il s’agit ici d’une énième preuve du traitement spécifique réservé aux agressions sexuelles, de l’attouchement au viol.
Si cette nomination et les critiques qui l’entourent ne sont qu’une énième illustration du faible intérêt du Gouvernement pour la défense des femmes, elle témoigne aussi de manière plus structurelle du dysfonctionnement de la justice sur ces sujets. Les discours sont une fois de plus éloquents : un exécutif dont les têtes les plus importantes sont masculines (la promesse du Président concernant le choix d’une femme au poste de Premier ministre semble enterrée) fait bloc pour défendre un homme dont la position va pourtant entraver une enquête dans laquelle il est impliqué.
Ce choix est une violence faite aux femmes, une insulte à celles qui en plus d’être victimes doivent faire face à un chemin de croix pour déposer plainte et espérer un jour que leur agresseur soit condamné. Ce qui se joue ici, c’est la possibilité que les comportements changent un jour : tant que le viol demeurera un acte impuni, rien n’arrêtera les agresseurs. Laisser Gérald Darmanin ministre de l’Intérieur, c’est envoyer le pire signal qui soit à celles et ceux qui se battent pour que cesse un jour, enfin, l’impunité et la banalité des agressions sexuelles et du viol.