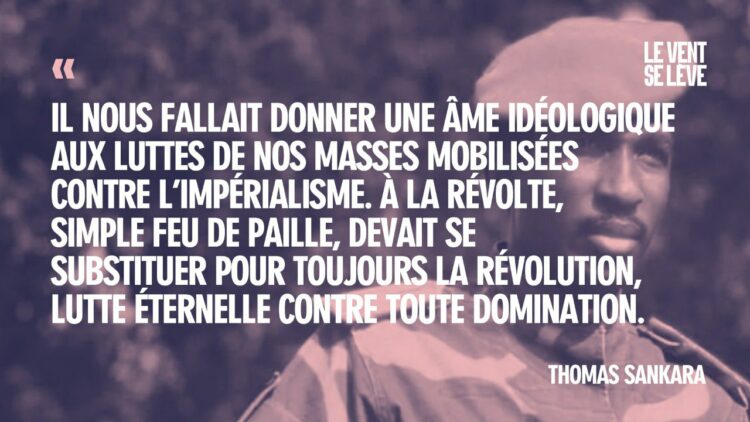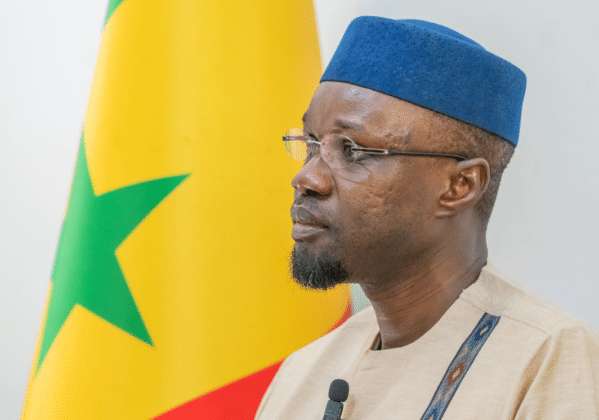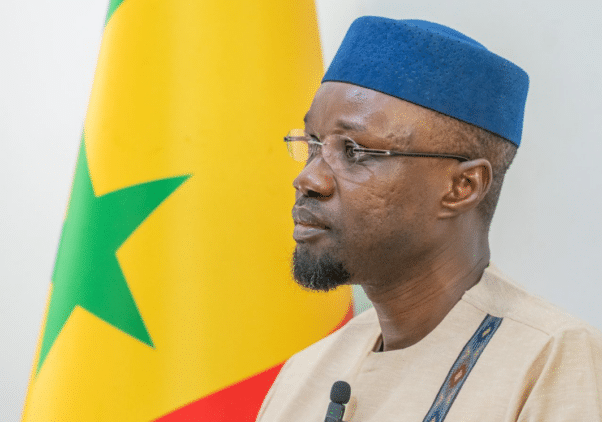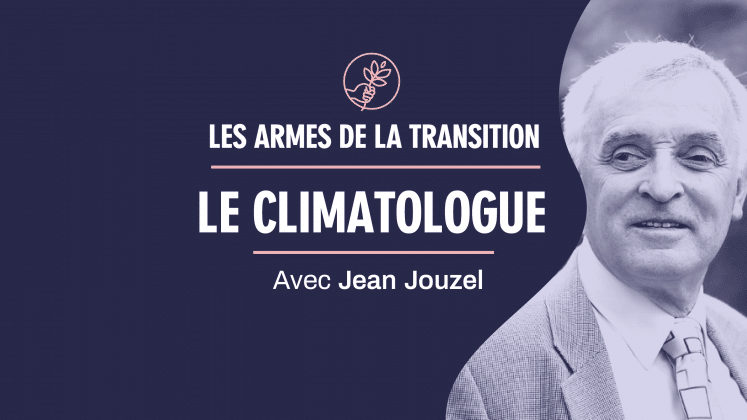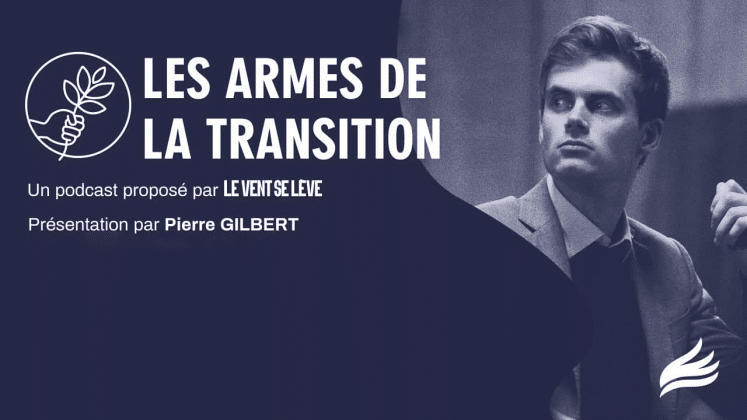Au Sénégal, les années 2023 et 2024 ont marqué un tournant politique majeur. Dans la foulée d’une mobilisation massive de la jeunesse violemment réprimée, l’élection du président Bassirou Diomaye Faye en mars 2024, portée par le Pastef et le charismatique Ousmane Sonko, a cristallisé l’espoir d’une rupture avec « l’ancien régime ». Le nouveau pouvoir, en promettant transparence, bonne gouvernance et souveraineté, a su canaliser l’élan d’une génération politisée, en quête de justice et de changements systémiques. Après plus d’un an, l’enthousiasme s’est essoufflé : face aux difficultés économiques et à la pression des marchés, la politique de rupture peine à se concrétiser. Sur le terrain, à Dakar comme dans les régions, les organisations de la société civile qui ont participé au mouvement protestataire restent vigilantes. Elles saluent certaines orientations « panafricanistes » et sociales du gouvernement, mais alertent : si les promesses ne sont pas tenues, la rue redeviendra leur tribune. Reportage.
Au Musée des Civilisations Noires de Dakar, à deux pas du port autonome et de la gare, l’exposition photographique « Première ligne » du photographe Abdou Karim Ndoye attire l’attention depuis plusieurs semaines. Proche du parti au pouvoir, le Pastef, l’artiste y retrace les mobilisations populaires et leur répression au Sénégal en 2021, 2023 et 2024, revenant, plus d’une année après les évènement, sur un mouvement politique et citoyen protestataire d’ampleur, marqué par une mobilisation à l’échelle nationale et une issue heureuse à l’élection présidentielle. Soutenu par Ousmane Sonko, actuel chef du gouvernement, l’artiste explique vouloir : « rendre hommage à ceux qui se sont dressés pour se faire entendre et nous invite à écrire ensemble la première ligne d’un avenir qui nous rassemble ».
La dure voie de la pacification et de la justice
Aux côtés de l’imagerie de lutte, l’exposition à l’accent éminemment politique raconte également l’ascension du président Bassirou Diomaye Faye et de son mentor Sonko. Ce qui marque surtout, c’est la place de la jeunesse dans chaque cliché : visages de résistance, slogans de rupture, récits de combat qui contredisent l’image lisse d’un Sénégal aux transitions apaisées. De ces manifestations, une « génération révoltée » y a surgit avec force, dans un pays où 75 % de la population a moins de 35 ans, et 50 % moins de 18 ans.
En ce mois de juin 2025, plus d’un an après ce que les sénégalais appellent communément dans les rues « l’arrivée du nouveau régime », les blessures mémorielles restent profondes. Le collectif citoyen CartograFreeSénégal, engagé pour le recensement et la mémoire des victimes des répressions sous l’ancien pouvoir, a publié récemment en collaboration avec Amnesty International Sénégal son « bilan définitif des décès liés à la répression des manifestations politiques ». Selon ce rapport, 65 personnes ont perdu la vie, dont 51 tuées par balles. La moyenne d’âge des victimes est de 26 ans, avec des cas aussi jeunes que 14 ans. D’autres avancent des chiffres beaucoup plus élevés, dépassant la centaine de victimes.
A ce titre, ces dernières semaines ont fait ressurgir l’actualité de ces repressions : une loi dite « d’interprétation de l’amnistie » portée par la nouvelle majorité et votée largement au Parlement, visant à exclure les infractions criminelles et correctionnelles du champ d’amnistie liées aux faits survenus entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, a été retoquée par le Conseil Constitutionnel au motif de sa non-conformité à la constitution. Une illustration des difficultés persistantes pour faire advenir une justice pourtant vivement demandée par les organisations de la société civile. Au cours des dernières années de règne de l’ancien président Macky Sall, alors qu’il envisageait de se représenter pour un troisième mandat pourtant interdit par la Constitution, plus de deux milles personnes auraient été incarcérées pour des raisons politiques, avec des pics au plus fort des mobilisations quelques mois avant l’élection présidentielle l’an dernier. Alors que le niveau de violence augmentait et que Macky Sall tentait de se maintenir au pouvoir en enfermant Sonko et en reportant l’élection, la pression de la rue et une décision du Conseil Constitutionnel jugeant illégal le report de l’élection finirent par sauver la démocratie sénégalaise. Le 24 mars 2024, le candidat du PASTEF, Bassirou Diomaye Faye, remporte la présidentielle dès le premier tour (54%) face au candidat de l’establishment Amadou Ba (Alliance pour la République).
Alors que le niveau de violence augmentait et que Macky Sall tentait de se maintenir au pouvoir en enfermant Sonko et en reportant l’élection, la pression de la rue et une décision du Conseil Constitutionnel finirent par sauver la démocratie sénégalaise.
Papa Ndaye Diop, président d’Amnesty Sénégal, explique : « Ce fut une période très compliquée, une blessure profonde, un traumatisme pour la population sénégalaise qui n’était plus habituée à ce niveau de violence et à ce recours excessif à la force des autorités. Aujourd’hui les choses se sont apaisées, mais le temps de la réparation et de la mémoire est encore long. Le processus suit son court. »
Le climat politique s’est partiellement détendu et les libertés publiques ont été retrouvées. En mai 2025, le Sénégal a progressé de 20 places dans le classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters Sans Frontières, passant de la 94e à la 74e position. Une avancée saluée, mais jugée insuffisante aux vues des récentes atteintes aux libertés journalistiques : des fermetures de médias pour non-conformité au Code de la presse qui questionnent, des arrestations de journalistes d’investigation avec pour dernier cas en date la garde à vue de Bachir Fofana le 25 juin 2025, ou bien des procédures de contrôles fiscaux excessives. Autant de pressions encore exercées cette fois par les nouvelles autorités, souvent perçues à rebours des promesses démocratiques lors de la campagne.
Des protestations multiformes au PASTEF
Fortes de leur expérience, les organisations civiles sénégalaises demeurent tout de même vigilantes. Denise Sow, cofondatrice du mouvement Y EN A MARRE — collectif d’artistes, d’intellectuels et de militants opposé dès 2011 au troisième mandat d’Abdoulaye Wade (2000-2012) — rappelle : « Ce n’est pas une question de parti politique. Dès qu’il s’agit de nos valeurs démocratiques, de défense des droits ou de ce que nous appelons “le Nouveau Type de Sénégalais (NTS)”, le mouvement se réorganise, avec un point d’attention et d’intensité sur les pratiques des autorités publiques. » Malgré l’apaisement depuis un an, les collectifs restent actifs et structurés en réseaux, grâce à de nouvelles plateformes de coordination. « Nous n’avons jamais déserté la rue. Nous avons toujours essayé d’être des lanceurs d’alerte. On se présente comme une sentinelle de la bonne démocratie », insiste Maïmouna Ndaye, responsable des programmes à Y EN A MARRE. Le collectif, signataire des plateformes M-23 en 2012 et F24 en 2023, concentre aujourd’hui ses efforts sur la jeunesse engagée et, avec Enda-Ecopop, sur la création d’« observatoires de la démocratie » dans plusieurs régions, pour surveiller les élus.

Pour Ousmane Majha, doctorant à l’université Cheikh Anta Diop, une récupération politique s’est bel et bien opérée en 2024. « Lorsqu’on regarde l’évolution des opinions et positions politiques à travers une perspective historique, on voit que le Pastef aujourd’hui au pouvoir a su capter ingénieusement les mécontentements venus de la société civile organisée, de la jeunesse et, d’une manière générale, des classes populaires. » D’abord partisan de la transparence et de la bonne gouvernance – ses fondateurs étant d’anciens inspecteurs des impôts qui ont dénoncé divers scandales – le Pastef est devenu un parti de masse dégagiste, capable de structurer et d’amplifier les mobilisations. « Aujourd’hui ses messages sont encore largement suivis par la population car l’organe sait jouer de la communication. De plus, la population est sensible aux idées. »
Souleymane Gueye, délégué général du FRAPP — mouvement connu pour ses campagnes contre les multinationales et le système monétaire mondial — observe lui aussi une transformation profonde : « La politisation de la jeunesse ne se résume pas à l’adhésion aux partis politiques, mais touche avant tout les questions du quotidien. » Grâce aux réseaux sociaux, les débats ne sont plus réservés aux anciennes générations ni aux médias traditionnels. « C’est le point majeur pour comprendre les stratégies de mobilisation. Aujourd’hui le nerf de la guerre pour la mobilisation est sur les réseaux sociaux. » Mouvance indépendante exclue du jeu électoral mais souvent associée à Pastef pour avoir coorganisé les marches « Le Chemin de la libération », le FRAPP a été l’un des premiers visés par la répression politique. Privé d’accès aux médias classiques, il s’est renforcé grâce à la circulation en ligne de ses messages.
« Boroom làmmiñ du réer » : raviver un héritage historique patriotique
À l’image de la dynamique à l’œuvre en Afrique de l’Ouest, les discours panafricains connaissent un fort écho au Sénégal, particulièrement auprès de la jeunesse, via les réseaux sociaux. Un levier de mobilisation que le nouveau gouvernement, poussé par des acteurs civils, a su intégrer cette vision à son horizon de rupture souverainiste. Dès son entrée en fonction, le président Bassirou Diomaye Faye a ainsi initié une cérémonie mémorielle le 1er décembre 2024 pour les 80 ans du massacre de Thiaroye, où plusieurs centaines de tirailleurs sénégalais furent tués sur ordre d’officiers français. Un geste fort pour réhabiliter une mémoire longtemps étouffée. L’État français, par la voix d’Emmanuel Macron, a pour la première fois reconnu un « massacre », là où l’on parlait jusque-là de « mutinerie ». Rappelons-nous l’ignoble discours qu’avait prononcé Nicolas Sarkozy en 2007 à l’université Cheikh-Anta-Diop de Dakar qui avait choqué par « ses clichés sur « l’homme africain » en affirmant qu’il n’était « pas assez entré dans l’Histoire ».
À l’image de la dynamique à l’œuvre en Afrique de l’Ouest, les discours panafricains connaissent un fort écho au Sénégal. Un levier de mobilisation que le nouveau gouvernement a su intégrer cette vision à son horizon de rupture souverainiste.
« Boroom làmmiñ du réer » (« Qui sait se servir de sa langue ne se trompera jamais de chemin »), dit un proverbe wolof. Cette réappropriation mémorielle passe aussi par la langue : les discours officiels sont désormais souvent prononcés en wolof, parlé par plus de 80 % de la population, poussé par le volontarisme des nouvelles autorités l’enseignement primaire et secondaire en langues nationales se généralise. Le 22 mai 2025 dernier, des assises au Grand Théâtre national de Dakar, intitulées « L’État et ses langues nationales », ont ouvert la voie à leur reconnaissance institutionnelle. Autre fait institutionnel, le ministre Abdourahmane Diouf a invité lors de débats au parlement le législateur à accompagner cette évolution : « C’est la société qui est en avance (…). Il faut que le français, le wolof et les autres langues nationales aient la même signification à l’Assemblée nationale. »
Pour Abdoulaye, étudiant en sciences politiques à l’UCAD et cofondateur d’ICAP-Sénégal, « cela coule de source ». Il observe « une rupture culturelle douce et un retour à l’honneur des mémoires historiques ». Selon lui, « il y a clairement une conscientisation des jeunes, un questionnement général sur les formes de restitution culturelle et d’africanisation des récits ». Son association projette d’ailleurs de créer une fondation promouvant la culture africaine par les langues locales, avec des contenus audiovisuels destinés aux enfants.
Ce regain mémoriel s’inscrit aussi dans une redécouverte de figures historiques longtemps marginalisées. Omar Blondin Diop, militant mort en détention en 1973 sous Senghor, ou encore Cheikh Anta Diop et Thomas Sankara, sont désormais régulièrement cités dans les discours politiques. « Il ne s’agit pas d’un abandon complet de l’histoire senghorienne historiquement très proche de la culture de l’ancien colonisateur », nuance Abdoulaye, mais d’un nouvel équilibre symbolique. De son côté, le FRAPP, fidèle à son orientation anticolonialiste et anticapitaliste, organise chaque mois en partenariat avec le Musée des Civilisations Noires des conférences sur des figures panafricaines. Parmi les premières mises à l’honneur : Lamine Senghor, militant communiste et défenseur de la « race noire », ou Aline Sitoé Diatta, héroïne de la résistance casamançaise (ndlr : la Casamance région du sud du pays a été le théâtre de combats indépendantistes dès la création de l’Etat du Sénégal).
Cette dynamique s’exprime aussi dans la toponymie, avec un dernier fait en date qui a marqué joyeusement la population. Le 4 avril, jour de l’indépendance, l’avenue Charles de Gaulle à Dakar a été rebaptisée au nom de Mamadou Dia, ancien Premier ministre et figure de l’indépendance, compagnon de route puis opposant au régime de Léopold Sédar Senghor après 1962. Une décision symbolique saluée par la population : jusqu’ici, le défilé militaire se tenait sur une avenue dédiée à une figure de l’ex-puissance coloniale. Des collectifs appellent désormais à étendre ces changements à d’autres villes, notamment à Saint-Louis, pour redonner à l’espace public une empreinte plus fidèle à l’histoire nationale.
Le mur du système financier
Dans les rues, beaucoup retiennent encore les mots du nouveau chef de l’État lors de son investiture : « Les résultats sortis des urnes expriment un profond désir de changement systémique ». Pourtant, depuis quelques mois, une autre tonalité s’impose : nombreux dialogues et consultations nationales, mais peu d’actes concrets dans le quotidien des Sénégalais, et aucun changement économique majeur. L’impatience grandit. La « rupture » promise au niveau sociétal et en économie devait passer par le « Plan Sénégal 2050 : stratégie de développement 2025-2029 », présenté comme un sésame pour le gouvernement.
Sur le plan politique, rien de fondamental n’a changé. Le 28 mai dernier, une concertation nationale a réuni 700 représentants de partis, experts, société civile et syndicats pour refonder le système politique. L’objectif était de relancer le dialogue et de « poser les actes de concorde nationale ». Cheikh Guèye, modérateur, a salué des « débats féconds » en faveur d’un « système plus juste, représentatif, éthique ». Parmi les mesures, la création d’une Commission électorale nationale indépendante (CENI) ou la fin du cumul des fonctions de chef d’État et de chef de parti. Mais dès la clôture, des critiques ont surgi : « Beaucoup de déclarations mais peu d’interrogation réelle du système démocratique pour le rendre plus participatif, au service de la population et moins de la caste politique », confie un représentant sous anonymat dont l’organisation a été invitée.
Plusieurs partis de l’opposition ont boycotté la rencontre, l’opposition présente a demandé des gestes forts et de bonne volonté, notamment par « la fin de toutes les détentions provisoires » d’anciens responsables politiques. Ce souhait est difficile à satisfaire car le président Faye et le Premier ministre Sonko ont promit de punir les anciens dirigeants accusés dans des affaires financières. A ce titre, cinq anciens ministres du pouvoir précédent sont aujourd’hui poursuivis par la justice sénégalaise sur fond de scandale de détournement des fonds anti-Covid. Ils dénoncent des « arrestations arbitraires » et une « instrumentalisation politique de la justice ».
Les attaques contre l’institution judiciaire se poursuivent, suscitant la crainte d’instrumentalisations par les organisations syndicales du milieu. Voyant sa condamnation pour diffamation confirmée le 1er juillet par la Cour suprême, Ousmane Sonko a surpris les observateurs en revêtant sa tenue d’opposant pour s’attaquer vivement au système judiciaire. « La justice sénégalaise est l’un de nos plus gros problèmes », a-t-il déclaré dans une longue vidéo postée en ligne, avant de poursuivre : « De ce qui reste de mon existence, si je ne participe pas à une élection, ce serait de ma propre volonté parce que rien ne peut m’empêcher d’être candidat »
Etienne, acteur culturel dans la région de Joal Fadiouth (sud-est de Dakar), estime : « C’est le risque d’avoir porté ce type de personnalité au pouvoir. Ces dirigeants populistes divisent la population, soufflent sur les braises et s’attaquent à ce qui freine leur pouvoir lorsqu’on leur résiste. » Il poursuit sévèrement : « La jeunesse mobilisée sera déçue lorqu’elle se réveillera et qu’elle verra que peu de choses vont changer ».
En matière économique, le pouvoir garde cependant un fort soutien dans sa quête de souveraineté. La population a salué le bras de fer avec Woodside Energy, géant pétrolier australien exploitant le champ de Sangomar. L’administration fiscale réclame 62,5 millions d’euros de taxes, contestées par l’entreprise qui a lancé un arbitrage international. Cette nouvelle a été reçue comme conforme au discours du pouvoir affirmant rechercher une plus grande autonomie concernant les ressources naturelles – avec en premier lieu de grands projets gaziers et pétroliers.
En matière économique, le pouvoir garde un fort soutien dans sa quête de souveraineté. La population a salué le bras de fer avec Woodside Energy, géant pétrolier australien exploitant le champ de Sangomar.
Le Sénégal veut ainsi renforcer sa maîtrise fiscale, augmenter ses recettes et réduire sa dépendance aux financements extérieurs, notamment du FMI, pour avoir les mains libres. L’ombre d’un système financier international contesté se fait de plus en plus pesante. Le dernier coup de semonce est venu le 30 juin d’un nouveau rapport réévaluant la dette publique du pays à 119% du PIB pour 2024 (faisant du Sénégal, le pays le plus « endetté » d’Afrique), obligeant le gouvernement d’annoncer un nouveau « plan de redressement » de l’économie pour réduire les dépenses de l’Etat. Les agences de notation mondiales ont de nouveau dégradé la note souveraine du Sénégal, Moodys’s Ratings a fait passer la note de « B1 » à « B3 » condamnant encore un peu plus les capacités d’emprunt de l’Etat sénégalais sur les marchés tout en accentuant l’étouffement de l’économie du pays.
Il faut dire que l’annonce officielle par la Cour des comptes d’un maquillage des comptes publics, donc du déficit, sous l’ancienne présidence de Macky Sall n’a pas aidé à la situation. L’encours de la dette représenterait aujourd’hui plus de 100% du PIB, un taux largement supérieur au montant annoncé de 74% du PIB par le précédent régime. Cela a eu pour conséquence la « mise en pause » par le Fond monétaire international (FMI) de son programme de soutien économique avec le Sénégal. Ces annonces de pénalités ont mis en rogne bon nombre de sénégalais pointant les agences de notation occidentales (Moody’s, S&P et Fitch, et surtout leurs critères de notation.
Tout en pointant la situation de plusieurs Etats occidentaux mieux notés mais avec une dette « colossale » (la dette des Etats-Unis est estimée au 4ème trimestre 2024 à 125% du PIB, celle de l’Italie à 135%, de la France à 112% ou encore du Royaume-Uni à 100%), certains citoyens sénégalais défendent alors l’idée d’une solvabilité évaluée à partir des richesses réelles comme l’or, le lithium ou le cobalt, et surtout un système qui prendrait en compte les rapports « déséquilibrés » entre « les Nords et les Suds ». Beaucoup évoquent ainsi le projet de création d’une agence panafricaine de notation, l’Agence africaine de notation de crédit (AfCRA) devrait voir le jour à partir de septembre 2025. Lors de la 4ème édition de la Conférence internationale sur le financement du développement, organisée à Séville le 30 juin dernier, le Sénégal par la voix de son président a quant à lui appelé « à une révision des critères de notation des agences d’évaluation ».
Pour Souleymane Gueye (FRAPP), ces évolutions sont positives, mais « un loup reste dans la bergerie » : le système monétaire, qui bloque l’autonomie des pays ouest-africains. Né en 2017, le FRAPP réclame l’abolition du franc CFA, qu’il qualifie de « structure arriérée » et « domination économique étrangère néocoloniale». Il défend une monnaie souveraine, africaine, imprimée sur le continent et intégrée équitablement au système mondial.
« Un loup reste dans la bergerie » : le système monétaire, qui bloque l’autonomie des pays ouest-africains.
Le PASTEF, au pouvoir, a pris l’engagement d’aborder la question monétaire, jusque-là taboue. La primature, annonçant des besoins de financement de 1195 milliards de FCFA pour 2025, a récemment remis en cause le lien avec le franc CFA : « Le FCFA ne cadre pas avec notre vision. Soit la monnaie sera changée avec nos partenaires de l’UEMOA, soit nous prendrons nos responsabilités », cependant sans annoncer de calendrier précis. La société civile réclame depuis des décennies cette réforme. Cependant, le Sénégal ne peut agir seul et cherche à coopérer avec les autres pays concernés. Sa doctrine diplomatique mise sur un échange basé sur le « respect mutuel » et des « conditions gagnantes ». Cette posture s’exprime notamment dans le rôle de médiateur dans le conflit institutionnel entre l’Alliance des États du Sahel* (Mali, Burkina Faso, Niger) et la CEDEAO. Cette diplomatie « panafricaine », pourtant largement soutenue, a ouvert de profondes critiques des ONG et défenseurs des droits humains, qui dénoncent les atteintes aux libertés dans ces pays dirigés depuis quelques années par des juntes militaires. Le gouvernement rappelle les liens de dépendance économique, culturelle et sécuritaire dans une région frappée par le djihadisme.

Concernant les relations sur la scène internationale à propos des ressources naturelle et du commerce, certaines mesures sont appréciées mais dans l’attente d’actes plus féconds. Le gouvernement a satisfait sa population par des annonces concrètes. Face à la crise de la pêche artisanale due à la surexploitation et la raréfaction des ressources, il a refusé de renouveler les accords de pêche avec l’Union européenne, en vigueur depuis les années 1980. Pourtant, lors de la conférence de l’ONU sur les océans le 9 juin dernier, des organisations de pêcheurs ont dénoncé à nouveau la pêche massive des chalutiers chinois navigant sous pavillons sénégalais ou en dehors des radars et accusés de « pillage » des eaux sénégalaises.
Ces activités détruisent l’écosystème du littoral tout en m’étant en péril un secteur économique crucial pour le pays, on estime que la pêche fait vivre de façon directe ou indirecte 600 000 travailleurs. De plus les scientifiques estiment que les produits halieutiques constituent 7,9% de l’apport en protéines pour la population, avec des plats traditionnels consommés au quotidien tel le thiéboudiène (riz au poisson). Mamadou Sarr, pêcheur et secrétaire général du comité des pêcheurs de Ouakam, dénonce ces accords de libre-échange : « L’État devrait dire stop. On peut donner une licence parce que vous avez le droit, mais ce n’est pas le moment ».
« Bombe sociale à retardement »
Ce manque de remise en question des modèles de libre-échange reflète-t-il une forme de largesse idéologique ou, à tout le moins, les contradictions d’un parti « attrape-tout » une fois au pouvoir ? Ou bien s’agit-il plutôt de la dure réalité d’un exercice d’équilibrisme, pour un gouvernement de rupture confronté à une économie encore largement dépendante de l’extérieur ? Les récentes rencontres du président Bassirou Diomaye Faye, avec Emmanuel Macron et surtout avec Donald Trump à la maison blanche pour parler affaires et exploitation des ressources, ont sérieusement mis en doute l’orientation de rupture. Même si pour beaucoup ces rencontres consistaient à défendre les intérêts du pays. Le Sénégal figure, par exemple, sur la liste des 24 pays soumis aux récentes restrictions de visas consécutives au durcissement de la politique migratoire américaine.
M. Dialo Diop, figure historique de « l’extrême gauche » sénégalaise, aujourd’hui vice-président du Pastef qu’il a rejoint en 2021, et conseiller à la présidence, a récemment défendu la ligne du parti dans Le Monde diplomatique. Selon lui, il faudrait « arrêter de penser avec les termes venus de l’extérieur » pour retrouver « l’égalitarisme africain ». Un discours qui fait écho aux thèses de Cheikh Anta Diop, appelant à une « révolution culturelle » pour sortir les peuples africains de catégories conçues comme « occidentales » – socialisme, capitalisme, libéralisme, etc – et construire leurs propres modèles. Et qui justifie une inflexion libérale du Pastef ? Sous couvert d’unité du continent, le parti soutient en effet le projet de Zone de libre-échange continental africaine (ZLECAf).

Certains observateurs soulignent ainsi le poids croissant des factions libérales au sein du Pastef. Le soutien affiché de certains capitalistes fortunés, à l’image du magnat de l’immobilier Pierre Goudiaby Atepa — qui a soutenu tous les régimes successifs et ambitionne de grands projets d’exploitation des ressources naturelles — n’est pas passé inaperçu. Reste à voir comment le gouvernement gérera les immenses terrains récupérés après la fermeture de la base militaire française, en plein centre de Dakar. De nombreuses voix s’élèvent pour demander la création de logements sociaux, dans une capitale où se loger devient un casse-tête. Mais cette demande populaire fera-t-elle le poids face aux intérêts puissants des promoteurs immobiliers ?
Certains observateurs soulignent le poids croissant des libéraux au sein du Pastef. Le soutien affiché de certains capitalistes fortunés, à l’image du magnat de l’immobilier Pierre Goudiaby Atepa – qui a soutenu tous les régimes successifs – n’est pas passé inaperçu.
Alors qu’un parfum d’austérité flotte dans l’air, la question de l’emploi — enjeu crucial pour un pays en pénurie chronique — reste sur toutes les lèvres. Le 1er mai dernier, après plusieurs mois de menaces de grève générale, un tournant a semblé s’amorcer. Lors de la Fête internationale du Travail, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé la signature d’un « pacte de stabilité sociale » avec les syndicats et le patronat. Fidèle au slogan « Jub, Jubbal, Jubbanti » [Droiture, transparence, réforme], ce pacte national se veut une nouvelle base de dialogue et d’unité. Annonce importante : une trêve sociale de trois ans, conclue avec les quatre principales centrales syndicales et les organisations patronales. En échange d’une cessation des grèves le gouvernement s’est alors engagé à mener une politique d’amélioration des conditions de travail.
Mais combien de temps cet accord va-t-il tenir ? Dès les rassemblements du 1er mai, des critiques s’étaient déjà fait entendre. Le Front syndical pour la défense du travail et le syndicat SELS avaient exprimé leurs doutes. Et les faits leur ont donné raison. Moins de trois mois plus tard, les grèves et débrayages se multiplient dans des secteurs clés en pleine ébullition : la santé, la justice et l’enseignement. Malgré l’engagement de certains responsables syndicaux, de nombreux travailleurs refusent toute mise en pause de la contestation tant que les pensions impayées, les reclassements bloqués ou les suppressions de postes dans l’administration ne seront pas réglés. L’actuel gouvernement devra faire face ces prochains mois à d’éventuels premiers mouvements d’humeur et de contestation d’ampleur. Preuve que la méfiance reste forte. Plusieurs travaux sociologiques ont déjà mis en lumière la dégradation des conditions de travail au Sénégal.
Le travail est aussi le sujet du futur. La société sénégalaise fait face à une pression démographique intense : chaque année, entre 100 000 et 300 000 jeunes arrivent sur le marché du travail, pour seulement 30 000 emplois créés. Résultat : un taux de chômage des jeunes estimé à 60 %, bien au-dessus du taux national, qui atteignait 20,3 % fin 2024. Beaucoup se tournent alors vers le secteur informel, mal rémunéré et souvent très précaire. La situation est aussi structurelle : près de la moitié des jeunes en quête d’emploi sont sans diplôme, et un quart n’ont pas achevé le cycle secondaire. À Dakar, il n’est pas rare de voir les centres d’orientation sociale débordés, où des centaines de jeunes attendent, papiers en main, leur tour dans l’espoir d’un accompagnement. « C’est une véritable bombe sociale à retardement » nous confie un syndicaliste le jour du rassemblement du 1er mai. Face à ce défi, le gouvernement a organisé fin avril une « grande conférence sociale sur l’emploi et l’employabilité au Sénégal », sans réelles annonces.
Une chose est sûre : « Les gens ne veulent plus avoir les mots entre les dents, ils veulent avoir les actes concrets », lance, ferme, un jeune sénégalais interrogé avec ses amis au détour d’une rue. De quoi y voir un avertissement clair au pouvoir en place : si les promesses ne se traduisent pas en actes, les mobilisations pourraient vite reprendre. Pour les dirigeants, l’équation pourrait bien être résumée par ce célèbre proverbe du pays : « À qui saute et tombe dans le feu, il reste à faire un autre saut ». Ce saut sera-t-il celui de l’ère d’un changement tant attendu ?