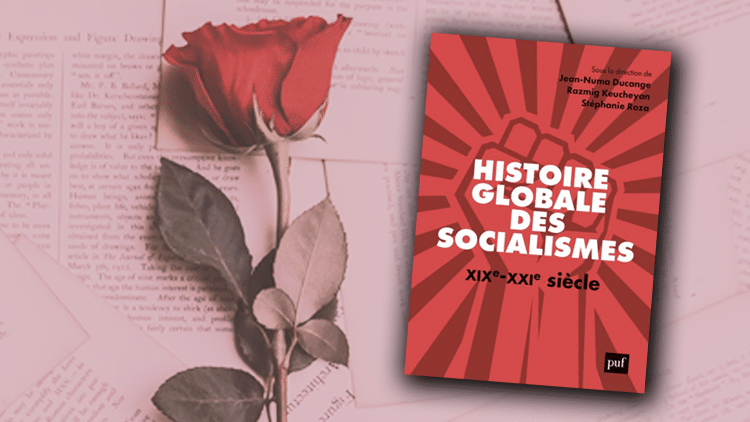S’il est un mot que la politique électorale a usé, c’est bien celui de « socialisme ». Le mandat de François Hollande et l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron, parvenu des rangs du « PS », ont contribué à susciter la méfiance à l’égard des étendards brandissant la couleur des roses. Pourtant, par-delà ce discrédit, le socialisme demeure l’une des traditions les plus fécondes de notre histoire politique, dont la mémoire autant que l’ambition révolutionnaire méritent d’être rappelées. L’Histoire globale des socialismes (XIXe-XXIe siècle), qui paraît cette rentrée aux PUF, sous la direction de Stéphanie Roza, Jean-Numa Ducange et Razmig Keucheyan, retrace la genèse des projets socialistes pour mieux s’interroger sur leurs devenirs contemporains. Ce vaste ouvrage de plus de mille pages, composé par un collectif de chercheurs et décliné en trois sections (les mots du socialisme ; les moments ; les figures), brosse ainsi le tableau d’une famille politique, aussi élargie que conflictuelle. Jaurès méditant sur le socialisme de l’avenir espérait qu’il permette d’accomplir « une vie toujours plus large qui accroisse et apaise le désir » – gage est ici donné que cette Histoire globale lui en offre une chance nouvelle, en appelant à renouer avec « la critique combattive de l’ordre existant » et à mettre fin à l’époque des renoncements. Les lignes qui suivent sont extraites de l’introduction, proposée par les directeurs du volume, et de l’entrée « Révolution », rédigée par l’historien Matthias Middell.
Tout socialisme est aujourd’hui en crise. Une crise électorale dans de nombreux pays, qui est aussi plus fondamentalement une crise d’identité. Cet ouvrage est-il un bilan avant liquidation ? Certes non. D’abord, les socialistes en ont vu d’autres. Que l’on songe à ce qu’être socialiste pouvait supposer de courage et de détermination à certaines époques, par exemple durant les années 1930 en Europe ou les années 1970 en Amérique latine, lorsque la répression s’abattait massivement sur ses militants et que toute perspective positive semblait relever de l’impossible. Surtout, le socialisme est l’envers du capitalisme. Aussi longtemps que ce système exploitera et aliénera, des socialistes s’élèveront contre la misère et les inégalités qu’il génère. Le monde de crises financières, de guerres, de changement climatique et de pandémies qui est le nôtre produira sans nul doute des socialistes. Reste à savoir sous quelles formes.
Les frontières du socialisme ont toujours été floues et évolutives. C’est pourquoi il sera question dans ce volume des socialismes au pluriel, et non du socialisme. Cependant, il est une caractéristique qui définit le socialisme partout et toujours : la centralité de la question sociale, l’analyse des sociétés modernes en termes de classes sociales et de leur lutte pour l’appropriation des ressources matérielles et symboliques. Les courants réformistes considèrent le capitalisme comme indépassable, en tout cas dans un avenir prévisible. À leurs yeux, il est toutefois possible d’en contrebalancer les effets néfastes. Ils ne nient pas l’existence des classes sociales, mais considèrent le compromis de classe – qui n’interdit pas le rapport de force – comme un optimum pour les classes populaires. De ce compromis de classe émane le progrès, forcément graduel.
Les révolutionnaires voient au contraire le capitalisme comme irrémédiablement sous-tendu par des contradictions. Elles ne le conduisent pas nécessairement à elles seules à sa perte. Mais elles intensifient les luttes sociales et politiques, ce qui rend concevable le dépassement de ce système. Dans cette perspective, le rôle des socialistes est d’organiser la transition vers la société post-capitaliste, une transition considérée comme plus ou moins rapide selon les courants. Bien entendu, à propos des classes sociales et de leurs luttes, il existe différentes approches. Certains mettent en avant une définition économique des classes, d’autres insistent sur les aspects culturels ou « subjectifs ». De même, le fonctionnement de la société post-capitaliste a donné lieu à de nombreux débats. L’État aura-t-il dépéri, l’« administration des choses et la direction des opérations de production » prenant le relais du « gouvernement des personnes », selon la formule de Friedrich Engels, citant Saint-Simon ? La politique conservera-t-elle ses droits ?
Ces deux traditions ne sont pas pures : difficile d’écrire une histoire des socialismes qui se contenterait d’opposer un bloc « réformiste » à un autre « révolutionnaire ». Au cours de cette histoire, elles n’ont cessé de s’entremêler. Tout au long des xixe et xxe siècles, d’autres revendications s’y sont ajoutées, par exemple féministes ou nationales. Comme on le constatera à la lecture de ce volume, les combats des socialistes sont loin de s’être limités à la question sociale étroitement conçue. Mais l’appartenance d’un auteur ou d’un parti à la tradition socialiste suppose qu’il accorde à la question sociale un poids au moins équivalent à ces autres revendications. Si d’autres revendications prennent le dessus, il en sort, de facto. Ceci n’empêche pas les alliances avec des courants extérieurs au socialisme dans le cadre de luttes particulières, par exemple de libération nationale. Cela suppose toutefois que la question sociale demeure la colonne vertébrale du programme.
Du point de vue adopté dans cet ouvrage, le communisme et l’anarchisme font partie de l’histoire des socialismes. C’est donc une acception large des socialismes que nous avons privilégiée. Chacun de ces courants pourrait bien sûr faire l’objet d’un volume en soi. Les relations de leurs représentants avec les organisations socialistes proprement dites furent souvent houleuses. Après la révolution russe, le clivage entre socialistes et communistes a structuré l’histoire des gauches dans de nombreux pays, en Europe et ailleurs. Dans certains, comme l’Espagne ou l’Argentine, un puissant courant anarchiste est venu s’ajouter à eux, introduisant des idées et un répertoire d’actions novateurs.
Le communisme et l’anarchisme sont partie intégrante de l’histoire des socialismes en ceci qu’ils accordent eux aussi une centralité à la question sociale. Quels qu’aient été les désaccords – parfois violents – entre ces courants aux xixe et xxe siècles, il apparaît ainsi rétrospectivement que ce qui les rapproche est plus important que ce qui les sépare. Les désaccords demeurent, par exemple à propos de l’analyse de l’État ou de la tactique de l’action directe. Mais le triomphe du capitalisme sous sa forme néolibérale à la fin du xxe siècle a rebattu les cartes, et relativisé des différences autrefois significatives. C’est un constat à garder à l’esprit dans la perspective de la reconstruction d’un socialisme pour le xxie siècle. Dans le cas du mouvement communiste, la disparition de l’URSS et des pays affiliés a bouleversé la donne sur le plan programmatique et stratégique.
« Le socialisme étant l’envers du capitalisme, les évolutions de ce dernier ont forcément influé sur les mouvements et les idées socialistes. »
Le socialisme étant l’envers du capitalisme, les évolutions de ce dernier ont forcément influé sur les mouvements et les idées socialistes. La création des partis socialistes « de masse » en Europe – le SPD allemand le premier d’entre eux – à la fin du xixe siècle est concomitante de l’exode rural et de la concentration croissante des ouvriers dans de grandes structures industrielles. Elle aurait été difficilement concevable avant la « seconde » révolution industrielle. Pour autant, mouvements et idées disposent d’une « autonomie relative ». En Chine, lors de la période révolutionnaire qui mène à l’instauration du régime communiste de 1949, le pays n’a pas encore connu le développement industriel qui sera le sien un demi-siècle plus tard : la révolution est avant tout paysanne. Le développement du pays s’opère après l’arrivée du communisme, et non avant, comme en Europe. Dans ce cas comme dans d’autres, les liens entre le capitalisme et les modalités de sa contestation sont complexes. Même à l’échelle d’une région, les rythmes politiques peuvent être discordants.
Les trois décennies qui nous séparent de la chute du mur de Berlin auront vu l’apparition de courants difficiles à identifier, dont les liens avec le socialisme ne sont pas clairs. Peut-être est-ce le propre des périodes de transition. Le principal d’entre eux est le « populisme », dont les origines remontent au xixe siècle, notamment en Russie et aux États-Unis, mais dont des théoriciens et des mouvements ont recommencé à se réclamer dans le sillage de la crise économique de 2008. Avant qu’elle arrive en Europe, une vague de gouvernements progressistes parfois nommés « populistes de gauche » avait déferlé sur l’Amérique latine durant les années 2000, en Argentine (Néstor Kirchner), au Brésil (Lula), en Bolivie (Evo Morales), au Venezuela (Chávez) ou en Équateur (Rafael Correa).
Le « populisme de gauche », celui de Podemos en Espagne ou de La France insoumise en France, est-il une variante de socialisme ? Les populistes ont repris à leur compte certaines revendications centrales de ce dernier, par exemple l’égalité. Sur le plan électoral, leur implantation recoupe également largement celle des anciens partis de gauche, sociaux-démocrates et communistes. Ils s’en distinguent toutefois en ceci qu’ils substituent un vocabulaire essentiellement moral à celui, plus politique, des socialistes, dénonçant par exemple la « corruption » des élites plutôt que les mécanismes de l’exploitation. De même, l’opposition qu’ils établissent entre la « caste » dominante et le « peuple », ou entre les « 1 % » et les « 99 % », se distingue du type d’analyse de classes dominant dans les socialismes. L’alliance des classes populaires avec les classes moyennes – notamment à fort « capital culturel » – a été un enjeu stratégique important pour les socialismes au xxe siècle, notamment en Europe de l’Ouest. L’opposition entre la « caste » et le « peuple » qu’établit le populisme rend la pensée de ce problème impossible. […]
Socialisme ou barbarie ?
Le socialisme a un passé, mais a-t-il un avenir ? Il est aujourd’hui confronté à des défis nouveaux, comme il l’a été tout au long de son histoire. On en relèvera trois, parmi d’autres. Le premier est l’écologie. Celle-ci est-elle une alternative au socialisme, ou son prolongement sous un autre nom ? Pour répondre à cette question, il faut reprendre le critère énoncé ci-dessus : accorde-t-elle une importance au moins aussi grande à la question sociale qu’à l’environnement ? Pour nombre de courants de l’écologie, la réponse est clairement négative. L’écologie « profonde » d’Arne Næss, par exemple, lui accorde une importance quasi nulle. Elle se livre à une critique de l’anthropocentrisme de nos catégories morales, qui distinguent les humains des autres êtres vivants, et nous invite à accorder à ces derniers une « valeur intrinsèque ».
Mais pour d’autres courants, comme l’écologie sociale d’un Murray Bookchin ou certaines tendances de l’écoféminisme, la question sociale est déterminante. À leurs yeux, la principale cause de la crise écologique est le capitalisme, si bien que la résolution de cette dernière suppose une adhésion à l’anticapitalisme. Ces courants de l’écologie considèrent que la nature est sociale, autrement dit que la lutte des classes doit inclure les enjeux environnementaux. Écologie et socialisme convergent donc parfois, aussi bien sur le plan théorique qu’au sein des mouvements sociaux. « Écosocialisme » est une appellation qui circule déjà, et qui sera peut-être amenée à se diffuser dans les années qui viennent.
Un deuxième enjeu est la reconstruction d’un internationalisme, dans un monde où les pulsions nationalistes conservatrices s’expriment de plus en plus ouvertement. La chute du mur de Berlin a débouché durant les années 1990 sur un monde « unipolaire », avec les États-Unis comme seule grande puissance. Trente ans plus tard, le paysage géopolitique a considérablement changé. L’émergence de la Chine et le retour de la Russie sur la scène internationale suscitent un monde « multipolaire ». Les États-Unis demeurent dominants au plan économique et militaire, mais ils ne sont plus sans rivaux. Cette multipolarité rapproche la situation géopolitique présente du « concert des nations » qui a suivi le congrès de Vienne au début du xixe siècle, qui est aussi la période qui a vu naître les socialismes.
En quoi les évolutions actuelles vont-elles affecter les mouvements socialistes au xxie siècle, et en particulier la possible émergence d’un nouvel internationalisme ? Au xxe siècle, la révolution russe puis la structure « bipolaire » de la guerre froide donnent lieu à une partition entre une Deuxième Internationale « socialiste » et des Komintern et Kominform « communistes ». À ces Internationales formellement constituées se sont ajoutées des Internationales informelles, comme les « nouvelles gauches » qui se sont mobilisées sous des formes diverses, aux quatre coins du monde, lors des « années 1968 ». Quelles qu’aient été leurs orientations, elles furent toutes polarisées par l’existence d’un camp socialiste, qui a recouvert jusqu’à un tiers de la surface du globe. Ce camp n’est plus. C’est une libération par rapport au fardeau que constitua le bilan de l’URSS, mais aussi un défi, l’Internationalisme du futur devant se construire sans l’appui d’États. Là encore, on renoue en un sens avec l’internationalisme du xixe siècle.
Le troisième enjeu est l’invention d’organisations politiques adaptées au nouveau siècle. L’histoire des socialismes est faite de créativité organisationnelle. Le parti d’« avant-garde » de Lénine, clandestin et formé de révolutionnaires professionnels, n’est pas le parti de masse du leader du Parti communiste italien Palmiro Togliatti après 1945, légal et à l’implantation populaire. Ce dernier ressemble par certains aspects au SPD allemand des origines. Prenant acte de l’évolution des contextes stratégiques, et en particulier de la stabilisation des institutions de la démocratie représentative, les socialistes et les communistes ont su bâtir, durant la seconde moitié du xxe siècle, des organisations adéquates.
Qu’en sera-t-il au xxie siècle ? Les sociologues insistent aujourd’hui sur la relative déstabilisation des identités politiques, qui rend plus difficile qu’autrefois la transmission de valeurs et opinions de générations en générations. On était socialiste ou communiste de père ou mère en fils ou fille, on ne l’est plus, en tout cas plus automatiquement. La socialisation politique des jeunes par les médias – les réseaux sociaux notamment – en plus de la famille est l’un des facteurs qui nourrissent ce phénomène. Cette déstabilisation des identités politiques affecte tous les courants, de gauche ou de droite. Comment influera-t-elle sur l’adhésion aux socialismes ? Autant que des luttes et des campagnes électorales, les socialismes furent des « cultures » ancrées dans des espaces sociaux : quartiers, communes, villes ou régions. La construction de ces cultures prenait place dans des temporalités longues. Sera-t-il possible d’en imaginer de nouvelles dans notre monde individualisé et en accélération constante ?
L’alternative posée par Rosa Luxemburg en 1915 dans sa « Brochure de Junius », socialisme ou barbarie, n’est-elle pas plus actuelle que jamais ? À l’exploitation capitaliste et aux guerres s’est ajouté un péril nouveau pour l’humanité, auquel « Rosa la rouge » ne pouvait avoir réellement pensé : le changement climatique. La crise des socialismes à la fin du xxe siècle a été suivie de peu par celle des démocraties représentatives. Avec Donald Trump, Jair Bolsonaro ou Viktor Orbán, les gouvernants « autoritaires » s’assument comme tels, et traitent avec mépris les droits démocratiques se multiplient. Le capitalisme, de son côté, ne s’est toujours pas relevé de la crise financière de 2008, les taux de croissance de la décennie qui ont suivi n’ayant pas été à la hauteur des périodes de « rattrapage » qui habituellement succèdent aux crises. Au crash de 2008 il faut désormais ajouter les effets économiques en cascade de la pandémie. Dans ce contexte, il est urgent de renouer avec une critique socialiste combattive, à la fois économique, politique et écologique, de l’ordre existant. Cela passe par la connaissance de son histoire, à laquelle cet ouvrage espère œuvrer.
***
Révolution
La révolution est sans nul doute un concept central pour de nombreux courants socialistes, si ce n’est le concept fondateur de leur identité. Cela ne signifie pas pour autant que tous ces courants ont adhéré à l’idée selon laquelle un bouleversement révolutionnaire seul permettrait d’atteindre le socialisme. Le débat (encore en cours) entre les différentes tendances des mouvements et des partis socialistes montre toutefois que la réponse à cette question était, et reste encore aujourd’hui, absolument essentielle pour définir leur place dans le spectre des socialismes – ce qui a parfois eu des conséquences tragiques, entraînant de multiples scissions au sein de ces mouvements.
Il n’est certainement pas exagéré de considérer la Révolution de 1789 comme le point de référence historique le plus important pour l’émergence des idées et des mouvements socialistes. Marx s’y intéresse dès ses premiers travaux. La Révolution ne cesse d’inspirer des comparaisons entre le modèle de la fin du xviiie siècle et les tentatives de révolutions ultérieures. En cela, plusieurs dimensions de l’expérience de la révolution ont joué un rôle décisif.
Le concept moderne de révolution a émergé avec la Révolution française. Il allait de pair avec l’idée de progrès dans l’histoire, qui avait été théorisée par les Lumières. Ce n’est toutefois qu’à partir de 1789 qu’a commencé à s’imposer l’idée d’une coupure nette entre l’Ancien Régime et l’ordre nouveau. L’expérience révolutionnaire portait en elle la représentation d’une rupture fondamentale avec l’ancien ordre politique (la monarchie absolue) et son fondement social (la domination des ordres). Cette rupture, considérée par les révolutionnaires comme une nécessité, était présentée comme un moyen de tenir les promesses de liberté, d’égalité et de fraternité. Ce faisant, la Révolution avait un caractère à la fois local et universel : en France (y compris dans les colonies), elle était synonyme de libération du joug des anciennes structures, dont le caractère féodal était condamné, aussi bien en raison de l’injuste répartition des biens qu’elles supposaient qu’en raison de leurs effets économiques sclérosants. En même temps, la Révolution constituait un exemple pour les mouvements qui poursuivaient les mêmes objectifs et qui allaient permettre tôt ou tard à l’ordre nouveau de s’imposer dans le monde entier. Fallait-il exporter la révolution ou se contenter d’être solidaires avec les révolutionnaires autochtones ? Cette question divisait les factions jacobines menées par Brissot et par Robespierre, et allait être régulièrement débattue par les mouvements révolutionnaires ultérieurs.
Dans le même temps, la Révolution française avait montré que son efficacité reposait sur la large mobilisation de groupes sociaux ayant des objectifs et des intérêts très différents. Elle se fondait en quelque sorte sur l’« illusion héroïque » selon laquelle l’ordre nouveau instituerait la liberté et la justice pour tous, en toute équité. Dans des circonstances historiques particulières, cette illusion a permis pendant un certain temps d’empêcher certains membres de cette large coalition de se détourner de la Révolution et de pactiser avec ses opposants. Cependant, l’effort pour sauver la jeune République a exigé une organisation de plus en plus stricte du pouvoir et une répression des mécontentements. Cette conduite radicale de la Révolution (la Terreur) a fini par lui faire perdre ses soutiens. Les masses étaient désarmées et ceux qui espéraient tirer un profit matériel de la Révolution perdaient patience face à la menace permanente d’une nouvelle redistribution des richesses.
La notion de contre-révolution fait également partie des héritages de la Révolution française. Elle est directement issue de l’expérience de la résistance des anciennes élites à la transformation sociale, et à leur perte de pouvoir. Toutefois, sa portée est plus large ; du reste, la résistance des anciennes élites ne s’est pas limitée à un simple rejet de la nouveauté. Les élites d’Ancien Régime ont exploité les contradictions du nouvel ordre instauré et ont su attiser le mécontentement d’assez larges masses, provoqué par les espoirs déçus ou les difficultés engendrées par la crise révolutionnaire. Lorsque celle-ci s’est aggravée en 1793, ni les jacobins, ni leur base populaire n’ont su faire la différence entre la contre-révolution menée par les élites et le rejet de la révolution de certaines franges de la population (comme par exemple en Vendée, qui en est devenue le symbole). Ils n’ont pas non plus su distinguer, d’une part, les différentes conceptions de l’avenir de la révolution et, d’autre part, les visées contre-révolutionnaires. Tous ceux qui ne prenaient pas explicitement parti pour les chefs de file de la révolution étaient considérés comme ses ennemis. Cela a eu des conséquences bien au-delà de la chute de Robespierre. Presque aucun mouvement révolutionnaire socialiste n’a réussi à sortir de la dichotomie simpliste entre révolution et contre-révolution, ce qui a coûté la vie à de nombreux partisans de l’ordre nouveau, ou les a fait passer pour des ennemis de la révolution, car ils avaient, pour diverses raisons, déplu à ses chefs de file, ou bien s’étaient rebellés contre eux. Les conséquences en furent funestes : les révolutionnaires socialistes n’ont jamais vraiment su repérer le moment où les mesures répressives visant à assurer la survie de la révolution devenaient superflues et contre-productives.
Dans la réception de la Révolution française au sein du socialisme et de la démocratie radicale, on trouve une critique selon laquelle la Révolution de 1789 n’aurait pas tenu ses promesses et n’aurait rien fait ou presque pour les classes populaires. Ce n’est pas un hasard si, dans sa généalogie du socialisme moderne, Marx mentionne Jacques Roux, Théophile Leclerc et Gracchus Babeuf comme des précurseurs décisifs, car ils ont promu l’idée qu’une seconde révolution venant compléter la première serait nécessaire. Ils ont essayé d’unir la pensée utopique du début de l’époque moderne (de la Cité du Soleil de Campanella à l’Utopie de Thomas More) et les espérances égalitaristes des populations sans terre, des petits paysans et des sans-culottes. L’idée d’une société excluant toute forme d’exploitation n’a d’abord nourri que des conspirations et des tentatives d’insurrection vouées à l’échec. Mais elle a inspiré tous les mouvements socialistes ultérieurs, qui se sont posé ces questions : comment utiliser l’extraordinaire force d’accélération des bouleversements révolutionnaires ? Comment parvenir à la souveraineté nationale et obtenir la liberté économique et politique prônée par la démocratie libérale, tout en mettant un terme à la pauvreté et à l’exploitation ? Si les révolutions pouvaient être considérées comme des « locomotives de l’histoire mondiale », il fallait alors allier l’énergie de la révolution démocratique-bourgeoise et les objectifs du socialisme. Là où la bourgeoisie se rangeait du côté de la contre-révolution, il fallait faire émerger la révolution socialiste.
« Si les révolutions pouvaient être considérées comme des « locomotives de l’histoire mondiale », il fallait alors allier l’énergie de la révolution démocratique-bourgeoise et les objectifs du socialisme. Là où la bourgeoisie se rangeait du côté de la contre-révolution, il fallait faire émerger la révolution socialiste. »
L’année révolutionnaire 1848-1849 a cependant montré que cette conception restait encore une position marginale : elle ne pouvait compter sur un large soutien et n’était pas en mesure de déstabiliser les anciens rapports de domination. La révolution de 1848, perçue comme une défaite par les premiers socialistes, a soulevé plusieurs questions : fallait-il une justification sociopolitique plus approfondie du nouveau rôle du socialisme ? Était-il nécessaire de mieux organiser les mouvements socialistes, en clarifiant les critères d’affiliation et de démarcation ? Et comment identifier les alliés d’un mouvement socialiste que l’on devait d’abord convaincre de ses objectifs ?
Durant les décennies qui suivirent 1848, Karl Marx et Friedrich Engels sont devenus les principaux théoriciens des mouvements socialistes. Ils ont cherché à répondre à ces questions dans des études approfondies et exposé leurs conclusions dans diverses publications journalistiques. D’une part, ces travaux ont permis de constituer un réseau transnational et transrégional impliquant de nombreux penseurs socialistes, en Europe occidentale et centrale, mais aussi en dehors. D’autre part, ils ont occasionné de vives polémiques, au cours desquelles le socialisme fondé sur le marxisme a pris ses distances avec les autres écoles de pensée.
En analysant du point de vue politique et économique les débuts du capitalisme industriel et l’émergence de la classe ouvrière, Marx a identifié le groupe social sur lequel pourraient s’appuyer le socialisme du futur et la révolution (ou les révolutions). Il poursuivait ainsi une ligne d’argumentation qui trouvait son point de départ notamment chez Antoine Barnave. Ce dernier avait soutenu dès 1792 que la Révolution française devait être comprise comme l’émancipation d’un nouveau groupe social, qui prenait ses distances avec les anciens ordres privilégiés et se distinguait du tiers état (dont l’existence était définie juridiquement). Pour Marx et Engels, les révolutions bourgeoises étaient portées par une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie, et visaient la progression du capitalisme et de la démocratie. De même, le prolétariat était la figure centrale d’une révolution qui allait encore plus loin et qui avait pour objectifs l’abolition de toutes les exploitations et l’association des hommes libres. Marx intègre dans son analyse la vision d’une révolution qui dépasse le capitalisme. D’une part, il défend l’idée d’une croissance illimitée des forces de production du capitalisme (c’est-à-dire une capacité d’innovation et de croissance intrinsèques irrépressibles). D’autre part, il développe l’argument selon lequel cette croissance irait de pair avec une concentration de la propriété, qui ferait croître le nombre des prolétaires n’ayant rien d’autre à perdre que leurs chaînes (et devenant ainsi le sujet révolutionnaire idéal). Cela signifie que la probabilité d’une révolution est la plus élevée là où le capitalisme est le plus développé. De plus, cette révolution ne peut être qu’une révolution mondiale, résultat organique de la croissance des forces de production et de l’augmentation du poids de la classe ouvrière dans la société. Les mouvements ouvriers émergents devaient donc mettre en place une organisation adéquate pour faire de ce prolétariat le porteur d’une révolution indépendante. Il fallait également déterminer le moment approprié pour créer une synergie entre des conditions structurelles et un acteur révolutionnaire.
Malgré sa courte durée et son champ d’action limité, la Commune de Paris de 1871 a donné lieu à de nouvelles expériences. Cette douloureuse défaite a ouvert une ère nouvelle : à partir de ce moment, la révolution n’est plus l’affaire que du prolétariat, car le potentiel révolutionnaire de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie semble s’être épuisé. Mais le prolétariat, d’abord conçu comme un groupe homogène, s’est avéré trop faible, isolé face aux autres classes sociales subalternes et, surtout, trop hétérogène socialement et politiquement pour pouvoir échapper à la prompte répression de l’insurrection. Le contexte de la guerre de 1870, dans lequel les troupes de Bismarck ont facilité la brutale répression des communards, soulève en outre la question de savoir comment définir les relations futures entre, d’une part, le foyer local de la révolution et, d’autre part, les rapports de forces internationaux.
Au cours des dernières décennies du xixe siècle, plusieurs systèmes politiques et sociaux de l’hémisphère Nord s’avérèrent assez flexibles pour intégrer un mouvement ouvrier qui gagnait de l’ampleur. La participation au parlementarisme ou la mise en place d’un État-providence faisaient partie de ces modalités d’intégration. Dans le même temps, l’expansion des empires coloniaux conduisait à l’exclusion et à la discrimination des populations locales, et parfois même au génocide des peuples indigènes. Pour les théories de l’impérialisme qui commençaient à se développer, ces deux tendances allaient de pair. Un ensemble de courants réformateurs émergèrent au même moment au sein des partis et des mouvements socialistes, qui comptaient accepter ces propositions d’intégration pour leurs électeurs et permettre le renforcement de la participation et de la prospérité pour tous, sans recourir à une révolution violente. À ce socialisme s’opposait la radicalisation d’autres courants, selon qui la prospérité (et la réduction des inégalités) dans les centres du capitalisme serait achetée au prix de l’exploitation des colonies et d’une augmentation des inégalités à l’échelle mondiale. Ils soutenaient par ailleurs qu’elle était une illusion, dans la mesure où le degré d’exploitation augmentait bien plus vite que les miettes distribuées par l’État-providence.
L’entrée en scène des bolcheviks en tant que « jacobins du xxe siècle » avait pour objectif de mobiliser l’héritage radical des montagnards afin de s’opposer aux réformateurs, pour qui les révolutions des xviiie et xixe siècles avaient permis de mettre en place la démocratie, rendant inutiles d’autres révolutions et permettant l’expansion d’un mouvement progressiste orienté vers le socialisme.
Au moment de la Première Guerre mondiale, l’ordre social s’effondra et la misère économique s’aggrava dans de nombreux pays, dont la Russie. Dans les colonies, dont les ressources avaient été mobilisées pendant la guerre, les mouvements d’émancipation avaient gagné de l’ampleur. Ces circonstances, ajoutées au mécontentement croissant des soldats et de la population civile qui souffrait de la faim, entraînèrent une série de soulèvements. Ainsi, la périphérie du système impérialiste, qui n’avait pas du tout été prise en compte à ses débuts, devint le centre de l’attention des révolutionnaires. En Russie, la transition fut rapide entre la révolution de Février et la révolution d’Octobre : le régime contrôlé par le Parlement, discrédité, fut remplacé par un gouvernement révolutionnaire dirigé par des conseils de soldats et d’ouvriers. Cela souleva le problème du « socialisme dans un seul pays » et de la transition entre la révolution socialiste et le communisme. Il fallut de nouveau repenser la révolution : elle ne constituait plus le point final des changements socio-économiques, mais restait en fin de compte une explosion imprévisible du mécontentement des masses, à laquelle les révolutionnaires professionnels devaient conférer une nouvelle signification. Aussi se répéta, comme lors des révolutions antérieures, le drame d’une coalition sociale initialement large, qui, fondée sur l’illusion héroïque d’intérêts homogènes, avait chassé l’ancien régime, avant de se réduire. Le gouvernement révolutionnaire se trouva confronté à une diminution de sa base sociale dans un contexte international particulièrement hostile à son égard. Avec le communisme de guerre, puis la nouvelle politique économique et enfin la modernisation industrielle à marche forcée sous Staline, le gouvernement révolutionnaire expérimenta divers moyens pour tenter d’initier des changements économiques et sociaux qui permettraient de pallier le succès prématuré de la révolution politique. Mais au final, il demeura fidèle à l’avant-gardisme qui allait dorénavant marquer les représentations de la révolution.
La victoire des Alliés et l’important tribut de sang payé par l’Armée rouge conférèrent à l’Union soviétique une nouvelle reconnaissance internationale. Elle devint pendant la guerre froide un adversaire sérieux, à qui les États-Unis reprochèrent de vouloir faire progresser la révolution mondiale partout où cela était possible. Pourtant, la crise des missiles de Cuba montra clairement qu’il y avait des limites à un tel radicalisme.
À Yalta et Potsdam, Staline parvint à placer sous son hégémonie l’Europe centrale et orientale, devenues glacis de la puissance militaire soviétique. Il était difficile d’interpréter cette transformation, conquise à la pointe des baïonnettes, comme le fruit d’un acte révolutionnaire des masses locales. Si bien qu’en Europe de l’Est, la représentation du pouvoir communiste comme produit de l’énergie révolutionnaire peina à convaincre. Le rapport discrédité entre révolution et socialisme réel se manifesta sous diverses formes. Tout d’abord, après 1948, les dirigeants du bloc de l’Est (qui, au départ, étaient tout à fait disposés à coopérer avec la social-démocratie et à intégrer ses partisans) prirent de plus en plus leurs distances avec la social-démocratie occidentale, à qui ils reprochaient d’avoir trahi la révolution. À l’inverse, de nombreux partis sociaux-démocrates occidentaux se détournèrent du socialisme réel, en déclarant que la révolution était un bouleversement inutile. De nombreux communistes furent déçus : ils se référèrent à la révolution socialiste manquée de 1945 et reprochèrent à ces régimes leur manque de radicalisme, ou soulignèrent que la seule chose qui avait subsisté de l’élan révolutionnaire était la violente répression des ennemis de la révolution. La thèse des « trois principaux courants du mouvement révolutionnaire mondial », toujours invoquée comme base d’un espoir d’alliance, se heurtait d’un côté à la dure réalité d’un mouvement communiste souvent marginalisé dans les centres occidentaux du capitalisme, et pour qui une révolution n’avait guère de chances de se produire, et de l’autre, à la mise en doute du caractère révolutionnaire des pays du socialisme réel.
Il restait l’espoir de nouveaux bouleversements issus des mouvements de libération dans les pays du Sud. La Chine de Mao repéra très vite la faiblesse stratégique d’une espérance révolutionnaire ne reposant que sur le rôle moteur du prolétariat. En mettant l’accent sur l’insatisfaction des paysans pauvres et sur l’amélioration de leur situation grâce à une réforme agraire et des politiques de redistribution des terres, son projet devint attractif et eut un effet mobilisateur pour de nombreux mouvements politiques en Asie et en Afrique, mais aussi en Amérique latine, région en situation de dépendance chronique. Cela eut aussi pour effet d’accentuer le poids de la Chine, qui était en compétition avec l’Union soviétique dans le domaine de la politique étrangère.
Les troubles révolutionnaires parfois importants de la fin de l’ère coloniale eurent pour mots d’ordre l’obtention d’une souveraineté économique et politique, la consolidation d’un nouveau régime, mais aussi la satisfaction des besoins les plus urgents de la classe moyenne émergente et des classes inférieures. Certes, le soutien élargit le champ d’action des mouvements de libération ou des nouveaux gouvernements, mais le modèle marxiste de la révolution fut interprété de façon extrêmement variée, lorsqu’il trouva un écho. La frustration engendrée par le décalage fréquent entre les performances des régimes issus de mouvements d’indépendance et les attentes qu’ils avaient suscitées eut pour effet, d’une part, d’alimenter de nouvelles tentatives révolutionnaires, et, d’autre part, d’affecter l’image de la révolution comme outil de transformation efficace.
Ainsi, le débat se déplaça, passant des causes et du déroulement de la révolution à la manière dont on pouvait se libérer de la perspective révolutionnaire. Ce débat, qui eut lieu en Afrique et en Asie durant les années 1970, s’accompagna d’une révision critique de la période stalinienne en Union soviétique. Ici aussi, de nouvelles interprétations accordèrent la plus haute attention à la question de savoir comment il était possible de sortir de l’incessante spirale de la violence et de la répression des dissidents. La fin de la révolution devint donc le centre d’attention de la pensée socialiste à l’époque de la coexistence pacifique et de la crainte d’une catastrophe nucléaire. Le rejet de la perspective révolutionnaire telle qu’elle avait été imaginée jusqu’alors s’incarna dans l’eurocommunisme. Durant les années 1980, une révolution ne semblait plus stratégiquement ni prometteuse, ni souhaitable, étant donné les bouleversements qu’elle pouvait provoquer dans un ordre mondial dans lequel les mouvements et les régimes socialistes n’avaient plus l’initiative.
« La fin de la révolution devint donc le centre d’attention de la pensée socialiste à l’époque de la coexistence pacifique et de la crainte d’une catastrophe nucléaire. »
Cependant, ce renoncement implicite au futur de la révolution ne dura pas, car à la surprise générale, en 1989, on assista à un effondrement de régimes socialistes, à des mouvements de masse et à des transformations sociales, qui sont les critères d’une révolution. Comme cela avait été le cas à la fin du xviiie et au début du xixe siècle, en 1848-1849 ou encore en 1918-1919, les bouleversements révolutionnaires ne se limitèrent pas à un lieu ou même à un continent, mais entraînèrent une réorganisation fondamentale du monde.
La qualification des événements de 1989 a toutefois posé des problèmes conceptuels considérables à la pensée socialiste : d’une part, ces révolutions ont renversé des régimes qui se considéraient comme socialistes, d’autre part, ces révolutions se sont accompagnées d’une délégitimation dramatique du marxisme et des perspectives socialistes. En outre, ces révolutions ont étonné par la quasi-absence de recours à la violence. Enfin, un consensus anticommuniste a permis de fédérer une base de masse, et de nouvelles élites constituées d’oligarques perspicaces, d’anciens cadres du parti communiste et de l’industrie nationale se sont adaptées facilement à la logique de marché et se sont laissé tenter par une variante néolibérale de la mondialisation.
C’est en particulier l’idée de « révolution pacifique » qui a remis en question le concept de révolution tel qu’il était connu jusque-là, et a relancé le débat. Une révolution est-elle concevable sans violence, ou bien la violence des luttes sociales constitue-t-elle l’essence de toute révolution ? Durant le dernier quart du xxe siècle, deux convictions se sont imposées dans de nombreux pays occidentaux : d’une part, les appareils de pouvoir en place sont si bien armés qu’il serait impensable de les vaincre en élevant des barricades, dans une société globalement pacifiée ; d’autre part, la résistance violente contre l’État paraît de moins en moins acceptable, si bien que les mouvements révolutionnaires se marginaliseraient et se discréditeraient en recourant à la violence. L’expérience des deux premières décennies du xxie siècle montre toutefois qu’il n’est pas totalement justifié de limiter ainsi aux pays du Sud le lien entre violence et révolution. Ainsi, les contestations du printemps arabe se veulent non violentes ; c’est aussi le cas dans les « révolutions de couleur » en Europe de l’Est et en Asie centrale. En revanche, la non-violence des mouvements de contestation sociale, représentés par exemple par les Gilets jaunes en France ou le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, n’est pas attestée, même si le recours à la violence les marginalise. La question des rapports entre violence et révolution s’avère donc plus ouverte que ne le laissaient entrevoir les prévisions de 1989, selon lesquelles il n’y aurait plus à l’avenir que des révolutions pacifiques.
Entre 1989 et 1991, la révolution en Europe de l’Est fut accueillie avec triomphalisme par les adversaires du socialisme d’État, qui renouèrent ainsi, ironie du sort, avec l’idée de la fin de l’histoire par l’effondrement définitif de toutes les perspectives révolutionnaires. Pourtant, tout comme 1989 avait étonné ceux qui s’étaient jusqu’alors crus détenteurs d’un monopole sur les révolutions, la suite des événements surprit les vainqueurs de 1989 : les révolutions de couleur, la révolution des Roses en Géorgie en 2003, la révolution orange en Ukraine en 2004, la révolution du Cèdre un an plus tard au Liban, la révolution des Tulipes au Kirghizistan en 2005, la révolution safran en Birmanie en 2007, la révolution du Jasmin en Tunisie de 2010 à 2011 (qui ne constitue qu’une petite partie du printemps arabe), ont donné tort à tous ceux qui n’attendaient plus rien des mouvements populaires, même si la qualification de « révolution » peut se poser pour ces processus.
Il semblerait donc que l’histoire des révolutions soit loin d’être terminée. On peut prédire sans grand risque de se tromper qu’il continuera à y avoir, à l’avenir, des revendications pour plus de liberté politique et d’égalité sociale, mais aussi des crises profondes remettant en question la légitimité des régimes établis. Il est plus difficile de prédire si les mouvements socialistes continueront à puiser dans le répertoire de l’histoire révolutionnaire moderne pour résoudre ces crises. On peut cependant affirmer avec certitude que les mouvements sociaux poursuivront leur lutte pour la reconnaissance de leurs revendications, s’il le faut en contestant l’ordre établi : l’histoire des révolutions se poursuit.