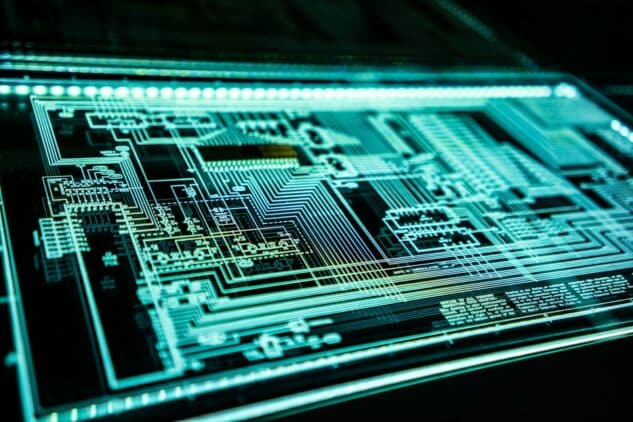Du pamphlet à l’enquête issue de travaux académiques en passant par l’essai, des dizaines d’ouvrages mêlant technologie et politique sont publiés chaque année. C’est un domaine aussi foisonnant que médiatiquement sélectif car peu, parmi ces titres, sont affichés sur les chaînes grand public. Le livre d’Asma Mhalla, docteure en études politiques et experte au sein du think tank libéral Institut Montaigne, Technopolitique – Comment la technologie fait de nous des soldats (Seuil, 2024) atteint cet objectif. La thèse, plutôt sensationnaliste, n’y est pas pour rien : la technologie se militarise et prend d’assaut nos cerveaux. Il faut réagir, repolitiser la question, refonder les bases d’une démocratie nouvelle. Si le projet peut par moments faire écho aux critiques de la surveillance généralisée ou de l’hubris technophile, il déplie une vision contestable de la démocratie (martiale) et du citoyen (soldat), le tout principalement basé sur la défiance vis-à-vis des puissances non occidentales. Au prix de quelques oublis.
Spectre de « l’hyperguerre » et cerveaux comme champs de bataille
Technopolitique est composé de onze courts chapitres dont les premiers exposent la boîte à outils conceptuelle de l’autrice. En synthèse : les technologies de « l’hypervitesse » menacent les démocraties libérales, infiltrent les moindres interstices de nos vies, jusqu’à véroler de l’intérieur la construction d’un régime de vérité partagé. En cause, un projet de « Technologie Totale (…) par sa volonté de puissance et de contrôle hors limite » (p. 13), indifférent aux opinions politiques, compatible avec « tous les clivages et antagonismes traditionnels » (p. 36), et surtout, en voie de militarisation. Le risque, en revenir à un « état Hobbesien de violence primaire » que seul le « retour du politique » (p. 14) pourrait contrecarrer. Ce qu’il faudrait faire : « nous mettre d’accord sur un nouveau récit démocratique » (p. 26).
Au cœur de l’ouvrage, les thématiques abordées sont plurielles, dépliant une variété de controverses devenues classiques dans le champ des critiques du numérique. Tout y passe donc : le poids financier des « Big Tech » et leur co-dépendance avec le Pentagone, les idéologies toxiques de la Silicon Valley (« long-termisme », « effective altruism », qui affectent de Sam Altman à Peter Thiel, sans oublier Elon Musk), les errements de la police prédictive, en passant par la reconnaissance faciale dont les garde-fous restent bien fragiles. Mhalla continue un combat entamé de longue date contre la surveillance généralisée, de Russia Today à Quotidien en passant par Télé Matin, et rappelle avec justesse que « d’ici à 2026, le marché mondial de la reconnaissance faciale devrait par exemple peser plus de 11 milliards de dollars » (p. 215).
Autre sujet brûlant : le rôle des réseaux sociaux, invasifs, favorisant ici et là l’ingérence de puissances étrangères dans le quotidien, jusqu’aux périodes électorales. Une « guerre cognitive » gronderait, avec pour champ de bataille nos cerveaux, nouvelles cibles bientôt altérées par les implants Neuralink (Elon Musk) dans le but de « lire vos pensées et de modeler votre esprit » (p. 126) : une forme de guerre de l’opium 2.0. Le point de fuite : une augmentation des thèses complotistes réunies sous la formule « Internationale conspirationniste » (p. 132), et un inévitable éclatement social caractérisé par des crises à répétition, dont ont témoigné la tentative de prise du Capitole en 2021, l’épisode des Gilets jaunes ou encore celui des émeutes en banlieues pour le cas français (p. 204). Réseaux sociaux dont il serait souhaitable de « repenser l’entièreté des modèles économiques » (p. 112), mais dont il ne faudrait pas se départir dans ces sombres moments de déclin démocratique, car « déserter cette partie de l’espace public [X – ex Twitter] au moment où nous avons le plus besoin de repères et d’informations fiables, n’est-ce pas une lâcheté ? » (p. 112).
La diversité du « nous » est diluée dans un conflit civilisationnel surplombant. Marx, mentionné par l’autrice, a peut-être été poussé un peu vite vers la sortie.
Est enfin rappelé le danger d’un glissement d’usages civils vers les usages militarisés. La reconnaissance faciale servant ainsi de cheval de Troie pour générer son acceptabilité à des fins sécuritaires : le « ludique comme arme de guerre » (p. 125). Du particulier, l’argumentaire s’étend au global, au géopolitique, et le champ militaire n’est pas épargné : armes autonomes, drones, sur fond de guerre froide renouvelée avec la Chine en substitut fonctionnel à l’URSS. Le spectre de « l’hyperguerre » (notion empruntée à John R. Allen et Amir Husain) menacerait, avec un point de mire funeste : la délégation de l’usage de l’arsenal atomique à l’intelligence artificielle (crainte presque aussi vieille que l’arme atomique elle-même, en réalité).
En plus des risques liés à la convergence déjà consommée de l’intelligence artificielle et des armées, sont pointés les enchevêtrements entre intérêts publics et privés, faisant émerger un dilemme insoluble entre « Big Tech » et « Big State », la relation entre les deux étant « liquide, variable, lunatique, ambivalent[e] » (p. 150). Parmi les réponses proposées : mettre à distance toute naïveté et « “armer” cognitivement le citoyen-soldat », apprendre à « naviguer en eaux troubles » dans une « démocratie symbiotique » et « désirante » (p. 53), alors qu’il serait devenu presque impossible de renouer avec des questions simples telles que « qui me parle ? » et « d’où me parle-t-on ? »
Le fond et la forme : qui est « nous » ?
Par-delà la collection de faits retenus, principalement depuis la presse généraliste, Mhalla propose différentes grilles d’analyses et autres concepts de son invention pour interpréter la période. Marx tout d’abord, est mobilisé pour sa vision des rapports superstructure/infrastructure, (débouchant sur la notion de « MétaStructure » – la mise en donnée du monde – et « d’InfraSystème » – les infrastructures matérielles) mais aussitôt enterré pour le reste de son oeuvre, car ce nouveau couple « acte la disparition du concept de classe. » (p. 43). Un triptyque « économie, technologie et idéologie » est également introduit pour « passer de la théorie à la pratique sans perdre en complexité » (p. 57). On ne discutera pas ici plus avant la fiabilité et l’utilité de cette terminologie qui fait déjà grincer des dents dans certaines sphères académiques (voir notamment, le texte de Dominique Boullier pour le média AOC « Technopolitique ou l’art de la pêche au gros », où il est avancé que les « gros concepts » sont là pour « sidérer le lecteur »).
Cet excès sémantique est évidemment discutable, et interroge avant tout la nature de l’ouvrage qui, loin des standards académiques, est à classer dans la catégorie « essai » (un registre situé à la page 260). Cela n’est en rien un problème si deux conditions sont réunies : la clarification statutaire préalable (rendue objectivement floue par le titre de « chercheuse » qualifiant parfois l’autrice1), et le travail probatoire auquel tout essayiste – chercheur ou non – est censé se prêter.
Pour qui est déjà familier du sujet, il est clair que Technopolitique n’est pas d’une folle générosité en matière de citations. Peu d’universitaires pourtant spécialistes des thématiques abordées sont sollicités, laissant au lecteur averti l’impression que plusieurs portes ouvertes sont enfoncées. Mais là n’est pas la cible de l’ouvrage, qui s’adresse plutôt à un lectorat disposant de quelques notions de base en science politique, comme le retour à l’état de nature de Hobbes (dont une multitude de travaux ont montré qu’il s’agissait d’un mythe, études des peuples pré-étatiques à l’appui2). L’un dans l’autre, élargir le débat à des sphères non expertes n’est pas un mal : ce qui compte, c’est la nature du propos.
Là où la forme rejoint le fond d’une manière plus percutante encore – justifiant cet écart vers la méthode – est dans l’usage systématique d’un « nous » non situé. Si le procédé a l’avantage d’embarquer les lecteurs dans un récit qui les concernerait tous au même degré, c’est un choix qui est loin d’être neutre, puisqu’il s’agit bien de bâtir à travers lui la réponse aux problèmes évoqués par Mhalla tout au long du livre. Ainsi, des interrogations aussi simples que « où devons-nous nous situer » (p. 18) et « Comment préserver notre réel face à leur futur fantasmé et fantasmatique ? » (p. 101) gomment littéralement toute lecture qui dépasserait l’opposition frontale entre le projet de « Technologie Totale » (des Big Tech) et un lectorat uniforme dont on ne saisit clairement l’identité qu’à la page 230 : « Quel contre-modèle occidental souhaitons-nous revendiquer pour affirmer notre singularité, notre puissance, notre pouvoir d’attractivité ? » Le « nous » équivaudrait donc à l’Occident (Europe et États-Unis) face à la Chine – un « nous contre eux », en somme.
Dès lors, on ne trouvera que très peu de passages dans Technopolitique qui soient de nature à « complexifier » les liens entre technologie et politique du point de la variété des citoyens et travailleurs qui profitent des progrès techniques ou qui en pâtissent. La représentation syndicale par exemple, reste hors-champ dans la démocratie selon Asma Mhalla, tout comme sa déconstruction politique après des décennies de néolibéralisme, aux États-Unis comme en France. Toute la diversité du « nous » est diluée dans un conflit civilisationnel qui surplombe tout et tous. Il y aurait pourtant beaucoup à dire sur ce qui relie un ouvrier d’une usine de Foxconn à un manutentionnaire d’Amazon dans un entrepôt à Belfort : Marx a peut-être été poussé vers la sortie un peu vite.
L’horizon nationaliste de la « technopolitique »
C’est en fin d’ouvrage, après un étalage de faits bien documentés, dont la plupart font consensus (et quelques autres non), que l’autrice déploie un projet politique concret. Tout au long du livre, les promesses d’un renouveau collectif ont été distillées : « nous allons devoir collectivement décider de ce que nous souhaitons faire de ces technologies » (p. 104), « Au-delà des billevesées de comptoir, que souhaitons-nous réellement en faire ? » (p. 229), etc. Ce projet s’illustre sur deux plans : une série de propositions qui concernent les usages dans la sphère individuelle, puis une vision plus globale de ce que devrait être une démocratie dans un techno-monde en crise.
Parmi les pistes avancées, l’usage des écrans chez les jeunes qu’il s’agirait de limiter pour « amortir le danger symbiotique entre le réel et le virtuel » (p. 257), les réseaux sociaux qui pourraient faire l’objet de campagnes de sensibilisation massives pour inviter à ne pas réagir « dans les cinq secondes » qui suivent l’exposition à un contenu (p. 250), la surveillance qui appellerait à une « “troisième voie sécuritaire” occidentale » (p. 223). Si les sujets ont le mérite d’être posés, Mhalla ne tranche pas toujours, ou reprend des idées déjà en l’air : voilà 10 ans qu’on nous conseille de désactiver nos notifications, de faire des jours « sans téléphone », de passer l’écran en noir et blanc, etc.
Quant aux défaillances de la modération en ligne, on pourrait regretter que ne soient pas ouvertes plus complètement des solutions collectives et citoyennes, un peu effleurées mais pourtant prometteuses. Côté surveillance, les constats sont justes mais l’autrice s’arrête au milieu du gué : l’inefficacité des dispositifs de surveillance étant bien documentée et traitée dans l’ouvrage, promouvoir leur abolition aurait pu s’entendre – a minima, citer la principale association qui en fait un combat (la Quadrature du Net) aurait pu orienter le lecteur. La ligne de crête : ne pas pointer du doigt les coupables (en dehors des promoteurs de la « Technologie Totale », principalement situés aux USA, car en dehors d’eux, « personne n’est à blâmer », p. 225).
Sur un autre plan, Asma Mhalla propose d’inclure à la discussion la société civile, cite le philosophe pragmatiste John Dewey à plusieurs reprises, dans l’idée d’injecter une « dose de participation “civile” via les ONG », se référant dans un même élan aux propositions d’Emmanuel Macron consistant à assurer une « co-régulation entre États et plateformes lors du Forum sur la gouvernance d’internet en 2018 » (p. 237). À cette « dose » démocratique à « injecter », répond donc un projet plus ample, celui d’une alliance entre « Big Tech » et « Big State » : « L’organisation de la riposte aura au moins autant besoin de l’État que des “Big Tech” dans une relation davantage complémentaire qu’antagoniste » (p. 141). Si certaines conditions sont posées à cette capitulation (et notamment « l’inter-nationalisation » des « Big Tech » dans le but d’en faire des « bien communs immatériels propres aux pays de l’Alliance » p. 239), reste un paradoxe, celui d’avoir longuement déplié la liste des controverses suscitées par ces mêmes « Big Tech » au cours de la décennie passée (Facebook, Clearview, Palantir et tant d’autres), pour finir dans leurs bras, pour ne dire sous leur joug – en postulant que ceux-là se laisseront faire quand il s’agira de les mettre au service du bien commun.
Cette idée se double d’une proposition plus générale encore : assumer juridiquement la fusion Europe / États-Unis et sa composante civilisationnelle, à travers une « “souveraineté élargie”, une co-gouvernance transatlantique solidaire, une Alliance Technologique de nouvelle génération à laquelle le citoyen, le Big Citizen, prendrait part en se présentant directement face aux deux autres pôles, Big Tech et Big State » (p. 231). Comment ? L’autrice ne renseignera pas tellement plus le lecteur – un recours aux travaux académiques en matière de participation aurait pu permettre de combler ce vide, voire d’éviter les pièges d’une participation citoyenne certes souhaitable mais souvent instrumentalisée et sans conséquences sur le réel3.
Un levier puissant pour susciter l’émoi, resserrer les rangs et lever une « armée citoyenne » (p. 250) est en revanche identifié : le drapeau. Pour gagner la « bataille du vrai », écrit Mhalla, il faut gagner celle de l’imaginaire et des récits, « ne pas taire la menace » (p. 252), « recréer le sentiment de fierté et d’appartenance, de résistance » (p. 253). C’est là où commence la figure du citoyen-soldat : non pas dans la défense des valeurs démocratiques dans l’absolu, moins encore dans la contestation des rapports de production inégaux qui concernent aussi l’intelligence artificielle, ni même dans l’identification de technologies répondant à des besoins fondés en raison et compatibles avec l’impératif climatique, mais bien dans l’opposition à un ennemi. Technopolitique fait au fond sienne une devise connue : « si tu veux la paix, prépare la guerre. »
La couverture médiatique de Technopolitique demande à aller plus loin que la remise en cause des éléments de langage qui s’y trouvent, le magnétisme de ses superlatifs, le manque de sources ou d’historicisation qui tend parfois à présenter les continuités comme des ruptures (à commencer par exemple, par la dualité des technologies). Asma Mhalla pose un certain nombre de constats qui peuvent être partagés. Acte de changements d’échelles réels et de la nécessité d’opérer des arbitrages quant à l’usage objectivement délétère de certaines technologies, au sein des États occidentaux comme depuis des puissances étrangères.
Sur le fond, ce sont deux questions majeures qui doivent être opposées à l’autrice. D’abord, un certain déterminisme qui conduit à interpréter tous les maux de l’époque comme émanant des technologies, passant outre le reste des contextes sociaux qui motivent et alimentent une « fatigue démocratique » : conditions de travail, répartition des richesses, place des médias libres et indépendants, comportement des « élites », jusqu’à l’urbanisme ou encore la montée de partis racistes. La technologie ne fait pas tout. Ensuite, il convient d’interroger la pertinence d’un changement d’échelle « démocratique » basé sur un non-dit ou un non-assumé : l’idée d’un inévitable choc de civilisations, dont les perspectives pacificatrices pour le « citoyen-soldat » sont pour le moins incertaines, le forçant à s’engager dans un nationalisme technologique aveugle à la complexité de nos histoires collectives et individuelles, et dont les principaux ressorts sont l’exclusion et l’éternelle course à la puissance, précisément celle où s’enracinerait le projet de « Technologie Totale ».
Notes :
1 On notera que les appellations et titres retenus par les journalistes pour qualifier un auteur, peuvent lui échapper.
2 On ne donnera ici qu’un seul exemple, avec David Graeber, David Wengrow, Au commencement était, Une nouvelle histoire de l’humanité, Les liens qui libèrent, Lonrai, 2021.
3 Le champ de la « Démocratie technique » aborde cette question depuis plusieurs décennies, avec des conclusions en demi-teinte et des propositions diverses pour gouverner démocratiquement les choix technologiques. Voir notamment Yannick Barthe, Michel Callon, Pierre Lascoume, Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique, Paris, Seuil, 2001. Sur la limite des formats participatifs, voir également Manon Loisel et Nicolas Rio, Pour en finir avec la démocratie participative, Textuel, 2024.