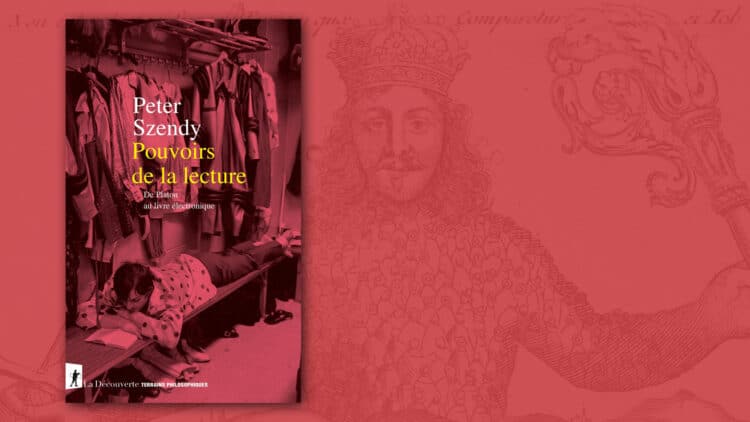Peter Szendy est l’un des théoriciens de la littérature les plus importants de notre époque. Nous l’avons rencontré à l’occasion de la parution de son ouvrage, Pouvoirs de la lecture. De Platon au livre électronique (La Découverte, 2022), dans lequel il étudie l’expérience de la lecture comme une scène, psychologique, sociale et politique complexe. Il se penche également sur les récentes transformations technologiques de cette expérience et notamment sur les implications anthropologiques de la croissance significative du marché du livre audio. Entretien réalisé par Simon Woillet.
LVSL – À l’heure où les technologies numériques bouleversent notre rapport aux savoirs, vous proposez de réinterroger l’expérience fondamentale de la lecture, dans une approche qui tente de faire droit aux zones d’ombres entre lecteur et texte. Vous déclarez, ce faisant, vouloir sortir de la vision de la lecture produite par les Lumières, où la relation au texte était principalement conçue selon vous sur le mode de la transparence en termes de transmission des connaissances. Pouvez-vous nous éclairer sur le sens de cette démarche ?
Peter Szendy – Il y a dans votre question deux marqueurs temporels importants : le passage au numérique d’une part et les Lumières d’autre part. Il ne s’agit pas pour moi de tenir ces balises chronologiques pour des frontières historiques intangibles. Au contraire, mon travail consiste à faire droit à ce que l’on pourrait appeler des hétérochronies, c’est-à-dire des temporalités différentes mais simultanées. Autrement dit, la relation des lecteurs d’aujourd’hui aux textes qu’ils lisent obéit à des régimes anciens en même temps que contemporains, des régimes qui peuvent coexister, s’hybrider ou s’affronter, ce qui implique une vision stratifiée des paradigmes historiques de l’expérience de la lecture.
J’essaie d’être attentif à la coexistence de vitesses contrastées, par exemple : qu’il s’agisse des vitesses propres aux systèmes de renvois internes à un texte (la consultation d’une note en fin d’ouvrage n’implique pas la même vitesse de renvoi qu’un lien hypertexte à cliquer) ou bien des vitesses de réception, de diffusion d’un ouvrage dans la texture de l’espace dit public (où la lecture qu’on a pu qualifier d’intensive, à savoir la rumination des mêmes textes, comme ce fut longtemps le cas de la Bible, coexiste avec la lecture dite extensive, celle des journaux, des nouvelles, des romans-feuilletons au XIXe siècle, des tweets ou autres notifications aujourd’hui…).
S’il y a donc des différences de vitesse dans la circulation des Lumières et dans leurs inscriptions sur papier ou sur écrans rétroéclairés, c’est aussi qu’il se crée des zones d’ombre, aujourd’hui comme au XVIIIe siècle. Non seulement parce qu’il y a de l’incompréhension, de l’inattention, disons, en un mot, de l’inéclairé qui résiste ou se reforme dans les plis de l’hétérochronie, mais aussi (j’imagine que nous y reviendrons) parce que tout acte de lecture implique de la violence, de la soumission, de l’irraisonné et de l’infondé. Il faudrait dire en outre, si l’on considère cette fois l’histoire matérielle des supports d’inscription des savoirs, que la propagation des « lumières » actuelles — les lasers, les systèmes de gravure et de décodage, les fibres optiques… — repose sur l’obscurité des tractations géopolitiques, du secret industriel et de la raison d’État ainsi que sur l’aveuglement face aux conséquences environnementales de ces technologies du visible ou du lisible.
LVSL – Vous proposez également une interprétation fascinante de notre rapport ambigu au livre audio.
PS – Je voulais d’abord faire un pas en arrière face à ce que l’on appelle un peu vite la crise de la lecture à l’ère numérique. Car le premier effort de réflexion devrait d’ores et déjà consister à ne pas tenir pour acquis que la lecture serait strictement cantonnée à un rapport silencieux à un texte écrit. Je ne suis bien évidemment pas le seul à le penser : beaucoup d’autres avant moi ont travaillé sur l’histoire de l’expérience de la lecture et sur les formes de résistance de l’oralité face au scriptural. C’est notamment ce qu’a pu développer Roger Chartier. Mais il reste que la puissance du paradigme scriptural continue de faire écran à une compréhension plus fine des voix intérieures de la lecture.
Toujours est-il que, en adoptant une perspective décentrée par rapport au seul support écrit, il me semble que l’on peut éviter d’en rester aux mêmes discours nostalgiques sur la perte du goût de la lecture ou la « mort du livre ». Qu’il suffise de penser à l’importance immense que revêt aujourd’hui le livre électronique (tant sur un plan économique qu’anthropologique). Il se présente sous deux formes : le livre numérisé lu sur écran, certes, mais également le livre audio, qui représente une part de marché toujours plus importante. « 9,9 millions d’audio-lecteurs en 2022 », pouvait-on lire dans un communiqué du Syndicat national de l’édition qui annonçait le lancement, en mai 2022, du « mois du livre audio », accompagné du slogan « lire ça s’écoute » (www.sne.fr/actu/parce-que-lire-ca-secoute).
Même si l’idée que lire peut consister à écouter un livre commence à faire son chemin, ce type de propos ne va pourtant pas de soi. Matthew Rubery, dans sa belle histoire du « livre parlant » (The Untold Story of the Talking Book), se fait l’écho d’une attitude fréquente : « écouter des livres », écrit-il, « est une des rares formes de lecture pour lesquelles les gens s’excusent ». Il met ainsi le doigt sur un malaise diffus mais sensible, révélateur en tout cas, dès lors qu’on applique le verbe « lire », voire un verbe d’action tout court, au fait d’écouter un livre audio. Il semble que l’on hésite à concevoir cette écoute comme un acte, car on ne sait pas très bien ce que l’on fait, au juste, avec ou face à un livre audio. Comme si écouter un livre n’était pas vraiment faire quelque chose, surtout lorsqu’on se consacre en même temps, comme c’est souvent le cas, à une activité parallèle (les courses, le ménage, la marche, la conduite…). Sans doute qu’une partie de cette drôle de honte ressentie à l’égard du format audio tient à la prétendue « passivité » de ce type d’expérience.
Quoi qu’il en soit, l’hésitation quant au statut de la lecture audio en tant qu’acte de lecture me semble révélatrice d’un changement de paradigme. Les failles du langage quotidien révèlent ici la tectonique des plaques en jeu dans les transformations anthropotechniques de la lecture. Il faut rouvrir le chantier de l’analyse de la lecture à l’aune de ces formes nouvelles.
LVSL – Selon vous, sommes-nous réellement sortis de ces représentations passives de la lecture oralisée ? Dans un chapitre de votre livre intitulé « l’anagnoste et l’archonte », vous convoquez les formes antiques de la lecture et les rôles sociaux liés à cette activité pour construire une grille d’interprétation des différentes « voix » qui cohabitent dans notre psychisme de lecteur. Pouvez-vous revenir sur ces concepts et ce qu’ils impliquent pour l’époque actuelle, notamment du point de vue des nouvelles formes de subordination de la lecture impliquée par les algorithmes de recommandation des contenus ?
PS – L’anagnoste, dans l’antiquité gréco-romaine, c’est l’esclave spécialisé dans la lecture à haute voix pour d’autres. C’est un rôle défini au sein d’une hiérarchie économique et politique précise, un rôle qui s’inscrit dans un réseau de relations aussi bien sociales que symboliques. Tout d’abord, l’anagnoste est bien évidemment une figure du dominé ou du subalterne — c’est un esclave —, mais qui est d’emblée complexe car il s’agit d’un travail auquel on associe une haute valeur symbolique. Son labeur ouvre la voie, facilite l’accès à la sphère idéalisée du sens.
Dans ses rares représentations ou apparitions (rares, car il est voué par essence à s’effacer devant le texte), l’anagnoste est une figure qui oscille de manière fascinante entre ces deux extrêmes que sont l’activité totale et la passivité totale. En effet, en lisant pour son maître, il est actif face à ce dernier, qui l’écoute passivement. Mais en même temps, l’anagnoste prête son corps et sa voix à un texte par lequel il se laisse traverser et littéralement posséder. Dans le lexique qui était celui de la pratique grecque de la lecture (comme l’a montré Jesper Svenbro dans sa remarquable Anthropologie de la lecture en Grèce ancienne), l’esclave lecteur, l’anagnoste peut être décrit à la fois comme l’« éraste », l’amant en position active, et l’« éromène », l’aimé en position passive. Il est actif en tant qu’il lit pour l’autre ; il est passif en tant qu’il est le simple relais du discours lu qui passe par lui.
LVSL – De ce point de vue, la figure de l’anagnoste vous semble-t-elle pertinente pour décrire notre propre situation vis-à-vis des algorithmes de recommandation de contenus sur les technologies numériques ? Puisque nous sommes autant producteurs des données qui les alimentent qu’esclaves des techniques de manipulation émotionnelle et attentionnelle qui constituent leur raison d’être économique ?
PS – C’est une idée intéressante. On pourrait déjà faire l’hypothèse que l’anagnoste antique se dilue ou se dissémine dans toute sorte de machines, de logiciels, d’algorithmes qui font ce travail de « faire exister » des textes en les lisant pour nous. L’exemple le plus évident serait la voix automatisée du GPS qui vous « lit » la carte de votre trajet, qui est l’anagnoste de votre itinéraire. Mais il existe aussi quantité d’applications pour la vocalisation des textes, à l’instar de Speechify ou NaturalReader, qui vous permettent de choisir le genre ou l’âge ou les caractéristiques ethniques de la voix lisante ainsi que sa vitesse de lecture.
Ceci dit, votre question nécessite que l’on considère la position de l’anagnoste au sein de la scène de lecture antique d’une manière à la fois plus précise et plus vaste. Car l’anagnoste n’est qu’une des voix ou qu’une des instances dans cette scène. Il y a également le texte lui-même, bien sûr, à savoir le texte lu par l’anagnoste lorsqu’il prête sa voix à celle de l’auteur. Il y a ensuite la place de l’auditeur, de celle ou celui qui écoute la lecture : j’ai proposé, pour désigner cette instance, le néologisme de lectaire, par analogie avec destinataire. Enfin, et c’est le plus important peut-être dans la perspective ouverte par votre question, il y a cette figure implicite et pourtant centrale qui peut, je crois, éclairer notre relation aux algorithmes de recommandation dans la lecture numérique : il s’agit de l’instance qui commande la lecture, à ne pas confondre avec le lectaire, car un personnage peut, comme on le voit par exemple dans certains dialogues de Platon, commander à l’anagnoste de lire à haute voix pour quelqu’un d’autre que lui-même, pour un tiers.
Avant d’en venir à cette antique instance prescriptive et à ce qu’elle pourrait bien nous dire sur les prescriptions de lecture actuelles, je voudrais souligner que la structure de la scène de lecture, telle qu’elle nous apparaît depuis son histoire lointaine et largement oubliée, est fondamentalement triangulée. Il est en effet impossible d’en dégager ou d’y identifier une relation simplement et purement duelle, à l’image de ce que nous avons fini par construire comme l’expérience par excellence de la lecture, à savoir le face-à-face du lecteur et du texte, l’immersion de celui-là dans celui-ci. Lorsque l’anagnoste s’entend commander de lire à haute voix pour un lectaire, c’est déjà une relation à trois, c’est déjà un réseau qui s’ébauche, une circulation réticulée plutôt qu’une absorption frontale, immédiate, transparente.
On pourrait donc faire l’hypothèse que la lecture a toujours été une affaire de « réseaux ». C’était le cas pour la lecture pratiquée par l’anagnoste antique, mais c’est également vrai lorsque c’est le phonographe qui « lit » des « livres parlants » ou lorsqu’on lit aujourd’hui des livres électroniques. L’une des premières idées de Thomas Edison, dans son texte intitulé The Phonograph and its Future(1878), était précisément que son invention servirait à enregistrer des textes pour que d’autres puissent les écouter. Le phonographe ainsi utilisé, c’est, si vous voulez, la mécanisation de la fonction de l’anagnoste, sa rationalisation technique et sa reproductibilité à une échelle industrielle.
Mais je reviens à votre question concernant les algorithmes de recommandation. Là où l’ordre de lire adressé à l’anagnoste avait la structure simple d’un impératif (« prends le livre et lis ! », disent l’un des personnages du prologue du Théétète de Platon à l’esclave lecteur), les modalités actuelles de la prescription, à l’ère du capitalisme numérique, impliquent des bouquets de données (ce que Gilles Deleuze, dans son « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle », avait analysé comme la désagrégation de l’individu en flux dividuels). Cela modifie et l’injonction de lecture sur les réseaux sociaux et la signification même de l’acte de lire, qui se redouble d’un ensemble d’activités d’enregistrement et de formatage invisible de votre comportement, en temps réel et à votre insu. Sur Kindle par exemple, vous pensez être seul face à votre livre, mais en réalité vous êtes vous-même « lu », c’est-à-dire observé, et constitué en travailleur numérique inconscient par les technologies de ce type d’entreprises : vous êtes une série de points, un nœud de données (vitesse de lecture, types de contenus choisis, fréquence de la consultation de l’outil, passages relus…) dans un réseau plus vaste et dont la finalité est en général purement commerciale (l’ergonomie servant souvent à cacher ces formes de surveillance et de formatage autant qu’à les rendre possibles en renforçant la fluidité de l’expérience de l’utilisateur).
Je raconte dans Pouvoirs de la lecture une anecdote personnelle à ce propos. Me pensant bien assis chez moi, dans l’intimité d’une scène de lecture domestique idéalisée, je m’aperçois soudain, en touchant naïvement le texte à l’écran de ma tablette et en voyant s’afficher une petite case de commentaire, que je suis le nième utilisateur à souligner telle phrase précise. Une expérience comme celle-ci, que nous sommes tous susceptibles de faire, nous ramène brutalement à la puissance des technologies de prescription qui structurent désormais nos vies sans que nous en ayons suffisamment conscience.
Au début des années 1990, Bernard Stiegler avait initié un beau projet à la Bibliothèque nationale de France, qui consistait à produire des outils numériques de « lecture assistée par ordinateur » afin de matérialiser et de rendre transmissibles les traces laissées par les lecteurs dans leur élaboration du texte (je renvoie à son article intitulé « Machines à écrire, machines à penser », paru dans le n° 5 de la revue Genesis en 1994). Ce système d’annotations devait permettre de rendre visibles les gestes de lecture autrement invisibles au sein d’une sorte de communauté de lecteurs qui se formerait autour d’une œuvre. Et ce que montre ce type de démarche, c’est qu’il est possible de concevoir des régimes numériques de circulation de la lecture, des mises en réseau d’actes de lecture qui ne soient pas pensés uniquement dans la perspective d’une prescription marchande.
L’une des questions passionnantes que soulèvent les annotations des lecteurs, c’est sans doute celle de la singularité de l’acte de lecture. Une marque de lecture doit-elle ou peut-elle être signée, et si oui, comment ? Ce n’est pas le même type d’anonymat qui est en jeu dans l’impersonnalité machinique des algorithmes de recommandation de contenu, dans les commentaires de lecteurs identifiés par des pseudonymes sur les plateformes de vente en ligne ou dans les griffonnages dus à d’autres lecteurs inconnus que l’on rencontre en feuilletant un ouvrage emprunté à une bibliothèque. L’anonymat des modes de prescription propres au capitalisme numérique tend à être celui, statistique, du nivellement, de l’homogénéisation des singularités. Mais l’anonymat d’une trace de lecture, ce peut être aussi ce qui ouvre la possibilité de l’accident, la chance de l’imprévu.
LVSL- Vous parlez de « phonoscène » intérieure de la lecture notamment pour désigner les développements que vous venez de nous présenter et vous suggérez qu’il faut se pencher sur les relations entre les parties prenantes implicites de toute « scène de lecture ». Vous montrez dans votre livre et comme nous venons de le voir qu’il existe toujours une instance que l’on peut appeler « l’impératif de lecture ».
PS – En effet, cette instance impérative fait partie intégrante de toute scène de lecture, c’est-à-dire de tout acte de lecture. Mais elle est susceptible d’être configurée et appropriée — sur le plan psychique, social et technologique — de manière extrêmement différente selon les contextes et les époques historiques. Il semble n’y avoir rien de commun entre, par exemple, l’enfant qui exige qu’on lui lise une histoire et l’injonction implicite de lecture qui se loge dans la nécessité de cocher la case « lu et aprouvé » des « conditions générales d’utilisation ». Mais il y va, dans l’une comme l’autre de ces situations de lecture, d’une certaine configuration de l’impératif dont nous parlons. Il arrive aussi que cette instance impérative ou prescriptive (« lis ! ») soit détachée, présentée pour elle-même, pour ainsi dire sur le devant de la scène de lecture. Pensons au cas de La philosophie dans le boudoir de Sade, que j’analyse dans Pouvoirs de la lecture : l’impératif de lecture vient se loger sur la couverture du livre, sous la forme d’une sorte d’exergue (« la mère en prescrira la lecture à sa fille »).
Si l’impératif de lecture fait donc partie intégrante de toute scène de lecture, c’est parce que lire implique toujours quelque chose qui est de l’ordre de la soumission. Une soumission à déjouer, à contester, à refouler, mais implicitement à l’œuvre, avec laquelle il faut compter. Pas de lecture sans soumission du lecteur à l’ordre (typographique, syntactique, argumentatif, rhétorique, narratif…) du texte. Ce qui ne veut pas dire, loin de là, que la lecture se réduit à cette passivité. Les lecteurs ne cessent de subvertir l’autorité de cet ordre, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou non. Qu’on pense à l’attention flottante, aux formes variées de l’interprétation, érudite ou spontanée, des textes : le lecteur est en permanence dans une relation équivoque, tendue, avec le tissu des « micropouvoirs » dont est constitué tout ordre textuel. On pourrait dire, en reprenant ce mot proposé par Deleuze et Guattari, que tout acte de lecture est un acte « micropolitique ». Autrement dit : la lecture rejoue en miniature, sur un mode micrologique, des rapports de pouvoir que l’on retrouve ailleurs, sur d’autres scènes, sociales, politiques… Tout acte de lecture est un tel jeu avec des structures de pouvoir. C’est ce qui fait de la lecture un espace intrinsèquement politique (bien au-delà du fait que tel ou tel texte puisse proposer ou non des idées ou des thèmes explicitement identifiés comme politiques).
LVSL – Pouvez-vous revenir sur votre analyse magistrale du Léviathan de Hobbes et la relation entre politique et lecture dans ce texte fondamental ?
PS – Comme nous l’évoquions à l’instant, tout acte de lecture est à la fois un acte de soumission et d’affrontement, de contestation et d’assimilation critique des règles du pouvoir. En ce qui concerne le Léviathan de Hobbes, on est face à un moment-clé de l’histoire de la philosophie politique, bien sûr, mais également face à un moment-clé dans l’histoire des discours sur la lecture, des réflexions sur la performativité, l’efficacité des dispositifs de lecture. Il y a, dans ce texte, une sorte de correspondance entre, d’une part, le dispositif micropolitique des prescriptions adressées au lecteur (le Léviathan est en effet ponctué de conseils, explicites ou implicites, sur la manière de lire ce livre qu’il est) et, d’autre part, le dispositif macropolitique de l’État moderne tel qu’il est élaboré théoriquement au fil de l’ouvrage. Ces deux niveaux s’articulent en permanence et de manière souvent paradoxale. Le lecteur est ainsi appelé à devenir une sorte de souverain pour s’assimiler pleinement le sens du texte, en même temps qu’il est incité explicitement par Hobbes à se soumettre au dispositif de lecture. Hobbes construit une sorte de machine textuelle qui identifie les opérations de lecture et les opérations du bon gouvernement. La souveraineté politique et la souveraineté du lecteur sont superposées ou repliées l’une sur l’autre tout au long du texte.
Les conseils de lecture qui ponctuent le Léviathan sont parfois explicites, par exemple quand Hobbes recommande à son lecteur de ne pas faire comme ces oiseaux qui perdent la mémoire de l’entrée dans la pièce où ils sont dès lors bloqués et condamnés à virevolter (une belle métaphore pour l’inattention du lecteur distrait ou vagabond dans sa lecture). Mais certaines prescriptions de lecture du Léviathan restent implicites, sans être moins efficaces pour autant, au contraire. C’est le cas lorsque Hobbes performe l’acte de lecture pour le lecteur, en employant par exemple des expressions apparemment anodines mais en réalité puissamment configurantes telles que « en somme », ou encore en proposant au lecteur des résumés de ce qui a été lu. C’est ainsi que s’établit, que s’impose un dispositif de lecture cumulative, une lecture additive. À savoir un régime de lecture (entendez ce mot de « régime » à la fois dans son sens mécanique ou moteur et dans son sens politique) qui en exclut beaucoup d’autres possibles.
Cette petite machine de lecture, implicite et explicite, explose toutefois lorsque Hobbes conclut sur deux prescriptions contradictoires, enjoignant simultanément le lecteur à opérer une somme intégrale de tout ce qui a été préalablement énoncé et à contester chaque aspect. Car, dit-il sans réaliser pleinement les conséquences de ce qu’il dit, c’est en objectant que l’on peut renforcer sa conviction de la nécessité des arguments et de leur ordre précis d’énonciation. Ce moment, ce point de lecture aux exigences contradictoire est fascinant, car on y voit le code des prescriptions se déconstruire lui-même et faire signe vers son caractère impossible ou aporétique.
LVSL – Vous proposez également une interprétation philosophique du passage du volumen au codex puis du codex à l’écran, pouvez-vous revenir là-dessus. On parle fréquemment de l’infinite scrolling, est-ce un nouveau temps de lecture ?
PS – C’est une question que pose Giorgio Agamben dans « Du livre à l’écran » (l’un de ses textes recueillis dans Le Feu et le récit). Il oppose, d’une part, un temps circulaire et continu qui serait propre au volumen, c’est-à-dire à la forme enroulée d’un rouleau de papyrus ou de parchemin, et, d’autre part, un temps linéaire qui serait celui du codex, c’est-à-dire le cahier paginé, voire indexé, donc discontinu. L’écran paraît conjuguer ces deux propriétés opposées. D’une part, le scrolling se présente comme un déroulement potentiellement infini, même s’il est en réalité bel et bien bordé, limité par des caractéristiques matérielles et spatio-temporelles (il ne saurait y avoir de page infinie car tout stockage est par essence fini). Mais d’autre part, l’hypertexte sur écran se compose d’innombrables renvois sous forme de liens qui sont autant d’indexations, autant de discontinuités, autant de « paginations », si l’on veut, interrompant la continuité du déroulement. Bref, à l’écran, le codex devient volumen et le volumen devient codex.
On est donc face à un déroulement en forme de flux, certes, mais infiniment accidenté, discrétisé ou discrétisable. Cette discrétisation fluide ou cette fluidité discrète de l’espace de lecture relève de ce que Deleuze et Guattari, reprenant une distinction proposée par Pierre Boulez, appelaient le « temps lisse » (ici : celui de la lecture continue) et le « temps strié » (ici : celui de la lecture discontinue, ponctuée par des renvois référentiels). Ces temporalités contrastées se replient sans cesse l’une sur l’autre dans notre expérience contemporaine de la lecture numérique. Et ce faisant, elles invitent à instituer, mais aussi et aussitôt à destituer, de nouveaux dispositifs de lecture-pouvoir constitués par des injonctions — souvent invisibles pour les lecteurs — qui se trament entre ces divers registres, entre ces strates que sont le texte lu, le sous-texte de son encodage ainsi que le formatage inhérent aux supports logiciels et matériels qui les portent.
Plus que jamais, l’acte de lecture, à l’ère du numérique, est tramé, transi de micropouvoirs.