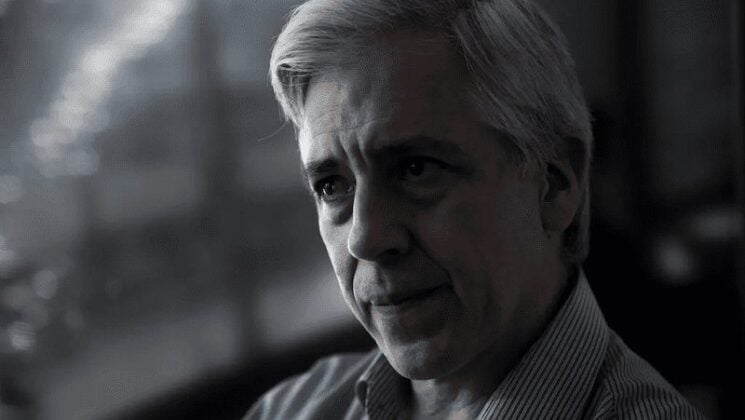Conseiller en politique étrangère de Bernie Sanders de 2017 à 2022, Matt Duss est vice-président du Center for International Policy. Dans cet entretien, il revient sur les contradictions de l’administration Trump, tiraillée entre des « faucons » nostalgiques de l’interventionnisme période Bush, et une base « Make America Great Again » (MAGA) qui leur est opposée. Celle-ci exprime une hostilité majoritaire aux « guerres sans fin », sur laquelle il estime que les progressistes pourraient s’appuyer. Il analyse le dossier ukrainien, à propos duquel il préconise la voie diplomatique du « moindre mal ».
LVSL – On a beaucoup glosé sur la « vision » (ou l’absence de vision) géopolitique de Donald Trump, qui semble être influencé par des forces contradictoires. D’un côté, les « isolationnistes » du mouvement Make America Great Again (MAGA) continuent de se faire entendre. De l’autre, les « faucons » républicains traditionnels occupent des postes clefs – notamment le secrétaire d’État Marco Rubio. Ce clivage est particulièrement fort en ce qui concerne la question russo-ukrainienne : alors qu’une partie des Républicains plaide pour un retrait (comme le sénateur Tom Cotton), d’autres, menés par le sénateur Lindsey Graham, défendent un durcissement des sanctions contre la Russie et un accroissement de l’aide à l’Ukraine. Pensez-vous que la politique étrangère de Donald Trump soit autre chose qu’une tentative chaotique de concilier ces deux positionnements ?
MD – Tout d’abord, je ne pense pas qu’il y ait de réels « isolationnistes » dans l’administration Trump. Ils ne se définissent d’ailleurs pas comme tels : « isolationniste » est un qualificatif employé pour les décrire, généralement de manière critique. Certains républicains, en revanche, se déclarent en faveur d’une politique étrangère plus restreinte, plus modeste, moins interventionniste. Cette terminologie est plus adéquate.
Effectivement, il y a bien des factions antagoniques au sein du Parti républicain. Certains estiment que les États-Unis devraient en rabattre sur le dossier ukrainien, qu’il ne correspond pas aux intérêts profonds du pays, à l’inverse du terrain Indo-Pacifique. Cela peut valoir pour des Républicains qui sont par ailleurs des « faucons » à propos de la Chine ou du Moyen-Orient – c’est le cas du sénateur Tom Cotton, que vous avez mentionné. De l’autre côté, nous sommes effectivement en présence de « néoconservateurs » à l’ancienne comme Lindsey Graham, qui estiment que les États-Unis devraient être présents partout en même temps.
« Si des concessions territoriales ukrainiennes peuvent mettre un terme durable à la guerre, malgré l’injustice flagrante de la situation, alors c’est une démarche que les progressistes devraient soutenir. »
Trump parvient-il à défendre une position ukrainienne indépendamment de ces factions ? Il est certain qu’il tient en haute estime sa propre capacité à conclure des deals avec les nations perçues comme « puissantes » – voyez sa relation avec Poutine ou Netanyahou –, et à les imposer aux pays faibles. Il estime que les États-Unis ont pâti d’un leadership faible, et qu’il va changer la donne comme « faiseur de deals ». Sur cette base, il s’est révélé hautement imprévisible sur l’Ukraine, privilégiant ce qui lui semble aller dans son intérêt immédiat.
Pour autant, il arrive qu’il s’aligne assez nettement sur une faction du Parti républicain, lorsqu’elle parvient à le persuader d’agir dans son sens. Prenez l’Iran : Trump était très attaché à des négociations avec Téhéran ; mais les « faucons » républicains – Lindsey Graham, Tom Cotton –, en lien avec Netanyahou, ont persuadé Trump de rompre le dialogue et de bombarder le pays.
LVSL – La question des causes du conflit russo-ukrainien fragmente la gauche. Certains mettent en cause la nature expansionniste de la politique étrangère russe et la nostalgie impériale affichée par certains soutiens de Vladimir Poutine. D’autres prennent au sérieux les déclarations du Kremlin vis-à-vis de la « menace » que constitue l’OTAN. Quelle grille de lecture privilégiez-vous ?
MD – Il y a du vrai dans les deux.
Mais tout d’abord : l’OTAN ne s’étend pas d’elle-même. Elle ne s’impose pas par elle-même : certains pays ont souhaité rejoindre l’Alliance, estimant qu’elle offrait des garanties de sécurité, et l’ont fait librement.
Pour autant, il est clair que les dirigeants russes, avant même Vladimir Poutine, craignent l’extension de l’OTAN. Après tout, l’OTAN est une alliance de Guerre froide, destinée à faire contrepoids à l’Union soviétique. Il est donc compréhensible que les Russes considèrent sa progression jusqu’à leurs frontières avec déplaisir.
Cela ne doit pas nous faire oublier que Vladimir Poutine a explicitement défendu le droit naturel de la Russie à se comporter comme un empire. À cet égard, son discours de juin 2022, qui défend l’unité « historique » des peuples russe et ukrainien, est emblématique. Les choses ne se résument donc pas à l’OTAN.
LVSL – Comment une administration progressiste prendrait-elle en compte les récriminations de la Russie à l’égard de l’OTAN ?
MD -À mon sens, la manière dont Joe Biden a traité cette question – même si je suis très critique de sa présidence – était cohérente avec une vision progressiste. Il a tenté d’éviter la guerre et multiplié les démarches diplomatiques auprès de Poutine avant l’invasion de l’Ukraine. Mais lorsque celle-ci est survenue, il a décidé de soutenir le pays agressé, avec des limites claires : pas de troupes américaines, pas d’aviation américaine en Ukraine.
« Kamala Harris a déroulé un tapis rouge à Donald Trump en lui permettant de se présenter comme le candidat de la paix. »
Les progressistes doivent reconnaître avec clarté que la Russie est l’agresseur. Elle a violé un principe majeur des relations internationales et commis des atrocités dans les zones occupées. L’aide à l’Ukraine s’inscrit dans une vision progressiste des relations internationales.
Cela étant posé, les progressistes doivent toujours se demander : quelle est la voie du moindre mal ? Si effectuer des concessions territoriales peut aider l’Ukraine à mettre un terme durable à la guerre, malgré l’injustice flagrante de la situation, alors c’est une démarche que les progressistes devraient soutenir. Je ne suis cependant pas convaincu que Poutine soit intéressé par une paix durable.
LVSL – La Russie réclame une neutralisation et une démilitarisation, au moins partielle, de l’Ukraine. Celle-ci exige des « garanties de sécurité » et parle de renforcement militaire. Voyez-vous une issue qui permette de concilier ces exigences sécuritaires a priori contradictoires ?
MD – Tel est le défi ! Il faut continuer de parler à la Russie, et bien sûr à l’Ukraine. Il est bon que les États-Unis (via Donald Trump, mais aussi à d’autres niveaux) soient en discussion régulière avec la Russie. Ici encore, le blocage vient du Kremlin : les Ukrainiens souhaitent mettre un terme à la guerre, mais Poutine ne semble pas pressé de conclure un accord. Il faut intensifier les efforts diplomatiques et explorer diverses voies vers la paix.
LVSL – Si un accord de paix est trouvé, quelle réaction escomptez-vous des démocrates ? Peut-on s’attendre à ce qu’ils le rejettent, au risque d’apparaître comme le parti de la guerre ?
MD – Si c’est un accord qui garantit l’indépendance et la souveraineté de l’Ukraine, la plupart des démocrates le soutiendront. S’il s’agit d’un accord imposé à l’Ukraine, qui autorise la Russie à s’emparer d’une portion significative du pays et lui donne des leviers pour une guerre future, la plupart des démocrates s’y opposeront. Les clauses de l’accord seront déterminantes.
LVSL – Une administration progressiste américaine ferait face au lobby militaro-industriel. Quels sont les leviers de politisation de la population face aux forces bellicistes ? La base « MAGA », hostile aux « guerres sans fin », n’exprime-t-elle pas une demande sur laquelle les progressistes pourraient s’appuyer ?
MD – Oui, bien sûr. Souvenez-vous de la campagne de 2020 : Joe Biden a promis de mettre un terme aux « guerres sans fin ». Il redonnait ainsi vie à un élan impulsé par Bernie Sanders.
Il y a de toute évidence une hostilité très importante à l’égard des guerres. Et ce, de la part des Américains des deux partis. Depuis la fin de la Guerre froide, les Américains ont systématiquement voté pour un président hostile aux guerres – avec une seule exception : 2004.
[En 2004, George W. Bush est réélu en pleine guerre d’Irak. Quatre ans plus tôt, il avait fait campagne en critiquant l’interventionnisme de son concurrent démocrate. Il avait déclaré, lors d’un débat avec le candidat Al-Gore : « Si nous ne cessons pas d’envoyer nos troupes dans le monde entier pour reconstruire les pays des autres, nous allons avoir de sérieux problèmes. Et je vais empêcher cela. » NDLR]
Joe Biden, en 2020, a tenu un discours de rejet des guerres. Malheureusement, il a changé son fusil d’épaule en 2024 ; cette inflexion a été poursuivie par Kamala Harris, qui a permis à Trump de se présenter comme le candidat de la paix ! Les démocrates devraient se présenter comme le parti anti-guerre et pro-paix – et Trump leur donne de bonnes occasions de le faire.
LVSL – Les Européens se gargarisent d’avoir pu constituer une force politique aux côtés de l’Ukraine lors de la dernière rencontre à la Maison Blanche. Si l’on parcourt la presse américaine, la place accordée à l’influence diplomatique que les Européens auraient exercée est faible, à tout le moins. Comment percevez-vous leur rôle diplomatique ?
MD – Les Européens n’ont pas une grande influence, et ils en sont réduits à flatter Trump. Si l’on en croit les compte-rendu de la réunion, ils ont appris à le faire avec un certain talent. Je le déplore, mais je comprends que les Européens agissent de la sorte : ce sont les cartes qu’ils estiment devoir jouer. Et il semblerait qu’ils ne soient pas revenus totalement bredouilles : ils semblent avoir obtenu de Trump qu’il s’engage à soutenir des forces armées européennes déployées pour protéger l’Ukraine, dans le cadre d’un deal. Du moins pour le moment.