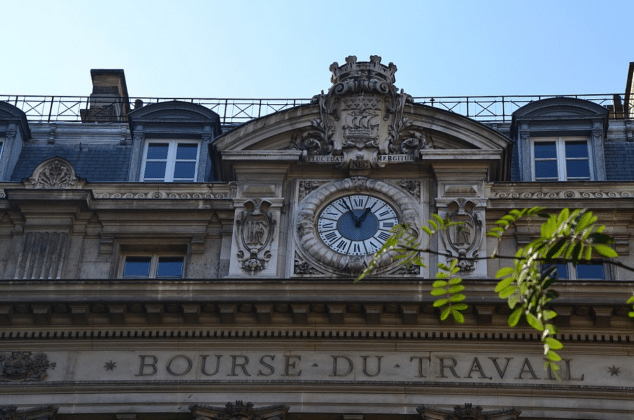La proposition de loi relative à la sécurité globale déposée par deux députés LREM à l’Assemblée nationale en octobre dernier a rencontré une opposition importante. De nombreux acteurs évoquent des mesures liberticides et protectrices de certaines dérives de l’institution policière. Les cas de violences par des personnes dépositaires de l’autorité publique gagnent en effet en visibilité, à travers la circulation d’images sur les réseaux sociaux. À l’encontre des manifestants ou pour un simple contrôle – comme ce fut le cas pour Michel Zecler – les cas de violences policières apparaissent courants, gratuits et fréquemment matinées de racisme, de sexisme ou d’homophobie. L’institution policière est-elle discriminatoire ? Quel contrôle l’IGPN apporte-t-elle à ces comportements déviants et illégaux ? Pour répondre à ces questions, nous avons échangé avec Jérémie Gauthier, maître de conférences en sociologie à l’Université de Strasbourg et chercheur associé au centre Marc Bloch de Berlin ainsi que Luc Rouban, directeur de recherche au CNRS et membre du CEVIPOF.
L’institution policière n’est pas un corps social homogène
La police, dans son acceptation contemporaine, désigne une institution et une fonction de l’État. Ses missions relèvent du maintien de l’ordre public, de la tranquillité publique. En France, la police est associée à une fonction à la fois publique mais aussi régalienne comme c’est le cas depuis 1941 – la police était auparavant une fonction exclusivement municipale.
Luc Rouban évoque des normes et valeurs diverses suivants les différents corps de la police, la place dans la hiérarchie ou encore l’appartenance géographique : « L’institution policière est aussi une organisation complexe. Elle recouvre des métiers, des formations et des cultures professionnelles très différentes. »
« L’institution policière est aussi une organisation complexe. Elle recouvre des métiers, des formations et des cultures professionnelles très différentes. »
Luc Rouban
Un membre d’une brigade anti-criminalité, un agent mécanicien pour la police nationale ou un enquêteur issu d’une brigade financière exercent en pratique des métiers assez différents développe Jérémie Gauthier. Le chercheur constate également, et ce, depuis quelques années, la visibilité croissante des controverses sur la police dans l’espace public. « On utilise le terme de « police » par facilité mais en réalité les débats se concentrent sur les polices urbaines (les brigades de police secours ou encore les brigades anti-criminalité) et sur le maintien de l’ordre, c’est à dire la « police des foules » (les Compagnies Républicaines de Sécurité, la gendarmerie mobile et les autres unités intervenant dans les rassemblements) ». Nous nous centrerons aussi sur cette police de sécurité publique évoluant directement sur le terrain au contact des citoyennes et citoyens.
Révélation et visibilisation de la discrimination et des violences
Les violences policières et les discriminations opérées par la police n’ont pas toujours été un problème public. Selon Jérémie Gauthier, cette évolution est récente. « Il y a depuis longtemps une préoccupation pour les violences policières, pour le racisme policier, au moins depuis les années 1970 mais à l’époque ces problèmes étaient portés par des acteurs issus d’espaces sociaux relégués comme par exemple le Mouvement des travailleurs arabes puis, plus tard, le Mouvement de l’immigration et des banlieues ». Après les rébellions urbaines de l’automne 2005, la question des relations entre police et population – notamment dans les quartiers de relégation – a été mise à l’agenda. Des études sociologiques ont été menées et certaines ont conclu que le caractère discriminatoire des contrôles d’identité était l’un des nœuds du problème. Il s’agit en effet d’un générateur de tensions entre la jeunesse masculine issue des classes populaires et les policiers de terrain. Par le biais de l’Union européenne, les juristes s’emparent du sujet et développent le droit de la discrimination qui fait valoir le droit à la non-discrimination.
La violence de la police est toutefois une problématique ancienne. On la retrouve dans la culture populaire, comme en témoignait déjà par exemple en 1995, le long-métrage La Haine. Ce qui contribue à la sortie de cette opacité, c’est d’un côté la révélation d’images, de témoignages, le fait que les acteurs qui dénonçaient auparavant ces discours et ces pratiques ont maintenant des ressources juridiques, politiques, médiatiques qui leur apportent une meilleure crédibilité, mais aussi, d’un autre côté, l’intérêt d’un nombre croissant d’acteurs pour ces questions de violences et de discriminations.
Normes et valeurs de l’institution
Dans les années 1960, les premières enquêtes sociologiques sur la police conduites aux États-Unis avaient souligné l’existence d’une « culture policière ». Ces travaux caractérisaient cette dernière par un ensemble de traits, d’attitudes et de stéréotypes partagés : racisme, machisme, goût pour l’action, pour la prise de risque, hostilité envers les médias, sentiment que la justice ne suit pas suffisamment les affaires traitées par les policiers. Aujourd’hui encore, certains traits communs se dégagent. Jérémie Gauthier évoque un rapport critique envers les élites politiques, la justice ou bien souvent les médias. « Les policiers manifestent souvent de l’hostilité vis-à-vis des médias, en tout cas le sentiment que les médias, de manière générale, déforment la réalité de leur quotidien et dressent des bilans à charge alors que, objectivement, ce n’est pas le cas. L’action de la police est souvent saluée dans les grands médias qui s’appuient d’ailleurs généralement sur des informateurs au sein des services de police […], sans parler des documentaires hagiographiques prétendant dévoiler la “réalité” du quotidien policier. »
« Les policiers manifestent souvent de l’hostilité vis-à-vis des médias, en tout cas le sentiment que les médias, de manière générale, déforment la réalité de leur quotidien et dressent des bilans à charge alors que, objectivement, ce n’est pas le cas. »
Jérémie Gauthier
Luc Rouban, quant à lui, évoque des cultures plus affirmées, une « culture de l’autorité, culture de l’État, une culture globalement plus répressive et moins de libéralisme culturel ». Le chercheur avance toutefois que les différences le long de la hiérarchie sont importantes. Ces dissemblances sont aussi identifiées par le maître de conférences à l’Université de Strasbourg qui pointe « un tableau trop homogène pour une profession hétérogène : la condition policière, caractérisée par la cohabitation de différentes idéologies professionnelles, est traversée par des clivages forts tant sur les perceptions du métier, des publics ou encore du rapport à la loi ». Les normes et valeurs évoquées ci-dessus sont donc davantage partagées par la police dite de sécurité publique que par leurs supérieurs hiérarchiques.
Le poids de la formation et de la socialisation professionnelle
Les valeurs défendues par ces policiers de terrain, les stéréotypes qu’ils reproduisent sont produits par une socialisation professionnelle spécifique. Le début de cette socialisation professionnelle coïncide fréquemment avec une rupture biographique. Pour beaucoup de jeunes policières et policiers, l’entrée dans la profession implique de quitter sa région d’origine, sa famille, ses proches. Jérémie Gauthier observe aussi une rupture culturelle. La socialisation professionnelle amène avec elle un ensemble de codes : hexis corporelle, catégories partagées de compréhension et d’appréhension du monde social. Pour les gardiens de la paix, la formation est courte, d’environ huit mois. Après le passage en école de police, la suite de la formation se fait au commissariat, directement au contact des pairs mais aussi de policiers plus expérimentés lors des prises de poste. Il y a alors une injonction forte à adopter rapidement des codes, des valeurs, une vision du monde, une perception du monde social, qui sont celles partagées par les pairs.
La police de terrain s’approprie et perçoit son environnement de travail, le tissu urbain, d’une manière spécifique. Jérémie Gauthier, chercheur associé au centre Marc Bloch, nous explique que cette perception conjugue plusieurs critères. Parmi ces critères on retrouve la classe sociale, l’âge, le sexe, l’origine ou encore l’apparence des personnes. « Le regard se porte quasi-exclusivement sur les hommes dans le cadre de soupçons d’infraction. Les catégories raciales sont aussi des catégories opérantes dans la manière qu’ont les policiers de comprendre, hiérarchiser et de décrire le monde qui les entoure. »
« Le regard se porte quasi-exclusivement sur les hommes dans le cadre de soupçons d’infraction. Les catégories raciales sont aussi des catégories opérantes dans la manière qu’ont les policiers de comprendre, hiérarchiser et de décrire le monde qui les entoure. »
Jérémie Gauthier
Ces catégories racialisantes sont inscrites dans le fonctionnement quotidien de l’institution, sur les PV, dans les logiciels de police, les « types » (européen, nord-africain, africain, européen de l’est) sont par exemple mentionnés dans les PV. Ces catégories sont en circulation dans le quotidien des policiers, aux côtés de catégories plus souterraines relevant du langage commun (blancs, noirs, rebeus, renois, etc.) et parfois aussi d’un vocabulaire relevant de l’insulte raciste, de la volonté de dégradation, afin d’établir un rapport d’autorité voire de domination vis-à-vis de tel ou tel public. Ainsi, la socialisation professionnelle policière apparaît particulièrement perméable aux dynamiques de racialisation qui peuvent ensuite déboucher sur des manifestations de racisme ou de pratiques discriminatoires.
Dès les années 1990, les sociologues Michel Wieviorka et Philippe Bataille avaient pointé l’existence, dans la police, d’un « discours raciste général […] une véritable norme, à laquelle il est difficile, lorsqu’on est policier de base, de s’échapper et plus encore de s’opposer ». À partir d’enquêtes menées depuis les années 2000, Jérémie Gauthier parle quant à lui de « tentation raciste » pour désigner la séduction que représente pour beaucoup de jeunes policiers et policières l’adoption de perceptions et de principes d’action fondés sur des stéréotypes racistes. Selon le sociologue, cette tentation est particulièrement forte dans un métier reposant beaucoup sur le décryptage des apparences des personnes en circulation dans l’espace public. Le sociologue développe : « J’interviewais des policiers issus de l’immigration, dont les familles étaient originaires d’Afrique du nord, d’Afrique subsaharienne […] qui me disaient qu’ils en venaient eux-mêmes parfois à adopter des stéréotypes, un sentiment d’hostilité envers des groupes minoritaires. » Les catégories d’apparence (morphologie, couleur de peau, chevelure etc.) sont donc des outils professionnels. Ainsi, les catégories socio-raciales font partie du répertoire disponible des policiers pour qualifier et hiérarchiser les personnes avec lesquelles ils ont des interactions au quotidien et parfois aussi pour asseoir un rapport de domination. Face à cette « tentation raciste », certains agents développeront des perceptions ouvertement racistes, d’autres n’activeront qu’occasionnellement une lecture racialisée des situations et d’autres, enfin, tenteront de s’opposer à cette vision du monde.
Cet outil est aussi valorisé par les pairs. Opérer ces classements rapidement, trouver, identifier d’éventuels délinquants sont autant de qualités valorisées sur le terrain. Les effets pervers et discriminatoires suivent naturellement comme l’explique Jérémie Gauthier : « Un policier d’une BAC parisienne me disait que, dans l’arrondissement dans lequel il travaillait, le deal de cocaïne et de crack c’était plutôt des nord-africains, les sacs à main arrachés c’était plutôt des maghrébins de cité, etc. Au yeux des policiers, il y a un ancrage empirique des catégories raciales qu’ils utilisent et qui fonctionnent comme une prophétie autoréalisatrice. Les croyances des policiers vont déterminer et légitimer leurs manières d’agir, qui vont, de manière circulaire, contribuer à alimenter leurs croyances. À partir du moment où on associe tel type de délits à tel groupe socioracial et qu’on s’en sert comme principe d’action, cela relève de ce que les anglo-saxons appellent du « profilage racial », ce qui est interdit par différents textes nationaux et européens. »
Ainsi, selon le chercheur, la déontologie ne résiste pas longtemps à cet enracinement très profond des catégories raciales dans la pratique professionnelle. C’est là sûrement une dimension structurelle, et non strictement individuelle, à prendre en compte – comme ça a été par exemple le cas au Royaume-Uni dans les années 2000 – si l’institution décide de rompre avec les habitudes de tolérance vis-à-vis du racisme qui s’exprime dans ses propres rangs.
Une violence ciblée et rationnelle
Tout comme le racisme et les discriminations, la violence et sa victime ne sont pas le produit du hasard. « La violence, on la rejette souvent du côté de l’irrationnel et de la spontanéité alors qu’en fait, toute expression de violence porte en elle-même une rationalité et est le produit d’une histoire de la violence. Les brutalités policières manifestent des similitudes qui relèvent des cérémonies de dégradation », explique Jérémie Gauthier.
« Les brutalités policières manifestent des similitudes qui relèvent des cérémonies de dégradation. »
Jérémie Gauthier
Il s’agit d’un moment où l’individu est dégradé par différentes formes de violences ritualisées. On peut par exemple évoquer le déchaînement collectif, où plusieurs individus portent des coups, le fait d’accompagner les violences d’insultes à connotation raciste, afin de renforcer cette dégradation (comme l’a illustré l’affaire Michel Zecler en 2020). On observe parfois des actes qui relèvent d’atteintes sexuelles (comme les violences subies par Théodore Luhaka en 2017 ). Le rite de la « haie d’honneur » fait également partie de ces « cérémonies » comme ce fut le cas lors de « l’affaire du Burger King », en décembre 2018 : en marge d’une manifestation des gilets jaunes, les manifestants, réfugiés dans le fast-food ont subi des violences de la part des policiers à l’intérieur avant de subir de nouvelles violences par les policiers à l’extérieur du bâtiment.
L’exercice de la brutalité fait donc l’objet d’une ritualisation. Elle dépasse aussi l’individu et se retrouve liée à l’histoire de l’institution et du collectif : il s’agit de manières d’intérioriser l’exercice de la violence. De plus, la violence policière ne vise pas chaque individu de la même manière. Jérémie Gauthier observe que les morts et victimes de ces violences sont en majorité des hommes, non-blancs, issus de catégories populaires urbaines. Il évoque la notion de police property, l’idée qu’il y a des gens envers lesquels les policiers s’autorisent à se comporter en dehors des règles déontologiques qui, de manière générale, encadrent leurs actions. On peut ainsi évoquer, dans différents registres, des contrôles d’identité répétés ou encore différentes formes de violence, verbale ou physique.
Le mutisme hiérarchique
Si la hiérarchie intermédiaire est au courant de ces catégories de pensée, il n’y a pas pour autant un travail de réflexivité effectué pour les remettre en cause. La hiérarchie est souvent dans une posture de déni par rapport au racisme, aux discriminations. « La police est républicaine et ne peut donc être raciste. C’est un raisonnement tautologique qu’on observe très souvent […] par exemple lorsqu’ Emmanuel Macron déclarait en mars 2019 :« Ne parlez pas de “répression” ou de “violences policières”, ces mots sont inacceptables dans un État de droit . » Un raccourci, là où l’horizon d’une police qui serait républicaine, et donc non-discriminatoire, doit encore être atteint. De leur côté, les commissaires, officiers ne savent pas comment ou ne souhaitent pas intervenir sur ces problématiques de racisme, de discrimination. Plusieurs points sous-tendent cette réalité : un manque de volonté, une volonté d’invisibiliser ces problèmes, un manque de savoir-faire, d’outils nécessaire mais aussi le fait de considérer que ces interventions ne sont pas parties intégrantes de leur mission. On observe aussi cette logique au sommet de l’institution : aucun ministre de l’Intérieur, aucun préfet de police de la ville de Paris ne s’est attaqué de manière franche et volontariste à la question du racisme et des discriminations produites par l’institution.
« La police est républicaine et ne peut donc être raciste. C’est un raisonnement tautologique qu’on observe très souvent […] par exemple lorsqu’ Emmanuel Macron déclarait en mars 2019: « Ne parlez pas de « répression » ou de « violences policières », ces mots sont inacceptables dans un État de droit . »
Jérémie Gauthier
Dénoncer et remettre en cause l’autonomie de cette police de sécurité publique pourrait donner lieu à des résistances, des conflits vis-à-vis de leur hiérarchie. En effet, l’institution policière a la particularité de suivre un principe d’inversion hiérarchique. Les agents ayant le plus d’autonomie sont ceux situés au bas de l’échelle hiérarchique. Ils prennent en effet des initiatives, des décisions cruciales au fonctionnement de toute l’institution. Ce principe renforce la difficulté qu’a la hiérarchie d’intervenir auprès de leurs subordonnés pour des choses qui ne sont pas vues comme relevant du fonctionnement technique ».
Une institution de contrôle dysfonctionnelle
Théoriquement, il est du ressort de l’Inspection générale de la Police nationale d’enquêter voire de condamner ces attitudes et comportements illégaux, parfois violents, envers certains administrés. L’IGPN est en effet une institution crainte au sein des services de police et elle fonctionne assez bien pour enquêter et sanctionner les atteintes des policiers envers leur propre administration ou envers leurs pairs. Toutefois, elle fait face à de nombreux dysfonctionnements quand il s’agit de sanctionner des faits perpétrés par des policiers sur des administrés, notamment des faits de violence.
Plusieurs points permettent d’expliquer ces dysfonctionnements. Luc Rouban évoque premièrement l’esprit de corps policier, une forme de solidarité professionnelle qui garantit une non-dénonciation des pairs face à des pratiques illégales, discriminatoires, voire violentes. Ici, la crainte de l’exclusion, de la marginalisation garantit la sécurité du groupe. S’opposer à l’unité professionnelle sur la voie publique est perçu comme une trahison. Selon Jérémie Gauthier, être accepté par le collectif est une condition sine qua non à la réussite de la socialisation professionnelle du jeune policier. On ne peut faire sa carrière seul dans la police. L’enjeu de se faire accepter est extrêmement fort dès l’école de police, dès les premières affectations. « Cela donne un poids extrêmement important au collectif professionnel, ce qui explique qu’il est très difficile de dévier des normes collectives, on le voit par exemple dans différentes affaires récentes soulevées par des policiers lanceurs l’alerte. » Le maître de conférences à l’Université de Strasbourg avance d’autres points comme la volonté d’organiser l’opacité sur les faits de brutalité – même s’ils sont de plus en plus visibles –, la difficulté à sanctionner les brutalités policières car une telle sanction pourrait remettre en cause la légitimité et l’habilitation des policiers et policières à faire usage de la force. Ces dysfonctionnements peuvent aussi être logistiques. L’IGPN est en effet une institution débordée, les effectifs de l’inspection peinent à mener l’ensemble des saisies. Enfin il peut être difficile d’identifier les policiers faisant usage de la violence. On peut observer à cet effet différentes pratiques comme le fait de ne pas porter son numéro d’identification.
Ouvrir la police au regard des autres
On peut observer une forme de « tradition » française de l’opacité. La police a toujours essayé de se soustraire aux regards extérieurs, des journalistes, des chercheurs mais aussi des citoyens. La production d’une telle opacité peut empêcher de regarder directement ces dysfonctionnements. Ouvrir l’institution policière à des acteurs extérieurs peut être une solution. L’instance britannique de contrôle de la police intègre des citoyens, des policiers, des magistrats. La police allemande encourage la remise en cause des catégories de pensée, forme des officiers pour faire de la médiation et de la résolution de conflit au nom de la non-discrimination.
Outre-manche, les systèmes policiers ont intégré la notion d’accountability c’est à dire le fait que les institutions – y compris policières – doivent rendre des comptes auprès du public de la qualité de leur travail.
En France, l’efficacité de la police se mesure par le nombre de faits élucidés, le nombre d’interpellations, de passages en garde à vue. Il n’existe pas d’indicateur pour mesurer la satisfaction, les attentes et les besoins de la population, les jugements que portent les personnes sur la police. Outre-manche, les systèmes policiers ont intégré la notion d’accountability c’est à dire le fait que les institutions – y compris policières – doivent rendre des comptes auprès du public de la qualité de leur travail. Cette ouverture apparaît nécessaire pour que la police puisse à nouveau garantir ses missions premières, sans comportement illégal, violent et parfois impuni, et ainsi, veiller à la sécurité et à la paix des personnes.