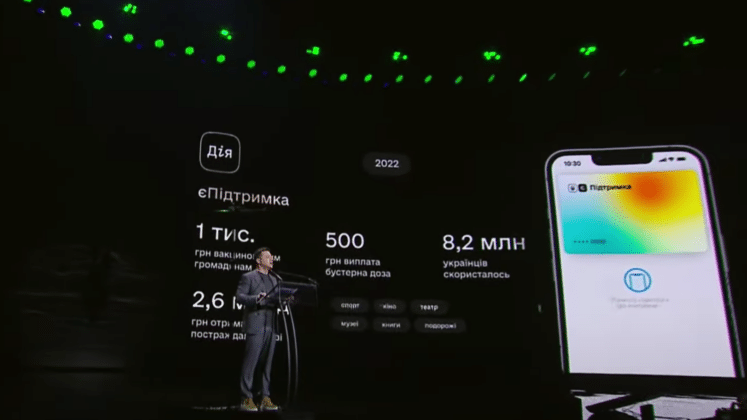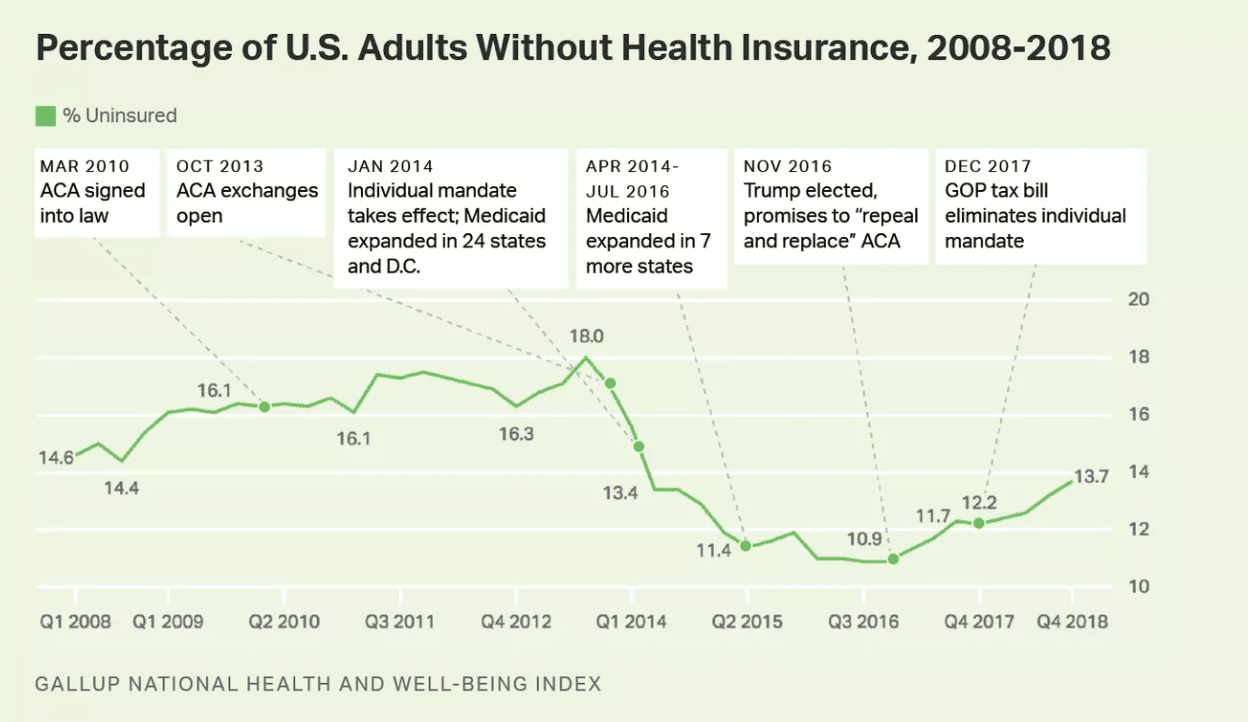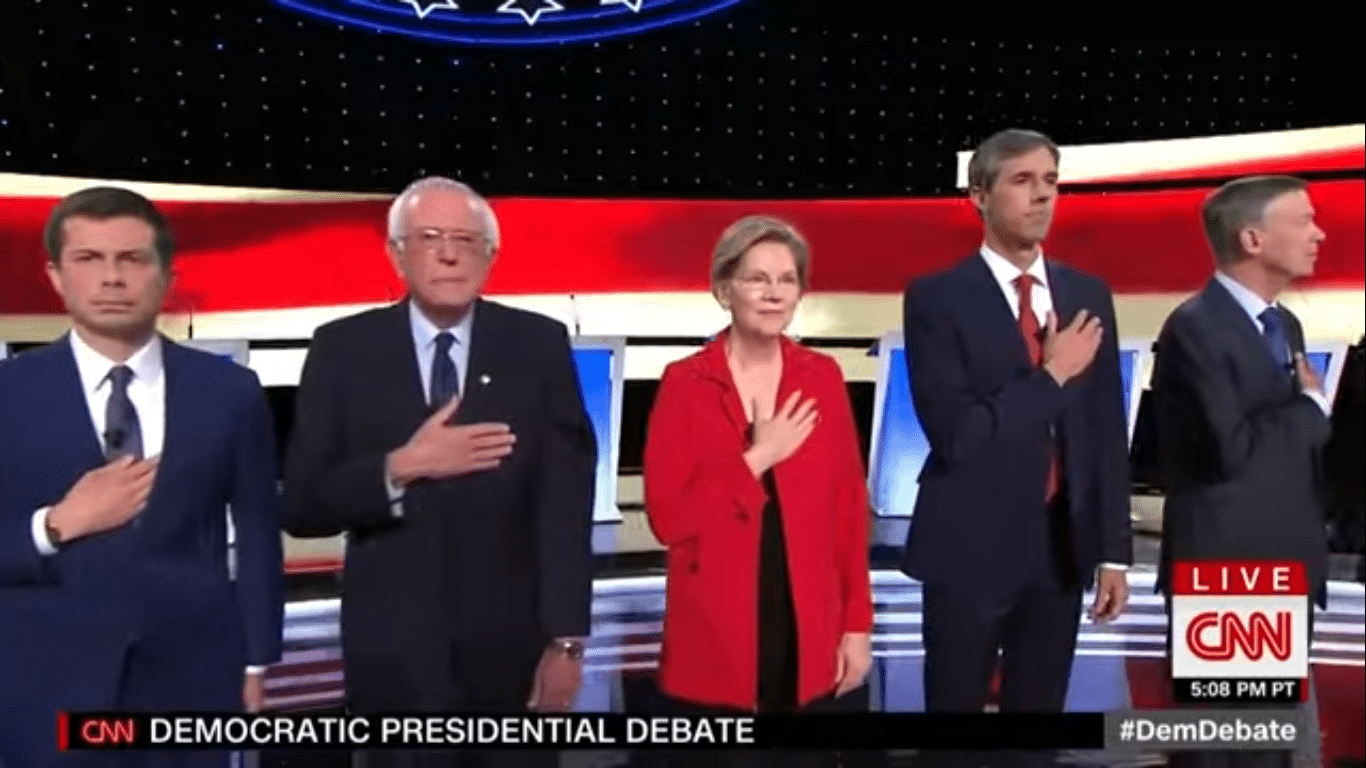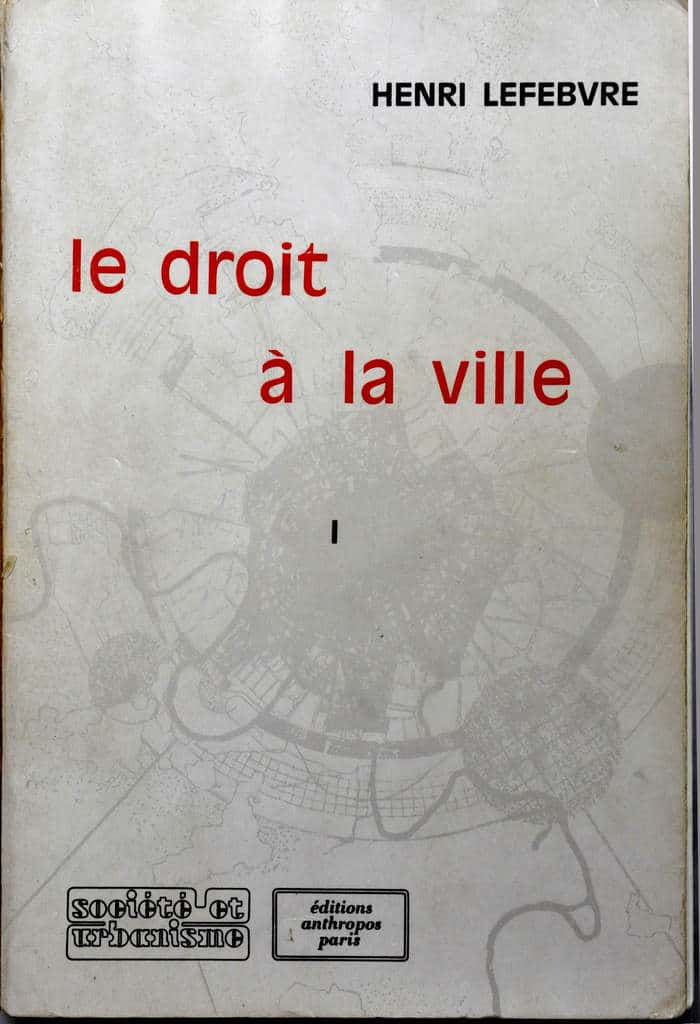Sans véritable discussion dans la presse et au parlement, sans opposition organisée, la Finlande a rejoint l’OTAN depuis le 4 avril, et la Suède est en bonne voie pour lui emboîter le pas. Alors que la Suède avait soumis au vote populaire l’adhésion à l’Union européenne et à la zone euro, elle n’a pas même envisagé d’organiser un référendum sur l’OTAN. Comme une évidence. Il s’agit pourtant d’une rupture historique avec des décennies de neutralité. Et pour la Suède, d’un rejet définitif d’une tradition de non-alignement actif. Ce consensus au sein des élites s’explique – si l’on met de côté les intérêts économiques de l’industrie de l’armement – par le signal envoyé aux marchés. En rejoignant l’OTAN, la Suède et la Finlande promettent d’enterrer pour de bon leur modèle social-démocrate. Article de Lily Lynch publié sur la New Left Review, traduit pour LVSL par Piera Simon-Chaix.
Depuis l’invasion de l’Ukraine on lit partout – et jusqu’à l’outrance – une citation de Desmond Tutu : « Si vous êtes neutres dans les situations d’injustice, c’est que vous êtes du côté de l’oppresseur ». Dans de nombreux sommets, cette phrase a été mobilisée afin d’enjoindre les États à abandonner leur neutralité et à s’aligner derrière l’OTAN. Peu importe que « l’oppresseur » auquel Desmond Tutu faisait référence ait pu être l’Apartheid sud-africain – un régime dont on oublie un peu vite qu’il avait été soutenu par l’alliance militaire atlantique. Mais la période actuelle, en Russie comme en Occident, semble être caractérisée par une amnésie constamment réalimentée.
La Finlande et la Suède ont fait le choix de renier leur politique de neutralité, observée de longue date. L’adhésion à l’OTAN de la Finlande (depuis le 4 avril 2023) et de la Suède (en cours) peut être qualifiée avec exactitude d’historique. La Finlande maintenait sa neutralité depuis sa défaite face à l’Union soviétique pendant la Seconde guerre mondiale, suite à laquelle elle avait signé, en 1948, un traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle. La Suède, pour sa part, avait mené d’innombrables guerres contre la Russie entre le XVIe et le XVIIIe siècle, mais s’était arrangée pour se tenir éloignée des conflits postérieurs à 1814. Adhérer à l’OTAN équivaut à rejeter une tradition centenaire qui a contribué à définir l’identité nationale de ce pays.
La couverture médiatique de la campagne pour l’adhésion à l’OTAN a été euphorique. Si, en Suède, un débat virulent quoique limité a eu lieu, en Finlande les voix discordantes n’ont eu aucune place. Alors que le pays demandait son adhésion à l’OTAN, la Une du journal le plus lu de Finlande, Helsingin Sanomat, présentait l’image de deux silhouettes bleues et blanches (les couleurs de la Finlande) embarquées dans un drakkar et se propulsant à la rame vers un horizon illuminé, où s’élève, tel un soleil, l’étoile à quatre branches de l’OTAN. L’embarcation en bois laisse derrière elle une structure sombre qui la domine, ornée d’une étoile rouge. Impossible d’être plus clair… sauf peut-être si l’on consulte l’édition en ligne du grand quotidien suédois Dagens Nyheter, qui affichait au même moment des pop–ups de l’emblème de l’OTAN se transformant en signe de paix…
Les termes du débat médiatique étant ainsi posés, il n’est pas surprenant que le soutien à l’adhésion à l’OTAN ait été si important : il était d’environ 60 % en Suède et 75 % en Finlande lorsque ces pays l’ont requise. Néanmoins, un regard plus attentif porté sur les segments démographiques révèle quelques fissures dans ce récit.
Pour la presse atlantiste, « la question de l’OTAN » reflète une évolution générationnelle : les « jeunes » seraient davantage favorables à l’adhésion, par opposition à leurs parents qui seraient, semble-t-il, désespérément attachés à une position démodée de non-alignement. « Fermement opposée, il y a à peine quelques semaines, à un quelconque premier pas en direction de l’OTAN », écrivait l’ancien Premier ministre suédois devenu un groupie des think-tanks libéraux, Carl Bildt, « [la classe politique] est confrontée à une compétition opposant une génération plus âgée à une autre plus jeune, qui pose sur le monde un regard plus frais. »
En réalité, c’est strictement l’inverse que l’on observe : en Suède, le segment démographique le plus opposé à l’adhésion est celui des jeunes hommes de dix-huit à vingt-neuf ans. Nulle surprise à cela : il s’agit de la tranche de la population qui serait appelée à participer à toute éventuelle excursion militaire !
Certains des plus ardents défenseurs de l’OTAN se trouvent parmi les dirigeants d’entreprises. En avril 2022, le président finnois organisait une « réunion secrète sur l’OTAN » à Helsinki. Parmi les personnes conviées, le milliardaire suédois Jacob Wallenberg – dont les holdings familiaux cumulés équivalent à un tiers du marché boursier de son pays.
Contrairement au présupposé selon lequel l’agression russe aurait induit un consensus en faveur de l’OTAN en Suède, des voix discordantes ont vu le jour. Le 23 mars 2022, à la suite de l’invasion de l’Ukraine, 44 % des jeunes interrogés étaient favorables à l’adhésion et 21 % défavorables. Deux mois plus tard, 43 % d’entre eux se prononçaient toujours pour une entrée dans l’OTAN, tandis que 32 % s’y opposaient désormais – une augmentation non négligeable.
En Finlande, les enquêtes d’opinion allaient dans le même sens. Un sondage du Helsingin Sanomat décrit le partisan-type de l’OTAN comme une personne éduquée, d’âge moyen ou plus, de sexe masculin, cadre, d’un salaire d’au moins 85 000 € par an et votant à droite, alors que l’opposant-type a moins de trente ans, est travailleur ou étudiant, gagne moins de 20 000 € par an et se situe à gauche.
Certains des plus ardents défenseurs de l’adhésion à l’OTAN se trouvent parmi les dirigeants d’entreprises suédois et finlandais. En avril 2022, le président finnois Sauli Niinistö organisait une « réunion secrète sur l’OTAN » à Helsinki. Parmi les personnes conviées, on pouvait compter le ministre des Finances suédois Mikael Damberg, des représentants militaires de haut rang et des personnalités influentes des milieux entrepreneuriaux suédois et finlandais. On pouvait y croiser le milliardaire suédois Jacob Wallenberg, dont les holdings familiaux cumulés constituent jusqu’à un tiers du marché boursier de son pays. Il participe régulièrement aux conférences Bilderberg – institution élitaire dédiée à la diffusion de la bonne parole atlantiste et néolibérale. C’est sans surprises que de tous les entrepreneurs présents, Wallenberg ait été l’un des plus fervents partisans de l’OTAN.
Au cours des semaines qui ont précédé la demande suédoise d’adhésion à l’OTAN, le Financial Times prédisait que les prises de position de la dynastie Wallenberg allaient « peser lourdement » sur le parti social-démocrate au pouvoir – sur lequel elle exercerait une influence considérable.
Au sommet d’Helsinki, les personnalités officielles du gouvernement suédois ont été averties que leur pays allait devenir moins attractif pour les capitaux étrangers s’il demeurait « le seul État d’Europe du Nord à ne pas adhérer à l’OTAN ». Une telle prophétie, associée à des avances notables de la Finlande, a joué un rôle décisif dans la décision du ministre de la Défense Peter Hultqvist de changer son fusil d’épaule et de pencher en faveur de l’Alliance. Le journal suédois l’Expression a affirmé que la réunion laissait transparaître une mainmise du milieu affairiste bien plus importante qu’imaginée auparavant sur les décisions prises en matière de politique extérieure.
Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi les entreprises sont aussi investies. Le géant suédois de l’industrie de la défense, Saab, s’attend à tirer des profits considérables de l’adhésion à l’OTAN. L’entreprise, dont la famille Wallenberg est actionnaire majoritaire, a vu le prix de ses parts doubler depuis l’invasion russe. Son PDG Micael Johansson a ouvertement affirmé que l’adhésion de la Suède à l’OTAN ouvrirait de nouvelles possibilités pour Saab dans les domaines des missiles de défense et de la surveillance. L’entreprise s’attend à des gains faramineux, dans un contexte où les Européens augmentent leurs dépenses de défense – le rapport du premier trimestre révèle que les bénéfices d’exploitation ont déjà augmenté de 10 % par rapport à l’année précédente.
Les médias ont fréquemment affirmé que l’adhésion de la Finlande et de la Suède signifierait que ces pays rejoindraient enfin « l’Occident ». Une telle rhétorique n’a rien de nouveau. Peu de temps avant l’adhésion du Monténégro à l’Alliance, le Premier ministre Milo Đukanović avait affirmé que le clivage était « civilisationnel et culturel ».
L’influence considérable exercée par les dirigeants d’entreprise sur la question de l’OTAN contraste avec celle du public lambda. Même si la Suède a tenu un référendum sur chaque décision importante prise au cours de son histoire récente – adhésion à l’UE, adoption de l’euro –, aucune consultation des citoyens sur la question de l’OTAN n’est prévue. La personnalité politique la plus en vue à avoir appelé à un vote était la dirigeante du parti de gauche Nooshi Dadgostar, mais sa proposition a été courtoisement enterrée. Le gouvernement, qui craignait un rejet de l’adhésion à l’OTAN une fois calmée l’hystérie qui entoure la guerre, a donc opté pour une forme de « stratégie du choc », imposant ses ambitions politiques à une période où l’Ukraine faisait encore les gros titres.
Cependant, en Finlande, l’OTAN a rencontré peu d’opposition au sein du grand public. La fibre nationaliste a été sollicitée, et les opposants à l’adhésion accusés de négliger la sécurité du pays. C’est ainsi que le Parlement a voté à une écrasante majorité en faveur de l’adhésion en mai 2022, avec 188 parlementaires favorables et seulement huit opposants. Parmi ces huit irréductibles, l’un d’entre eux est membre du parti populiste de droite Finns, un autre est un ancien membre de ce même parti, et les six restants font partie de l’alliance de gauche. Les dix autres députés de l’alliance de gauche ont néanmoins voté en faveur de l’adhésion. L’un des représentants du parti est même allé jusqu’à proposer une nouvelle législation qui criminaliserait les tentatives d’influencer l’opinion publique en faveur d’une puissance étrangère : un précédent qui pourrait théoriquement entraîner des poursuites pour toute critique à l’encontre de l’OTAN.
RecepTayyip Erdoğan a mis un coup de frein dans cette course effrénée. En accusant la Suède et la Finlande d’être des « incubateurs » de la terreur kurde, le président turc est parvenu à ralentir le processus d’adhésion de la première – mais a fini par lâcher du lest sur la seconde (l’adhésion à l’Alliance nécessite l’approbation unanime de tous les États membres). En cause : le refus de la Finlande et de la Suède d’extrader trente-trois membres du PKK et du mouvement güleniste, ce dernier étant accusé d’avoir fomenté en 2016 un coup d’État sanglant. Il a également exigé que la Suède lève son embargo sur les armes, imposé en réaction aux incursions turques en Syrie en 2019.
La question kurde a réémergé sur la scène politique suédoise. Lorsque les sociaux-démocrates ont perdu leur majorité parlementaire en 2021, la Première ministre Magdalena Andersson s’est trouvée contrainte de négocier directement avec une parlementaire kurde, ancienne combattante des Peshmergas, Amineh Kakabaveh, dont le vote allait décider du sort du gouvernement. En échange de son soutien, Kakabaveh avait demandé à ce que la Suède accorde son appui aux YPG en Syrie, ce qui avait été accepté. En 2022, Kakabaveh avait flétri ce « renoncement » face à Erdoğan et menacé de retirer son soutien au gouvernement.
Aucune personnalité n’avait incarné la solidarité internationale des sociaux-démocrates suédois comme le Premier ministre Olof Palme. Des photographies le montrent en train de fumer un cigare aux côtés de Fidel Castro et il est demeuré dans les mémoires pour avoir fustigé les bombardements de l’armée américaine sur Hanoï et Haiphong – les comparant à « Guernica, Oradour, Babi Yar, Katyn, Lidice, Sharpeville [et] Treblinka ».
Nombreux sont ceux qui craignent que le gouvernement passe un accord privé avec Erdoğan, dont un échange de militants kurdes et de dissidents turcs contre la levée du veto à l’adhésion pourraient constituer les termes. Dans le même temps, le président croate, Zoran Milanović, avait fait preuve d’une audace croissante, soulevant un nouvel obstacle quoique de moindre importance : il promettait de bloquer l’adhésion de la Suède et de la Finlande à moins d’un changement de la loi électorale de Bosnie Herzégovine, en vue de mieux représenter les Bosniens croates…
Les médias de ces pays, reconduisant une rhétorique de « choc des civilisations » digne de Samuel Huntington, ont fréquemment affirmé que l’adhésion de la Finlande et de la Suède signifierait que ces pays rejoindraient enfin « l’Occident ». Une telle rhétorique n’a rien de nouveau. Peu de temps avant l’adhésion du Monténégro à l’Alliance, en 2007, le Premier ministre Milo Đukanović, avait affirmé que le clivage n’était pas centré autour de l’OTAN, mais d’enjeux « civilisationnels et culturels ».
Il est néanmoins curieux – et révélateur – de retrouver un même orientalisme en Scandinavie. Un commentateur marqué à gauche avait alors écrit qu’en rejoignant l’OTAN, la Suède devenait enfin « un pays occidental normal », avant de se questionner sur une éventuelle abolition, par le gouvernement, du Systembolaget, le monopole d’État sur l’alcool. On comprend ainsi ce que « rejoindre l’Occident » signifie réellement : se lier à un bloc dirigé par les États-Unis et dissoudre de manière incrémentale les institutions socialistes qui demeurent – un processus déjà entamé depuis des décennies.
L’abandon du principe de neutralité s’inscrit dans une évolution de la signification de l’internationalisme, en particulier pour la gauche des pays nordiques. Au cours de la Guerre froide, les sociaux-démocrates suédois défendaient un principe de solidarité internationale à travers leur soutien aux mouvements de libération nationale. Aucune personnalité n’avait incarné cette approche comme Olof Palme, que des photographies montrent en train de fumer un cigare aux côtés de Fidel Castro et qui est demeuré dans les mémoires pour avoir fustigé les bombardements de l’armée américaine sur Hanoï et Haiphong – les comparant à « Guernica, Oradour, Babi Yar, Katyn, Lidice, Sharpeville [et] Treblinka ».
À l’époque de l’effondrement de la Yougoslavie, dans les années 1990, cet « internationalisme actif » a été reconceptualisé en rien de moins que la « responsabilité de protéger » mise en avant par l’OTAN. En vertu de cette logique, l’ancien clivage entre pays exploiteurs et exploités a été remplacé par une nouvelle ligne de fracture, entre États « démocrates » et « autocrates ».
Pour autant, davantage que cet « internationalisme » dévoyé, c’est la « menace russe » qui a été agitée pour convaincre les populations de rejoindre l’OTAN. Bien que la Russie soit en difficulté face à un adversaire bien plus faible que la Suède et la Finlande, et qu’elle s’avère incapable de tenir la capitale avec des troupes ayant subi de lourdes pertes, elle constituerait une menace imminente pour Stockholm et Helsinki.
Ainsi, dans ce climat de psychose, les menaces – sans doute plus concrètes – à l’encontre des systèmes sociaux nordiques que représenterait une adhésion à l’OTAN ont été ignorées : disparition de l’État-providence, privatisation et marchandisation de l’éducation, accroissement des inégalités et affaissement du système de santé universel. Dans leur course pour s’aligner sur « l’Occident », les gouvernements suédois et finlandais ont fait montre de bien moins d’empressement pour remédier à de telles crises sociales…