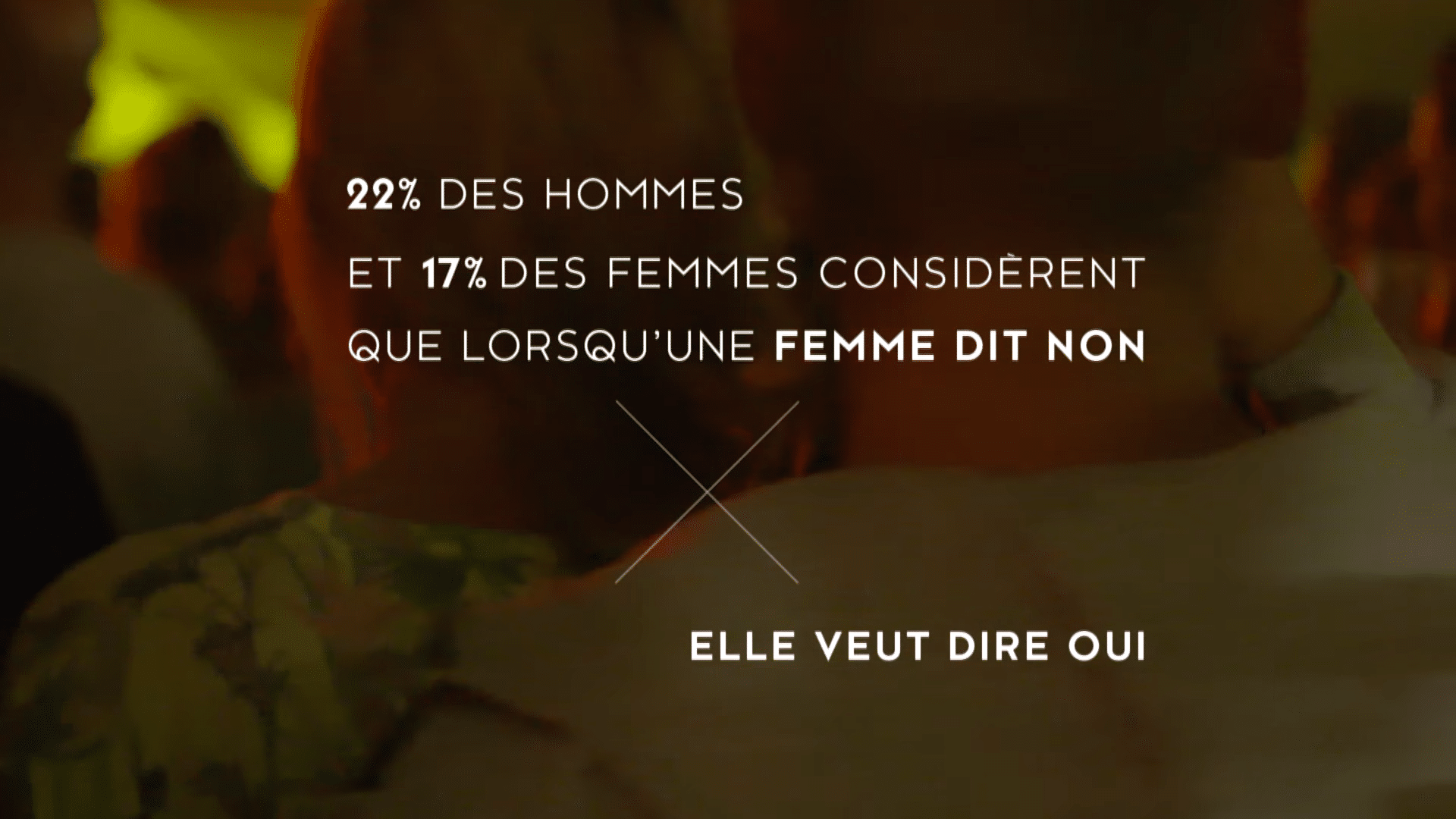Six femmes, à visage découvert, qui reviennent sur des relations sexuelles qu’elles ont subies, sans qu’elles aient donné leur consentement. C’est le pari du documentaire Sexe sans consentement, diffusé par France 2 le mardi 6 mars. L’occasion de revenir sur le malaise entourant les contours flous de la “zone grise” du consentement. Dans leur cas, c’était un ami, une connaissance, un flirt, un futur mari, qui, ce jour-là, a choisi d’aller plus loin alors qu’elles ne le souhaitaient pas. Loin de l’image du violeur pathologique, du prédateur sexuel. Entretien avec Blandine Grosjean, coréalisatrice du documentaire (avec Delphine Dhilly).
LVSL : Pourquoi avez-vous décidé il y a deux ans, bien avant l’affaire Weinstein et le #BalanceTonPorc, de faire un documentaire sur le sujet du consentement sexuel ?
Ce qui m’intéressait dans le sujet c’était moins le consentement que les débuts de la sexualité. Il existe toute une partie de la construction de la sexualité féminine qui n’est pas documentée. Comment on apprend à gérer les relations sexuelles, comment on se fait avoir au début. Il y a une absence de dialogue et un grand malentendu entre les garçons et les filles. Le documentaire, c’est ce moment-là. Quand ce genre de situations arrive à quarante ans, on est davantage capable de réagir. Là, nos témoins n’ont pas réussi à verbaliser, à sortir de la relation sexuelle.
LVSL : Qu’est-ce que la « zone grise » du consentement ?
L’expression de « zone grise » a le mérite de parler, sans regard pénal, sociologique, ou même extérieur : elle permet de savoir qu’on est dans l’intime. Quand il y a un phénomène, même quand le mot pour le désigner est imparfait, il permet d’ouvrir le débat. Il n’est pas toujours facile pour les victimes de qualifier intuitivement de viol une relation sexuelle non-consentie. Nos témoins sont dans la zone grise, à part une seule, son cas est particulier. Ce sont toutes des filles qui sont restées dormir après la relation à côté du mec. Elles leur font crédit d’une forme de malentendu. Elles sortent de la zone grise quand elles savent que le mec avait décidé d’avoir une relation sexuelle dans tous les cas, qu’elles le veuillent ou non.
Je pense que chacune a le droit de dire dans quelle zone elle s’est sentie. On a été en contact avec plein de filles. Celles qui savaient que c’était un viol ou qui ont décidé de porter plainte ne sont pas dans le film car ce n’est pas le sujet. La zone grise n’est pas une définition sociologique et pénale, c’est quelque chose qui permet de réfléchir sur ce qui nous est arrivé. Tout le monde est libre d’en sortir, pour dire s’il s’agissait d’un simple mauvais plan cul ou d’un viol. Dans le documentaire, les filles ont été forcées mais ne se disent pas violées. Elles savent aussi ce qu’elles font quand elles disent qu’elles ont été forcées, ce n’est pas anodin.
“Je trouve que les jeunes ont aujourd’hui une parole beaucoup plus sincère entre elles, sur la sexualité. Elles n’hésitent pas à tout se raconter (…) Les jeunes filles d’aujourd’hui n’acceptent plus la zone grise du consentement.”
LVSL : En 2010, vous êtes rédactrice en chef de Rue 89 et lorsqu’intervient l’affaire Assange. Une femme qui a été sa maîtresse l’accuse de l’avoir violée le lendemain matin d’un rapport sexuel. Vous dites que selon les générations, la vision de cette affaire était très différente dans la rédaction. Comment l’expliquez-vous ?
La scission n’était pas seulement générationnelle, c’était plus culturel. J’étais plus old school, pour moi la sexualité c’est compliqué, il y le viol, le harcèlement et puis tout le reste. J’avais peur que tout soit étiqueté dans la sexualité. L’affaire Assange, je l’associais vraiment à quelque chose de l’ordre du mauvais plan et pas de l’ordre du viol, à l’époque. J’ai vu qu’il y avait des femmes dans des registres beaucoup plus marqués que le mien, et certains hommes avec elles. Certains avaient une culture plus anglo-saxonne, ils avaient pu vivre aux États-Unis auparavant. Il y avait deux, trois, jeunes journalistes, qui avaient les idées très claires sur la sexualité, sur ce qu’est un viol, ce qu’est le harcèlement.
LVSL : Est-ce que les articles que vous autorisiez en tant que rédactrice en chef vous ont fait changer d’avis ?
Je pense que je n’avais pas d’avis. Les relations sont compliquées quand on est jeune. Les filles essaient de se faire accepter en ayant des mecs, les mecs essaient de se faire accepter de la même manière. Pour moi ça ne rentrait pas dans le domaine du féminisme. C’était comme un invariant auquel on ne pouvait rien changer. Je ne rentrais pas dans l’histoire de la domination masculine. Avec le papier que j’ai fait faire sur la zone grise du consentement, j’ai commencé à en parler autour de moi. Les choses n’ont pas changé dans les expériences sexuelles. La différence, c’est la colère.
LVSL : Oui, vous dites des jeunes filles d’aujourd’hui qu’elles sont en colère, qu’elles en parlent entre elles. Qu’est-ce qui vous empêchait, vous et vos amies, d’être en colère et de le faire savoir ?
Nous, à l’époque, quand on avait une histoire avec un mec, on était plutôt fières de se dire : « voilà je l’ai fait ». Nous pouvions être assez crues, très libres, au niveau de la sexualité mais chacune se démerdait. Il y avait beaucoup moins de partage et ce n’est pas lié qu’aux réseaux sociaux. Nous pouvions tout nous dire de façon sentimentale mais je trouve que les jeunes ont aujourd’hui une parole beaucoup plus sincère entre elles, sur la sexualité. Elles n’hésitent pas à tout se raconter. Nous, nous essayions de nous en sortir autrement. Entre frangines nous ne nous racontions rien. Mes deux filles de 22 et 30 ans se racontent tout, toutes leurs histoires, tous leurs ressentis. Les jeunes filles d’aujourd’hui n’acceptent plus la zone grise du consentement.
LVSL : Vous racontez dans un article paru dans Le Monde du vendredi 26 janvier 2018, une expérience sexuelle que vous qualifiez de « moment désagréable ». Vous avez quinze ans et demi et vous revenez des îles Glénant, vous dormez chez un moniteur de voile un peu plus âgé que vous, il veut avoir une relation sexuelle et vous dites être piégée sans autre endroit que chez lui où dormir. A cette époque vous ne mettez pas le mot de viol sur cette expérience. Le mettriez-vous aujourd’hui ?
Non, parce que si j’avais pris mes affaires et que j’étais partie, il ne m’aurait pas retenue et il n’y aurait pas eu de relation sexuelle. Ce n’était pas une relation consentie, parce que j’étais piégée mais je ne l’ai pas vécu comme un viol. Je suis sûre qu’il ne m’aurait pas empêchée de sortir.
LVSL : Quelle idée vous faisiez-vous de ce qu’était un viol à l’époque ?
Dans un viol, il y avait de la violence physique. J’ai pu entrevoir ce que c’était, j’étais à la campagne, je faisais beaucoup de stop. J’ai vraiment vu passer des moments où ça aurait pu être un viol. Nous écoutions RTL chez moi, les faits-divers. Le viol et la mort c’était assez proche pour moi à l’époque. Il y avait des histoires de filles qu’on enlevait, violait puis tuait. On ne parlait pas de viol conjugal. Je n’ai pas le souvenir de copines, qui auraient été violées et qui m’en auraient parlé. On n’en parlait pas entre nous. C’est ça qui a changé.
Propos recueillis par Anaïs Ribot (La main aux fesses).