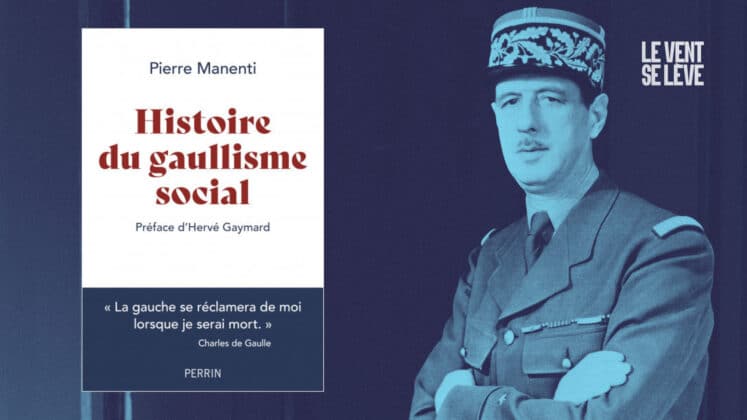Vice-président délégué du groupe MGEN et militant mutualiste, Éric Chenut est l’auteur de L’émancipation, horizon de nos engagements mutuels (Fondation Jean-Jaurès / L’Aube, 2020). Dans cet entretien, il revient pour nous sur les origines et sur les fondements philosophiques du mouvement mutualiste, mais aussi sur sa conception de l’émancipation, notion au cœur de son engagement. Il y défend le rôle de l’État dans la garantie à chacun des moyens de l’émancipation. Il analyse également l’importance du numérique dans nos sociétés et dessine les contours d’une démocratie sanitaire pour renouer la confiance entre la population et les autorités, dans le contexte de la crise que nous traversons. Entretien réalisé par Léo Rosell.
LVSL – Vous vous présentez avant toute chose comme un « militant mutualiste », et exercez des responsabilités de premier plan dans la Mutuelle générale de l’Éducation nationale (MGEN). Pourriez-vous revenir à la fois sur les origines et sur les fondements philosophiques du mouvement mutualiste ?
Éric Chenut – Être militant mutualiste, c’est avant tout s’inscrire dans une philosophie particulière de l’action, à la fois individuelle et collective. Une philosophie qui implique un savoir-être et un vouloir-être-ensemble pour soi et pour les autres. Une mutuelle, par définition, est un bien collectif, animé et porté par des femmes et des hommes engagés, qui partagent des convictions communes. Des convictions qui s’incarnent au quotidien dans la manière d’activer des solidarités intergénérationnelles, interprofessionnelles, interrégionales, entre actifs et retraités, entre malades et bien portants, dans le service apporté à ses adhérents ainsi que dans la gouvernance démocratique qui est la signature du mutualisme.
Nous agissons par et pour les adhérents, les bénéficiaires finaux de notre action. Le mutualisme est une manière originale, résolument moderne d’entreprendre, une forme d’économie circulaire à échelle humaine. Elle cherche à rationaliser notre action pour en maximiser l’utilité sociale, où la mesure d’impact est démocratiquement contrôlée par les représentants des adhérents. Le mutualisme induit une efficacité vertueuse s’il n’est pas dévoyé par l’hyper-concurrence qui pourrait le conduire à se banaliser pour répondre aux canons du marketing, des appels d’offres remettant en cause le fondement même de son essence solidariste et émancipatrice.
Avec l’avènement du siècle des Lumières, ces groupements, ces mouvements inspirés du principe de solidarité se détachent de la charité pour donner forme aux Sociétés de secours mutuels qui se développent concomitamment à la Révolution industrielle.
Très concrètement, le mutualisme est un modèle économique et solidaire fondé sur la Mutualité, c’est-à-dire une action de prévoyance collective par laquelle des personnes se regroupent pour s’assurer mutuellement contre des risques sociaux que sont la maladie, les accidents du travail, le chômage ou encore le décès. Nous pouvons adapter les réponses du mutualisme afin qu’il puisse se préoccuper des nouveaux fléaux sociaux, induits par des risques émergents comme l’environnement, les vies plus séquentielles ou de nouvelles crises pandémiques.
Pour ce qui est des origines philosophiques du mutualisme, plusieurs courants de pensée ont participé à sa conceptualisation, comme le mutualisme inspiré par Proudhon ou le solidarisme promu par Léon Bourgeois. Bien sûr, si on retrouve des traces d’actions de secours mutuel dans l’Antiquité, l’histoire du mutualisme en France remonte plus sûrement au Moyen-Âge avec les guildes, les confréries, les jurandes, les corporations et le compagnonnage. Avec l’avènement du siècle des Lumières, ces groupements, ces mouvements inspirés du principe de solidarité se détachent de la charité pour donner forme aux Sociétés de secours mutuel qui se développent concomitamment à la Révolution industrielle. Libérées de leur sujétion au pouvoir politique, après le Second Empire, et se développant d’abord en marge voire en opposition aux syndicats ainsi qu’aux assurances, les mutuelles proprement dites s’organisent dans un cadre juridique plusieurs fois remanié, concrétisé en France par le Code de la mutualité.
Le mouvement mutualiste continue donc d’investir et d’innover, contribuant ainsi à l’aménagement du territoire en santé en apportant des réponses de proximité.
En France, le mutualisme s’inscrit aujourd’hui dans le mouvement de l’économie sociale et solidaire qui promeut ce mode d’entreprendre à but non lucratif, ce qui ne signifie pas sans excédents. Ceux-ci sont réinvestis pour apporter aux adhérents des services nouveaux, à travers des réalisations sanitaires et sociales, des œuvres mutualistes, des services de soins et d’accompagnements mutualistes, aussi divers que des EHPAD, des cliniques de médecine, de chirurgie, d’obstétrique, des établissements de soins de suite et de réadaptation, des établissements de santé mentale, des centres de santé, des établissements médico-sociaux, des services à domicile, des centres d’optiques, dentaires ou d’audiologie, des crèches ou encore des services funéraires. Le mouvement mutualiste continue donc d’investir et d’innover, contribuant ainsi à l’aménagement du territoire en santé en apportant des réponses de proximité.
La mutualité n’est donc pas soluble dans l’assurance tant sa dimension sociale, sociétale et d’accompagnement est forte, elle concourt à la dimension sociale de la République aux côtés de la Sécurité sociale.
LVSL – Justement, à la Libération, la mise en place du régime général de la Sécurité sociale, par le ministre communiste du Travail Ambroise Croizat, et le directeur de la Sécurité sociale Pierre Laroque, a suscité l’inquiétude, voire la méfiance de la Mutualité, qui craignait de perdre le poids qu’elle avait acquis dans le mouvement social depuis plus d’un siècle. L’ordonnance portant statut de la Mutualité reconnaît toutefois que « les sociétés mutualistes sont des groupements qui, au moyen des cotisations de leurs membres, se proposent de mener, dans l’intérêt de ceux-ci ou de leur famille, une action de prévoyance, de solidarité ou d’entraide ». Comment ont évolué, depuis, les rapports entre la Mutualité et la puissance publique ?
E. C. – L’intervention de l’État dans le domaine social a été beaucoup plus tardive en France que dans la majorité des pays européens, ce qui explique le poids qu’y ont pris les mutuelles. La Sécurité sociale n’a pas été créée ex nihilo en 1945 sur une décision du Gouvernement provisoire de la République française, elle est le résultat d’un processus historique. Elle repose sur deux lois antérieures. La première, la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, fut votée en 1910 et concerna à l’époque 2,5 millions de personnes. La seconde fut votée en 1930 et a établi les Assurances sociales, inspirées en partie du système dit bismarckien mis en place en Allemagne de 1883 à 1889.
La Sécurité sociale innove sur trois points : d’abord, elle porte une ambition universelle et prétend couvrir tous les Français. Ensuite, elle prend en charge l’ensemble des risques sociaux. Enfin, les caisses de Sécurité sociale sont gérées par les travailleurs eux-mêmes, à travers leurs représentants syndicaux élus.
La France est le dernier grand pays d’Europe à s’être inspiré de ce système et à mettre en place les Assurances sociales, en raison principalement d’une farouche opposition d’une partie du patronat et à la réticence des médecins libéraux qui avaient promu leur charte de la médecine libérale à la fin des années 1920. Les Assurances sociales ont été investies par les mutualistes : aussi notre pays compte 15 millions de mutualistes à la Libération. Le rapport de force est alors favorable à la gauche et aux syndicats.
La Sécurité sociale innove sur trois points. D’abord, à la différence des lois de 1910 et 1930, elle porte une ambition universelle et prétend couvrir tous les Français. Ensuite, elle prend en charge l’ensemble des risques sociaux, jusqu’alors gérés par des acteurs différents ; seule exception, le chômage qu’on croit avoir vaincu. Enfin, les caisses de Sécurité sociale sont gérées par les travailleurs eux-mêmes à travers leurs représentants syndicaux élus.
Il s’agit donc d’un moment difficile pour la Mutualité, qui voit son périmètre d’activité et de légitimité se réduire à mesure que la Sécurité sociale se généralise. Son modèle, parce qu’il a gagné, induit de fait son retrait. À partir de ce moment, elle doit donc se réinventer, et aller sur de nouveaux risques, que la Sécu ne couvre pas, et se développer sur des protections par des prestations en espèces, certes, mais surtout en nature et en services. S’ouvre alors une ère d’innovation et d’investissement pour apporter des réponses territoriales et accompagner la reconstruction du pays, l’accès aux soins et des actions de salubrité publique.
La Sécurité sociale couvrant les salariés, les syndicats et les mutualistes portent son élargissement aux fonctionnaires. En 1947, la loi Morice établit un accord entre l’État et la Mutualité : cette dernière, reconnaissant la Sécurité sociale, gagne le droit de gérer celle des fonctionnaires, notamment pour la MGEN, celle des enseignants.
La Mutualité a su se développer, et convaincre de son utilité sociale, alors que la Sécurité sociale se généralisait, preuve qu’il n’y a pas à les opposer.
Au sein du mouvement mutualiste une ligne de divergence exista pendant plusieurs dizaines d’années entre les défenseurs d’une alliance objective avec l’assurance maladie, et ceux estimant que la Mutualité avait été spoliée. Depuis, ces querelles ont totalement disparu, les mutualistes défendant la Sécu comme premier levier de mutualisation, le plus large possible, socle indispensable au creuset républicain.
La Mutualité a su se développer, et convaincre de son utilité sociale, alors que la Sécurité sociale se généralisait, preuve qu’il n’y a pas à les opposer. Alors qu’elle couvrait 15 millions de personnes à l’après-guerre, elle en protège aujourd’hui 38 millions et gère 2 800 services de soins et d’accompagnement mutualistes sur tout le territoire, faisant d’elle le premier réseau non lucratif de soins du pays.
À partir des années 1970, les assureurs privés, avec des objectifs lucratifs, commencent à investir le domaine de la santé, au détriment des mutualistes. Ils sont confortés par le cadre européen, qui privilégie leurs statuts, celui des mutuelles n’existant pas dans la plupart des autres pays.
La Mutualité n’a pas toujours entretenu une relation apaisée et fluide avec les syndicats. La Fédération nationale de la Mutualité française (FNMF), créée en 1902 au Musée social à Paris, attendit 1971 pour engager des relations régulières avec la CFDT, la CGT et FO, sous l’impulsion des mutuelles de fonctionnaires où les relations étaient bien plus nourries et structurées.
Le mouvement mutualiste est soumis aujourd’hui à une concurrence de plus en plus sévère, induit par la doxa libérale européenne et les ordonnances de concurrence libre et non faussée qui induisent la déconstruction méthodique des cadres solidaires émancipateurs mutualistes. Les contrats groupes d’entreprises, sous couvert d’une meilleure couverture des salariés, ont déconstruit les solidarités entre actifs et retraités. Les besoins de portabilité des droits renforcent les stratégies de segmentation des marchés et d’individualisation des risques. L’hyper-concurrence engendre des coûts d’acquisition renforcés sans création de valeur sociale pour l’adhérent, les dernières modifications législatives imposant la résiliation infra-annuelle pour les complémentaires santé ayant pour principal impact une augmentation des coûts de gestion.
Nous devons jouer notre rôle de leader et rester ce que nous sommes : des militants de la protection sociale solidaire, des entrepreneurs du mieux vivre.
Alors que la question devrait être au contraire d’imposer un haut niveau de redistribution, de créer de la valeur pour les bénéficiaires finaux, les conditions de marché et un impensé politique conduisent à réglementer à outrance les contrats plutôt qu’à interroger le sens de l’action des acteurs et des opérateurs.
La Mutualité a donc intérêt aujourd’hui encore plus qu’après-guerre à se réinterroger sur son devenir, compte tenu des impacts induits par ce contexte concurrentiel, l’accélération des regroupements, aujourd’hui moins de 400 mutuelles, et la constitution de groupes mutualistes couvrant des millions de personnes. Le groupe VYV cofondé par la MGEN en 2017 protège ainsi plus de 10 millions de personnes. Comment allier taille et proximité ? Comment innover et investir pour inventer les métiers de demain de la protection sociale sans perdre de vue la préoccupation de la vie quotidienne des femmes et des hommes que l’on protège ?
Voilà une des nombreuses équations auxquelles les mutualistes ont à apporter la meilleure réponse possible. Ils doivent se réinventer pour ne pas se banaliser et préserver leurs capacités à entreprendre, à jouer l’émulation avec les autres acteurs de la protection sociale sans avoir peur d’être copiés. Nous devons jouer notre rôle de leader et rester ce que nous sommes : des militants de la protection sociale solidaire, des entrepreneurs du mieux-vivre.
Il appartient aux mutualistes de créer les conditions du rapport de force pour être entendus des pouvoirs publics et de l’État pour ce qu’il est, un employeur responsable, un investisseur de long terme dans les territoires, et un acteur contribuant au développement de l’action publique, confortant par le non lucratif les services publics de proximité.
Les mutualistes, par leur action, par le développement de leurs réponses, participent de la politique des territoires et du pays, même si ils ne sont pas toujours payés en retour. Il leur faut nouer des alliances objectives afin de pouvoir davantage peser dans le débat public à la hauteur de leur contribution sociale effective.
LVSL – L’idée d’émancipation est au cœur de votre ouvrage, comme en témoigne son titre. Quelle conception vous faites-vous de ce terme, de sa valeur philosophique et de son utilisation possible dans le domaine politique ?
E. C. – Je me suis aperçu en préparant ce livre que l’émancipation était au cœur de tous mes engagements depuis plus de 25 ans. Et cela m’a interrogé, car je n’en avais pas forcément eu conscience au moment de mes choix d’engagement successifs ou concomitants.
J’ai toujours voulu être libre, que l’on ne me réduise pas à l’image que l’on se faisait de moi. Je voulais être jugé pour ce que je faisais, et non pour ce qu’en apparence j’étais, ou ce à quoi on voulait me restreindre. Comme tout le monde, j’ai de multiples identités, elles ne peuvent suffire à me définir seules. À la différence de Kant, je crois que l’on se définit plus par ce que l’on fait que par ce que l’on pense.
Je n’oppose pas l’émancipation individuelle et collective car l’une comme l’autre se nourrissent, se renforcent. C’est parce qu’en tant qu’individu, je me sens libre, éduqué, en capacité de faire des choix, que j’ose les faire.
Je me réfère régulièrement à Montaigne, qui pose le principe d’individuation. Je suis par moi-même, et je crois que chacun l’est, femme ou homme libre. Je fais partie d’un groupe, un village, des amis, une famille, une profession, mais je suis moi-même. Je ne suis pas seulement une partie du groupe. Je concours au groupe, j’interagis avec les autres. Montaigne ne fait pas l’éloge de l’individualisme comme certains ont voulu le caricaturer, il porte le germe de l’émancipation, en ce sens qu’il pousse l’individu à se réaliser par lui-même, pour lui-même avec les autres, dans son écosystème, humain, naturel, animal. Je crois à cette nécessité de rechercher une harmonie, au fait que l’on ne se construit pas contre les autres, mais avec eux et par eux.
Je n’oppose pas l’émancipation individuelle et collective car l’une comme l’autre se nourrissent, se renforcent. C’est parce qu’en tant qu’individu, je me sens libre, éduqué, en capacité de faire des choix, que j’ose les faire. C’est parce que le groupe, la société, la nation investissent et croient en moi, me protègent de l’aléa, me donnent les outils pour que je sois un citoyen libre et éclairé, que je pourrais la défendre si une menace apparaissait.
La République a donc tout intérêt à investir massivement pour que ses filles et ses fils puissent être libres, émancipés de toute pression politique, religieuse, consumériste, et agissent en femmes et hommes libres, éclairés, car c’est ainsi qu’elle sera confortée. Elle sera questionnée, elle devra être elle-même irréprochable, car plus les gens sont formés et informés, plus leur niveau d’exigence progresse. C’est donc un cheminement exigeant, une recherche d’amélioration permanente, où le sens est d’être plus que d’avoir, où le progrès se mesure dans la concorde et aux externalités positives et non à l’accumulation, où l’essentiel est la PIBE, la participation intérieure au bien-être, et non le PIB, gage de gabegies et d’aberrations environnementales.
Pour que cette émancipation individuelle et collective prenne force et vigueur, cela suppose que différentes conditions soient remplies, que la République porte une ambition aspirationnelle, que l’État garantisse à chacun les moyens de cette émancipation par l’éducation, la culture, la santé, la solidarité et la citoyenneté.
L’émancipation, c’est donc ce qui me permet d’être moi-même, un être civilisé, connecté avec mon environnement, pouvant agir et interagir avec lui, comprenant les enjeux, et pouvant décider en toute connaissance de cause. Pour que cette émancipation individuelle et collective prenne force et vigueur, cela suppose que différentes conditions soient remplies, que la République porte une ambition aspirationnelle, que l’État garantisse à chacun les moyens de cette émancipation par l’éducation, la culture, la santé, la solidarité et la citoyenneté.
LVSL – Votre livre s’ouvre sur le constat que « la société française apparaît de plus en plus fracturée, loin du mythe révolutionnaire de la nation une et indivisible la structurant », ce qui constitue un défi considérable pour le vivre-ensemble. La croissance des inégalités sociales et territoriales a dans le même temps altéré en profondeur l’égalité des chances, réduisant ainsi ce que vous appelez « la capacité des individus à s’émanciper ». Si ce constat est souvent fait dans les champs politique et médiatique, quelles en sont la portée et la spécificité selon une perspective mutualiste ?
E. C. – Depuis les années 1980, l’évolution des inégalités est en hausse partout dans le monde, de telle sorte que même si en Europe celles-ci sont moins fortes qu’ailleurs dans le monde, notamment en raison de nos systèmes sociaux, les inégalités n’y régressent plus pour autant. Les politiques publiques permettent moins qu’avant à un enfant de réussir par son seul mérite à se hisser dans une autre classe sociale que celle de sa naissance. Cela ne peut que générer du ressentiment social, qui se traduit vite en exutoire violent, faute de débouché politique si ces frustrations ne trouvent pas de possibilité de traduction constructive.
Aujourd’hui, celles et ceux qui contribuent le plus aux solidarités proportionnelles par l’impôt et les cotisations sociales sont les classes moyennes qui, paradoxalement, voient leurs efforts moins récompensés qu’avant. En effet, l’action publique investit moins pour l’avenir à travers des infrastructures ou l’éducation permettant à leurs enfants de pouvoir avoir une vie meilleure que la leur. Depuis l’après-guerre, ma génération est la première à ne pas avoir vu sa condition s’améliorer par rapport à celle de ses parents.
Par ailleurs, celles et ceux qui bénéficient de l’action sociale se voient dans l’obligation de justifier toujours davantage les aides auxquelles ils ont droit, et ces dispositifs d’accompagnement, plutôt que de les aider à évoluer, à s’élever, leurs permettent juste de survivre.
Par conséquent, les contributeurs nets comme les bénéficiaires nets ne peuvent nourrir dans cette situation qu’une vision négative de l’action publique, des dispositifs d’aide sociale, sans que l’État ne les réinterroge en profondeur pour les refonder. Une situation qui nourrit un sentiment de gâchis, et qui alimente une perte de sens collectif, tout en nuisant à la conscience que les solidarités sont nécessaires et participent à la richesse de tous. De plus, elle est largement instrumentalisée par les tenants du tout libéral.
La crise sanitaire actuelle, qui aggrave dangereusement cette crise économique et sociale, en témoigne : sans amortisseurs sociaux, elle aurait été encore plus violente. Mais si on ne rétablit pas la pertinence des solidarités, nous aurons du mal à convaincre de l’utilité de l’impôt et des cotisations sociales.
Si le rapport à la société et aux autres n’est pas apaisé, nous, en mutualité, ne pouvons promouvoir efficacement nos constructions solidaires, nos mécanismes redistributifs. Si chacun calcule son risque a posteriori, et veut en avoir pour son argent, le mécanisme même d’assurance n’est plus possible. C’est pourquoi il faut en revenir au sens, rendre compte de l’utilisation des ressources qui nous sont confiées pour montrer le bon usage qui en est fait, et rappeler pourquoi nous avons intérêt à être solidaires les uns avec les autres en termes de prévention des risques et d’apaisement social.
La meilleure des garanties de la Mutualité est son essence démocratique. Il nous faut donc renforcer la place des adhérents dans les mutuelles et la gouvernance mutualiste.
Cette crise sanitaire a rappelé à chacun que nous étions mortels, fragiles, et que sans les autre nous n’étions rien. Même la coopération internationale et européenne, quand elle a failli au début de la pandémie, a montré à quel point nous étions vulnérables. Il faut espérer que nous ayons des femmes et des hommes politiques qui portent cette aspiration au dépassement, au sursaut républicain, pour que nous ayons à cœur l’attention de l’autre, pour éviter les tensions de demain que tout repli nationaliste induirait inexorablement.
La Mutualité est traversée par les mêmes interrogations que la société. Elle doit donc elle aussi démontrer la force de son modèle, l’efficacité de ses mécanismes de redistribution solidaire, la résilience de son économie. La meilleure des garanties de la Mutualité est son essence démocratique. Il nous faut donc renforcer la place des adhérents dans les mutuelles et la gouvernance mutualiste en utilisant notamment les nouveaux moyens de communication afin de les associer aux réflexions et de rendre compte des décisions qui sont prises.
LVSL – Vous présentez cet ouvrage comme le résultat d’un « travail d’archéologie sur [vous]-même », dévoilant votre enfance, notamment marquée par un sentiment d’injustice suscité par votre handicap, et par une scolarité dans une ville, Nancy, où l’école jouait encore « le rôle de creuset républicain », avant d’évoquer vos engagements successifs dans le milieu mutualiste et plus largement associatif, et de résumer les valeurs qui vous animent selon le triptyque suivant « humanisme, émancipation, laïcité ». Pourriez-vous revenir sur les principales étapes de votre parcours, et sur les motivations qui vous ont mené à écrire cet ouvrage ?
E. C. – J’ai débuté mon parcours en mutualité en 1993, après avoir milité dans le syndicalisme étudiant à l’UNEF ID. J’ai trouvé dans cette forme d’engagement une dimension très concrète que je ne retrouvais pas ailleurs et qui me correspondait bien. Comme je l’ai dit, je crois que l’on se réalise aussi en faisant, en étant dans l’action.
Puis, les rencontres m’ont amené à m’intéresser à d’autres questions que la prévention, l’accompagnement social. J’ai eu envie et besoin de comprendre, d’approfondir les questions sous-jacentes qui amenaient à cette situation. J’ai voulu agir en amont, et donc j’ai élargi mon champ des possibles en essayant de remonter le fil et de voir où et comment il était possible d’agir pour que chacun puisse devenir réellement l’artisan de sa propre vie, sans que personne ne soit contraint par un problème de santé, de handicap, une origine ethnique ou religieuse, une contrainte économique et sociale.
La politique fut donc une source de réflexion et d’engagement naturelle pour moi, au Parti socialiste, où j’ai réfléchi et travaillé sans vouloir prendre de responsabilités au sein de l’appareil du parti. J’ai été élu municipal et communautaire d’opposition de 2008 à 2014, mandat au cours duquel j’ai beaucoup appris, en découvrant l’action publique depuis l’intérieur. Ce fut une expérience que j’aurais probablement poursuivie si mon engagement professionnel ne m’avait pas conduit à quitter Nancy pour m’installer à Paris.
La MGEN m’a permis de m’intéresser et de me former à différents champs d’activités dans l’assurance, la prévention, la recherche en santé publique, la gestion d’établissements de santé, le numérique en santé, me donnant une vision prospective qui a nourri ma capacité à faire des propositions, et là où je suis, à la MGEN, au Groupe VYV ou à la FNMF, d’être force de propositions pour que nous nous réinterrogions quant à notre devenir, notre contribution perceptible par celles et ceux pour qui nous sommes là, les adhérents.
Nos organisations, parce qu’elles sont inscrites dans le camp du progrès, se doivent d’éclairer l’avenir et de porter une parole courageuse dans le concert du mouvement social dont nous faisons partie.
LVSL – Dans son discours lors de la réception de son prix Nobel, en 1957, Albert Camus a dit : « Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. » En accordant une place centrale aux « enjeux de notre génération », et en rappelant que ceux-ci ont énormément évolué depuis l’après-guerre, vous semblez aussi traduire des inquiétudes qui concernent l’asservissement de l’humanité, non plus tant par les idéologies que par le numérique. Dans quelle mesure cet enjeu est-il devenu celui de notre génération, et comment faire progresser efficacement une culture scientifique et un nouvel humanisme, capables d’armer les citoyens face à cette menace qui alimente nombre de récits dystopiques ?
E. C. – Je crois que notre préoccupation est davantage de savoir quelle génération nous allons laisser au monde que de savoir quel monde nous allons laisser aux générations futures. Si nous n’armons pas ces générations à pouvoir se projeter, à pouvoir comprendre leur environnement et y agir, comment pouvons-nous imaginer leur donner la capacité de faire de bons choix pour elles-mêmes et pour les générations qui viendront après ?
Le numérique bouleverse et transforme toutes les sociétés. Aucune parcelle de l’organisation de notre monde ne semble lui échapper. L’organisation des États, des économies, des démocraties, a vu les algorithmes et aujourd’hui l’intelligence artificielle suppléer ou se substituer à l’intelligence humaine, quand ils ne sont pas des moyens de la manipuler. Nos comportements quotidiens, nos choix en tant que citoyens et consommateurs, nos rencontres, notre vie amoureuse et intime sont de plus en plus accompagnés, si ce n’est commandés, par d’habiles suggestions d’algorithmes qui nous connaissent parfois mieux que nous-mêmes.
Il faut bien avoir conscience que l’avènement de l’ère numérique annonce une civilisation nouvelle qui se dessine sous nos yeux depuis trente ans et s’impose à une vitesse exponentielle. Aucune génération dans l’histoire n’a connu de changement si radical et si profond en un temps si court.
En me posant la question des menaces qui alimentent les récits dystopiques, vous posez la question de savoir qui du numérique ou de l’homme sert l’autre et qui du numérique ou de l’homme peut asservir l’autre ? C’est l’éternelle question de la liberté de l’homme dans son environnement, et notamment dans son environnement historique. L’ère numérique n’est ni plus ni moins qu’un fait historique majeur, le dernier développement de la révolution scientifique entamée au XVe siècle en Europe mais aussi l’aboutissement de la globalisation.
Il faut bien avoir conscience que l’avènement de l’ère numérique annonce une civilisation nouvelle qui se dessine sous nos yeux depuis trente ans et s’impose à une vitesse exponentielle. Aucune génération dans l’Histoire n’a connu de changement si radical et si profond en un temps si court. Qui aurait pu imaginer le rôle du smartphone dans le quotidien des individus il y a seulement vingt ans ? Qui aurait pu imaginer une telle transformation dans le fonctionnement des États et de l’économie dans le même temps ? Où serons-nous dans vingt ans ? Personne n’est en mesure de le dire avec certitude.
Il faut permettre à chacun de comprendre, apprendre, anticiper pour ne pas subir les évolutions techniques, technologiques, scientifiques et médicales.
Ainsi, nous devons accompagner cette révolution en investissant sur l’éducation et la culture pour permettre à chacun d’appréhender le visible comme l’invisible, car je crois que l’on apprend autant de ce qui existe que de ce qui manque. Il faut permettre à chacun de comprendre, apprendre, anticiper pour ne pas subir les évolutions techniques, technologiques scientifiques et médicales.
Le numérique, par ce qu’il induit de progrès, est une opportunité que nous devons saisir pour mieux la faire partager au plus grand nombre. Mais au regard des transformations consubstantielles liées aux données qui en sont le ferment, il faut apprendre aux assurés sociaux, aux patients, aux personnes malades, à savoir comment les utiliser, savoir avec qui et comment les mettre à profit.
Il est singulier de voir que de nombreux individus ne s’émeuvent pas de laisser ses données de santé en accès via leur smartphone à leur opérateur ou via les applications utilisées mais se méfient du fait que l’État puisse avoir des informations le concernant via « Tous Anti-Covid ». À ce sujet, une expérience d’un blue button à la française où chacun aurait accès à ses données, pourrait décider de les partager avec les professionnels de santé ou de participer à des programmes de recherches, me semblerait une expérimentation utile à proposer. Ainsi, chacun aurait la capacité de gérer son capital santé en pleine responsabilité.
Mais pour que cela soit possible, il faut que la confiance soit au rendez-vous, et donc que des principes clairs soient établis et que l’État soit garant de leur application. Un principe de transparence, pour que celles et ceux qui sont à l’origine des algorithmes soient connus. Un principe de loyauté, afin que l’on n’utilise pas l’intelligence artificielle à l’insu des personnes. Un principe de libre consentement qui suppose que les assurés sociaux soient formés et informés. Un principe d’égalité pour que chacun puisse avoir accès aux dispositifs, ce qui suppose de régler les problèmes liés aux zones blanches. Un principe d’inviolabilité des infrastructures, ce qui nécessite que l’État garantisse la sécurité et impose des normes élevées aux acteurs et opérateurs.
Et pour finir, un principe de garantie humaine afin que jamais une personne ne soit seule face à un algorithme ou un robot, et puisse toujours bénéficier d’une médiation humaine pour expliciter un diagnostic. À l’aune du respect de ces principes éthiques, la confiance pourra être possible, l’individu respecté et donc nous pourrons lui permettre d’être arbitre de ses choix.
LVSL – De même, vous rappelez que « l’enjeu de l’émancipation est vital pour la République », et que celle-ci doit se réarmer idéologiquement et créer un nouveau contrat social, pour reproduire un cadre collectif protecteur et émancipateur, en termes d’accès à l’éducation et à la culture, de protection sociale ou encore de laïcité. Quels devraient être, selon vous, les contours de ce nouveau contrat social ?
E. C. – Tout au long de ce livre, je plaide en filigrane pour l’engagement mutuel, qui pourrait être le socle d’une reviviscence de la citoyenneté et d’un nouveau contrat social.
Il ne peut y avoir de République si elle n’est constituée d’individus émancipés, de citoyens éclairés, de gens heureux.
Un engagement mutuel entre l’État et les structures de l’économie sociale et solidaire, entre l’État et les organisations syndicales, entre l’individu qui s’engage et l’État, entre les personnes qui s’engagent et la structure dans laquelle elles le font.
Oui, l’émancipation est vitale pour la République, nous le rappelions plus haut, et il ne peut y avoir de République si elle n’est constituée d’individus émancipés, de citoyens éclairés, de gens heureux. Je crois que c’est à l’État, parce qu’il est l’émanation et l’instrument de la société pour accompagner les transformations du monde et se transformer elle-même, de donner toutes les clés de compréhension aux individus via l’éducation nationale, la culture.
Très clairement, je ne crois pas que l’État doive tout faire, mais je ne suis pas non un adepte du tout libéral, où le marché réglerait le bonheur des gens. Je suis convaincu qu’une articulation entre la puissance publique et le champ du non lucratif serait utile et pertinente, offrant la capacité aux gens de s’engager et d’agir à l’échelle locale comme nationale à travers des associations, des fondations, des coopératives, des mutuelles et des syndicats, pour appréhender à leur façon la chose publique.
Je crois aussi fondamentalement que l’économie sociale et solidaire, par son mode d’organisation et sa façon d’entreprendre, offre des capacités à faire, à initier le faire-faire, pour que la puissance publique ne porte pas tout. Les organisations doivent permettre à leurs membres de s’investir, ainsi nous démultiplierons les espaces de coopération, de co-construction des décisions et aspirations collectives. Nous pourrons, dans cette optique, créer des espaces de concordes sociales, donner des espaces au plaisir d’être et de faire ensemble. Il faut générer des espaces vertueux démocratiquement où celles et ceux qui veulent agir puissent le faire. Ainsi on créera des remparts pour défendre la République contre ses adversaires, et ils sont nombreux.
Il faut réaffirmer la République, ses valeurs et ses principes. Elle ne doit pas être solvable dans le marché, sauf à perdre son ambition émancipatrice. Il faut redonner du lustre à l’universalisme, à la fraternité/sororité républicaine qui, trop souvent, est moins appréhendée que la liberté et l’égalité pour lesquelles les débats sont si fréquents, alors qu’elle est le ciment de la société.
Nous nous réunissons davantage par notre envie d’être ensemble que par seulement une langue, un drapeau et un hymne. La République doit donc nourrir, entretenir cette aspiration, si elle veut que la flamme républicaine ne s’éteigne pas.
LVSL – Votre dernière partie, intitulée « À l’heure des choix », sonne comme l’ébauche d’un programme politique pour repenser la question des « jours heureux », pour reprendre le titre de celui du CNR. Quels en sont les axes principaux ?
E. C. – L’époque nous impose de dramatiser les enjeux autour des choix que nous devons faire. Vous êtes vous-même historien, activement engagé dans la cité, vous savez que l’Histoire peut être sévère et que chaque génération est jugée sur les choix qu’elle fait, sur l’héritage qu’elle laisse.
Mais si le lot de notre génération peut paraître un peu lourd tant les défis sont nombreux, il n’appartient qu’à nous de nous prendre en main pour refonder le pacte social et républicain, « Liberté, égalité, fraternité », pour redonner confiance en la démocratie, pour réussir la reconstruction écologique.
Je crois que l’universalisme, qui est peut-être le plus important des héritages qu’on nous ait légués, doit être au cœur de la reconquête démocratique et sociale.
Nous ne partons non plus d’une page blanche, bien heureusement, nous avons à notre disposition quelques acquis et fondamentaux sur lesquels nous appuyer pour construire l’avenir. Je crois que l’universalisme, qui est peut-être le plus important des héritages qu’on nous ait légués, doit être au cœur de la reconquête démocratique et sociale. Nous devons nous réapproprier cette notion, la défendre, la partager, l’enseigner, la transmettre.
En effet, la puissance publique qui doit nous unir ne peut le faire que si elle promeut ce qui est commun à tous, des principes s’appliquant à toutes et tous, et surtout pour toutes et tous, garantissant un espace public fondé sur la neutralité où chacun puisse agir, s’épanouir.
Concomitamment, la laïcité doit être réaffirmée comme cadre organisationnel émancipateur, garantissant à chacun de vivre librement dans le respect des autres. Et nous rappeler aussi ce qu’est la laïcité. Si elle est un cadre juridique, l’esprit de la loi va bien plus loin : c’est un principe d’organisation de la société qui s’est imposé comme clef de voûte de l’édifice républicain. Réduite à une simple opinion par ses contempteurs, la laïcité est au contraire la liberté d’en avoir une.
La laïcité est l’essence de nos libertés individuelles et de l’égalité des droits, elle constitue le fondement indispensable de l’harmonie sociale et de l’unité de la nation […] qui offre à chacun un accès égal aux connaissances et aux responsabilités, aux mêmes droits et aux mêmes devoirs. C’est, in fine, une doctrine de la liberté dans l’espace civique.
Concrètement, que garantit la laïcité en France ? Le droit absolu à la liberté de conscience, à la liberté d’expression et au libre choix. Elle est ainsi l’essence de nos libertés individuelles et de l’égalité des droits, elle constitue le fondement indispensable de l’harmonie sociale et de l’unité de la nation. Elle dessine le contour de notre civilité, une exigence à être au monde selon les codes d’un humanisme moderne qui offre à chacun un accès égal aux connaissances et aux responsabilités, aux mêmes droits et aux mêmes devoirs. C’est, in fine, une doctrine de la liberté dans l’espace civique.
J’y reviens assez longuement dans la troisième partie du livre, les questions du progrès, du temps et du bonheur doivent être réinvesties par le politique, pour leur redonner un sens partagé. La technologie, l’allongement de la durée de l’existence, mille choses ont depuis quelques décennies considérablement modifié notre rapport à l’espace, au temps, à nous-même en tant qu’individus, et en tant que société.
Nous devons resituer notre action individuelle et collective à l’aune des enjeux donc au-delà de ce que nous sommes : une espèce humaine vivant dans un monde dont les ressources sont finies, dans lequel nous nous devons de vivre harmonieusement. La question du sens devient essentielle, vitale même. Nous devons redonner une vision commune et partagée, donc débattue, des aspirations collectives. Nous devons requestionner l’économie pour que celle-ci, qui n’est qu’un moyen de nous réaliser, soit plus humaine, soit bien davantage structurée pour financer la santé, le social, l’environnemental.
Il faut également que l’Europe soit une terre d’émancipation et de progrès partagés à l’échelle continentale, plus sociale et solidaire. Ce qu’est devenue l’Europe est à bien des aspects problématiques. L’Europe doit renouer avec l’ambition de préparer l’avenir, d’assurer la prospérité du continent, d’offrir demain aux nations qui la composent les moyens de leur destin et de leur liberté. La reconstruction de l’esprit européen, de la conscience commune d’appartenir à un ensemble cohérent de peuples ayant des intérêts convergents, ne se fera pas sans un puissant effort pour rebâtir un dessein dans lequel chacun pourra se reconnaître, pour une Europe souveraine et solidaire.
LVSL – Dans une tribune parue dans le journal l’Humanité, vous estimez également qu’« associer les citoyennes et les citoyens à l’élaboration d’une ambitieuse politique de santé publique permettrait non seulement à cette politique d’être largement comprise et acceptée, mais participerait également à l’éducation populaire aux questions de santé publique et lèveraient des appréhensions légitimes, en particulier sur la politique vaccinale. » Est-ce à une sorte de démocratie sanitaire que vous aspirez, dans le sens où la population aurait à la fois davantage de poids et de visibilité sur les questions de santé publique, qui nourrissent de plus en plus d’inquiétudes ?
E. C. – Je suis toujours surpris de voir que nous nous soyons collectivement accommodés des milliers de morts chaque année de la grippe saisonnière parce que nous connaissions cette maladie, ou de voir le coût considérable induit par des pathologies certes moins graves comme les gastro-entérites, alors que des gestes simples permettraient de les éviter, par de la prévention et de la responsabilité individuelle. Nous avons préféré miser sur le curatif plutôt que sur le préventif. Cela ne peut se corriger en pleine crise et il est illusoire de demander à une population d’adopter des gestes barrières qu’on ne lui a pas enseignés préalablement.
Si nous voulons que des citoyens se responsabilisent, il faut que par l’éducation, à l’école, mais aussi tout au long de leur vie personnelle et professionnelle, via la médecine scolaire, universitaire ou du travail, on leur permette de comprendre et donc d’agir.
Je propose que l’ensemble des médecins de santé publique travaillent avec les médecins scolaires, universitaires et du travail à travers des pôles d’éducation et de promotion de santé sur de la recherche, notamment interventionnelle. Ainsi, les assurés sociaux pourront être accompagnés et devenir acteurs eux-mêmes de leur parcours, ils pourront appréhender en quoi et comment, par leur comportement, leur engagement, ils contribueront à l’amélioration de l’état de santé de leur communauté territoriale.
C’est par cette émulation collective, cet engagement de toutes et tous que l’on peut donner du sens à la démocratie sanitaire, car les gens pourront mesurer leur contribution, leur impact.
La crise sanitaire que nous vivons est singulière, en ce qu’elle a induit un retrait de la place des patients ou de leur organisation à la différence de crises précédentes comme le sida, le sang contaminé ou le Médiator. C’est donc la première fois que la démocratie sanitaire recule à l’occasion d’une crise, alors que les précédentes l’avaient au contraire fait progresser.
Si l’on veut dépasser cette défiance, il convient de conforter la transparence en permettant aux citoyens ou leurs représentants de questionner notre organisation en santé publique.
Si on pouvait le comprendre au moment de la sidération du mois de mars dernier, où en situation de crise majeure il a fallu agir vite, rien ne le justifie depuis mai dernier. Alors que le professeur Delfraissy, président du comité scientifique, demande la mise en œuvre d’un comité citoyen à côté de l’instance d’experts pour accompagner l’appropriation citoyenne des enjeux de cette crise, les pouvoirs publics ne l’ont pas installé ni même validé.
C’est regrettable au regard de la défiance induite par les errements de la communication gouvernementale du mois de mars. Si l’on veut dépasser cette défiance, alors que nous entrons dans la phase de la vaccination de la population, il convient de conforter la transparence en permettant aux citoyens ou leurs représentants de questionner notre organisation en santé publique. La démocratie sanitaire pourrait permettre de conforter la participation au bien-être physique, psychique, social et environnemental auquel j’aspire, permettant à chacun d’être acteur et non sujet, voire objet de soins.
Pour rétablir la confiance, il faut rendre les citoyens acteurs de leur parcours et non les infantiliser, comme cela est fait depuis la crise de la Covid-19, en leur permettant de comprendre les enjeux et d’être en capacité de questionner les pouvoirs publics à l’allocation des moyens pour atteindre des objectifs clairement établis.
En santé comme en politique, la démocratie ne peut fonctionner que si elle est participative, et si celles et ceux en responsabilité acceptent de rendre des comptes en toute transparence, pour conforter la confiance.
Il est ainsi surprenant de voir qu’actuellement, faute de confiance dans les pouvoirs publics, nous n’avons d’autre alternative que d’imposer, d’interdire ou de rendre obligatoire certaines pratiques auprès des assurés sociaux au lieu de miser sur l’intelligence collective en matière de santé publique. Avant même cette crise, compte-tenu de la montée du sentiment vaccino-sceptique très développé dans notre pays, les autorités ont ainsi fait passer le nombre de vaccins obligatoires de 3 à 11. Je suis convaincu de la nécessité de la vaccination, mais de telles décisions ne risquent-elles pas pour autant d’être contre-productives ?
Pour gagner en efficacité et en pertinence, la santé publique doit se penser à long terme, il faut miser et investir dans le temps long, et surtout y associer les femmes et les hommes qui sont concernés, tant les professionnels de santé que les patients ou assurés sociaux. En santé comme en politique, la démocratie ne peut fonctionner que si elle est participative, et si celles et ceux en responsabilité acceptent de rendre des comptes en toute transparence, pour conforter la confiance.