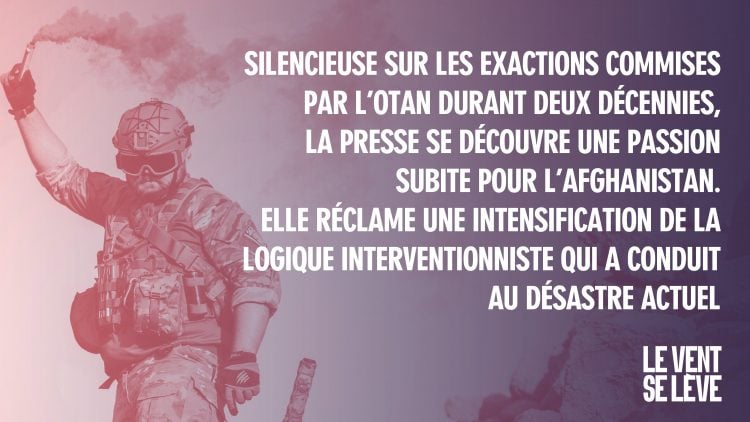Loin d’être salué pour sa détermination à mettre fin à une guerre jugée ingagnable par l’armée américaine elle-même, Joe Biden a essuyé un torrent de critiques d’une rare violence. Arguments fallacieux et techniques manipulatoires déployés par la presse américaine ont souvent été repris – plus ou moins consciemment – en France, empêchant toute prise de recul sur un dénouement pourtant inévitable.
Après vingt ans de conflit, plus de deux cent cinquante mille morts, des centaines de milliers de blessés et de déplacés, la pratique du viol et de la torture systémique, l’emploi de milices et de mercenaires, les massacres de civils, 2 000 milliards de dollars dépensés (trois fois le budget de l’État français et cent fois le PIB de l’Afghanistan), l’OTAN n’a pu empêcher le retour au pouvoir des talibans. En 2001, ils ne contrôlaient qu’une partie du territoire et combattaient le trafic d’opium. Al Qaeda demeurait une organisation obscure, essentiellement localisée dans les montagnes afghanes. Désormais, les talibans sont maîtres de la totalité du pays. Ils produisent 80 % de l’opium mondial – soit 400 millions de dollars de recette annuels – et le terrorisme islamique s’est répandu à travers le monde, jusqu’à devenir endémique aux États-Unis et en Europe. Le terme fiasco n’est probablement pas assez fort pour décrire l’étendue de l’échec occidental.
NDLR : pour une analyse des modalités de l’occupation américaine en Afghanistan, lire sur LVSL l’article d’Ewen Bazin : « L’Afghanistan, paradis des sociétés militaires privées »
Loin d’en tirer la conclusion logique sur la futilité des guerres humanitaires et les efforts pour « exporter la démocratie », la majorité des commentateurs, acteurs politiques et de la presse – en particulier aux États-Unis – semblent en vouloir davantage. Davantage d’interventions en Afghanistan et davantage d’ingérence occidentale de par le monde.
À l’instar de BHL s’exprimant sur BFMTV, ce ballet de pseudo-experts disqualifiés relèverait du registre de l’absurde et du comique si leur argumentaire halluciné ne trouvait un écho positif dans l’opinion américaine et la presse française.
Coupable de s’être opposé à l’avis de ses généraux, du Pentagone, du corps diplomatique et des services de renseignements – qu’on désigne généralement par le terme État profond -, Joe Biden fait face à un barrage médiatique sans réel précédent. Pourtant, depuis les années 2010, le quatrième pouvoir se divise en deux camps épousant plus ou moins fidèlement les positions des deux partis politiques majeurs. D’un côté l’incontournable Fox News, le New York Post et le Wall Street Journal. De l’autre le New York Times, le Washington Post, MSNBC, CNN et les hebdomadaires libéraux. Moins partisanes, mais solidement ancrées au centre, figurent les chaînes nationales (ABC, NBC, CBS), et la presse régionale.
Lorsque Joe Biden avait arraché un compromis au Parti républicain pour faire adopter son plan d’investissement dans les infrastructures du pays, Fox News dénonçait le coût « astronomique » tandis que le New York Times louait « l’incroyable talent de négociateur » de Joe Biden. Sur le dossier afghan, à l’inverse, tous les principaux médias ont fait bloc contre l’occupant de la Maison-Blanche. Fait rarissime, le prestigieux New York Times, le très conservateur National Review et le tabloïd d’extrême droite Washington Times ont tous les trois reproduit la même attaque personnelle contre Joe Biden, l’accusant d’instrumentaliser la mort brutale de son fils aîné pour défendre la fin du conflit afghan.
De manière sidérante et caricaturale, les principaux architectes de cette débâcle militaire et diplomatique, en particulier les cadres de l’administration Bush et les généraux ayant perdu l’Afghanistan sur le terrain, ont été invités à dire tout le mal qu’ils pensaient de la politique de Joe Biden sur les plateaux audiovisuels et les colonnes des grands journaux. Même les anciens conseillers d’Obama se sont acharnés contre son ex-vice-président. Le Washington Post a beau avoir exposé leurs mensonges répétés en publiant les Afghanistan papers, tous ces pompiers-pyromanes ont eu les égards des plus grands médias américains.
À l’instar de Bernard-Henri Lévy (BHL) s’exprimant sur BFMTV, ce ballet de pseudo-experts disqualifiés relèverait du registre de l’absurde et du comique si leur argumentaire halluciné ne trouvait un écho positif dans l’opinion américaine et la presse française. La cote de popularité de Joe Biden décroche pour différentes raisons, mais la couverture résolument négative du retrait de l’Afghanistan a incontestablement fragilisé le président américain le plus progressiste de ces cinquante dernières années.
NDLR : pour une analyse des cent premiers jours de la présidence Biden, lire sur LVSL l’article du même auteur : « Après 100 jours, pourquoi Joe Biden impressionne la presse française »
Analyser pourquoi et comment les médias font bloc pour défendre la poursuite du conflit afghan avec une telle obsession fournit un exemple éloquent de ce qui attend tout chef d’État désireux de s’attaquer au statu quo défendu par l’establishment et aux intérêts du capital – que ce soit en matière de politique étrangère ou économique.
Amnésie journalistique et impensés stratégiques
Dès avril 2021, le New York Times regrette que « Joe Biden ne se soit pas laissé persuader par le Pentagone » de poursuivre le conflit afghan. Dans une série d’articles alimentée par des fuites anonymes, on apprend qu’à peine entré à la Maison-Blanche, Joe Biden a subi de multiples pressions de la part du département de la Défense et de l’armée pour le contraindre à renoncer aux accords de Doha signés par Donald Trump en février 2020. Cet accord, certainement critiquable, avait mis fin aux attaques talibanes contre les troupes de l’OTAN et les civils occidentaux, contre la promesse du départ de l’armée américaine avant le 31 mai 2021. Biden a négocié une extension de trois mois, tout en continuant d’appuyer les forces militaires afghanes depuis les airs.
Mais contrairement à ses deux prédécesseurs, qui avaient été poussés par le même État profond à renier leurs promesses de campagne pour redoubler les efforts militaires en Afghanistan quelques mois à peine après avoir été élu, Joe Biden n’a pas flanché. Il connaissait les ficelles, lui qui avait conseillé Obama contre le déploiement massif de soldats réclamés par le Pentagone en 2009. Cette fois, les efforts répétés des militaires n’auront pas suffi à faire changer d’avis le président tout juste élu, qui faisait face à un dilemme : rompre les accords avec les talibans et redéployer des milliers d’hommes pour faire face à leur offensive, ou mettre fin au conflit.
Une conflit perdu depuis longtemps, comme l’avait démontré le Washington Post en publiant les Afghanistan papers, cette compilation de rapports internes au ministère de la Défense rédigés par le Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR). Rendus publics en décembre 2019, ils dressent un bilan catastrophique de l’occupation occidentale. Militairement, l’OTAN brillait par son absence de stratégie, son manque d’objectif clair, son soutien répétés aux crimes commis par ses alliés afghans et son incapacité à déterminer qui étaient ses véritables ennemis.
Financièrement, les sommes gigantesques déversées sur le pays ont surtout servi à enrichir les entreprises occidentales impliquées dans l’effort de guerre et de reconstruction, tout en provoquant un niveau de corruption inouïe au sein du gouvernement afghan, qui s’est rapidement auto-organisé en kleptocratie. Cette corruption ne se limite pas à l’accaparement de l’aide occidentale par les dignitaires locaux, elle a provoqué des pratiques terrifiantes de la part des fonctionnaires, de la police et de l’armée afghane : viols systémiques de femmes et d’enfants, rackets, extorsion, harcèlement, massacres de civils, torture, attaques délibérées de convois occidentaux pour justifier a posteriori la rémunération des seigneurs de guerres… Autant de comportements qui ont fini par pousser une partie de la population dans les bras des talibans, épuisée par les morts et la violence engendrés par l’occupation de l’OTAN.
Mais les informations cruciales de cette nature ont été occultées par la presse, qui s’est découvert une nouvelle passion pour le conflit uniquement après le retrait des troupes américaines. Le 8 juillet, lors d’une conférence de presse qui fera date, Biden est assailli de questions sur l’Afghanistan. Lui qui souhaitait évoquer son plan d’investissement massif dans l’économie américaine se voit contraint de spéculer sur la capacité militaire de l’armée régulière afghane. Dire que le régime en avait pour trois ans au maximum et probablement pas pour plus de six mois, comme l’assurait alors le Pentagone, aurait précipité sa chute.
“On nous a rapporté des histoires terrifiantes, à propos des veuves de l’armée afghane [pro-occidentale]. Elles devaient offrir des faveurs sexuelles pour obtenir leur pensions. Aucun américain n’accepterait pareil traitement.”
Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR) – 2017,
Pendant des mois, son administration a pressé les ressortissants occidentaux de quitter le pays, tout en distribuant des visas aux Afghans les plus exposés aux représailles talibanes. Si le traitement des fameux visas fut compliqué par les nombreuses barrières administratives mises en place par l’administration Trump à dessein – une difficulté que Joe Biden n’avait pas anticipée – il demeurait difficile de faire plus vite. À part embarquer de force les civils, au risque de saper davantage le moral des troupes afghanes qui auraient effectivement été réduites à l’état de bouclier humain destiné à gagner du temps, le retrait ne pouvait que se terminer par une situation chaotique.
Puisque le Pentagone était convaincu de la chute inévitable du régime, l’effondrement rapide du gouvernement et la prise de Kaboul sans le moindre coup de feu était rétrospectivement préférable à une longue guerre civile minée par d’innombrables morts, déplacés et atrocités. Pour éviter les nombreux drames qui se sont produits à Kaboul, Joe Biden aurait dû capituler en bonne et due forme dès sa prise de fonction. Mais donner les clefs du pays aux talibans sans combattre aurait été interprété comme une haute trahison et indéfendable face à l’opinion publique. L’unique alternative à l’évacuation tragique à laquelle nous venons d’assister aurait été une reprise des combats – et des morts occidentaux.
À ce titre, l’attentat commis par Daech aux abords de l’aéroport, qui a causé 170 morts dont 13 marines américains et 28 talibans, illustre parfaitement vers quoi le maintien de la présence occidentale aurait débouché. Tout comme la frappe de drone américaine sur une voiture suspectée d’abriter des terroristes, mais qui s’est avérée transporter une famille d’Afghans possédant des visas pour les États-Unis. Ici, le bilan s’élève à 10 morts, 7 enfants, dont 2 de moins de 2 ans.
Un criminel de guerre pour faire le procès du retrait de l’Afghanistan, quoi de plus normal de la part d’un journal dont 93% du lectorat vote démocrate ?
Enfin, il ne faut pas oublier l’exportation de ce conflit en Occident, à travers le terrorisme islamique endémique qu’il facilite et le terrorisme d’extrême droite aux États-Unis qu’il provoque. 750 000 soldats américains ont été déployés en Afghanistan, nombre d’entre eux issus de milieux défavorisés et désormais victimes de syndromes post-traumatiques (PTSD). La semaine dernière, un vétéran a pénétré dans la maison d’une famille de Floride et tué quatre personnes à l’arme semi-automatique, dont une mère et son bébé de trois mois. Il souffrait de troubles psychologiques liés à son déploiement en Afghanistan.
Ce genre de considérations et de critiques n’a pas eu droit de cité dans la presse américaine, qui a produit une couverture médiatique hystérique et univoque en faveur de la poursuite du conflit.
Propagande médiatique et fabrique du consentement
La chute de Kaboul a été immédiatement décrite par les médias américains comme une « débâcle » (CNN), un « fiasco » (MSNBC) et une « humiliation » (Fox News). Certes, les images de talibans posant dans le palais présidentiel avec leurs kalachnikovs et les vidéos tragiques des civils s’accrochant aux avions américains ne favorisaient pas la prise de recul. Mais une fois la situation revenue sous contrôle – 122 300 personnes évacuées en trois semaines, du jamais vu, la presse américaine a continué sa couverture hystérique des événements, avec une volonté de plus en plus apparente de nuire au président Biden.
Par le volume d’abord. Pendant deux semaines, en dépit de la hausse massive de décès liés au variant delta, des multiples catastrophes environnementales et du projet historique de réforme économique débattu au Congrès, le New York Times a fait systématiquement sa Une sur la situation en Afghanistan. La page d’accueil du Times, site d’information le plus consulté du pays et l’un des plus influents du monde occidental, a donné le ton à l’ensemble des médias, qui ont consacré un temps d’antenne impressionnant aux évènements, y compris en France.
Par l’angle ensuite. Puisque trois Américains sur quatre continuent de soutenir le retrait des troupes américaines, les critiques se sont essentiellement portées sur l’exécution de cette décision. Pas pour vanter la logistique qui a permis d’évacuer par les airs un nombre record de réfugiés en une dizaine de jours. Mais pour taxer l’administration Biden d’incompétence. Afin de retourner l’opinion publique contre la Maison-Blanche, les principales techniques déployées pour vendre la guerre en Irak ont été ressuscitées.
En premier lieu, la multiplication d’articles mensongers ou invérifiables, reposants sur des fuites anonymes. La presse a d’abord cherché à faire croire que Biden avait été averti par les agences de renseignement de l’imminence du désastre. Une idée réfutée par le haut commandement militaire (Joint Chief of Staff) et le simple fait que le directeur de la CIA était en déplacement dans les jours qui ont précédé la chute de Kaboul, clairement pas préoccupé par un risque d’effondrement soudain. Ensuite, en alimentant le récit douteux d’une administration Biden totalement dépassée par les évènements, incompétente et paniquée. Toujours à l’aide de « déclarations anonymes » de sources « proches du pouvoir » et souvent directement relayées par les correspondants français à Washington, sans le moindre recul. Enfin, l’enregistrement audio d’une conversation entre Biden et le président afghan fuité à l’agence Reuters – un délit passible d’emprisonnement – devait prouver le manque d’anticipation de la Maison-Blanche. Sous la présidence Trump, des fuites similaires et tout aussi illégales avaient été fréquemment déployées contre le milliardaire pour entraver sa politique étrangère.
À ces pratiques s’ajoute la complicité médiatique, qui débute par la suppression éditoriale de toute opinion contraire au récit dominant.
Selon de nombreux témoignages, les agents audiovisuels qui ont proposé des intervenants favorables au retrait des troupes ont été placés sur liste noire par les chaînes de télévision. Qu’il s’agisse d’élus, des innombrables journalistes et officiers vétérans qui soutiennent le retrait des troupes, ou simplement du reporter du Washington Post à qui l’on doit les Afghanistan papers, pratiquement aucun n’a eu droit de cité sur les plateaux télévisés et les éditoriaux de la presse papier. À la place, une farandole de commentateurs désirant la poursuite de la guerre est venue expliquer en quoi Joe Biden avait bâclé son retrait. Dont les ministres et conseillers emblématiques de W Bush : Condoleezza Rice dans le Washington Post, Karl Rove et Paul Wolfowitz dans le Wall Street Journal, John Bolton sur CNN… Le plus caricatural reste probablement l’éditorial acerbe d’un général afghan, en une du New York Times, intitulé « J’ai commandé des troupes afghanes cette année, nous avons été trahis. » Deux semaines plus tard, il s’est avéré que ce commandant ordonnait à ses troupes de massacrer les civils des régions qu’il abandonnait aux talibans. Un criminel de guerre pour faire le procès de Joe Biden, quoi de plus normal de la part d’un journal dont 93% du lectorat vote démocrate ?
De même, l’ancien ambassadeur de Barack Obama à Kaboul Ryan Crocker, dont les mensonges ont été exposés par les Afghanistan papers, a eu l’honneur des colonnes du Times pour écrire une tribune sobrement intitulée « Pourquoi le manque de patience stratégique de Biden a provoqué un désastre. » Selon lui, Joe Biden aurait dû attendre pour exécuter le retrait, jugeant que le statu quo pouvait être « maintenu indéfiniment et à moindres coûts humain et financiers ». En supposant que la rupture des accords de Doha ne remette pas en cause ce fameux statu quo, on parle de 15 000 morts par an et 300 millions de dollars par jour, comme le rappelle The Economist.
Ce genre d’argumentaire invraisemblable et inhumain a été reproduit ad nauseam par les premiers responsables du fiasco afghan, de Tony Blair à John Bolton en passant par le général David Petraeus. Ce dernier, pourtant passible de condamnation pour haute trahison pour avoir partagé des secrets défense à sa maîtresse lorsqu’il dirigeait la CIA, avant que celle-ci ne s’en serve pour le faire chanter, ne croupit pas en prison comme les lanceurs d’alertes qui ont révélé les crimes de l’armée américaine. Au contraire, il siège au sein du conseil d’administration d’une entreprise liée à l’industrie de l’armement et a pu donner un long interview au New Yorker, hebdomadaire progressiste dans lequel il plaide pour le retour de sa stratégie manquée de « contre-insurrection » qui avait nécessité la mobilisation de 100 000 soldats américains sous Barack Obama.
Où étaient l’indignation lorsque l’OTAN rasait un hôpital ou tuait une famille entière de soixante civils en bombardant un mariage ?
Le message est clair : tant que vous ne remettez pas en cause le complexe militaro-industriel et la vision impérialiste de la politique étrangère, tout vous sera pardonné. Joe Biden, lui, a franchi une ligne rouge. C’est ce qui ressort des conférences de presse, où les questions portent exclusivement sur l’exécution du retrait et les futures interventions militaires, sans jamais interroger la décision d’envahir l’Afghanistan ni les erreurs commises ensuite. Deux questions sont néanmoins sorties du lot par leur bellicisme : la première demandait le retour des frappes aériennes contre les talibans, alors que ces derniers avaient la vie de plusieurs milliers de ressortissants américains entre leurs mains. La seconde visait à obtenir la garantie explicite que Biden n’avait pas perdu sa détermination à envahir d’autres pays, si nécessaire.
Indignation sélective et instrumentalisation de la souffrance
Enfin, les médias ont cherché par tous les moyens à mobiliser les affects de l’opinion publique en pratiquant une indignation sélective frisant l’indécence, car limitée aux derniers jours du conflit et à Kaboul. Les récits et témoignages de militantes s’exprimant dans un parfait anglais ont alterné avec les rapports d’exactions talibanes. Mais où étaient l’indignation, les caméras et les micros tendus pour recueillir des témoignages lorsque l’OTAN rasait un hôpital ou éradiquait des familles entières en bombardant au moins huit fêtes de mariages depuis le début du conflit ?
Les rapports officiels du recours à la torture par l’armée américaine puis afghane – avec le soutien de l’OTAN – n’ont pas provoqué d’émoi médiatique particulier. Pas plus que la révélation du viol systémique d’enfants commis par les milices afghanes pro-occidentales, sur lesquels les soldats coalisés avaient ordre de fermer les yeux. Ni les révélations sur l’emploi d’escadron de la mort par la CIA, afin d’exécuter des enfants dans des villages dans le but d’instiguer la terreur. La présence puis la réhabilitation d’un tortionnaire et violeur notoire au cœur du pouvoir pro-occidental n’avaient déclenché aucun outrage.
Pire : les Afghanistan papers, qui ont montré à quel point les diplomates et militaires ont constamment menti au public pour vendre la poursuite du conflit, tout en couvrant de nombreuses atrocités – abus sexuel systémique des veuves des combattants afghans compris – n’ont fait l’objet d’aucune couverture médiatique significative. Les multiples frappes aériennes ciblant les mosquées, écoles, les enterrements, les mariages, tout comme les décisions de raser entièrement des villages n’ont jamais suscité l’émotion observée après la chute de Kaboul.
Si le sort des femmes afghanes vivant dans les grandes villes s’est considérablement amélioré sous l’occupation occidentale, celui des femmes rurales – soit 70 % de la population – a tellement empiré que nombre d’entre elles applaudissent le retour au pouvoir des talibans ou les soutiennent activement.
Les milliards de dollars d’argent public dépensés lors de l’occupation de l’Afghanistan ont avant tout bénéficié aux entreprises américaines, qui savent défendre leurs intérêts
Une fois le retrait achevé, le principal correspondant de la chaîne NBC a solennellement déclaré qu’il s’agissait « de la pire capitulation des valeurs occidentales de notre vivant ». Mais de quelles valeurs parle-t-on ? L’UNICEF a estimé que les sanctions occidentales imposées à l’Irak de Saddam Hussein ont tué un demi-million d’enfants. Celles imposées à l’Iran, Cuba, au Venezuela, en Syrie et au Liban en pleine pandémie tuent des dizaines de milliers de civils. En Afghanistan, où plusieurs millions de personnes sont exposées à la famine, ces sanctions économiques s’annoncent particulièrement brutales. L’accès au système financier mondial a déjà été coupé, l’aide humanitaire suspendue et les routes commerciales entravées. L’Afghanistan s’achemine vers une crise humanitaire comparable à celle provoquée par l’Occident et ses alliés au Yémen, dont les dégâts sont tout bonnement inouïs. Mais de ces aspects, la presse ne parle pas. Les souffrances s’arrêtent à Kaboul et commencent avec le retrait des troupes…
Derrière le fiasco diplomatique, militaire et journalistique : les intérêts privés
Le refus d’accepter les multiples demandes d’armistices envoyées par les talibans fin 2001 s’explique en partie par des calculs politiques, l’administration Bush refusant de « négocier avec les terroristes » et cherchant à vendre à l’opinion sa « guerre contre la terreur », quitte à refuser de se faire livrer Ben Laden au risque de provoquer l’enlisement des troupes occidentales qui sèmera les graines de l’insurrection talibane.
Mais depuis que la guerre est clairement perdue, c’est-à-dire au mieux 2006, comment expliquer ce refus de mettre un terme à ce formidable gâchis ? Outre les arguments géopolitiques discrédités et la vision exceptionnaliste des États-Unis partagée par l’essentiel des élites de Washington, il faut comprendre la poursuite du conflit comme une formidable opération de racket. Les milliards de dollars d’argent public dépensés ont avant tout bénéficié aux entreprises américaines, qui savent défendre leurs intérêts. Les huit généraux à la retraite qui ont successivement commandé les opérations en Afghanistan sont employés par l’industrie de l’armement. De même, l’écrasante majorité des analystes et experts sollicités par les médias américains pour commenter le retrait afghan sont également payés par cette industrie, en tant que conseiller, consultant, lobbyiste ou membre des conseils d’administration.
« Peut-être bien que notre plus grande et unique réalisation, malheureusement — et par inadvertance, bien sûr —, a été le développement de la corruption de masse. »
Ryan Crocker, ambassadeur américain à Kaboul sous Obama – cité dans les Afghanistan paper en 2016, traduction Le Monde diplomatique (septembre 2021)
Des conflits d’intérêts cachés au public, alors que les chaines d’informations emploient de plus en plus souvent des anciens cadres du renseignement pour commenter l’actualité. Les grands titres de presse sont par ailleurs dépendants ou influencés par leurs sources gouvernementales, elles-mêmes orientées par l’idéologie dominante et les perspectives de pantouflages. D’autant plus que la majorité des membres de l’administration Biden ont fait des allers-retours spectaculaires entre le public (sous Obama) et le privé, souvent dans des entreprises en lien avec l’industrie de l’armement.
En mettant fin au conflit afghan, Biden a également tué la poule aux œufs d’or. Pas étonnant qu’on lui fasse payer le prix fort.