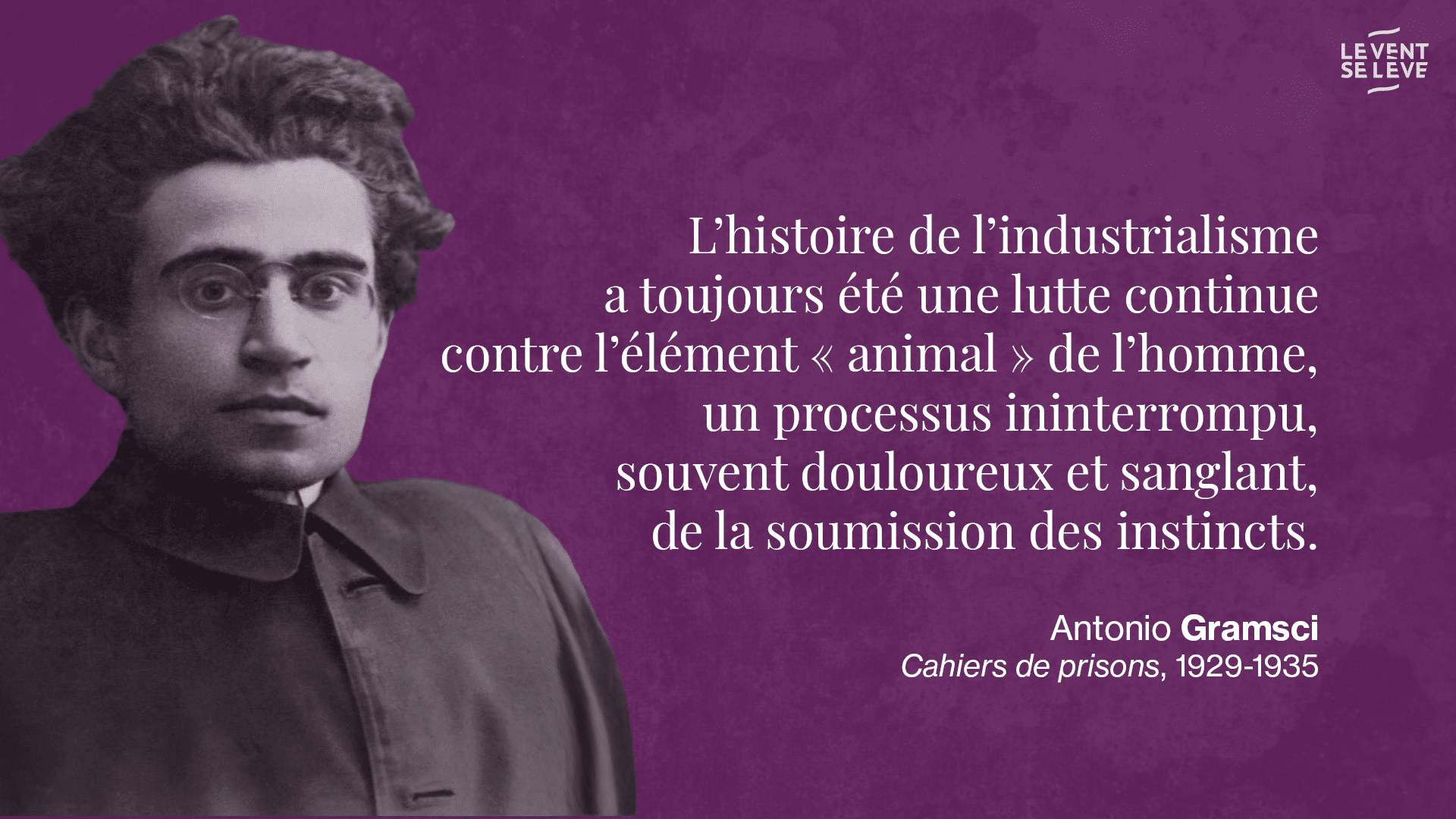Le texte présenté ici est tiré des Cahiers de prison rédigés par Gramsci durant son incarcération dans la première moitié des années 1930. Si ces textes restent à l’état de fragments, ils n’en constituent pas moins une contribution considérable à l’approfondissement de la théorie marxiste. Les extraits présentés ici dans le cadre de notre série « Les grands textes » sont issus du cahier 22. Parmi les plus cités de l’œuvre de Gramsci, « Américanisme et fordisme » propose de penser à nouveaux frais la dialectique infrastructure/superstructure en interrogeant l’alternance de cycles de puritanisme et de libertinage en lien avec les mutations du mode de production capitaliste. En l’occurrence, Gramsci pointe le rôle de la famille, du contrôle des mœurs et de la prohibition dans l’avènement de l’homme nouveau du capitalisme tayloriste. Inspiré et libre, ce texte conserve toute sa force, près d’un siècle après.
[…] Il faut remarquer que les industriels (et particulièrement Ford) se sont intéressés aux rapports sexuels de ceux qui sont sous leur dépendance et, d’une façon générale, de l’installation de leurs familles ; les apparences de « puritanisme » qu’a pris cet intérêt (comme dans le cas de la « prohibition ») ne doit pas faire illusion ; la vérité est que le nouveau type d’homme que réclame la rationalisation de la production et du travail ne peut se développer tant que l’instinct sexuel n’a pas été réglementé en accord avec cette rationalisation, tant qu’il n’a pas été lui aussi rationalisé. (Mach., pp. 323-326.)
« Animalité » et industrialisme
L’histoire de l’industrialisme a toujours été (et elle le devient aujourd’hui sous une forme plus accentuée et plus rigoureuse) une lutte continue contre l’élément « animal » de l’homme, un processus ininterrompu, souvent douloureux et sanglant, de la soumission des instincts (instincts naturels, c’est-à-dire animaux et primitifs) à des règles toujours nouvelles, toujours plus complexes et plus rigides, et à des habitudes d’ordre, d’exactitude, de précision qui rendent possibles les formes toujours plus complexes de la vie collective, conséquences nécessaires du développement de l’industrialisme. Cette lutte est imposée de l’extérieur et les résultats obtenus jusqu’ici, malgré leur grande valeur pratique immédiate, sont en grande partie purement mécaniques et ne sont pas devenus une « seconde nature ». Mais chaque nouvelle façon de vivre, dans la période où s’impose la lutte contre l’ancien, n’a-t-elle pas toujours été pendant un certain temps le résultat d’une compression mécanique ? Même les instincts qui doivent être dominés aujourd’hui parce qu’ils sont encore trop « animaux », ont été en réalité un progrès important sur les instincts antérieurs, encore plus primitifs : qui pourrait décrire combien a coûté, en vies humaines et en douloureuse soumission des instincts, le passage du nomadisme à la vie sédentaire et agricole ? Cela comprend les premières formes de l’esclavage de la glèbe et du métier, etc. Jusqu’ici tous les changements dans la façon d’être et de vivre se sont produits par coercition brutale, par la domination d’un groupe social sur toutes les forces productives de la société ; la sélection ou l’« éducation » de l’homme adaptée aux nouveaux types de civilisation c’est-à-dire aux nouvelles formes de production et de travail, s’est réalisée au moyen de brutalités inouïes, en jetant dans l’enfer dessous-classes les faibles et les réfractaires, ou en les éliminant complètement. À chaque apparition de nouveaux types de civilisation, ou au cours du processus de leur développement, des crises se sont produites. Mais qui a été entraîné dans ces crises ? Pas les masses travailleuses, mais les classes moyennes et une partie de la classe dominante elle-même, qui avaient éprouvé elles aussi la pression coercitive, qui s’était nécessairement exercée sur toute l’étendue de la société. Les crises de libertinisme ont été nombreuses : chaque époque historique a eu la sienne.
Lorsque la pression coercitive s’exerce sur l’ensemble social (et cela se produit spécialement après la chute de l’esclavagisme et l’avènement du christianisme) on voit se développer des idéologies puritaines qui confèrent à l’emploi intrinsèque de la force les formes extérieures de la conviction et du consentement : mais une fois le résultat atteint, au moins dans une certaine mesure, la pression se disperse (cette cassure se manifeste historiquement de façons très diverses, comme il est naturel, car la pression a toujours pris des formes originales, et souvent personnelles : si elle s’est identifiée avec un mouvement religieux, elle a créé son propre appareil, qui s’est personnifié dans certaines couches ou castes, et a pris le nom de Cromwell ou de Louis XV, etc.), et la crise de libertinisme se produit (la crise française après la mort de Louis XV, par exemple, ne peut être comparée avec la crise américaine qui suivit l’avènement de Roosevelt, de même que la prohibition n’a pas d’équivalent dans les époques précédentes, avec les actes de banditisme qui l’ont suivie, etc.) ; pourtant cette crise ne touche que de façon superficielle les masses travailleuses, où elle ne les touche qu’indirectement car elle déprave leurs femmes : en effet ces masses, ou bien ont déjà acquis les habitudes et les façons de vivre rendues nécessaires par le nouveau système de vie et de travail, ou bien continuent à ressentir la pression coercitive pour les nécessités élémentaires de leur existence (l’anti-prohibitionnisme lui-même n’a pas été voulu par les ouvriers, et la corruption que la contrebande et le banditisme apportèrent avec eux était répandue dans les classes supérieures).
Dans l’après-guerre on a assisté à une crise des mœurs d’une étendue et d’une profondeur considérables, mais cette crise s’est manifestée contre une forme de coercition qui n’avait pas été imposée pour créer des habitudes conformes à une nouvelle forme de travail, mais en raison des nécessités, d’ailleurs considérées comme transitoires, de la vie de guerre dans les tranchées. Cette pression a réprimé en particulier les instincts sexuels, même normaux, chez une grande masse de jeunes gens, et la crise s’est déchaînée au moment du retour à la vie normale, et elle a été rendue encore plus violente par la disparition d’un si grand nombre d’hommes et par un déséquilibre permanent dans le rapport numérique entre les individus des deux sexes. Les institutions liées à la vie sexuelle ont subi une forte secousse et la question sexuelle a vu se développer de nouvelles formes d’utopie de tendance « illuministe » [le terme renvoie à la philosophie des Lumières, ndlr]. La crise a été (et elle est encore) rendue plus violente du fait qu’elle a touché toutes les couches de la population et qu’elle est entrée en conflit avec les exigences de nouvelles méthodes de travail qui sont venues, entre temps, s’imposer (taylorisme et rationalisation en général). Ces nouvelles méthodes exigent une discipline rigide des instincts sexuels (du système nerveux), c’est-à-dire une consolidation de la « famille » au sens large (et non de telle ou telle forme de système familial), de la réglementation et de la stabilité des rapports sexuels.
Il faut insister sur le fait que, dans le domaine de la sexualité, le facteur idéologique le plus dépravant et le plus « régressif » est la conception « illuministe » et libertaire propre aux classes qui ne sont pas liées étroitement au travail producteur, et qui se propage de ces classes à celles des travailleurs. Cet élément devient d’autant plus important lorsque, dans un État, les classes travailleuses ne subissent plus la pression coercitive d’une classe supérieure, lorsque les nouvelles habitudes et aptitudes psycho-physiques liées aux nouvelles méthodes de production et de travail doivent être acquises par voie de persuasion réciproque ou de conviction proposée à l’individu et acceptée par lui. Il peut ainsi se créer peu à peu une situation à double fond, un conflit intime entre l’idéologie « verbale » qui reconnaît la nécessité nouvelle, et la pratique réelle, « animale », qui empêche les corps physiques d’acquérir effectivement de nouvelles aptitudes. Il se forme dans ce cas ce que l’on peut appeler une situation d’hypocrisie sociale totalitaire. Pourquoi totalitaire ? Dans les autres situations, les couches populaires sont contraintes à observer la « vertu » ; celui qui la prêche ne l’observe pas, tout en lui rendant un hommage en paroles, de sorte que l’hypocrisie est partielle, non totale ; cette situation, certes, ne peut durer et doit conduire à une crise de libertinisme, mais lorsque les masses auront déjà assimilé la « vertu » par des habitudes permanentes ou presque permanentes, c’est-à-dire avec des oscillations toujours plus faibles. Au contraire, dans le cas où il n’y a pas de pression coercitive d’une classe supérieure, la « vertu » est affirmée de façon générale et n’est observée ni par conviction ni par coercition, sans qu’il y ait cependant une acquisition des aptitudes psycho-physiques nécessaires pour les nouvelles méthodes de travail. La crise peut devenir « permanente », c’est-à-dire avoir des perspectives catastrophiques, car seule la contrainte pourra régler la question, une contrainte de type nouveau, dans la mesure où, exercée par l’« élite » d’une classe sur sa propre classe, elle ne peut être qu’une auto-coercition, c’est-à-dire une auto-discipline (Alfieri se faisant attacher à sa chaise). En tout cas, ce qui peut s’opposer à cette fonction des élites c’est la mentalité « illuministe » et libertaire appliquée au monde des rapports sexuels ; de plus, lutter contre cette conception signifie justement créer les élites nécessaires à cette tâche historique, ou du moins les développer pour que leur fonction s’étende à toutes les branches de l’activité humaine. (Mach., pp. 326-329.)
Rationalisation de la production et du travail
La tendance de Léon Davidovitch [Lev Davidovitch Bronstein, nom de naissance de Léon Trotsky ; Gramsci emploie ce nom pour tromper la censure de la prison, ndlr] était étroitement liée à cette série de problèmes, ce qui ne me paraît pas avoir été bien mis en lumière. Son contenu essentiel, à ce point de vue, consistait dans la volonté « trop » résolue (par conséquent non rationalisée) d’accorder la suprématie, dans la vie nationale, à l’industrie et aux méthodes industrielles, d’accélérer, par des moyens de contrainte extérieure, la discipline et l’ordre dans la production, et d’adapter les mœurs aux nécessités du travail. Étant donné la façon générale d’aborder tous les problèmes liés à cette tendance, celle-ci devait nécessairement aboutir à une forme de bonapartisme, d’où la nécessité impérieuse de la supprimer. Ses préoccupations étaient justes, mais ses solutions pratiques étaient profondément erronées. C’est dans ce décalage entre la théorie et la pratique que résidait le danger, qui du reste s’était déjà manifesté précédemment, en 1921. Le principe de la contrainte, directe ou indirecte, dans l’organisation de la production et du travail, est juste, mais la forme qu’elle avait prise était erronée ; le modèle militaire était devenu un préjugé funeste et les armées du travail échouèrent. Intérêt de Léon Davidovitch pour l’américanisme ; ses articles, ses enquêtes sur le « byt » [désigne le « mode de vie » en russe, ndlr] et sur la littérature ; ces activités étaient moins étrangères les unes aux autres qu’il ne pourrait sembler, car les nouvelles méthodes de travail sont indissolublement liées à un certain mode de vie, à une certaine façon de penser et de sentir la vie ; on ne peut obtenir des succès dans un domaine sans obtenir des résultats tangibles dans l’autre.
En Amérique la rationalisation du travail et la prohibition sont sans aucun doute liées : les enquêtes des industriels sur la vie privée des ouvriers, les services d’inspection créés dans certaines entreprises pour contrôler la « moralité » des ouvriers, sont des nécessités de la nouvelle méthode de travail. Rire de ces initiatives (même si elles ont été un échec) et ne voir en elles qu’une manifestation hypocrite de « puritanisme », c’est se refuser la possibilité de comprendre l’importance, le sens et la portée objective du phénomène américain, qui est aussi le plus grand effort collectif qui se soit manifesté jusqu’ici pour créer, avec une rapidité prodigieuse et une conscience du but à atteindre sans précédent dans l’histoire, un type nouveau de travailleur et d’homme. L’expression « conscience du but à atteindre » peut paraître au moins humoristique si l’on se souvient de la phrase de Taylor sur le « gorille apprivoisé ». Taylor exprime en effet avec un cynisme brutal le but de la société américaine : développer au plus haut degré chez le travailleur les attitudes machinales et automatiques, briser l’ancien ensemble de liens psycho-physiques du travail professionnel qualifié qui demandait une certaine participation active de l’intelligence, de l’imagination, de l’initiative du travailleur, et réduire les opérations de la production à leur seul aspect physique et machinal. Mais, en réalité, il ne s’agit pas de nouveautés originales, il s’agit seulement de la phase la plus récente d’un long processus qui a commencé avec la naissance de l’industrialisme lui-même, phase qui est seulement plus intense que les précédentes et qui se manifeste sous des formes plus brutales, mais qui sera dépassée elle aussi par la création d’un nouvel ensemble de liens psycho-physiques d’un type différent des précédents et, à coup sûr, d’un type supérieur. Il se produira inéluctablement une sélection forcée, une partie de l’ancienne classe ouvrière se trouvera impitoyablement éliminée du monde du travail et peut-être du monde tout court.
C’est à ce point de vue qu’il faut étudier les initiatives « puritaines » des industriels américains du type Ford. Il est certain qu’ils ne se souciaient pas de l’« humanité » et de la « spiritualité » du travailleur, qui sont immédiatement brisées. Cette « humanité » , cette « spiritualité » ne peuvent se réaliser que dans le monde de la production et du travail, dans la « création » productive ; elles existaient au plus haut point chez l’artisan, chez le « démiurge « lorsque la personnalité du travailleur se reflétait tout entière dans l’objet créé, lorsque le lien entre l’art et le travail était encore très fort. Mais c’est justement contre cet « humanisme » que le nouvel industrialisme entre en lutte. Les initiatives « puritaines » n’ont pour but que de conserver, en dehors du travail, chez le travailleur, exploité au maximum par la nouvelle méthode de production, un certain équilibre psychophysique qui l’empêche de s’effondrer physiologiquement. Cet équilibre ne peut être que purement extérieur et mécanique, mais il pourra devenir interne s’il est proposé par le travailleur lui-même et non imposé du dehors, s’il est proposé par une nouvelle forme de société, avec des moyens appropriés et originaux. L’industriel américain se préoccupe de maintenir la continuité de l’efficience physique du travailleur, de son efficience musculaire et nerveuse : il est de son intérêt d’avoir une main-d’œuvre stable, toujours en forme dans son ensemble, parce que l’ensemble du personnel (le travailleur collectif) d’une entreprise est une machine qui ne doit pas être trop souvent démontée et dont il ne faut pas trop souvent renouveler les pièces particulières, sans occasionner des pertes énormes.
Le fameux « haut salaire » est un élément qui se rattache à cette nécessité : il est l’instrument qui sert à sélectionner une main-d’œuvre adaptée au système de production et de travail, et à la maintenir stable. Mais le haut salaire est un instrument à double tranchant : il faut que le travailleur dépense « rationnellement » son salaire plus élevé, afin de maintenir, de rénover et, si possible, d’accroître son efficience musculaire et nerveuse, et non pour la détruire ou l’amoindrir. Et voilà que la lutte contre l’alcool, le facteur le plus dangereux de destruction des forces de travail, devient une affaire d’État. Il est possible que d’autres luttes « puritaines » deviennent elles aussi des fonctions d’État, si l’initiative privée des industriels se révèle insuffisante ou si se produit une crise de moralité trop profonde et trop étendue parmi les masses travailleuses, ce qui pourrait se produire à la suite d’une longue et importante crise de chômage.
À la question de l’alcool est liée la question sexuelle : l’abus et l’irrégularité des fonctions sexuelles est, après l’alcoolisme, l’ennemi le plus dangereux de l’énergie nerveuse et l’on observe couramment que le travail « obsédant » provoque des dépravations alcooliques et sexuelles. Les tentatives faites par Ford d’intervenir, au moyen d’un corps d’inspecteurs, dans la vie privée de ses employés, et de contrôler la façon dont ils dépensent leur salaire et dont ils vivent, est un indice de ces tendances encore « privées » ou latentes, mais qui peuvent devenir, à un certain moment, une idéologie d’État, en se greffant sur le puritanisme traditionnel, c’est-à-dire en se présentant comme un renouveau de la morale des pionniers, du « véritable » américanisme, etc. Le fait le plus important du phénomène américain dans ce domaine est le fossé qui s’est creusé, et qui ira sans cesse en s’élargissant, entre la moralité et les habitudes de vie des travailleurs et celles des autres couches de la population.
La prohibition a déjà donné un exemple d’un tel écart. Qui consommait l’alcool introduit en contrebande aux États-Unis ? C’était devenu une marchandise de grand luxe et même les plus hauts salaires ne pouvaient en permettre la consommation aux larges couches des masses travailleuses : celui qui travaille pour un salaire, avec un horaire fixe, n’a pas de temps à consacrer à la recherche de l’alcool, n’a pas le temps de s’adonner aux sports, ni de tourner les lois. On peut faire la même observation pour la sexualité. La « chasse à la femme » exige trop de loisirs. Chez l’ouvrier de type nouveau on verra se répéter, sous une autre forme, ce qui se produit chez les paysans dans les villages. La fixité relative des unions sexuelles paysannes est étroitement liée au système de travail à la campagne. Le paysan qui rentre chez lui le soir après une longue et fatigante journée de travail, veut la Venerem facilem parabilemque dont parle Horace ; il n’est pas disposé à aller tourner autour de femmes rencontrées au hasard ; il aime sa femme parce qu’il est sûr d’elle, parce qu’elle ne se dérobera pas, ne fera pas de manières et ne prétendra pas jouer la comédie de la séduction et du viol pour être possédée. Il semble qu’ainsi la fonction sexuelle soit mécanisée mais il s’agit en réalité de la naissance d’une nouvelle forme d’union sexuelle dépouillée des couleurs « éblouissantes » et du clinquant romantique propres au petit bourgeois et au « bohème » désœuvré. Il apparaît clairement que le nouvel industrialisme veut la monogamie, veut que le travailleur ne gaspille pas son énergie nerveuse dans la recherche désordonnée et excitante de la satisfaction sexuelle occasionnelle : l’ouvrier qui se rend au travail après une nuit de « débauche » n’est pas un bon travailleur ; l’exaltation passionnelle ne peut aller de pair avec les mouvements chronométrés des gestes de la production liés aux automatismes les plus parfaits. Cet ensemble complexe de pressions et de contraintes directes et indirectes exercées sur la masse donnera sans aucun doute des résultats et l’on verra naître une nouvelle forme d’union sexuelle dont la monogamie et la stabilité relative semblent devoir être les traits caractéristiques et fondamentaux.
Il serait intéressant de connaître les résultats statistiques concernant les phénomènes de déviation des habitudes sexuelles officiellement préconisées aux États-Unis, analysés par groupes sociaux : on constatera que, de façon générale, les divorces sont particulièrement nombreux dans les classes supérieures. Cet écart entre la moralité des masses travailleuses et celle d’éléments toujours plus nombreux des classes dirigeantes, aux États-Unis, semble être un des phénomènes les plus intéressants et les plus riches de conséquences. Jusqu’à ces derniers temps le peuple américain était un peuple de travailleurs : cette « vocation travailleuse » n’était pas seulement un caractère propre à la classe ouvrière, c’était aussi une qualité spécifique des classes dirigeantes. Le fait qu’un milliardaire continue pratiquement à travailler jusqu’à ce que la maladie ou la vieillesse l’oblige à se reposer, que son activité s’étende sur un très grand nombre d’heures de la journée, voilà des phénomènes typiquement américains, voilà le phénomène américain le plus stupéfiant pour l’Européen moyen. On a remarqué précédemment que cette différence entre les Américains et les Européens est due à l’absence de « traditions » aux États-Unis, dans la mesure où tradition signifie également résidu passif de toutes les formes sociales périmées de l’histoire. Par contre il existe aux États-Unis la toute récente « tradition » des pionniers, c’est-à-dire des fortes individualités chez qui la « vocation laborieuse » avait atteint la plus grande intensité et la plus grande vigueur, d’hommes qui, directement et non par l’intermédiaire d’une armée d’esclaves et de serviteurs, entraient en contact, de façon énergique, avec les forces naturelles pour les dominer et les exploiter victorieusement. Ce sont ces résidus passifs, qui, en Europe, résistent à l’américanisme (« représentent la qualité », etc.) car ils sentent instinctivement que les nouvelles formes de production et de travail les balaieraient implacablement. Mais, s’il est vrai qu’en Europe, dans ce cas, les vieilleries qui ne sont pas encore enterrées seraient définitivement détruites, que voit-on se produire en Amérique même ? La différence de moralité dont nous avons parlé montre que sont en train de se créer des marges de passivité sociale sans cesse plus vastes. Il semble que les femmes jouent un rôle dominant dans ce phénomène. L’homme, l’industriel, continue à travailler même s’il est milliardaire, mais sa femme et ses filles tendent de plus en plus à être des « mammifères de luxe ». Les concours de beauté, les concours pour être actrice de cinéma (se rappeler qu’en 1926, 30 000 jeunes Italiennes ont envoyé leur photographie en maillot de bain à la Fox), de théâtre, etc., en sélectionnant la beauté féminine dans le monde et la mettant aux enchères, font naître une mentalité de prostitution ; c’est la « traite des blanches » devenue légale pour les classes supérieures. Les femmes oisives voyagent, traversent continuellement l’océan pour venir en Europe, échappent à la prohibition de leur patrie et contractent des « mariages » saisonniers (rappelons que les capitaines de marine américains se sont vu retirer le droit de célébrer des mariages à bord, car de nombreux couples se mariaient à leur départ d’Europe et divorçaient avant de débarquer en Amérique) : c’est la prostitution réelle qui se répand, à peine masquée sous de fragiles formalités juridiques.
Ces phénomènes propres aux classes supérieures rendront plus difficile l’exercice de la contrainte sur les masses travailleuses pour les rendre conformes aux besoins de la nouvelle industrie ; en tout cas ils déterminent une rupture psychologique et accélèrent la cristallisation et la saturation des groupes sociaux, en rendant évidente leur transformation en castes comme cela s’est produit en Europe. (Mach., pp. 329-334.)
Taylorisation et mécanisation du travailleur
À propos de l’écart que le taylorisme déterminerait entre le travail manuel et le « contenu humain » du travail, on peut faire des observations utiles sur le passé, et particulièrement en ce qui concerne ces professions que l’on considère comme les « plus intellectuelles », c’est-à-dire celles qui sont liées à la reproduction des écrits en vue de la publication, ou de toute autre forme de diffusion et de transmission : les copistes d’avant l’invention de l’imprimerie, les typographes, les linotypistes, les sténographes, les dactylos. Si l’on y réfléchit, on s’aperçoit que, dans ces métiers, l’adaptation à la mécanisation est plus difficile que dans les autres. Pourquoi ? Parce qu’il est difficile d’atteindre au sommet de la qualification professionnelle, qui exige que l’ouvrier « oublie » le contenu intellectuel de l’écrit qu’il reproduit, ou qu’il n’y réfléchisse pas, pour ne fixer son attention que sur la calligraphie de chaque lettre s’il est copiste, ou pour décomposer les phrases en mots « abstraits » et ceux-ci en caractères d’imprimerie, choisir rapidement les morceaux de plomb dans les casses, pour décomposer non seulement chaque mot, mais des groupes de mots, dans le texte d’un discours, pour les grouper mécaniquement en abréviations sténographiques, ou pour obtenir la rapidité chez la dactylo, etc. L’intérêt que porte le travailleur au contenu intellectuel du texte se mesure à ses erreurs, autrement dit il constitue une déficience professionnelle : sa qualification se mesure précisément à son désintéressement intellectuel, c’est-à-dire à sa mécanisation. Le copiste du moyen âge qui s’intéressait au texte changeait l’orthographe, la morphologie, la syntaxe du texte qu’il recopiait, négligeait des passages entiers que sa faible culture ne lui permettait pas de comprendre ; le cours des idées que faisait naître en lui l’intérêt qu’il portait au texte, l’amenait à y intercaler des commentaires et des observations ; si son dialecte ou sa langue étaient différents de ceux du texte, il y introduisait des nuances étrangères ; c’était un mauvais copiste car en réalité il « refaisait » le texte. La lenteur de l’écriture médiévale (qui était aussi un art) explique bon nombre de ces déficiences : on avait trop de temps pour réfléchir et par conséquent la « mécanisation » était plus difficile. Le typographe, lui, doit être très rapide, ses mains et ses yeux doivent être sans cesse en mouvement, ce qui rend plus facile sa mécanisation. Mais, si l’on y réfléchit, l’effort que doivent faire ces travailleurs placés devant un texte dont le contenu est parfois passionnant (en effet dans ces cas-là on travaille moins vite et plus mal), pour n’en considérer que la graphie et ne s’attacher qu’à celle-ci, est peut-être le plus grand effort que l’on puisse exiger d’un métier. Cependant cet effort, l’homme l’accomplit sans tuer pour autant sa vie spirituelle. Une fois que l’adaptation s’est faite, on constate en réalité que le cerveau de l’ouvrier, loin de se momifier, atteint au contraire un état de complète liberté. Ce qui a été complètement mécanisé, c’est seulement le geste physique ; la mémoire du métier, réduit à des gestes simples répétés à une cadence très grande, a « fait son nid » dans les faisceaux musculaires et nerveux, laissant le cerveau libre et dégagé pour se livrer à d’autres occupations. Lorsqu’on marche, on n’a pas besoin de réfléchir à tous les mouvements nécessaires pour faire agir en synchronisme toutes les parties du corps d’une certaine façon : c’est de la même façon que l’on fait et que l’on continuera à faire, dans l’industrie, les gestes fondamentaux du métier. On marche automatiquement et l’on pense, en même temps, à tout ce que l’on veut. Les industriels américains ont fort bien compris cette dialectique propre aux nouvelles méthodes industrielles. Ils ont compris que le « gorille apprivoisé » n’est qu’une façon de parler, que l’ouvrier n’en reste pas moins, « malheureusement », un homme, et même que pendant son travail il réfléchit davantage, ou il a du moins une plus grande possibilité de penser, une fois qu’il a surmonté la crise de l’adaptation sans avoir été éliminé. Et non seulement il pense, mais le fait qu’il ne retire pas de son travail des satisfactions immédiates, et qu’il comprend qu’on veut le réduire à n’être qu’un « gorille apprivoisé », peut l’amener à avoir des idées peu conformistes. Qu’une telle préoccupation existe chez les industriels, c’est ce que nous montre toute la série de précautions et d’initiatives « éducatives » que l’on peut relever dans les livres de Ford et dans l’œuvre de Philip. (Mach., pp. 336-337.)
Source : Marxists.org.
Certaines corrections ont été apportées à la traduction proposée par marxists.org sur la base du texte établi par Razmig Keucheyan dans son anthologie Guerre de mouvement et guerre de position (éditions La Fabrique, 2014)