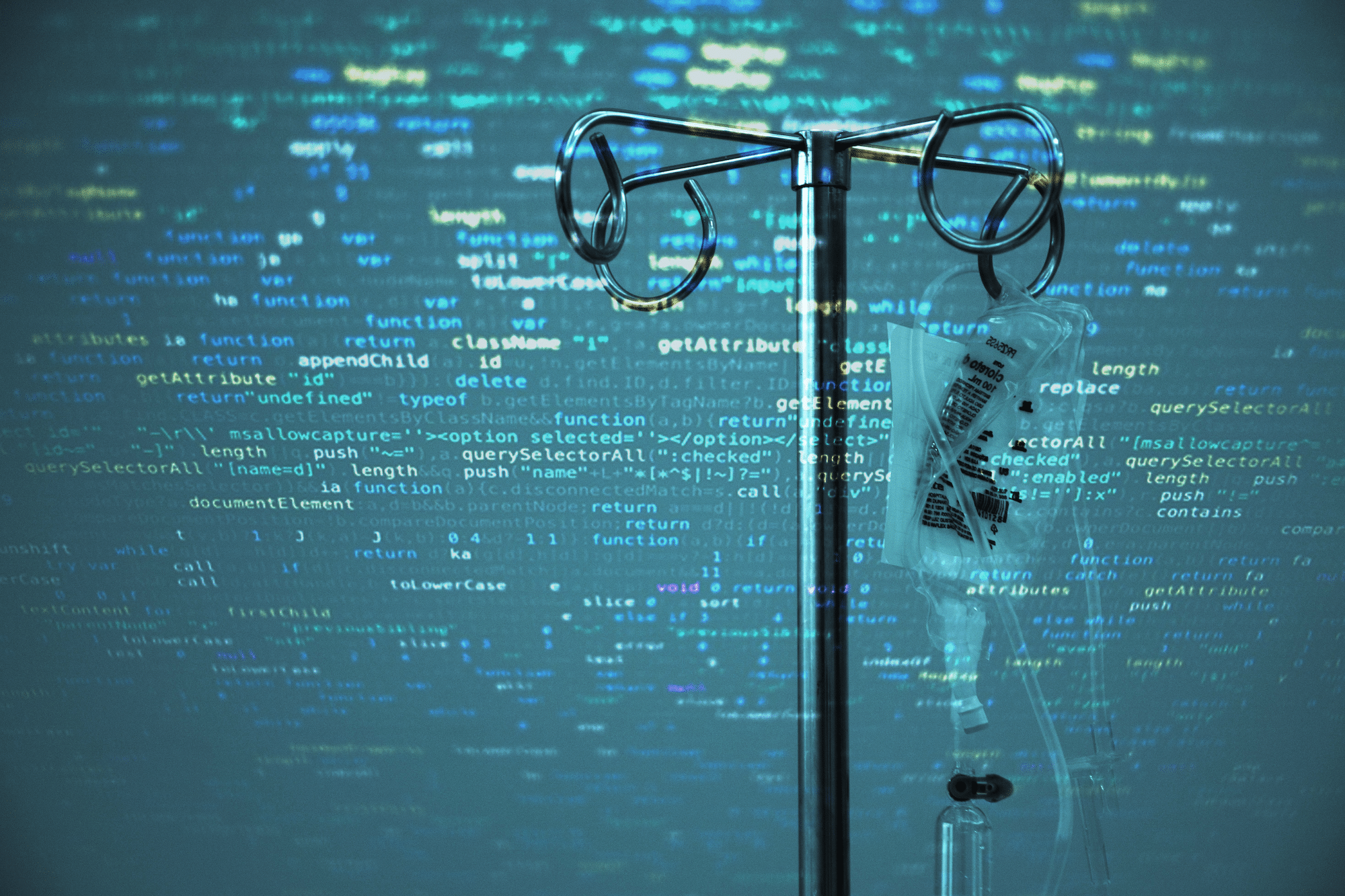Apple, Facebook et Google se présentent depuis quelques temps comme les « sauveurs dans la tempête », qui profitent de leur quasi-monopole sur les données informatiques pour oeuvrer à la résolution de la pandémie. Les GAFAM s’assurent ainsi un formidable accroissement de leur pouvoir en développant une forme de « biopolitique » de plus en plus liée à la datafication. Par Anna-Verena Nosthoff et Felix Maschewski, enseignants à la Freie Universität de Berlin et auteurs de Die Gesellschaft der Wearables – Digitale Verführung und soziale Kontrolle (« La société des wearables – Tentation digitale et contrôle social »). Traduit par Judith Kleman et Simon Darjesson.
Le 10 avril, Apple et Google déclaraient simultanément sur leurs sites Internet qu’il n’y avait « jamais eu meilleure opportunité » pour « travailler à la résolution de l’un des problèmes les plus urgents du monde ».
Les deux géants monopolistiques ont annoncé développer conjointement une plateforme pour le contact tracing – une technologie de suivi par smartphone des contaminations au Covid-19. L’objectif, promettent-ils, est « d’utiliser le pouvoir de la technologie (…) pour aider des pays dans le monde entier ». Autrement dit, les ingénieurs californiens s’arrogent un nouveau rôle : sauver l’humanité, la libérer du mal. Un rôle qui s’inscrit dans la devise de Google : Don’t be evil (« Ne soyez pas malveillants »).
À peine quelques semaines plus tôt, le président des États-Unis faisait faisait part de sa pleine confiance sur le sujet. « Je tiens à remercier Google », déclarait Donald Trump lors d’une conférence de presse. Sa gratitude s’adressait en particulier aux « 1700 ingénieurs » qui développaient un site destiné à réaliser un testing du Covid-19 à grande échelle. Le président se disait lui aussi convaincu que ce serait une aide précieuse pour toute la population et pour le monde entier : « We cover this country and large part of the world » (« Nous couvrons ce pays et une grande partie du monde »).
Dans le jargon de Google, cela se dit ainsi : « We’ve mapped the world. Now let’s map human health » (« Nous avons cartographié le monde. L’heure est venue de cartographier la santé humaine »).
Peu importe le caractère excessif d’une telle promesse et le fait que le site Internet ne s’est révélé tout au plus être qu’une ébauche brouillonne ou que la large panel du testing ait relevé plus de la lubie qu’autre chose. C’est le message ici qui est important : en cas de crise pandémique aigüe, la Maison Blanche mise sur l’élite de la high tech au point qu’elle excède la vision de la faisabilité digitale de cette élite elle-même. L’important est la célébration unanimiste d’une idéologie qui fait de la technologie l’outil ultime de la résolution des problèmes – ce qu’on appelle le solutionnisme.
C’est une grande lacune de la souveraineté des États qui apparaît ici à la faveur de l’état d’urgence virologique – et les sociétés de la Silicon Valley mettent tout leur poids et toute leur autorité pour la combler. Elles montent au créneau, en effet, sans aucune naïveté : elles s’intéressent au secteur de la santé depuis des années déjà, elles y ont déjà accumulé une expertise dans le traçage de données par le moyen des smartphones et autres wearables, comme on appelle toute technologie portable, connectée et destinée à être portée sur soi, du type des montres smart. La crise du coronavirus semble aujourd’hui faire advenir le moment décisif pour que les géants du numérique puissent s’imposer comme les précurseurs d’une politique sanitaire intégralement informatisée – tout en se mettant en scène comme « bienfaiteurs » de l’humanité.
Le mot d’ordre des deux compagnies est donc : « Never let a serious crisis go to waste » (« Une crise grave est une chance à ne surtout pas laisser passer »).
Google : la souveraineté dans l’état d’urgence
Alphabet – ainsi se nomme aujourd’hui le conglomérat Google – a pris l’annonce par Trump de la création du site de testing du coronavirus comme une incitation pressante à improviser une réponse. D’où l’annonce, simultanément à celle du site Internet destiné à coordonner les tests, que d’autres tests seraient menés, totalement indépendants des premiers. Leur réalisation serait confiée à une filiale d’Alphabet, Verily. On mobilisa alors en un temps très court un personnel considérable et on développa, en Californie, à New York, dans le New Jersey, dans l’Ohio ou encore en Pennsylvanie, des drive-throughs (testings d’automobilistes à leur volant) permettant un dépistage du Covid-19 efficace et sûr.
Il va de soi que les participants doivent remplir une sorte de test d’aptitude, répondre à des questions sur leur état de santé du moment, sur leur lieu d’habitation ou encore leur histoire sanitaire personnelle et qu’ils transmettent ainsi toutes sortes d’informations sensibles au testeur – et ce d’autant plus qu’au départ, avoir un compte Google était obligatoire pour participer au test… Tout cela s’accorde avec une philosophie d’entreprise où la plupart des services rendus ne sont que présumés gratuits. La devise de Google qui veut que « Sharing is caring » (« Partager, c’est prendre soin des autres ») – est particulièrement vraie en ces temps de coronavirus…
Avec sa rapidité de réaction, le conglomérat a donc apporté la preuve de sa capacité d’action, car, s’il n’avait pas réalisé entièrement la proposition de Trump, du moins il avait su la saisir au bond et lui conférer un fort impact médiatique. Enfin, il avait assumé souverainement ses responsabilités. Alphabet n’a pas attendu le coronavirus, en effet, pour concevoir la santé avant tout comme une question technologique, et donc un domaine où il a un marché à conquérir. La création de Verily a en effet permis d’avoir un spécialiste qui coordonne depuis 2018, avec le « Projet Baseline », des études à grande échelle ne promettant rien moins que de « redessiner le futur de la santé ».
Tantôt sont lancées dans ce cadre des recueils de données, sur quatre ans, auprès de 10 000 personnes porteuses de montres connectées de conception Google, tantôt des études sur des diabètes de type 2, sur la prévention des maladies cardiovasculaires aussi bien que mentales. On veut en savoir toujours plus sur les interactions entre le corps, l’environnement et le psychisme, étudier sur la base de données informatiques ce que signifie être sain ou malade, mais surtout développer de nouveaux produits et services. Le projet est tellement gigantesque qu’il n’est pas rare que le conglomérat parle d’une « révolution », une révolution qui, au nom de la santé publique, s’engagerait à toujours plus de mesures, toujours plus de financements pour des collectes de données toujours plus nombreuses et un tableau monopolistique toujours plus vaste. Dans le jargon de Google, cela se dit ainsi : « We’ve mapped the world. Now let’s map human health » (« Nous avons cartographié le monde. L’heure est venue de cartographier la santé humaine »).
Le testing du Covid-19 n’est d’ailleurs pas la seule réponse d’Alphabet à la crise du coronavirus. On recourt aussi aux voies conventionnelles de la cartographie et l’on génère via Google Maps, dans 131 pays, Suisse comprise, ce que l’on appelle des mobility reports. Sont utilisées ici, anonymisées et « agrégées », des données de localisation qui indiquent normalement la fréquentation d’un lieu donné, par exemple un restaurant à l’heure du déjeuner.
Ces données sont maintenant susceptibles d’être utilisées par les autorités pour pointer les « tendances dans les déplacements », localiser les zones à risque de l’épidémie et vérifier si la population se conforme ou non à l’impératif catégorique de « lisser la courbe » (flatten the curve), et reste confinée. Cette offre éminemment utile ne montre ainsi pas seulement avec netteté par exemple une augmentation de la fréquentation des parcs municipaux dans le canton de Berne, et le fait qu’il serait ou non « branché » de faire du télétravail à Genève ; le conglomérat apporte aussi le service d’un véritable outil administratif, ou les données recueillies fournissent des indications qui peuvent se transformer en réglementations nouvelles. En ce sens, est souverain celui qui a les meilleures cartes en mains.
Facebook : des données pour le Bien
Alphabet n’est pas le seul membre actif du « cabinet de crise technologique » à se soucier du bien-être des gens. Facebook lui aussi renoue dans l’état d’urgence avec sa propre fibre missionnaire, l’entreprise a conçu ces derniers temps non seulement un « Coronavirus Information Center » pour le fil d’actualité, mais a aussi combattu avec une détermination inédite les infox ou encore créé un nouveau émoticône, « coronavirus avec un cœur », pour promouvoir la solidarité automatisée. Le réseau social entend utiliser la « connectivité de la communauté » pour combattre le virus, et, avec la Carnegie Mellon University (CMU), cible des utilisateurs auprès desquels il promeut un questionnaire destiné à aider les chercheurs à établir des cartes géographiques hebdomadaires de symptômes cliniques qui ont été déclarés individuellement.
On espère ainsi toucher des millions d’utilisateurs. C’est seulement sur cette large base d’information – les données ne sont certes pas partagées avec Facebook, mais on peut se demander sur la base de quels critères Facebook choisit les participants potentiels – que l’on pense pouvoir renseigner sur l’état actuel des contaminations : « Ces informations peuvent aider les autorités sanitaires pour anticiper les besoins et planifier l’usage des moyens disponibles, et déterminer où et quand peut être entrepris le déconfinement de tel ou tel secteur de la population. »
Ces études sur des échantillons de masse peuvent être facilement perçues dans la situation présente comme étant uniquement un phénomène de crise. Mais qu’on ne s’y trompe pas : dans la Silicon Valley, elles sont depuis longtemps business as usual.
En sus du sondage quotidien, Facebook élargit encore son programme de « Disease Prevention Maps » (cartes pour la prévention des maladies). Le projet utilise données de géolocalisation et données de mouvements issus de l’utilisation des applications proposées par le groupe, et veut ainsi accroître « l’efficacité des campagnes sanitaires et la réaction aux épidémies » et a déjà été utilisé pour tracer le choléra au Mozambique ou pour contenir le virus Zika. Trois nouveaux outils, les co-location maps, les movement range trends et le social connectedness index, doivent à présent permettre d’évaluer dans quelle mesure les déplacements et les contacts sociaux de la population contribuent à la diffusion du virus, si les mesures de confinement prises ont un effet ou si de nouvelles mesures sont éventuellement nécessaires. Le slogan de l’encartage général est lui aussi très prometteur : Data for Good. Cela va de soi : on est ici engagé pour le Bien.
Mais il en va chez Facebook de beaucoup plus que de se positionner simplement en outil désintéressé des autorités sanitaires. Le cartographe de la sociabilité vise à étendre sa sphère d’influence et à se forger un véritable leadership. Si Mark Zuckerberg a fait don ces derniers temps de quelque 720 000 masques respiratoires à des institutions publiques et de 25 millions de dollars à la plateforme de recherche « Covid-19 Therapeutics Accelerator », ce n’est pas seulement pour se poser en philanthrope, caritatif autant que d’utilité publique. Son entreprise voit dans la crise une chance unique de développement, la chance de pouvoir passer d’un réseau social à une sorte de réseau de recherche scientifique, et se présente toujours plus comme l’infrastructure publique qu’elle a toujours voulu être : c’est-à-dire comme un élément essentiel du bon fonctionnement du système en l’état.
C’est pour cela qu’à côté de la CMU, on travaille au quotidien avec diverses institutions de santé, on cherche avec la New York University et le Mila Research Institute de Montréal comment utiliser des applications d’intelligence artificielle (IA) pour mieux préparer à la crise les hôpitaux et leur personnel. Par-delà cet investissement, on a aussi mis en place une ambitieuse « coalition internationale », le Covid-19 Mobility Data Network. Avec celle-ci, l’entreprise s’investit désormais dans une coopération qui à la fois confine au service de santé publique et est en même temps très calculée, avec la Harvard School of Public Health, la National Tsing Hua University à Taïwan, l’Université de Pavie en Italie ou la Bill & Melinda Gates Foundation. Le but avoué est, grâce aux « conclusions en temps réel obtenues à partir des Data for Good de Facebook », de déceler avec plus de précision le moment de la contamination et au bout du compte de produire des modélisations permettant de pronostiquer le déroulement de la crise. Bref : de transformer un futur indécis en un autre, probable.
Si des procédés analogues étaient surtout utilisés il y a encore quelques mois pour étudier les préférences des utilisateurs, prédire leur comportement de consommation et leurs déplacements afin de promouvoir une communication publicitaire basée sur le mouvement, la passion pour la collecte de données dans le cadre d’un capitalisme de la surveillance généralisée apparaît désormais sous un jour nouveau.
Car grâce à un management de crise requis dans des fonctions essentielles, que l’entreprise, dont l’image était sérieusement écornée, semble peu à peu se réhabiliter, savoir oublier toutes sortes de scandales dans le domaine de la protection des données et se produire à nouveau avec succès en sauveur presque magique de l’économie digitale. Comme l’écrit Mark Zuckerberg : « Le monde a été déjà confronté à des pandémies par le passé, mais cette fois nous avons une nouvelle superpuissance : la capacité à collecter et à échanger des données pour le Bien. »
Tout cela a aussi changé le regard porté sur le géant du numérique. Car bien qu’il ne soit nullement établi avec certitude que les cartes et les services sont d’une quelconque utilité dans la lutte contre le Covid-19, ils agissent comme une offre thérapeutique au puissant pouvoir de séduction. Une offre dont l’étendue consolide la position de monopole de l’entreprise et qui ravive ses ambitions. Et c’est ainsi que la crise fait l’effet pour Facebook d’une utile mise à jour du système, promettant de lui apporter une légitimité renouvelée.
Extension du domaine du tracking
Mais au-delà des analyses de données par l’entreprise, riches en perspectives, des expériences beaucoup plus concrètes sont actuellement menées en Californie. Elles visent à une autre proximité et relation au patient.
On travaille ainsi actuellement au Zuckerberg San Francisco General Hospital sur une façon de compenser le manque de testings à grande échelle en utilisant les technologies wearable. La bague « Oura » – une bague qui mesure aussi bien le rythme cardiaque que la fréquence respiratoire – vise à diagnostiquer les contaminations au coronavirus avant même que les symptômes soient ressentis. Les personnels des hôpitaux, les plus menacés du fait de leurs contacts permanents avec les personnes contaminées, sont équipés de cet appareil portable intelligent, qui ne les quitte pas, et transmettent des données intéressantes à un « système d’alerte précoce » particulièrement réactif. Le but de ce suivi en temps réel est de réagir plus rapidement à l’avenir, de sorte que les soignants développant la maladie puisse être identifiés plus tôt, contrôlés et soignés plus efficacement : cette bague est là pour les guérir, pour tous les détecter.
Dans l’étude « Detect » du Scripps Research Institute, on pense en dimensions encore beaucoup plus grandes, on cherche à élargir le plus possible le nombre de personnes testées. Dès lors le testing n’est pas associé à un unique wearable intelligent, mais à quasiment toute la palette des bracelets d’activité connectés – depuis le sobre Fitbit de Google jusqu’au très sophistiqué Apple Watch. Chaque auto-testeur peut participer pour autant qu’il vit aux États-Unis, et transmettre aux chercheurs ses données corporelles, en véritable scientifique citoyen, via l’application « MyDataHelps » (« Mes données aident »). Comme avec la bague « Oura », il s’agit ici aussi de détecter précocement des symptômes et de « resocialiser » des données individuelles en sorte que les foyers de contamination puissent être, là encore, mis en cartes, mieux localisées, délimités avec le plus de précision possible.
« Detect » fonctionne comme le remake d’une étude antérieure, parue dès janvier, qui étudiait ce qu’elle nommait le « real-time flu tracking » (traçage de la grippe en temps réel) via wearable auprès de quelque 200 000 porteurs d’appareils Fitbit. Par l’entremise de ce bracelet d’activité, étaient saisies des données sur le rythme cardiaque et le sommeil grâce auxquelles, selon les conclusions de l’étude, il était possible d’améliorer de manière significative les pronostics par rapport aux moyens existants. Certes, le traçage n’était pas convaincant de bout en bout – par exemple, les données du sommeil manquaient de précision, et l’on ne pouvait pas vraiment distinguer entre l’accélération du pouls dû à une infection grippale et celui dû au stress quotidien. Les auteurs n’en soulignaient pas moins l’énorme potentiel de la technologie wearable, dont la diffusion accrue devait rendre rapidement possible une surveillance continue sur une plus vaste échelle, et plus précise dans le temps. Rien qu’en Suisse, un petit cinquième de la population est d’ores et déjà utilisateur de wearables, et la tendance ne fait que s’accentuer.
C’est justement ce potentiel que l’étude « Detect » cherche à présent à traduire dans la réalité, on élargit avec les variables biométriques – type activité quotidienne – la profondeur de champ de la surveillance et c’est ainsi que le site internet peut déclarer avec optimisme : « Vous êtes désormais en mesure de pouvoir de prendre le contrôle de votre santé, de même que les soignants du système public de santé peuvent stopper l’émergence d’une maladie de type grippal dans des communautés relativement grandes ».
Avec l’acceptabilité accrue, par le Covid-19, du partage solidaire des données, l’individu quantifié mute vers le collectif quantifié. La saisie, l’analyse et le contrôle ininterrompus de données sensibles sont présentés comme un champ d’études innovant, comme une prise de pouvoir de la collectivité. Ainsi, autocontrôle et contrôle social sont indéfectiblement liés.
Ce qui pouvait être encore perçu avant le coronavirus comme une surveillance abusive, se présente désormais comme l’établissement d’une cartographie de la santé sur un mode participatif et aux fins de la recherche. Une recherche qui lie de plus en plus ses avancées à des appareils intelligents, dont l’utilisation est – de plus en plus – à portée de mains.
Apple : au service de l’humanité
Ces études sur des échantillons de masse via wearable peuvent être facilement perçues dans la situation présente – la Stanford University elle aussi a encore récemment lancé une étude liée au Covid-19 – comme étant uniquement un phénomène de crise. Mais qu’on ne s’y trompe pas : dans la Silicon Valley, elles sont depuis longtemps business as usual.
S’opère aussi un déplacement de souveraineté : le quotidien devient le laboratoire expérimental des entreprises, la vie elle-même n’est plus qu’une expérience de mesure intelligente (« smart »). On assiste à la systématisation toujours plus insistante de ce que l’on peut appeler une biopolitique en cours de datafication
Si Google entend mesurer la santé, via wearables, Apple, lui, s’exerce tout particulièrement depuis ces derniers temps au mode du laboratoire expérimental transportable. En développant sa Smartwatch et son « Research App », Apple a exploré de nouveaux champs de recherche entrepreneuriaux. Chacun a pu, dès avant la pandémie, participer à des études sanitaires de grande ampleur grâce à la sensorique connectée et au Big Data – des études allant des capacités auditives jusqu’au suivi de la menstruation-, chacun a pu mettre ses données à la disposition de toutes sortes d’universités, hôpitaux ou institutions comme l’OMS. Toute une infrastructure, reliant l’individu via wearable à la grande marche du monde et promettant de nouvelles avancées scientifiques, des produits d’avenir, et peut-être surtout une importance individuelle : « The future of health research is you » (« Le futur de la recherche médicale, c’est vous »).
Il n’est guère étonnant que l’Apple Watch soit aujourd’hui considérée comme un élément essentiel de nombreuses études sur le Covid-19. Que son contrôle d’activité d’avant-garde soit particulièrement coté. Et que la pandémie, comme l’a expliqué récemment le directeur des opérations d’Apple, Jeff Williams, rende indispensable plus rapidement de nouvelles fonctionnalités d’Apple Watch comme l’instrument de cardiométrie intégré. Tout ceci donne à penser que la « solution » en propre d’une étude Apple sur le Covid-19 n’est elle aussi vraisemblablement qu’une question de temps.
Dès maintenant, on ne reste pas inactif. Le président (CEO) d’Apple Tim Cook conseille le président américain, réorganise des chaînes de livraison, conçoit des visières de protection pour le personnel soignant et, à l’instar de Google, produit grâce à son propre système de cartes des rapports de mobilité pour l’administration. Ainsi Apple, qui considère que ses missions dans le secteur de la santé « ne sont pas limitées au poignet », se met-il lui aussi intégralement au service de la cause, et veut utiliser les vents favorables pour lancer de nouveaux services et applications : ce que Cook proclamait dès janvier 2019 est plus que jamais valable : « Si l’on demandait un jour ce qui aura été le plus grande contribution d’Apple à l’humanité, il n’y aura qu’une réponse possible : la santé. »
Qui a suivi ces derniers mois les recherches d’Apple et de Google dans le secteur médical ne sera guère surpris par la nouvelle récente de leur collaboration en matière de traçage des contacts. En bonne logique, sans attendre que les acteurs publics s’acquittent de leurs obligations, les deux multinationales présentent leur propre « solution globale » – en bons promoteurs de la « technocratie directe » qu’elles sont. L’infrastructure, qui est prévue pour toutes sortes d’applications de traçage, mise sur une approche décentralisée, se présente de ce fait comme plus égalitaire et « progressiste » que les systèmes centralisés – que finalement elle exclut complètement du jeu ! Que les multinationales, avec l’impact considérable qui est le leur sur le marché, créent ainsi une norme désormais incontournable, qu’elles généralisent et standardisent leur « solution » (le Chaos Computer Club parle de « diktat ») n’est dès lors qu’une sorte d’élégant effet secondaire.
On a ainsi conscience dans la Silicon Valley, en ces temps qui semblent totalement débridés, que l’heure est venue, on parle à nouveau sur un ton pénétré et l’on use à plein de son pouvoir de décision – utilisateurs de smartphones de tous les pays, unissez-vous ! Bien sûr, il n’y a « jamais eu moment plus important » pour Apple et Google, pour aider à sauver le monde « avec la force de la technologie », pour le remettre sur pieds selon ses idées bien arrêtées. Mais il y a rarement eu plus de disponibilité, ou plus exactement plus de nécessité, à les croire. À être obligé de les croire.
Biopolitique en voie de datafication : la santé comme prestation de service
Les crises engendrent nécessairement des espaces de décisions, un afflux temporaire d’une série de potentialités différentes, où il en va du tout ou rien, du succès ou de l’échec. Que les entreprises géantes de la Silicon Valley aient la décision facile, que certaines d’entre elles soient fermement assurées par temps de crise, elles l’ont fréquemment démontré au cours de ces dernières années. Avec la pandémie, la forme si particulière de résilience qui a cours en Californie se montre une nouvelle fois au grand jour.
On aura rarement pu observer plus clairement avec quelle rapidité les différents acteurs arrivent à s’adapter, usent de leurs infrastructures, voire les réorientent entièrement, pour se présenter en sauveurs incontournables, en outils de la lutte contre la crise – en somme : pour se réinventer.
Il n’étonnera guère qu’à cette occasion, du don’t be evil de Google au bringing the world closer together de Facebook, de vieux récits soient – avec talent ! – remis au goût du jour, que le solutionnisme trouve de tous côtés une nouvelle légitimation et que la connectivité se déploie toujours plus. Reste que tout cela est lié à des risques et des effets secondaires non négligeables.
Car de toute évidence, n’entrent pas seulement dans les potentialités des multinationales l’idée, louable en soi, de la lutte contre la crise, ou du soutien massif à la santé, à travers toutes sortes de partenariats public-privé. En elles s’opère aussi, insidieusement, clandestinement, un déplacement de souveraineté : le quotidien devient le laboratoire expérimental des entreprises, la vie elle-même n’est plus qu’une expérience de mesurage intelligent (« smart »). On assiste à la systématisation toujours plus insistante de ce que l’on peut appeler une biopolitique en cours de datafication.
Les acteurs d’État comme les acteurs privés ont compris depuis longtemps que le vieil outil biopolitique – statistiques périodiques ou valeurs moyennes évaluées par cycles – était aujourd’hui tout à fait suranné. Que, si l’on voulait maintenir en état de fonctionner le corps des individus, et plus encore le corps social, on avait besoin de mécanismes plus individualisés, de cartes plus parlantes et d’appareils plus « friendly ». Les sauveurs chamaniques de la Silicon Valley prennent ce qui ressort des fonctions régaliennes de l’État pour le ramener à leurs prestations de service, ils développent des instruments essentiels de politique sanitaire et, par le fait qu’ils se déclarent eux-mêmes « institutions de recherche », engrangent un fabuleux surcroît de compétence. Ainsi l’individu évolue-t-il toujours davantage, sous le signe de la santé, dans des espaces mesurés, ainsi ses données de mobilité et de contact sont-elles traquées et sondées en temps réel : son état de santé, son pouls ou son rythme de sommeil sont soumis à une surveillance de tous les instants. Que disait déjà le slogan du « Research App » d’Apple ? « Humanity says thank you » (« L’humanité vous dit merci »).
Ce qui semble pendant la crise tout à fait compréhensible, et même, dans quelques cas, raisonnable, crée rapidement un nouvel état de fait. Une réalité dans laquelle l’intrusion sur le mode monopolistique de la technologie numérique va si loin dans le monde de la vie et de l’expérience qu’elle finit par développer une force normative : le moment arrive où elle ne se content plus de seulement décrire ce qui est. Mais aussi ce qui devrait être.
Peut-être ne devrions-nous donc pas dire aussi inconsidérément « I want to thank Google », ni concevoir la crise comme un problème qui n’attend que l’intelligence artificielle pour être résolu. Nous devrions urgemment jeter aussi un coup d’œil à la notice jointe de la thérapeutique de surveillance capitaliste.
Les auteurs :
Anna-Verena Nosthoff est essayiste, philosophe et politologue. Elle enseigne à l’Université de Vienne, la Freie Universität de Berlin et était ces derniers temps « Research fellow » au Weizenbaum Institut pour la société connectée. Felix Maschewski est essayiste, économiste et enseigne à la Freie Universität de Berlin. Récemment est paru leur ouvrage commun « Die Gesellschaft der Wearables – Digitale Verführung und soziale Kontrolle » (« La société des wearables – Tentation digitale et contrôle social ») aux Éditions Nicolai-Verlag de Berlin.
Cet article est paru en allemand dans la revue Republik : https://www.republik.ch/2020/05/09/wie-big-tech-die-pandemie-loesen-will.