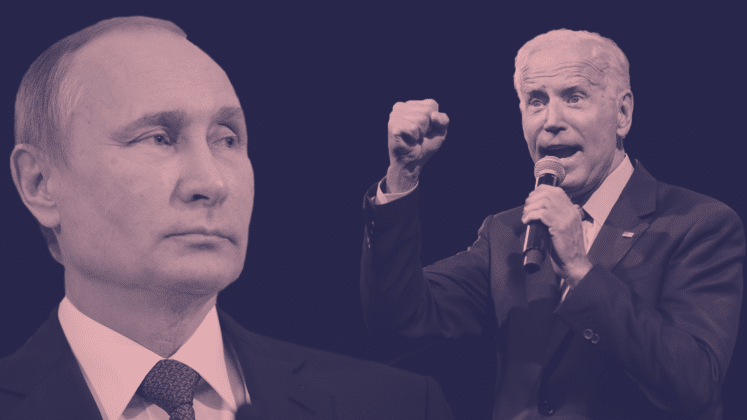La City est à la fois un quartier d’affaires, une entité administrative à part et une instance de représentation des intérêts de la finance britannique. Selon l’ancienne et éphémère Première ministre Liz Truss, elle est un « joyau de la Couronne ». Mais elle pourrait tout autant s’avérer être une malédiction pour l’économie britannique. Reportage au cœur du centre d’affaires londonien.
Des employés grisonnants d’une compagnie d’assurance britannique se lançant, tels des pirates, sur les hautes mers de la finance internationale : ainsi débutait Le Sens de la vie, film des Monty Pythons sorti sur les écrans en 1983. L’immeuble néo-baroque de la compagnie, transformé en navire, jetait l’ancre depuis la City de Londres et partait à l’abordage des gratte-ciels new-yorkais. Une allégorie burlesque de l’époque où la vénérable finance britannique se retrouvait plongée dans le grand bain de la mondialisation financière.
Quarante ans plus tard, c’est un tout autre paysage qui se présente au regard des promeneurs dans les rues du cœur historique de Londres. Les bâtiments victoriens ont fait la place à un faisceau de gratte-ciels modernes, dont les formes ont inspiré aux habitants des surnoms facétieux – le « Cornichon », le « Scalpel » ou encore la « Râpe-à-fromage ». Depuis la Tamise, la ligne d’horizon de la City évoque désormais celle des plus grands quartiers d’affaires internationaux. Et pour cause : la densité de banques et d’institutions financières au mètre carré y atteint des records.
Les chiffres donnent le tournis : avec près de 250 établissements, Londres représente la plus grande concentration de banques étrangères, surpassant les centres financiers de New York ou de Singapour. Près de la moitié des opérations mondiales de change (43%) ont lieu à Londres, où il s’échange deux fois plus de dollars… que sur les marchés de change américains1. Le tout sur d’une superficie d’un mile au carré – d’où le surnom de Square Mile attribué à la City – à laquelle il convient d’ajouter l’enclave plus récente de Canary Wharf, qui borde la Tamise plus à l’Est. Chaque jour de la semaine, une foule cosmopolite en costume et tailleur remplit dans les rues, les bureaux et les pubs des quartiers d’affaires londoniens. Près de 420 000 personnes y travaillent dans le secteur des services financiers. Une population supérieure à celle de villes comme Bordeaux ou Montpellier.
Avec près de 250 établissements, Londres représente la plus grande concentration de banques étrangères, surpassant les centres financiers de New York ou de Singapour.
Malgré ses allures modernes de quartier d’affaires international de premier plan, la City est également le centre historique de Londres. L’assemblage entre buildings modernes et édifices multiséculaires y surprend. Au croisement de Leadenhall Street et de Saint Mary Axe s’élancent cinq tours gigantesques dont le Lloyd’s building, à l’architecture industrielle évoquant le centre Pompidou2, et le futuriste Gherkin – le fameux « Cornichon ». Et puis, au milieu de ce décor gigantesque, une petite église du XVIe siècle semble s’être égarée. Plus loin, à une centaine de mètres à peine, l’ancien marché victorien de Leadenhall daté du XIVe siècle – l’un des plus vieux de Londres – accueille désormais restaurants et pubs qui égayent les afterwork des travailleurs de la finance. Il jouxte les travaux du prochain gratte-ciel, 40 000 m² de bureaux à la clé, dont l’achèvement est prévu en 2024.
Ce mélange étonnant n’a rien d’une simple curiosité. Il est une clé de compréhension du pouvoir économique, politique et symbolique concentré au fil des siècles dans le périmètre de Square Mile. La City a plusieurs visages : elle est à la fois un quartier d’affaires accueillant les banques du monde entier, et l’ancien cœur historique de l’Empire britannique. Infrastructure essentielle de la finance mondiale, elle abrite également des institutions d’origine moyenâgeuse dont l’influence s’étend bien au-delà du Royaume-Uni. De quoi La City est-elle donc le nom ? Pour le comprendre, un premier détour par l’histoire semble inévitable.
L’âge d’or de la finance londonienne
Aujourd’hui encore, les traces de l’époque où la City émergeait déjà comme un des moteurs du capitalisme mondial sont encore présentes dans le quartier d’affaires. Notre premier rendez-vous nous mène dans le quartier de Cornhill où, perdu dans un dédale d’allées médiévales, se tient un pub plébiscité par la faune locale. Il occupe la place de ce qui fut au XVIIe siècle la Jamaica Coffee House, un café dont le nom évoquait une des premières colonies britanniques des Caraïbes. « Il n’y avait alors qu’un simple étal où l’on servait le café » explique Nick Dearden, directeur de l’organisation Global Justice Now, qui accepté de nous servir de guide. « Puis les coffee houses sont devenus des lieux spécialisés pour discuter des affaires, en particulier des allées et venues des navires marchands ».
Le développement de la finance londonienne avait alors partie liée avec celui du commerce colonial. Au XVIIe siècle, le financement des expéditions vers les Indes orientales ou des Amériques était une activité aussi risquée que lucrative. Les investisseurs avaient la possibilité de ne prendre qu’une simple participation à ces expéditions. « Si le navire revenait, le profit était partagé. Et bien sûr dans le cas contraire, la mise était perdue » explique Dearden. Les biens produits dans les plantations esclavagistes, comme le tabac, le café ou l’indigo, étaient prisés en Europe. Mais c’est tout particulièrement le sucre, considéré comme un véritable « or blanc », qui a alimenté par son succès la machinerie financière coloniale. À Londres, sucre et café étaient consommés dans des établissements comme le Jamaica Coffee House, à l’endroit même où se discutaient les prochaines affaires. Le commerce d’esclaves était également une activité lucrative, sur laquelle la Compagnie royale d’Afrique, basée à La City, a longtemps régné en maître.
Le commerce de produits coloniaux et d’esclaves a contribué à faire la fortune des banquiers de la City, qui finançaient marchands et investisseurs.
Le commerce de produits coloniaux et d’esclaves a contribué à faire la fortune des banquiers de la City, qui finançaient marchands et investisseurs. Plus tard, d’autres négoces prendront le relais, comme celui de l’opium. L’accumulation de capital dans le centre de Londres est allée de pair avec le développement d’une diversité de services financiers et juridiques, comme le courtage d’actions. Les entreprises coloniales – comme la puissante Compagnie britannique des Indes orientales, la Compagnie des mers du sud ou encore la Compagnie royale d’Afrique – émettaient des participations sous forme papier. Souscrire ou acheter les actions de ces entreprises était d’autant plus lucratif qu’elles bénéficiaient, par l’intermédiaire d’une charte royale, de monopoles d’exploitation sur des marchés ou zones géographiques. Et de la protection de la flotte royale britannique, la Royal Navy. Investisseurs et courtiers avaient l’habitude de se retrouver dans les coffee houses, qui étaient « autant de petites places boursières », explique Dearden.
Une autre activité financière va se développer dans le sillage du commerce colonial : celle des assurances. Un autre café londonien, situé à Tower Street, servait alors servait de lieu de rencontre pour les marchands, capitaines et propriétaires de navires. Ces derniers pouvaient souscrire des contrats pour se couvrir contre d’éventuelles pertes auprès d’un club d’investisseurs connu sous le nom de Lloyd’s market, du nom du tenancier de l’établissement, Edward Lloyd. Par la qualité de ses informations et services, Lloyd’s market a rapidement gagné de la notoriété au point de devenir une référence en termes d’assurance maritime. Au XVIIIe siècle, Lloyd’s était déjà l’assureur de prédilection des marchands européens, y compris espagnols et français. Aujourd’hui, il s’agit de la plus grande bourse aux assurances du monde, et un des plus grands acteurs mondiaux du secteur de l’assurance. Son siège se situe dans la tour de Lloyd’s qui s’élance depuis Leadenhall Street, à l’endroit même où se situait la East India House, le quartier-général de la Compagnie orientale des Indes britanniques, et non loin de l’emplacement de la Africa House, le siège de la Compagnie Royale d’Afrique. « Cela montre l’interconnexion entre le développement de l’Empire britannique et celui de la City comme puissance financière naissante » résume Dearden.
Le « second Empire britannique » et le rôle de la Banque d’Angleterre
Notre second rendez-vous nous mène non loin de Leadenhall Street, devant le siège de la Banque d’Angleterre (la « Vieille Dame ») dont le colossal bâtiment a été achevé en 1833. Nous évoquons avec Nicholas Shaxson et John Christensen, respectivement journaliste et économiste spécialistes de la finance britannique, une autre période cruciale dans l’évolution de La City : les décennies qui suivirent la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les nuages s’accumulaient alors au-dessus de la place financière londonienne. Les contrôles des capitaux et des changes mis en place par les accords de Bretton Woods remettaient en cause l’essence même de la finance britannique. « Avant leur mise en place à partir de 1946, les financiers de La City étaient en mesure d’opérer dans le monde entier », explique Christensen. « Les accords de Bretton Woods ont sévèrement restreint les mouvements d’argent à l’échelle internationale ».
La décolonisation, imposée au Royaume-Uni à partir de 1947, constituait une seconde menace existentielle. « La City était le cœur financier de l’Empire britannique » explique Shaxson. « Elle a commencé à perdre son rang avec le déclin de l’Empire ». La crise du Canal de Suez, en 1956, marque la perte d’influence du Royaume-Uni sur la scène mondiale. Le retrait des troupes d’Égypte va aller de pair avec d’importantes sorties de capitaux et une spéculation fragilisant la clé de voûte de l’influence britannique : la livre sterling. Pour permettre à la place de Londres de retrouver son rang dans le nouvel environnement financier mondial, les financiers de la City vont dès lors développer, aux marges de l’ancien Empire, une véritable industrie de la dissimulation et du recel de capitaux. Un réseau offshore qui a posé les bases du système financier moderne3.
Pour permettre à la place de Londres de retrouver son rang dans le nouvel environnement financier mondial, les financiers de la City vont développer, aux marges de l’ancien Empire, une véritable industrie de la dissimulation et du recel de capitaux.
La première opportunité va prendre la forme d’un vide réglementaire laissé – à dessein ? – par la Banque d’Angleterre. Celle qui se nommait Banque de la City de Londres, nationalisée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, était censée remplir le rôle d’autorité de supervision bancaire. Mais à ses yeux, les activités des banques pour le compte de clients non-résidents et en devise étrangère ne relevaient pas de sa juridiction : ces opérations se déroulaient simplement… « ailleurs ». La porte était ouverte pour que les transactions réalisées en dollars par les banques de La City échappent à toute supervision ou contrôle. C’est ainsi que fut créé le marché des Eurodollars de Londres : un marché où s’échangent et se prêtent des dollars offshore – hors du contrôle des autorités étatsuniennes et affranchi de tout contrôle de capitaux. Autrement dit, un marché de devises complètement dérégulé, qui a attiré à partir des années 1960 des détenteurs de dollars et des banques du monde entier – y compris américaines. Il offrait à ces dernières la perspective de profits élevés et la possibilité d’échapper aux régulateurs nationaux, d’accéder à de nouveaux clients et de nouveaux emprunteurs à l’échelle internationale.
L’afflux d’Eurodollars à Londres va aller de pair avec la création, par les institutions de La City, de filiales dans plusieurs juridictions britanniques d’outremer comme les îles Caïmans, les Bermudes ou encore les îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey. « Ces institutions vont y créer de toute pièce des centres financiers offshore proposant une garantie solide de secret financier » explique Shaxson. L’objectif ? Attirer ainsi dans ces anciennes marges de l’Empire britannique les capitaux de « non-résidents » en quête de discrétion : pétrodollars du Moyen-Orient ou d’URSS, pactole des cartels de la drogue, revenus de tous types de trafics, évasion fiscale… Ces capitaux offshore n’étaient pas seulement soustraits au contrôle des Etats : ils pouvaient être recyclés – ou blanchis – sans difficulté par les institutions de la City via le marché des Eurodevises.
La connexion entre le centre financier de Londres et une myriade de juridictions d’Outre-mer – désignés plus tard comme paradis fiscaux – va constituer le socle de l’expansion exponentielle de la finance offshore. Ce « second Empire financier », selon le terme de Nicholas Shaxson, n’aurait pas pu voir le jour sans le soutien tacite de la Banque d’Angleterre. Avec ses allures de forteresse impénétrable, située au centre géographique de Square Mile, elle semble aujourd’hui encore veiller sur le quartier d’affaires. « La banque d’Angleterre est demeurée loyale envers les institutions de la City » note Christensen, « son personnel est d’ailleurs souvent issu de ces mêmes banques ». La « Vieille Dame » n’a pas seulement rendu possible la création du marché des Eurodollars, elle a accompagné le développement de la finance offshore, considéré avec bienveillance. Dans un rapport confidentiel daté de 1969, la Banque affirmait n’avoir « pas d’objection » à l’accumulation des capitaux offshore – tant que les paradis fiscaux n’étaient pas employés à des fins de fuite de capitaux britanniques.
Dans la concurrence avec New York, la complaisance de la Banque d’Angleterre – et des autorités britanniques – à l’égard des activités financières les plus suspectes a été un des atouts de la place de Londres. « Au Royaume-Uni, aucun banquier ne va en prison, les banquiers sont une espèce protégée », explique Shaxson. « Cela fait partie intégrante du modèle de business offshore : vous transférez vos capitaux chez nous et nous vous laisserons libres d’agir comme bon vous semble, sans risque de poursuites ». A cela s’ajoute la tradition réglementaire britannique laissant une place importante à l’informel et aux réseaux de sociabilité. Dans les années 1970, en guise de supervision, les banquiers étaient de temps en temps invités à la Banque d’Angleterre pour prendre le thé et expliquer leurs activités, comme le rapporte l’historien David Kynaston4.
À partir des années 1980, cette tradition de « réglementation légère » va prendre la forme d’un élan de dérégulation du secteur financier, sous l’égide de Margaret Thatcher. C’est le « Big bang » de 1986, qui va faciliter davantage l’installation de banques étrangères et supprimer les obstacles réglementaires au développement exponentiel du marché des services financiers. Le succès de la place financière de Londres ne s’est pas démenti depuis : le Royaume-Uni est désormais le premier exportateur mondial de services financiers, avec plus de 60 milliards de livres de surplus5.
La Corporation : une « vénérable institution »
Cet essor, ou plutôt ce renouveau de La City comme place financière mondiale n’aurait pas été possible sans de solides relais au sein de l’élite politique et administrative du Royaume-Uni. Depuis des siècles, la finance britannique est organisée pour défendre ses intérêts au plan national et international. Une institution incarne tout particulièrement l’influence et le prestige dont les financiers de Square Mile sont les dépositaires : la Corporation de la City de Londres (City of London Corporation). C’est à son siège que nous mène notre prochain rendez-vous.
À quelques rues seulement de la Banque d’Angleterre se tient le Guildhall, sorte d’hôtel de ville de La City, qui expose fièrement sa façade néo-gothique. De l’édifice original remontant au XVe siècle, seules quelques salles demeurent, dont le cérémonial Great Hall où l’on peut entrevoir, nichée dans une alcôve, la statue de Winston Churchill. Le reste du bâtiment a été plusieurs fois reconstruit après le grand incendie de 1666 et après les bombardements de la seconde guerre mondiale. Le Guildhall abrite également des restes du mur d’enceinte de la cité de Londres datant du XIe siècle ; ainsi que les vestiges de l’amphithéâtre de l’ancienne colonie de Londinium, ancienne capitale de la Bretagne romaine fondée en l’an 43.
Ici se tiennent les bureaux de la Corporation de la City. Cette institution d’origine médiévale remplit aujourd’hui encore le rôle de gouvernement local. Mais ses prérogatives sont bien plus larges que celles d’une simple municipalité. « Nous sommes en charge du gouvernement de Square Mile, mais également de défendre les intérêts de la City auprès des gouvernements et de représenter et promouvoir l’ensemble du secteur financier britannique », nous explique Chris Hayward. Dans son costume-cravate parfaitement ajusté, l’affable Policy Chairman de la Corporation – l’équivalent de chef de l’exécutif local – semble tout droit sorti d’un conseil d’administration de grande entreprise.
Sous des dehors parfois saugrenus, la Corporation apparaît ainsi pour ce qu’elle est : une instance de représentation de la finance.
Pour expliquer cet étrange mélange des genres entre les fonctions d’un conseil municipal et celle de représentation du secteur financier, Hayward évoque l’histoire de la Corporation de la City. Celle-ci ne remonterait pas moins de dix siècles en arrière. Entré en vainqueur dans Londres en 1066, le roi normand Guillaume le Conquérant aurait consenti à reconnaître le statut à part de la cité marchande – dont les anciens remparts dessinent aujourd’hui les limites de Square Mile – par l’adoption d’une charte royale. Ces droits et privilèges associés seront perpétués et parfois étendus au fil des siècles par les monarques, soucieux de ne pas s’aliéner les commerçants et financiers londoniens, source précieuse de prêts et de fonds pour la couronne britannique.
Les hôtes de Guildhall ne manquent pas de vanter les vertus démocratiques du fonctionnement de la Corporation, hérité du Moyen-Âge. A l’attention des visiteurs est exposé un exemplaire original de la Magna Carta de 1297, qui réaffirme les libertés accordées par la royauté aux marchands et artisans londoniens. Un document considéré par certains historiens comme une des premières pierres de l’Etat de droit. « La Corporation est la plus ancienne démocratie du monde » s’enthousiasme ainsi Hayward. Une démocratie en réalité bien singulière. Car si des élections municipales sont bien organisées tous les quatre ans, elles intègrent parmi les votants les représentants des entreprises actives dans la City en proportion de leurs effectifs. Les quelques 9000 résidents de Square Mile peuvent également voter, mais ils représentent une minorité des 20000 électeurs qui se sont prononcés aux dernières élections de mars 2022. En d’autres termes : ce sont bien les plus grands groupes financiers de la City qui dominent les élections du conseil de la Corporation.
Le système électoral de la City repose par ailleurs sur la cooptation : pour candidater à l’équivalent du conseil municipal, il est nécessaire de bénéficier du statut de « citoyen libre » (freeman of the City). Cet acte de citoyenneté garantissait jadis différents droits, comme celui de participer aux élections et de faire des affaires au sein de la cité. La voie traditionnelle pour l’obtenir implique d’être coopté par plusieurs dignitaires de la Corporation, ou par les représentants d’une de ses 110 guildes médiévales (livery companies). Ces anciennes associations de marchands et artisans participent encore activement au fonctionnement de la Corporation6. Certaines fonctionnent encore comme d’authentiques associations professionnelles, mais la plupart – dont les métiers ont disparu – remplissent désormais un rôle de sociabilité au sein de la bonne société de Square Mile, et d’organismes caritatifs7. C’est le cas, par exemple, de la vénérable compagnie des fabricants de souliers en bois (Worshipful Company of Pattenmakers), dont Hayward était le grand-maître avant d’être nommé Policy Chairman.
Une puissante instance de représentation de la finance
Sous des dehors parfois saugrenus, la Corporation apparaît ainsi pour ce qu’elle est : une instance de représentation de la finance. Et son pouvoir est loin d’être symbolique. Depuis ses origines, la Corporation a accumulé une richesse, une influence et un prestige uniques dans l’histoire britannique. « Elle est à la fois ce vestige étrange de traditions d’un autre temps et une des forces motrices du capitalisme britannique » explique Owen Hatherley, essayiste et spécialiste de l’urbanisme londonien. La Corporation bénéficie encore de nombreux privilèges : outre ses compétences municipales en termes de services publics et de développement urbain, elle bénéficie d’une exemption qui lui permet de définir son propre taux d’imposition des entreprises. La Corporation dispose aussi de sa propre police, indépendante de la police métropolitaine de Londres.
Ses ressources financières sont par ailleurs considérables. « La Corporation est incroyablement riche, elle est de loin la collectivité la plus riche du Royaume-Uni » explique Hatherley. Le City’s Cash est un fonds municipal destiné à gérer le patrimoine de la Corporation. En 2021, ses actifs étaient estimés à 3,4 milliards de livres. Les terrains et biens immobiliers détenus à travers le City’s Cash représentent près de 2 milliards de livres, et les placements gérés via des fonds d’investissement 932 millions de livres8. S’y ajoutent d’autres propriétés gérées par un second fonds, le City’s Fund, dédié au prélèvement des taxes et à la gestion des services municipaux9. En 2013, le patrimoine immobilier de la Corporation était estimé à 579 278 m² à Londres et au-delà (Essex, Kent, Surrey, Buckinghamshire) dont près de 80 000m² de bureaux10.
La Corporation n’est pas seulement un des plus grands propriétaires terriens de Londres… Elle est aussi l’autorité de planification urbaine de Square Mile. Et son urbaniste en chef de 1985 à 2014, Peter Rees, a largement contribué à façonner le quartier d’affaires. « C’est à son goût pour le “paysage urbain” que l’on doit cet assemblage artificiel de gratte-ciels modernes dans des allées médiévales » explique Hatherley. « Les promoteurs présentent leur projet et la Corporation décide s’il est conforme à ses lignes directrices en matière d’architecture ». Les gratte-ciels doivent par exemple éviter certains « couloirs » de sorte à ne pas obstruer la vue sur le dôme de la Cathédrale Saint-Paul. Pour autant, « mis à part quelques bâtiments médiévaux, tout peut être détruit et reconstruit. Le centre-ville évolue à une grande vitesse, on est plus proche de ce qui se fait à Hong-Kong ou Singapour ». L’architecte du « Gherkin », Ken Shuttleworth, n’hésite pas à comparer l’impact de l’urbaniste de la Corporation à celui… des bombardements allemands de la Seconde Guerre mondiale : « Il n’existe pas de forces qui aient eu plus d’impact sur la ligne d’horizon de Londres que la Luftwaffe et Peter Rees11 ».
Pour mener à bien sa mission de promotion de la finance, la Corporation peut compter sur un autre atout : son propre représentant à la Chambre des communes. Ce lobbyiste-en-chef, le Remembrancer, est autorisé depuis 1685 à siéger en observateur dans la chambre basse du Parlement britannique pour y défendre les intérêts de la City. Il dirige une équipe de juristes passant en revue les projets de lois débattus à la Chambre des communes qui pourraient affecter le secteur financier britannique. Le Remembrancer et les autres dignitaires de la Corporation ont à leur disposition les ressources financières du City’s Cash : le budget annuel dédié à leurs activités s’élevait à 13,7 millions de livres en 2021. Un montant supérieur aux dépenses du plus important lobby financier à l’échelle de l’Union européenne, la puissante Association for Financial Markets in Europe (AFME). Cette enveloppe annuelle couvre les dépenses du Remembrancer ; les frais de représentations du Lord Mayor, maire de la City et véritable ambassadeur de la finance londonienne à l’échelle nationale et internationale ; et les dépenses du Policy Chair, à la tête de l’exécutif local.
Quand La City détermine l’agenda du gouvernement
Dans le sillage de la crise financière mondiale, la vénérable Corporation de La City a contribué, en 2010, à doter le secteur financier d’une vitrine plus « moderne ». TheCityUK est un lobby créé avec la bénédiction du travailliste Alistair Darling et du conservateur Boris Johnson, qui étaient alors respectivement ministre des Finances et maire de Londres. C’est dans les bureaux de ce porte-voix de la finance britannique que nous poursuivons notre enquête, dans un immeuble élégant d’à peine cinq étages situé en plein dans le cœur de la City.
Son représentant, Jack Neill-Hall, est un fringant trentenaire à la barbe ciselée et aux lunettes épaisses. Son allure évoque moins l’image d’un financier ancienne école que celle du jeune cadre dynamique. Nous évoquons avec lui le rôle de son organisation, et l’agenda du secteur financier de La City. « Notre organisation est une sorte d’ONU de la finance britannique », plaisante-t-il entre deux gorgées de café. Dans son conseil de direction se côtoient les représentants de la finance mondiale, représentatifs de la diversité des groupes qui occupent Square Mile : les américains JP Morgan, Goldman Sachs et BlackRock ; les britanniques HSBC, Barclays, Citigroup et Lloyd’s ; et les françaises Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole et Axa ou encore la Deutsche Bank et la japonaise Nomura. Sans compter les consultants Ernst and Young, KPMG, PwC et les représentants de la Corporation de la City12.
« Nous permettons aux entreprises du secteur d’échanger et de s’exprimer d’une seule voix dans les périodes de crise » explique Neill-Hall. Il faut dire que les secousses n’ont pas manqué ces dernières années. En particulier, celles liées au Brexit. « C’est déjà de l’histoire ancienne » balaie Neil-Hall. « Nous sommes allés de l’avant depuis : le paysage a évolué, l’industrie s’est adaptée ». TheCityUK a pourtant longtemps été un acteur majeur dans les discussions sur la réglementation financière à l’échelle de l’Union européenne. Raison pour laquelle la majorité du secteur financier, à l’exception de quelques richissimes propriétaires de fonds spéculatifs, était opposée au Brexit. « Depuis des décennies, la City et ses bataillons de lobbyistes ont contribué à façonner le débat réglementaire à Bruxelles » explique Kenneth Haar, spécialiste du lobbying au sein de l’Observatoire de l’Europe Industrielle (Corporate Europe Observatory). « Le dernier Commissaire européen du Royaume-Uni avant le Brexit, Jonathan Hill, était d’ailleurs lui-même un ancien lobbyiste de TheCityUK ».
Pour Neil-Hall, l’enjeu consiste désormais à saisir de l’opportunité offerte par la séparation avec l’UE : celle de remettre en cause les standards européens jugés trop prescriptifs, et d’adopter une réglementation « souple » et « sur-mesure » pour l’industrie britannique. Le Brexit pourrait s’avérer à cet égard une opportunité pour demeurer « compétitif » dans un marché mondial toujours plus turbulent. « L’UE est comme un super tanker, énorme et difficile à manœuvrer » avance Neill-Hall, « alors que le Royaume-Uni est désormais un navire d’une envergure certes moindre mais plus facilement manœuvrable. » Et de filer la métaphore navale : « Dans un monde où les affaires et les vents changent à une allure folle, nous avons la possibilité d’aller plus vite ». L’objectif ? Concurrencer la place financière de New York, « le seul concurrent de Londres à l’échelle mondiale ».
Pour Neil-Hall, soigner les intérêts du secteur financier relève simplement du bon sens, compte tenu de son importance pour l’économie britannique. L’argumentaire est rodé : « le secteur représente 12 % du PIB du Royaume-Uni, il emploie 2,3 millions de personnes dans le pays, et il exporte plus que toutes les autres industries réunies » déroule Neil-Hall, enthousiaste. Des chiffres quelque peu surestimés, s’il on en croit le rapport sur la contribution du secteur financier à l’économie britannique commissionné par la Chambre des communes13. Quoiqu’il en soit, les montants témoignent du poids considérable de la finance britannique, avec un excédent commercial estimé 46 milliards de livres.
L’appel de la City à « assouplir » la réglementation semble avoir été entendu par le gouvernement conservateur : le 20 juillet 2022, il présentait une nouvelle loi sur les services financiers, avec l’objectif d’opérer un « Big Bang 2.0 » de la finance londonienne – en référence à la période faste qui a suivi les lois de déréglementation de la période Thatcher. Un de ses instigateurs, l’ancien ministre des finances de Boris Johnson et actuel Premier Ministre Rishi Sunak, affirmait déjà en mai la nécessité de « réduire le fardeau réglementaire dans le secteur financier14 ». Au programme notamment : l’introduction d’une nouvelle exigence, pour les régulateurs, de promouvoir la « compétitivité internationale » des services financiers. De quoi graver dans le marbre la supériorité de l’agenda de la City sur toute autre considération, et accélérer la course au moins-disant réglementaire en matière de régulation financière. Cette orientation a été reprise à son compte avec enthousiasme par l’éphémère Première ministre Liz Truss, qui place ses pas dans ceux de la « Dame de fer », Margaret Thatcher : le 6 septembre, jour de sa nomination par la reine, elle annonçait qu’elle protégerait la City comme un « joyau de la couronne », et qu’elle s’attacherait à « dynamiser » le quartier d’affaires « pour mieux favoriser la croissance15 » . Le gouvernement de Liz Truss aura certes tenu moins de deux mois, mais son successeur Rishi Sunak s’inscrit parfaitement dans la continuité de cet agenda.
Paradis financier, enfer social
Il est une catégorie de la population de Londres qui partage certainement l’enthousiasme des conservateurs les plus dérégulateurs quant à l’aubaine que représente une place financière florissante : celles des ultra-riches. De bien des manières, la City a contribué à façonner la ville comme un havre pour les milliardaires du monde entier. Dans son ouvrage, Alpha City, le sociologue Rowland Atkinson, spécialiste de la gentrification, dresse le portrait édifiant d’une capitale britannique « colonisée » par les ultra-riches, où « la ville ne fonctionne plus pour les gens, mais pour le capital ».
A Londres, tout semble être fait pour faciliter la vie des plus riches. Premier avantage : les services financiers fournis par les institutions de la City et en particulier pour placer son capital et ses biens offshore, à l’abri du contrôle des autorités. Nul risque de voir ces dernières faire preuve d’un quelconque zèle pour combattre la fraude : l’environnement juridique est taillé sur mesure pour les plus riches. Ces derniers y sont en sécurité pour investir – il en va de « l’attractivité » ou de la « compétitivité » de la capitale britannique – comme pour y habiter. Les milliardaires du monde entier peuvent acheter leurs résidences ou simples pieds à terre auprès de promoteurs immobiliers peu regardants, en liquide ou par l’intermédiaire d’un trust dans un paradis fiscal. « Dans le quartier central de Westminster, une habitation sur dix est détenue dans un paradis fiscal » avance le sociologue Rowland Atkinson. Ils peuvent également les vendre rapidement au besoin. « S’ils le souhaitent, les riches peuvent même acheter leur citoyenneté britannique » note Atkinson, « et ils ne se privent pas d’aller et venir en jets privés, depuis les nombreux aéroports prévus à cet effet ». Londres est d’ailleurs la seconde destination sur le marché du jet privé après New York.
La quasi-absence de contrôle sur l’origine des capitaux investis à Londres contribue à faire de la ville un centre de prédilection pour la circulation de fonds d’origine criminelle ou frauduleuse.
La quasi-absence de contrôle sur l’origine des capitaux investis à Londres contribue également à faire de la ville un centre de prédilection pour la circulation de fonds d’origine criminelle ou frauduleuse, ou plus généralement pour la dissimulation de capitaux. « L’agence nationale de lutte contre le crime organisé estime à près de 100 milliards de livres la somme d’argent sale blanchie chaque année au Royaume-Uni » rapporte Atkinson. Londres est en particulier un lieu de choix pour des dirigeants étrangers et d’oligarques, notamment russes, soucieux de disposer d’une base arrière pour sécuriser leur fortune et se replier en cas de complications dans leur pays d’origine.
« Avec la crise ukrainienne, le gouvernement a été contraint d’agir sur la question de la criminalité économique » affirme Atkinson, « mais les mesures prises sont très faibles et présentent de nombreux échappatoires ». De fait, les responsables politiques de tous bords ne sont pas empressés à remettre en question le modèle londonien. « Pour accueillir toujours plus de capitaux du monde entier, les membres du parti conservateur comme du parti travailliste en viennent à anticiper les souhaits des super-riches » explique Atkinson. Les responsables politiques acquis à la cause de la « compétitivité » de Londres, parfois eux-mêmes évadés fiscaux, font partie des groupes sociaux dont l’intérêt s’aligne avec celui des très riches. Tout comme d’autres « facilitateurs » dans le secteur des services financiers, juridiques, de l’immobilier ou encore de l’art, de la restauration ou du luxe.
« C’est de l’enfer des pauvres qu’est fait le paradis des riches » écrivait Victor Hugo. De fait, pour le reste de la population, le modelage de la ville en faveur des ultra-riches s’avère une malédiction. La capitale britannique est depuis des décennies le terrain de jeu des spéculateurs immobiliers. « Pour les gens ordinaires, se loger est devenu extraordinairement cher » explique Atkinson, « des centaines de milliers de logements sociaux ont été démolis pour faire la place aux projets des promoteurs ». La gentrification de Londres ne date pas d’hier. Le développement de la City depuis le « Big Bang » de 1986, puis de l’enclave de Canary Wharf dans les années 2000 est allée de pair avec la construction, dans des quartiers populaires tels que celui de Tower Hamlets, d’appartements de luxe et d’infrastructures à destination des plus riches ou des travailleurs de la finance. Ces opérations de « régénération » urbaine ont contribué à tirer les prix vers le haut et à expulser les anciens habitants.
A Londres, les prix de l’immobilier ne cessent de battre des records – plus de 10 % d’augmentation des prix sur un an en 2022 – alors même que la capitale figure déjà parmi les villes les plus chères au monde. Cela se répercute sur le prix des loyers, qui ont bondi sur la même période de 20 %16. D’autant que les locataires jouissent de moins d’égards que les riches propriétaires et sont peu protégés par la loi : les baux étant généralement signés pour un an, les loyers peuvent librement augmenter tous les ans. Les locataires peuvent même, au bout de six mois, voir leur bail résilié par le propriétaire. Au-delà des prix des loyers et de l’immobilier, le coût de la vie est élevé de par la faiblesse des politiques sociales et la cherté de la livre. A l’été 2022, Londres figurait au quatrième rang du classement des villes les plus chères au monde17. La situation est telle qu’elle affecte même les salariés les mieux nantis. « Entre le coût de la vie et l’absence de protection sociale, il est financièrement difficile d’envisager de fonder une famille à Londres » témoigne Pablo. Venu il y a dix ans à Londres pour travailler dans la finance, il cherche désormais à quitter la capitale britannique.
La malédiction de la finance
Pour John Christensen, le mal économique et social qui frappe Londres et le Royaume-Uni est bien identifié : c’est celui de la « malédiction de la finance ». Ce terme, qu’il a forgé de pair avec Nicholas Shaxson, s’inspire du principe de la « malédiction des ressources » qui frappe les pays en développement exportateurs de matières premières précieuses. La dépendance de leur économie vis-à-vis de l’exploitation de ces ressources précieuse conduit paradoxalement à son appauvrissement.
Le surdéveloppement de la finance britannique conduit à des maux identiques. La « malédiction de la finance » se traduit par la captation des ressources du pays par une économie tournée essentiellement vers l’extraction de rente. La dépendance excessive vis-à-vis du secteur financier a pour conséquence une capture des responsables politiques et des régulateurs, la faiblesse des investissements productifs et dans la recherche et développement, et la concentration des richesses à Londres. La surévaluation de la livre, conséquence de l’afflux de capitaux, contribue à affaiblir davantage l’industrie et enchérir coût de la vie.
La « malédiction de la finance » se traduit par la captation des ressources du pays par une économie tournée essentiellement vers l’extraction de rente.
« Les responsables politiques considèrent que la City est la poule aux œufs d’or » avance Christensen, « mais il serait grand temps d’en finir avec ce discours ». Selon l’économiste, la place financière exerce surtout une forme de parasitisme : « On dit que la City permet d’attirer des capitaux de Chine, des Etats-Unis, d’Europe et de les investir au Royaume-Uni » poursuit Christensen. « Mais quelle est la nature des investissements ? L’immobilier, la bourse ou encore des fusions et acquisitions. C’est-à-dire rien qui ne bénéficie à l’économie productive ». L’afflux de capitaux alimente en revanche le gonflement du prix des actifs sur les marchés boursiers ou immobiliers. La City serait ainsi, selon l’économiste, le symbole parfait d’un capitalisme rentier, tourné vers l’extraction de richesse, proche de celui qui existait déjà au XIXème siècle.
Pour Mareike Beck, spécialiste de la City au King’s College de Londres, le problème réside dans le fait que les intérêts de la finance sont profondément enracinés dans la société et l’économie britanniques – ce qui alimente son « pouvoir structurel ». Le modèle social anglo-saxon y contribue grandement : avec le recul de l’Etat providence et des prestations, les britanniques doivent recourir à des alternatives de marché pour assurer leur sécurité sociale : le recours à des fonds de pension ou encore à l’investissement immobilier pour préparer sa retraite ou encore des prêts à la consommation pour assurer leur subsistance dans les périodes difficiles. Quitte à s’endetter fortement et très tôt. Une grande partie de la population a ainsi partie liée, de contrainte ou de gré, avec le secteur financier.
Le pouvoir de la finance procède de son emprise sur la vie quotidienne, mais également de son influence sur la culture et les imaginaires – auquel participe sa capacité à modeler la ligne d’horizon de la ville. Et de son influence sur les responsables politiques, déjà reconnue en 1937 par le futur Premier ministre travailliste Clement Attlee : « Encore et toujours, nous voyons qu’il y a dans ce pays un autre pouvoir qui siège à Westminster. La City de Londres, ce terme bien commode pour désigner un ensemble d’intérêts financiers, est en mesure de s’imposer face au gouvernement. Ceux qui contrôlent l’argent peuvent mener à l’intérieur du pays et à l’étranger une politique contraire à celle qui a été décidée par le peuple18. »
Aujourd’hui la City semble plus que jamais en mesure d’imposer ses vues aux forces politiques britanniques – du parti conservateur au parti travailliste dirigé par Keir Starmer. « Avec Jeremy Corbyn, nous avions démontré qu’il était possible et populaire de remettre en cause le pouvoir de la finance » avance James Schneider, membre de l’aile gauche du parti travailliste. « Mais la direction actuelle a tourné le dos à toute critique à l’égard de la City ». Invitée à la conférence annuelle 2022 de TheCityUK, la députée travailliste Rachel Reeves, en charge de l’économie et des finances dans la direction du parti travailliste, ânonnait le discours lénifiant des lobbyistes de la City : « Le Royaume-Uni devrait être incroyablement fier du succès international de son industrie des services financiers, qui en est la première exportatrice mondiale ».
La crise qui vient
Et pourtant, le pouvoir de la City pourrait bien prochainement trembler sur ses bases. Car le modèle de croissance financiarisé qu’il a promu est fragile. Il dépend l’afflux de capitaux du monde entier à Londres pour alimenter l’investissement dans des activités non productives (immobilier, marchés financiers) et susciter une consommation de luxe… ou à crédit. Les crises récentes pourraient bien faire s’écrouler ce château de cartes. La crise énergétique initiée par l’invasion de l’Ukraine, l’inflation et le resserrement monétaire engagé par la Fed a conduit à une « fuite vers la sécurité » des capitaux vers les valeurs américaines, dopant le dollar et pénalisant les autres monnaies.
Alors que la marée des capitaux bon marché se retire, la faiblesse de l’économie de rente britannique, accentuée par le Brexit, apparaît au grand jour : mauvais fondements économiques, industrie exsangue, surévaluation des actifs … La chute de la livre accroit davantage une inflation élevée. Les investisseurs sont inquiets quant à la perspective de la récession et de sévères corrections à venir dans la valeur des actions et obligations. Après deux décennies de hausse continue des prix, l’immobilier a commencé à chuter. Mais aussi d’une résurgence du mouvement social face à la flambée du coût de la vie, avec des grèves massives dans de nombreux secteurs, d’une ampleur sans précédent depuis des décennies.
Face à ce scénario catastrophe, le (bref) gouvernement mis en place par Liz Truss, entre le 6 septembre et le 25 octobre 2022, semblait vouloir radicaliser la politique d’attraction des capitaux, celle-là même qui a mené le Royaume-Uni dans l’impasse. Le 23 septembre, son ministre des Finances annonçait un plan de réductions fiscales massives en direction des plus aisés – pour près de 45 milliards de livres. Mais celui-ci a été accueilli plus que froidement par les marchés : il a conduit à un nouveau plongeon de la livre, et a contraint la Banque d’Angleterre d’intervenir massivement pour enrayer la flambée des taux de la dette britannique. Le début d’une profonde crise du modèle britannique d’économie ? En tout cas, le successeur de Liz Truss, Rishi Sunak, ne montre pas de velléité de rompre avec la domination de la City. Au contraire, avec son projet de « Big Bang 2.0 », il s’apprête à programmer une nouvelle vague de dérégulation financière — ce qui revient à jouer avec des allumettes assis sur un baril de poudre.
Note : ce texte est une version enrichie d’un article paru dans Le Monde diplomatique de mai 2023.
Notes :
[1] « Key facts about the UK as an international financial centre 2022 », TheCityUk, janvier 2023, et « Key facts about UK-based financial and related professional services 2023 », mars 2023.
[2] Et pour cause : le Lloyd’s Building a été conçu par un des architectes du Centre Pompidou, Richard Rogers.
[3] Le documentaire The Spider’s Web réalisé avec le concours de John Christensen et Nicholas Shaxson revient sur la mise en place de ce réseau financier offshore.
[4] David Kynaston, Till Time’s Last Sand: A History of the Bank of England 1694-2013, Bloomsbury Publishing PLC, 2017.
[5] « State of the sector : Annual review of UK financial services 2022 », rapport conjoint du Trésor britannique et de la Corporation de la Cité de Londres, juillet 2022.
[6] A titre d’exemple, les représentants des guildes élisent plusieurs représentants honorifiques et sélectionnent les candidats au rôle de Lord Mayor.
[7] A l’instar de la vénérable compagnie des banquiers internationaux, qui a la particularité d’accueillir des membres de toutes nationalités, ou encore celle vénérable compagnie des conseillers fiscaux.
[8] « City’s Cash annual report and financial statements », Corporation de la Cité de Londres, 2021.
[9] « City of London funds », Corporation de la Cité de Londres, 2022.
[10] « Operational Property Portfolio Report 2013 », Corporation de la Cité de Londres, 2 octobre 2013.
[11] « Peter Rees: The man who reshaped the Square Mile », Evening Standard, 20/03/2014.
[12] « Leadership Council», site de TheCityUK (consulté le 2 octobre).
[13] Selon ce rapport sur la contribution du secteur financier à l’économie britannique, celui-ci contribuerait « seulement » à hauteur de 8,6% au PIB (deux fois plus qu’en France et en Allemagne), pour un total d’emplois de 1,1 million.
[14] « Rishi Sunak to weaken City regulation in post-Brexit nod to Tory donors », The Guardian, 10/05/22.
[15] « New PM Liz Truss will protect ‘crown jewel’ City of London », City A.M., 06/09/22.
[16] « These Are the World’s 20 Most Expensive Cities for Expats », Bloomberg, 08/06/22.
[17] Ibid.
[18] C. R. Atlee, The Labour Party In Perspective, Londres, Hesperides Press, 1937, 2008