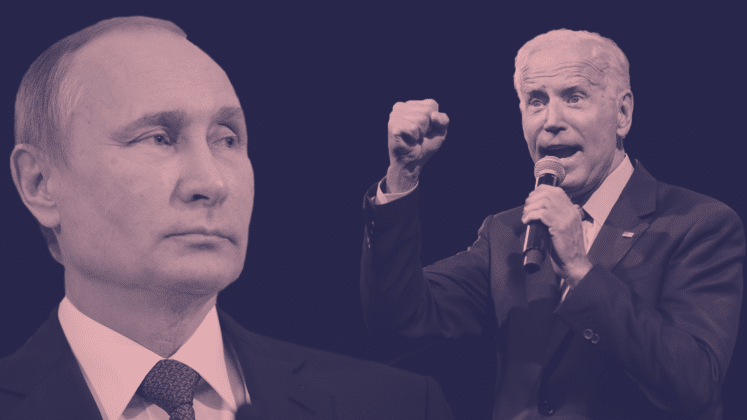La régulation financière européenne s’éloigne-t-elle des dogmes néolibéraux ? Dans les années qui ont suivi la crise financière des subprimes, la Commission européenne a affiché sa volonté de renforcer sa réglementation financière. La Banque centrale européenne (BCE) acceptait quant à elle d’intervenir massivement pour soutenir les cours – comme ce fut également le cas avec la crise du Covid. Ces orientations n’ont pas manqué de provoquer de fortes critiques. Celles de la Bundesbank, championne de l’orthodoxie monétaire, à l’égard d’une politique jugée trop laxiste. Ou encore celles des Brexiters, hostiles à une Union européenne (UE) considérée comme un Léviathan étouffant la finance sous ses normes juridiques. Assisterait-on à un tournant majeur dans la régulation financière européenne ? Une chose est sûre : les réformes mises en œuvre depuis une décennie sont loin de rompre avec le néolibéralisme. Elles résultent surtout de compromis visant à préserver les intérêts des systèmes bancaires et financiers nationaux. Et d’une féroce lutte d’influence, à laquelle se sont livrés les gouvernements allemand, français et britannique (avant le Brexit) pour modeler la réglementation à leur avantage.
Lors des réunions du G20 qui suivirent la crise financière mondiale de 2008, les dirigeants des plus grandes puissances économiques annonçaient, main sur le cœur, une grande réforme de la finance. Rien ne serait plus comme avant. Tout particulièrement en Europe. « Le laissez-faire économique a vécu » assénait le premier ministre britannique d’alors, Gordon Brown. Le président Sarkozy annonçait quant à lui « la fin d’un capitalisme financier qui avait imposé sa logique à toute l’économie et avait contribué à la pervertir ». Quelques mois plus tard, il cosignait avec la chancelière Angela Merkel un texte commun appelant à une « véritable régulation européenne dans le secteur financier ». Pour certains commentateurs, on assistait à la fin du néolibéralisme, de la même manière que la crise de 1929 avait contribué à remettre en cause le « laisser-faire » aux États-Unis et à l’échelle mondiale.
Pourtant plus de dix ans après la crise, force est de constater que l’ambition initiale a fait long feu. Plus de cinquante initiatives réglementaires ont certes été prises dans l’Union européenne dans la période qui a suivi la crise. Des réformes concernant les banques, assurances, fonds d’investissement, structures de marché, normes comptables, mécanismes de supervision financière… Mais le constat est le même que celui de l’historien Adam Tooze s’agissant du Dodd-Frank Act aux États-Unis : les réformes engagées dans l’UE constituent une mosaïque de mesures sectorielles insuffisantes pour s’attaquer aux causes profondes de la crise – comme le développement d’un modèle bancaire dopé aux financements de marché, aux activités boursières et hors-bilan.
Est-ce à dire que le programme de réformes mis en œuvre dans l’Union fut insignifiant ? Rien n’est moins sûr. Ces mesures ont été au cœur, non d’une remise en cause du néolibéralisme, mais d’un aggiornamento de la régulation financière. Et d’une importante bataille législative entre les États membres les plus influents en matière de réglementation financière.
De l’approche réglementaire anglo-saxonne à l’approche ordolibérale ?
Pour comprendre les tenants et aboutissants du programme de réformes financières européen, il est utile de revenir sur les différentes approches qui bercent la production de la réglementation financière dans l’Union européenne depuis plusieurs décennies. La première approche, historiquement associée au Royaume-Uni, repose sur une autorégulation avancée du secteur financier. Cette approche dite anglo-saxonne trouve notamment ses fondements idéologiques dans le néolibéralisme étatsunien, qui met l’accent sur l’efficacité supérieure des mécanismes de marché en comparaison avec la réglementation publique1.
L’aggiornamento post-2008 témoigne d’un glissement dans l’approche réglementaire de l’UE, d’une domination de l’approche anglo-saxonne à un retour en force de l’approche ordolibérale. Il ne constitue pas pour autant une rupture idéologique majeure.
L’approche anglo-saxonne vise à garantir la croissance économique par la libéralisation des marchés financiers dans l’Union européenne et le moins-disant réglementaire (approche light-touch). Elle repose sur l’application de mesures juridiques non contraignantes (soft law) et le recours à la discipline de marché. Au cours de la décennie 2000 et jusqu’à la crise financière, cette approche a été prédominante dans l’Union européenne en matière de réglementation financière2. Elle était notamment soutenue par l’Irlande, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et certains pays nordiques. Cette approche était également promue par la Commission européenne et la BCE qui considéraient que l’approfondissement de l’intégration financière permettrait de rendre tangibles les bénéfices de l’adoption de la monnaie unique (en 1999) et de la constitution du marché unique. Et bien sûr, elle était activement soutenue par le lobbying de l’industrie financière transnationale.
L’influence de l’approche anglo-saxonne imprime fortement le plan d’action pour les services financiers (PASF) adopté en 1999, programme législatif ambitieux qui visait à éliminer les obstacles à la circulation des capitaux et des services financiers d’ici à 2005. Ce programme a connu un succès impressionnant : en 2005, quarante-et-une des quarante-deux mesures prévues étaient mises en œuvre. Parmi elle, l’emblématique directive MiF, première du nom, qui organise la libéralisation et la déréglementation des places boursières et plateformes d’échange de titres financiers3. Avec l’objectif de créer un « marché des marchés » européen.
La seconde approche réglementaire, dite ordolibérale, portée par l’Allemagne, promeut un encadrement du marché pour garantir la performance du marché. En vertu de ses fondements théoriques, la réglementation et l’intervention publique doivent s’attacher à créer les conditions juridiques d’un ordre concurrentiel de marché4. Cet agenda ordolibéral est réactualisé dans les années 1980 par de nombreux travaux dans le cadre de la nouvelle économie institutionnelle et la théorie de l’agence5. L’approche ordolibérale a été, dès son origine, très prégnante dans la production réglementaire de l’Union européenne. Elle vise à une harmonisation des règles visant à mettre en place des conditions équitables de concurrence (level playing field) et la stabilité des conditions économiques – en particulier la stabilité financière. Les instruments réglementaires typiques de cette approche sont la mise en place de régimes d’incitations, de transparence et de surveillance du marché, dont la responsabilité revient à des agences sectorielles indépendantes.
NDLR : lire sur LVSL l’article de Jean-Baptiste Bonnet : « Ordolibéralisme : comprendre l’idéologie allemande »
En matière de réglementation financière, on assiste à un glissement suite à la crise de 2008, avec une remise en cause partielle de l’approche anglo-saxonne et un affermissement de l’approche ordolibérale soutenu notamment par l’Allemagne et la France. L’approche ordolibérale est saillante dans le programme de réforme financière européen, et dans les recommandations du rapport de Larosière dont il s’inspire. Ce dernier, présenté en février 2009, pointe les « défaillances du marché » à l’origine de la crise et appelle à « renforcer la surveillance réglementaire pour les établissements qui se sont avérés mal contrôlés ». À cet égard, les autorités de surveillance « doivent veiller à ce que l’autorégulation, lorsqu’elle existe, soit correctement mise en œuvre, ce qui n’a pas suffisamment été fait dans un passé récent ».
Dans tous les secteurs concernés par les cinquante-et-une initiatives réglementaires proposées entre mars 2009 et novembre 20146 et adoptées par l’UE, l’approche anglo-saxonne est en retrait. Le retournement le plus emblématique concerne la directive MiF2, qui instaure un régime de contrôle et de transparence renforcé pour les plateformes de négociation de titres (malgré de nombreuses lacunes), alors même que la précédente directive organisait la libéralisation du « marché des marchés » en supprimant notamment la règle de concentration des ordres, imposant l’exécution des transactions sur un marché réglementé. Certaines activités ou secteurs alors non réglementés à l’échelle européenne sont soumis à un régime d’autorisation, d’enregistrement et de transparence. C’est le cas des fonds spéculatifs (directive AIFM), des agences de notation (règlements CRA de 2009, 2011 et 2013), des transactions de dérivés de gré à gré, des ventes à découvert, des opérations de cession de titres ou encore des indices de référence (comme le Libor).
L’approche ordolibérale est également renforcée pour les activités ou secteurs déjà réglementés : renforcement des exigences de fonds propres bancaires et mise en place de nouveaux ratios de liquidité, mise en place d’un régime de contrôle pour les fonds de pension (directive UCITS V), d’une surveillance renforcée des abus de marché (règlement MAR et directive CSMAD), de mesures de protection des investisseurs et consommateurs, d’une limitation du recours à la comptabilité à la valeur de marché (fair value) notamment dans le domaine des assurances.
Le Royaume-Uni sur le départ
L’aggiornamento post-2008 témoigne donc d’un glissement dans l’approche réglementaire de l’UE, d’une domination de l’approche anglo-saxonne à un retour en force de l’approche ordolibérale. Il ne constitue pas pour autant une rupture idéologique majeure dans la production de la réglementation financière européenne. Les deux approches, loin d’être incompatibles, ont depuis longtemps coexisté dans l’UE, la production de la réglementation s’inscrivant dans un continuum entre ces deux pôles. C’est moins sur le plan idéologique que sur celui des intérêts nationaux que le programme de réformes financières va révéler des divergences majeures. En particulier entre les intérêts des trois pays les plus influents en la matière : le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne.
La plus évidente de ces divergences s’est exprimée dans l’opposition du gouvernement et de l’industrie financière britanniques à l’égard de nombreuses réformes mises en œuvre après la crise financière mondiale – notamment la réforme des fonds spéculatifs ou des agences de notation, ou encore le régime de supervision adopté dans le cadre de l’Union bancaire. Cette opposition n’a pas seulement une dimension idéologique : elle correspond également à une défense des spécificités du modèle économique britannique (ou « modèle de croissance » dans la littérature d’économie politique) et de ses « avantages comparatifs »7.
Selon Lucio Baccaro et Jonas Pontusson de l’Université de Genève, la consommation intérieure constitue le moteur du modèle de croissance britannique d’avant crise. Elle est rendue possible par un endettement bon marché (notamment pour les ménages) et un déficit chronique, tous deux financés par l’apport de capitaux étrangers. Ce modèle de croissance dépend donc de l’attractivité de La City de Londres comme centre financier international important et liquide. Il est étroitement lié à la faiblesse du contrôle réglementaire et aux mécanismes d’autorégulation, qui caractérisent historiquement la place londonienne.
Partant de cela, on comprend que les nouvelles contraintes réglementaires européennes ont été perçues comme une menace pour le modèle de croissance britannique, et expliquer les réticences britanniques à l’égard des réformes financières. Ces divergences n’ont pas été sans conséquence, puisqu’elles ont (entre autres) conduit le gouvernement de David Cameron à engager un bras de fer avec l’UE. En 2015, il entame des négociations pour un « nouvel accord8 » entre l’Union européenne et le Royaume-Uni… au terme desquelles est organisé le referendum qui conduit au Brexit.
NDLR : pour une analyse des motivations économiques du Brexit, lire sur LVSL l’article de Marlène Benquet et Théo Bourgeron : « Du néolibéralisme au libertarianisme autoritaire »
L’ironie de l’histoire étant que le coup de force britannique était en passe de porter ses fruits : la nouvelle Commission Juncker s’était vue dotée d’un agenda de libéralisation du secteur financier dans le cadre du projet d’Union des marchés de capitaux9. Un portefeuille à part entière de commissaire était dédié à ce programme de réformes, visant entre autres à remettre en cause les « fardeaux réglementaires inutiles », mais aussi à relancer le marché de la titrisation des crédits bancaires mis en cause après la crise financière. Aux manettes : Jonathan Hill, ancien lobbyiste de La City. De quoi susciter la méfiance de la France et l’Allemagne, perceptible à demi-mot dans une réaction commune à la consultation de la Commission sur l’Union des marchés de capitaux10.
Quoi qu’il en soit, les efforts de David Cameron pour faire avancer la cause de la finance britannique dans l’UE sont réduits à néant par le vote favorable au Brexit, qui conduit à la démission de Jonathan Hill. Le projet initial d’Union des marchés de capitaux, reposant sur la puissance de La City, est quant à lui largement amputé.
Divergences franco-allemandes
L’analyse par les particularités et modèles de croissance nationaux permet également d’éclairer les positions allemandes et françaises. Le modèle de croissance allemand repose fortement sur les exportations, et sur le dynamisme d’un tissu industriel constitué de PME (Mittelstand). Ce dernier est financé par des banques privées ayant des relations de proximité avec les entreprises exportatrices (Hausbanken), mais aussi par des caisses d’épargne (Sparkassen), des banques publiques et régionales (Landesbanken) et des banques coopératives. Le tout forme un secteur bancaire très décentralisé et davantage orienté vers le financement de long terme. La volonté de préserver ce modèle bancaire original, pilier majeur du modèle allemand, permet d’expliquer un certain nombre d’orientation des autorités allemandes suite à la crise financière.
Autre ligne de fracture entre les autorités françaises et allemandes : les politiques monétaires non conventionnelles. La mise sous perfusion du secteur financier par la BCE a particulièrement bénéficié aux grandes banques universelles françaises actives sur les marchés financiers, et a mis en difficulté les banques allemandes.
À l’inverse, la France se caractérise par un secteur finance financier dominé par quatre grandes banques universelles, considérées comme des « champions nationaux », et bénéficiant d’une très grande proximité avec l’administration et le pouvoir politique. Le modèle français, qualifié par l’économiste Ben Clift de post-dirigiste, repose sur cette interpénétration des sphères publiques et privées11. Grands patrons et hauts fonctionnaires, issus des mêmes écoles, œuvrent main dans la main pour le développement des « champions nationaux »12, y compris sur les marchés internationaux. Garantir la compétitivité des grandes banques a ainsi été, pour les autorités françaises, un enjeu majeur de politique économique suite la crise financière. Cette compétitivité repose sur une diversité d’activités, et notamment sur un partage oligopolistique du marché de détail français et un déploiement sans commune mesure des activités de marché et hors bilan (dont le commerce des produits dérivés).
C’est à l’aune des caractéristiques des modèles allemand et français que l’on peut comprendre l’opposition des deux pays à un projet majeur porté par la Commission européenne : la réforme structurelle des banques. Celle-ci consistait notamment à cloisonner les activités de marché des grandes banques universelles. En ligne de mire, « leurs activités de marché et le trading excessifs » selon les termes de la Commission dont le projet a été présenté en janvier 2014. Problème : les dispositions risquaient de pénaliser fortement les grandes banques universelles françaises en remettant en cause la diversification de leurs activités. Les banques allemandes étaient également vent debout le projet. L’association sectorielle qui porte leur voix a en particulier fait valoir à la Commission que « les entreprises allemandes, de taille moyenne et orientées vers l’export, ont besoin de produits financiers pour la finance d’entreprise et le négoce international, c’est-à-dire toute la gamme des services bancaires d’investissement13 »
De manière surprenante au premier abord, le gouvernement britannique n’était quant à lui pas défavorable à un cloisonnement des activités bancaires relativement strict, puisqu’il venait d’adopter au niveau national des mesures assez contraignantes (ring fencing). Ce choix peut s’expliquer par la perte d’influence des grandes banques universelles britanniques après la crise financière, mais également par une tradition historique plus prégnante de séparation des activités dans l’industrie bancaire britannique14.
Les divergences franco-allemandes n’ont pas manqué après la crise financière – quand bien même les deux pays partagent une approche réglementaire ordolibérale. Elles se sont exprimées notamment dans le processus d’adoption de la taxe européenne sur les transactions financières, en suspens depuis la première formulation du projet en 2011. Cette taxe a provoqué une levée de bouclier des grandes banques universelles françaises, soutenues par les gouvernements successifs sous les présidences Sarkozy, Hollande et Macron. Elle menaçait en effet de pénaliser les financements et activités de marché des grandes banques universelles, et tout particulièrement le commerce des produits dérivés. Le gouvernement allemand était quant à lui favorable à l’établissement d’une taxe large : pour des raisons de politique intérieure (la taxe figurait déjà dans l’accord de gouvernement CDU-SPD en 2013) mais également parce que le modèle d’affaire des banques allemandes tournées vers le financement des entreprises exportatrices n’était pas remis en cause15.
Les divergences franco-allemandes se sont également exprimées dans le cadre des négociations autour des trois piliers du projet d’Union bancaire16. Les deux premiers piliers, le mécanisme de surveillance unique (MSU) et le mécanisme de résolution unique (MRU) ont fait l’objet d’âpres négociations entre l’Allemagne et la France. La mise en place de règles communes concernant la surveillance et la résolution des crises bancaires était appelée des vœux des grandes banques transnationales, et fortement critiquée par les petites et moyennes banques allemandes. Ces mesures constituaient un premier pas vers une plus grande intégration et concurrence à l’échelle européenne dans un secteur bancaire fragmenté nationalement, et donc des opportunités de conquête pour les banques plus puissantes.
Dès lors, la volonté de préserver la spécificité du secteur bancaire national s’est exprimée dans les exemptions imposées par l’Allemagne sur l’étendue du mécanisme de surveillance unique (MSU). L’accord prévoit finalement que la BCE, dans le cadre du MSU, soit en charge de la surveillance directe des 120 plus grandes banques de la zone euro – et non de la totalité des plus de 6 000 banques potentiellement concernées, tel que souhaité initialement par la France. De même, l’Allemagne s’est opposée aux velléités françaises visant à établir un mécanisme de résolution unique (MRU) large, doté d’un fonds conséquent et de mécanismes de décision centralisés à l’échelle européenne. Avec à la clé un accord intergouvernemental obtenu fin 2013 bien en retrait par rapport aux propositions initiales.
Autre ligne de fracture entre les autorités françaises et allemandes : les politiques monétaires non conventionnelles. La mise sous perfusion du secteur financier par la BCE a particulièrement bénéficié aux grandes banques universelles françaises actives sur les marchés financiers – à travers notamment les opérations d’assouplissement quantitatif (quantitative easing ou QE). La chute des taux directeurs de la BCE, qui visait à stimuler le crédit bancaire, a aussi contribué à alimenter les marchés financiers. Elle a favorisé les rachats d’action permettant aux grandes entreprises de doper leur cours en bourse, et les placements rémunérateurs et risqués plutôt que l’épargne « patiente ». La baisse des taux d’intérêts s’est accompagnée, dans le même temps, d’une contraction des marges d’intérêt de la rentabilité des activités traditionnelles de crédit bancaire. Mettant particulièrement en difficulté les banques allemandes17. Au point que l’agence de notation Moody’s a abaissé leur perspective de « stable » à « négative » fin 2019, les banques allemandes pointant quant à elle ouvertement la responsabilité de la Banque centrale européenne et sa politique de taux bas.
Vers une renationalisation des enjeux financiers ?
Ainsi les réformes financières mises en œuvre dans l’UE après la crise financière mondiale n’ont pas constitué une remise en cause des dogmes libéraux. Mais elles ont mis au grand jour d’importantes divergences entre l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni en matière de régulation financière. De quoi faire voler en éclat plusieurs lieux communs. Non, la finance n’est pas dominée par des logiques transnationales : c’est un secteur où les intérêts nationaux jouent au contraire à plein. Oui, la France œuvre activement au développement de la finance de marché qui n’est pas le seul fait de l’influence anglo-saxonne. Certes, les politiques monétaires non conventionnelles mises en œuvre par la BCE ont contribué à éviter à l’Union européenne de sombrer dans la crise ; mais à défaut d’une véritable rupture avec le dogme austéritaire, elles préparent les fractures et les crises de demain en favorisant le gonflement de la sphère financière au détriment de l’économie.
Partant, plusieurs chemins semblent se dessiner pour l’avenir du secteur financier européen : celui d’un accroissement de l’intégration, passant nécessairement par une plus grande libéralisation et consolidation du secteur bancaire à l’échelle européenne. Cette option est appelée des vœux par la BCE, mais aussi par le gouvernement français – y voyant des opportunités de conquête pour les grandes banques nationales. Elle s’est jusqu’à présent opposée aux réticences allemandes visant à préserver les spécificités de son secteur bancaire, comme en témoigne les négociations autour de l’Union bancaire. Un autre scénario serait celui d’un accroissement des divergences entre des intérêts nationaux par trop éloignés. La crise financière a déchiré le voile d’une intégration financière européenne « gagnante-gagnante » pour toutes les parties prenantes. Dès lors, une renationalisation des enjeux financiers pourrait avoir différentes conséquences : du simple coup d’arrêt de l’intégration – statu quo – à des ruptures nationales d’ampleur que préfigurerait le Brexit.
Un troisième scénario n’est pas exclu : celui d’une véritable remise en cause du pouvoir de l’industrie financière, de ses velléités hégémoniques et de ses dogmes libéraux. Une telle option n’est pas aussi hors de portée que l’on pourrait le croire, mais il faut bien comprendre que le pouvoir de la finance s’inscrit avant tout dans un cadre national. Et que la France constitue, avec ses puissantes banques universelles, un des nœuds de ce pouvoir dans l’Union européenne. Dès lors, une remise sous tutelle démocratique de la finance pourrait prendre, au moins dans un premier temps, la forme d’une nationalisation des grandes banques françaises. Avec pour objectif de réorganiser le secteur bancaire, de réduire la taille des banques, de les soustraire aux contraintes concurrentielles et de mettre en œuvre les conditions d’un contrôle social sur leurs activités et leurs investissements. Une telle socialisation du secteur bancaire se justifierait par la dimension de service public de nombreuses activités bancaires, y compris des activités de crédit et de l’investissement, mais aussi par l’urgence de financer la réorientation écologique et sociale de l’économie. Elle pourrait être soutenue par une partie de l’encadrement de ces banques, encore acquises à cette dimension de service public. Réalisée à l’échelle nationale, elle servirait dans un second temps de modèle pour d’autres pays du continent et au-delà. Un tel scénario ne pourrait bien sûr voir le jour sans une mobilisation sociale d’ampleur, et une volonté politique forte au service du bien commun.
Notes :
1 Les travaux des néolibéraux étatsuniens portent notamment sur la critique du paradigme keynésien et de l’inefficacité de la réglementation publique, la théorie des anticipations rationnelles, l’hypothèse d’efficience des marchés… On distingue notamment les tenants de l’école de Chicago, Milton Friedman, George Stigler, Robert Lucas, Gary Becker, Ronald Coase, et ceux de l’école de Virginie, Gordon Tullock et James Buchanan (liste non exhaustive).
2 Voir à cet égard : Daniel Mügge (2011), « From Pragmatism to Dogmatism. EU Governance, Policy Paradigms, and Financial Meltdown », New Political Economy, vol. 16, n°2, pp. 185–206.
3 Lire à cet égard « Une directive européenne pour doper la spéculation », Le Monde diplomatique, septembre 2011 : https://www.monde-diplomatique.fr/2011/09/LAGNEAU_YMONET/20941
4 Les bonnes interventions étant jugées selon leur conformité à un certain nombre de « principes constituants » (stabilité de la politique économique, stabilité monétaire, ouverture des marchés, propriété privée, liberté des contrats, responsabilité des agents économiques…). Les penseurs de cette école sont notamment Walter Eucken et Wilhelm Röpke. Pour plus d’information voir Pierre Dardot et Christian Laval, La nouvelle raison du monde, La Découverte, 2009.
5 La théorie de l’agence ou théorie des incitations réglementaires s’attachent à décrire les enjeux liés au contrôle d’un acteur par un autre, par exemple d’une entreprise par le régulateur. Ces analyses s’accompagnent de prescriptions sur la conception de la réglementation et des règles de supervision, comme l’indépendance des agences de régulation. Parmi les travaux néo-institutionnalistes on compte par exemple ceux de Jean Tirole, David Baron ou Barry Weingast.
6 Ces dates correspondent à la période ouverte par la remise du rapport de Larosière, et la fin du mandat de la Commission Barroso II, à laquelle succède la Commission Juncker. Pour un bilan critique du programme de réforme de l’UE, voir notre étude : La réglementation financière empêchée : L’Union européenne après la crise de 2007-2008. Economies et finances. Université Paris-Nord – Paris XIII, 2020
7 Voir à cet égard : Lucio Baccaro et Jonas Pontusson (2016), « Rethinking Comparative Political Economy: The Growth Model Perspective », Politics & Society, vol. 44, n°2.
8 Voir la lettre de David Cameron a Donald Tusk évoquant les contours des négociations du « nouvel accord ».
9 Voir « Finance, Bruxelles rallume la mèche », Le Monde diplomatique, janvier 2016.
10 Cette réaction commune appelle notamment à ne pas « reproduire simplement le système financier américain », et à ce que le développement des marchés de capitaux soit « encadré de manière appropriée de façon à préserver la stabilité financière et mettre sur un pied d’égalité le financement bancaire et le financement par les marchés ».
11 Voir Ben Clift (2012) Comparative Capitalisms, Ideational Political Economy and French Post-Dirigiste Responses to the Global Financial Crisis, New Political Economy, 17:5.
12 Lesdits « champions nationaux » au cœur du modèle français étant souvent d’anciennes entreprises publiques privatisées.
13 Deutsche Kreditwirtschaft (2013), « Opinion to Directorate General Internal Market and Services: Consultation Paper on Reforming the Structure of the EU Banking Sector ».
14 Pour plus de détails sur la réforme bancaire britannique, voir La réglementation financière empêchée : L’Union européenne après la crise de 2007-2008, op. cit.
15 A titre de comparaison, le revenu des activité de trading et de change représentait 3,7% du revenu total des banques allemandes en 2016, contre respectivement 13% et 11% pour les banques françaises et britanniques (BCE, 2018).
16 Voir à cet égard : Howarth D. et Quaglia L. (2016), Political Economy of European Banking Union, Oxford, Oxford University Press ; Christina Neckermann (2019), The End of Bilateralism in Europe? An Interest-Based Account of Franco-German Divergence in the Construction of the European Banking Union, M-RCBG Associate Working Paper Series | No. 119
17 Cela se traduit notamment dans les indicateurs de rentabilité : les banques allemandes affichaient en 2019 un retour sur capitaux propres (return-on-equity ou ROE) de 1,73% contre 6,4% pour leurs homologues françaises, d’après les chiffres de la BCE.