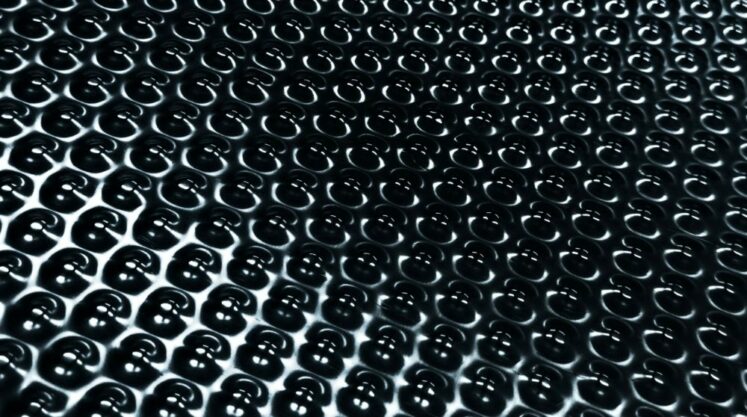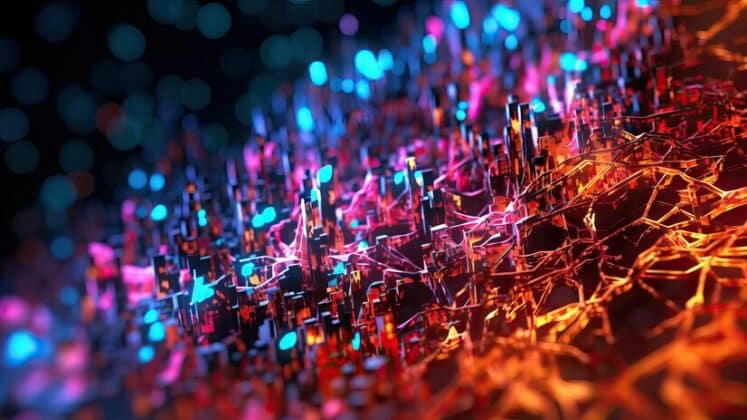Dans Si la logistique m’était contée (2021, FYP éditions), Jérôme Libeskind, consultant en logistique urbaine et e-commerce, décrit sur douze petites histoires les principales innovations qui ont façonné la livraison, le commerce mais aussi la ville au cours du siècle précédent. Du service de livraison de repas à domicile au système de magasin en libre-service, l’auteur nous apprend que les ancêtres d’Uber et d’Amazon s’appellent Mahadu Bachche, Félix Potin et Suzanne Trébis. Loin de proposer une histoire linéaire de ces innovations logistiques, l’auteur défend qu’en matière de livraison, de contrôle des flux urbains, mais aussi de gestion des déchets, nous avons bien plus souvent détruit qu’amélioré l’existant. Entretien réalisé et retranscrit par Simon Woillet et Audrey Boulard.
LVSL – Dans votre livre nous avons été interpellés par le fait que la plupart des innovations que l’on croyait issues du numérique ont vu le jour sans. Nous pensons par exemple au cas du magasin en libre-service par Félix Potin ou du modèle des dabbawalas de Mumbai, système de livraison de repas qui existe depuis 130 ans dont vous écrivez qu’il « est en tous points opposé à celui des plateformes ». Est-ce l’une des intentions de votre livre que de tordre le coup à l’idée selon laquelle pour être efficiente la logistique doit passer par des plateformes ?

Jérôme Libeskind – Je n’ai pas pensé mon livre en réquisitoire anti-digitalisation ou anti-plateformisation : les outils numériques, qui sont amenés à se multiplier, peuvent dans le cas de la livraison de repas par exemple, aider à l’optimisation des tournées. Cependant, ils ne remplacent pas les fondamentaux. Les applications de livraison de repas, aujourd’hui très performantes, reposent sur un modèle social, environnemental et organisationnel qui est catastrophique. Pour prendre un exemple parlant, un des fondamentaux de la logistique se trouve dans la consolidation des flux, afin de réduire l’impact environnemental de l’acheminement des marchandises. Ces plateformes développent au contraire des modèles qui poussent à la fragmentation, générant des flux supplémentaires qui ne sont pas sans conséquence sur l’environnement.
Il n’existe donc pas de vision écologique de la ville sans prise en compte de la logistique.
Le service de livraison de repas des dabbawalas de Mumbai dont je parle dans mon livre gère près de 400 000 mouvements de livraison par jour, et ce, sans avoir recours aux outils numériques. La réussite de ce modèle est sans commune mesure avec ce que propose les plateformes de livraison de repas, tout simplement parce que le numérique seul ne suffit pas à garantir le succès d’un projet logistique. En revenant à l’histoire, j’ai essayé de montrer que les problèmes que l’on se pose aujourd’hui ne sont pas nouveaux. Nous n’avons en définitive pas inventé grand-chose. Nous avons d’ailleurs surtout détruit des modèles qui avaient du sens.

LVSL – Dans l’introduction de votre livre, vous vous appuyez sur la définition que donne le Centre d’étude et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) pour définir la logistique : « la logistique urbaine est l’art d’acheminer dans les meilleures conditions les flux de marchandise qui entrent, sortent et circulent dans la ville ». La réflexion sur la logistique est-elle une condition nécessaire pour développer une vision écologique de la ville ?
J. L. – La logistique est une fonction transverse qui touche à l’urbanisme, à la mobilité des personnes et à la façon de consommer. Elle comprend tout un ensemble de fonctions qui concernent notre mode de vie, notre habitat, l’organisation du territoire, l’origine des marchandises que l’on consomme, leur durée de vie et leur conditionnement. Il n’existe donc pas de vision écologique de la ville sans prise en compte de la logistique. C’est pourtant un volet qui est souvent oublié ou qui n’est que partiellement pris en compte.
La logistique nécessaire pour évacuer les ordures ménagères dans les centres de déchets est par exemple très peu connue du grand public. Ce sont 550 véhicules par jour qui se rendent dans le centre de Paris pour traiter les déchets. Et une fois que les ordures ménagères sont brulées – parce qu’on ne le dit pas mais les ordures ménagères sont brûlées – les résidus sont à nouveau évacués par camions. Les déchets représentent donc des flux extrêmement importants avec à chaque fois des camions, des kilomètres, de la congestion de flux, des émissions de gaz à effet de serre, des émissions de polluant locaux, etc.
Ce que j’ai essayé de démontrer en filigrane dans le livre, c’est que la logistique peut constituer un levier écologique. Dans le chapitre que je consacre à Augustine Thwaites, l’inventeur en 1799 de la bouteille consignée, j’ai essayé de mettre en évidence la notion de valeur de l’emballage. Nous avons aujourd’hui en France beaucoup de mal à prendre des décisions à ce propos en grande partie parce des groupes de pression importants s’emploient à faire durer un modèle de recyclage plutôt que de réutilisation des bouteilles. L’évidence va pourtant vers la réutilisation.
LVSL – Vous mentionnez dans le chapitre sur Augustine Thwaithes, que le Danemark a été forcé de se mettre en conformité avec la législation européenne et d’accepter sur son territoire des emballages de cannettes aluminium qui étaient auparavant interdits au regard de préoccupations écologiques. Dans ce cas-là, y-a-t-il un problème dans une pensée économique libre-échangiste qui fait fi de la cohérence logistique ?
J. L. – L’Union Européenne a fait sur ce point une erreur gravissime. L’exemple danois était un modèle qu’il fallait étendre dans d’autres pays pour pallier le problème de ces filières logistiques très énergivores. Évidemment tout ne sera pas résolu par la consigne. J’ai cependant du mal à comprendre que les acteurs publics ne s’emparent pas de cette solution. Il y a sur ce point un vrai blocage juridique qui a de nouveau été apparent lors des discussions autour de la loi climat. Pourquoi préférons-nous le recyclage à un modèle de consigne qui réutilise les emballages ? Parce que les collectivités locales ont investi massivement dans des centres de tri de retraitement des déchets et qu’elles ont peur de ne pas pouvoir rentabiliser ces centres. Aujourd’hui, nous voyons plus d’initiatives en provenance des grands acteurs de la distribution, tels que Carrefour ou E.Leclerc. Ils y trouvent bien sûr un intérêt puisqu’ils s’assurent la fidélité des consommateurs qui reviennent déposer leurs bouteilles.
LVSL – Vous mobilisez dans votre livre l’exemple de Victor Gruen, inventeur du shopping mall, qui aux États-Unis a été le premier à mettre en garde contre le risque de dépendance à la voiture individuelle et l’expansion tentaculaire de la ville vers les périphéries. De ce point de vue, y-a-t-il une différence notable entre les modèles européen et américain ? Ou bien peut-on constater des phénomènes de mimétisme ou de transposition ?
J. L. – De par sa densité urbaine, la ville américaine est bien sûr très différente des villes européennes, qui sont elles-mêmes construites sur des modèles singuliers. Il est vrai néanmoins qu’on constate un certain mimétisme entre la ville française et les États-Unis. Dans le chapitre sur Victor Gruen, j’ai voulu montrer que les conséquences logistiques de l’étalement urbain – sur la consommation des terres agricoles, sur le déplacement des personnes et la dépendance à la voiture individuelle – sont considérables. En France, nous avons suivi il y a longtemps ce modèle de dépendance à la voiture individuelle. Ce qui n’est pas sans conséquence. En étalant les populations, on crée des territoires plus énergivores et plus difficiles à desservir. Nous créons des territoires qui sont inefficients sur le plan logistique, pour la gestion des biens de consommation ou des déchets. Avec Victor Gruen, on comprend que le modèle d’étalement de la ville sur plusieurs dizaines de kilomètres de long n’est pas efficace : il faut pouvoir recentrer les villes. C’est ce qu’on appelle aujourd’hui la ville du quart d’heure, un modèle qui avait déjà été pensé il y a un demi-siècle, même si à l’époque tout ceci semblait un peu utopique.
En France, le problème vient principalement de l’habitat. Dans le sud de la France, les villages situés à quarante kilomètres de Montpellier ont par exemple vu leur population doubler en dix ou quinze ans pour se transformer en villages dortoir dans lesquels il n’y plus de commerce, mais seulement des zones pavillonnaires qui hébergent les personnes qui travaillent en métropole. C’est exactement le modèle des suburbs qui s’est développé il y a cinquante ans aux États-Unis. Nous sommes passés d’un habitat collectif à un habitat individuel, en vendant précisément le rêve américain du pavillon comprenant un morceau de jardin et deux voitures. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’apparition de ce modèle en France est très récent – quinze ans tout au plus – et rien n’est fait de la part des pouvoirs publics locaux pour l’endiguer. Revenir en arrière ne sera pas simple, mais c’est pourtant une obligation.
LVSL – Vous avez rédigé votre ouvrage pendant le premier confinement. Cette situation particulière a-t-elle influencé le choix des exemples que vous mobilisez ?
J. L. – Depuis les événements étonnants qui se sont passés en mars dernier, tout le monde sait ce qu’est la logistique. Nous avons découvert que, sans camion, nos rayons de magasin sont vides, nous n’avons pas de masques, ni de vaccins et que nos hôpitaux ne sont pas approvisionnés.
La nouveauté avec l’ubérisation réside dans l’aspect collaboratif des plateformes permettant à tout un chacun de devenir livreur. Autrement dit, la nouveauté c’est le modèle social, ou plutôt son absence.
Dans le livre, je parle de la guerre franco-prussienne et des deux guerres mondiales, des périodes qui ont abouti à des innovations étonnantes sur le plan logistique. Notamment parce que les carences énergétiques et la nécessité de trouver des solutions d’approvisionnement pour les zones de combat ont favorisé l’émergence de solutions nouvelles. Ceci dit, je ne suis pas certain que cette crise aura des répercussions positives sur les pratiques. La livraison à domicile de repas a par exemple explosé en un an, développant des modèles très inquiétants sur le plan social, sur le plan de la sécurité, de l’environnement, et de la consommation d’emballage.
LVSL – Aujourd’hui, les réseaux sociaux et les plateformes emmagasinent de plus en plus de données permettant d’anticiper les comportements des consommateurs. Est-ce que cela change la donne du point de vue de la gestion des stocks ?
J. L. – Les gestions de stocks intégrées – qui vont de la production à la distribution – n’ont rien de nouveau. Félix Potin a tout inventé du commerce moderne au milieu du XIXe s., y compris la livraison à domicile. Maintenant, il faut pouvoir distinguer la technologie de l’ubérisation. La nouveauté avec l’ubérisation réside dans l’aspect collaboratif des plateformes permettant à tout un chacun de devenir livreur. Autrement dit, la nouveauté c’est le modèle social, ou plutôt son absence.
Dans une étude sur laquelle j’ai travaillé pour des organismes publics, j’ai découvert que ces entreprises s’appuient sur un outil technologique très performant, mais qu’elles en perdent complètement la maîtrise. Derrière ces plateformes ubérisées se développent des modèles sociaux dramatiques. On le voit au travers de l’emploi de sans-papiers. Aujourd’hui, près de 40% des comptes sont partagés, c’est-à-dire que ce sont des personnes en situation irrégulière, ou des mineurs qui sont utilisés pour livrer, avec une rétrocession d’une partie de leur rémunération. Il s’agit donc presque d’esclavage. Et cela concerne près d’une livraison sur deux de repas. L’État le sait parfaitement. Il y a simplement une volonté publique de laisser faire. Un siècle et demi après l’invention de la cyclologistique et près d’un siècle après la mise sur le devant de la scène de cyclologisticienne comme Suzanne Trébis, il est par ailleurs assez édifiant de constater que 98% des livreurs de repas sont des hommes.
Comme toute entreprise, ces plateformes devraient être dans l’obligation de maîtriser ce qui se passe chez elles. D’autant qu’elles sont en train d’évoluer vers des modèles de livraison de produits alimentaires, et que par leur biais, le commerce n’a pas fini de se transformer. On nous annonce par exemple la l’émergence de différentes plateformes qui vont faire des livraisons à vélo en 10 minutes dans Paris, ce qui est en réalité impossible à faire autrement qu’en scooters. Tant que ces plateformes ne seront pas adossées à un modèle social, comme c’est le cas à Mumbai avec le service des dabbawalas, elles continueront d’avoir les conséquences catastrophiques qu’on leur connait.

Diplômé de l’École des hautes études commerciales (HEC Paris), Jérôme Libeskind est expert en logistique urbaine, dernier kilomètre et e-commerce. Il dirige le bureau d’études Logicités qui accompagne les entreprises et les acteurs publics dans la compréhension des enjeux et la mise en œuvre de solutions opérationnelles. Chargé de cours de « logistique urbaine » à l’École supérieure des transports et à l’université Paris-Sorbonne (master TLTE), il a publié La logistique urbaine : les nouveaux modes de consommation et de livraison (FYP éditions, 2015) et La logistique urbaine au Japon (Logicités, 2018).