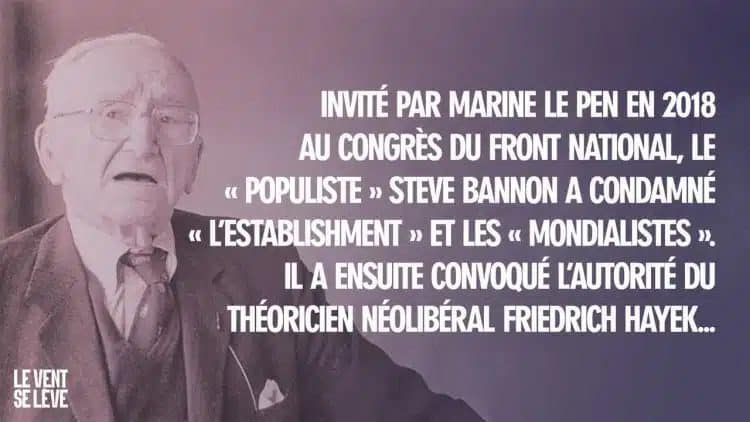En Italie, en Pologne ou en Hongrie, elles ont déjà conquis le pouvoir. Au Royaume-Uni ou en Allemagne, elles ont acquis une forte influence électorale. En France, elles se préparent à la prise de pouvoir (comme l’attestent les marques d’allégeance du Rassemblement national à l’égard du MEDEF, après avoir achevé son tournant patronal). Dans la quasi-totalité des pays européens, des forces politiques ont émergé se réclamant d’une droite neuve : nationaliste, populiste, identitaire et xénophobe. Alors que la plupart des médias ont décrit ces mouvements comme une réaction virulente contre le néolibéralisme, et qu’eux-mêmes revendiquent une rupture avec l’establishment, les « populistes » de droite et les néolibéraux partagent en réalité des racines communes. Un article de Quinn Slobodian, auteur de Globalists: The End of Empire and the Birth of Neoliberalism (2018), traduit par Keïsha Corantin.
Un récit tenace de ces dernières années identifie le populisme de droite (1) à une réaction sociale contre ce que l’on nomme « néolibéralisme. » Le néolibéralisme est souvent défini comme une forme de fondamentalisme du marché, ou comme une croyance en un ensemble de leitmotivs : tout dans ce monde a un prix, les frontières sont obsolètes, l’économie mondiale devrait remplacer les États-nations, et la vie humaine est réductible au cycle consistant à gagner de l’argent, le dépenser, emprunter et mourir.
Les « populistes de droite », a contrario, prétendent défendre le peuple, la souveraineté nationale et l’enracinement culturel. Aujourd’hui, alors que le soutien aux partis traditionnels décroît, les élites qui ont promu le néolibéralisme récolteraient les fruits de l’inégalité et de l’érosion de la démocratie qu’elles ont semées.
Mais ce récit est faux. Un regard plus attentif suffit à constater que d’importantes factions de ce « populisme de droite » constituent des souches mutantes du néolibéralisme. Après tout, les partis labélisés « populistes de droite », des États-Unis à l’Angleterre et à l’Autriche, n’ont jamais agi comme des anges vengeurs envoyés pour combattre la mondialisation économique. Ils n’ont pas l’intention de soumettre le capital financier, de rétablir les garanties de travail de l’âge d’or (2), ou de mettre fin au commerce mondial.
Friedrich Hayek, icône des deux bords du fossé néolibéral
Dans l’ensemble, les appels des soi-disant populistes à privatiser, déréglementer et réduire les impôts proviennent directement du manuel utilisé par les dirigeants mondiaux au cours des trente dernières années.
Mais plus fondamentalement, concevoir le néolibéralisme comme une volonté de marchandisation apocalyptique du monde est à la fois vague et trompeur.
Comme l’histoire le montre aujourd’hui, loin de mobiliser une vision du capitalisme sans États, les néolibéraux qui se sont rassemblés autour de la Société du Mont-Pèlerin fondée par Friedrich Hayek (qui a utilisé le terme néolibéralisme comme auto-description dans les années 1950) ont réfléchi pendant près d’un siècle sur la façon dont l’État doit être repensé pour restreindre la démocratie sans l’éliminer et comment les institutions nationales et supranationales peuvent être utilisées pour protéger la concurrence et les échanges.
Lorsque nous comprenons le néolibéralisme comme un projet de restructuration de l’État pour sauver le capitalisme, sa prétendue opposition au populisme de droite commence à se dissoudre.
Tant les néolibéraux que les « populistes de droite » rejettent l’égalitarisme, la justice économique mondiale et toute forme de solidarité qui s’étend au-delà des frontières nationales. Tous deux perçoivent le capitalisme comme inévitable et jugent les citoyens à l’aune de la productivité et de l’efficacité. Le plus frappant est peut-être que tous deux puisent dans le même panthéon de héros. Un exemple en est Hayek lui-même, icône des deux côtés du fossé néolibéral-populiste.
S’exprimant aux côtés de Marine Le Pen lors du congrès du parti du Front national français en 2018, le populiste autoproclamé Steve Bannon a condamné « l’establishment » et les « mondialistes »… mais a structuré son discours autour de la métaphore de la route du servitude (3), chère à Friedrich Hayek – invoquant ensuite l’autorité du maître.
Invité à Zurich la semaine précédente, Bannon avait également invoqué Hayek. Il y était reçu par Roger Köppel, éditeur de presse, membre de l’Union démocratique du centre (parti d’extrême droite) et de la Société Friedrich Hayek. Au cours de l’évènement, Roger Köppel a remis à Bannon le premier numéro de leur journal Wirtschaftswoche, en ajoutant, à demi-voix, qu’il datait de « 1933 » – une époque où ce même journal soutenait la prise du pouvoir par les nazis…
« Laissez-les vous traiter de racistes », a déclaré Bannon dans son discours de campagne. « Qu’ils vous traitent de xénophobes » ; « laissez-les vous appeler nativistes. Portez-le comme une médaille d’honneur. » L’objectif des populistes, a-t-il dit, n’est pas de maximiser la valeur actionnariale mais de « maximiser la valeur citoyenne ». Une perspective qui ressemble moins à un rejet du néolibéralisme qu’à une intensification de la logique économiciste au sein de l’identité collective. Les populistes rejetaient moins l’idée néolibérale de capital humain qu’ils ne la combinaient avec l’identité nationale.
Pendant son séjour en Europe, Bannon a pu également se réunir avec Alice Weidel, ancienne conseillère de Goldman Sachs, leader du parti populiste de droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) et membre de la Société Hayek jusqu’au début 2021. Un autre représentant de l’AfD, Peter Boehringer, est également membre de la Société Hayek, et député au Bundestag (Parlement fédéral allemand) où il préside la commission du budget.
En septembre 2017, Breitbart, un site d’information dont Bannon était le président exécutif, a interviewé Beatrix von Storch, une députée et leader de l’AfD qui est également membre de la Société Hayek. Elle a profité de l’occasion pour dire que Hayek l’avait inspirée dans son engagement pour le « redressement de la famille. » En Autriche voisine, la négociatrice de l’éphémère coalition du Parti de la liberté autrichienne (extrême droite) avec le Parti populaire autrichien (droite), Barbara Kolm, était à la fois présidente de l’Institut Hayek de Vienne, membre de la Société du Mont Pélerin, et partie d’une commission d’experts qui a cherché à créer au Honduras des zones franches spéciales échappant au contrôle de l’État.
Ce n’est donc pas tant à un affrontement entre courants théoriques opposés que l’on assiste : c’est à la manifestation publique d’un différend qui a clivé les classes dominantes de longue date, concernant les moyens nécessaires au maintien du libre marché. Ironiquement, le conflit qui a divisé les dits mondialistes et les populistes a éclaté dans les années 1990, à une époque où beaucoup pensaient que le néolibéralisme avait conquis le monde.
Qu’est-ce que le néolibéralisme ?
Le néolibéralisme est souvent conçu comme un ensemble de solutions, un manuel pour détruire la solidarité sociale et l’État-providence. Naomi Klein l’évoque dans le cadre de sa « stratégie du choc » : intervenir en cas de catastrophe, vider et vendre les services publics et transférer le contrôle des États aux entreprises.
Le consensus de Washington, décrit par l’économiste John Williamson en 1989, est l’exemple le plus célèbre du solutionnisme néolibéral : une liste de dix impératifs pour les pays en développement, allant de la réforme fiscale à la libéralisation du commerce en passant par la privatisation.
Le néolibéralisme ressembler ici à un livre de recettes, qui propose une panacée aux problèmes économiques et sociaux.
Mais les écrits des néolibéraux eux-mêmes offrent une image différente – il faut les lire pour donner un sens aux manifestations politiques apparemment contradictoires auxquelles nous assistons. Nous découvrons alors que la pensée néolibérale n’est pas faite de solutions, mais de problèmes.
Les juges, les dictateurs, les banquiers ou les hommes d’affaires peuvent-ils être des gardiens fiables de l’ordre économique ? De nouvelles institutions doivent-elle être construites ou celles dont on dispose doivent-elles évoluer ? Comment faire accepter à la société une logique de marché souvent cruelle ?
La sociobiologie (…) affirmait que le comportement humain pouvait être compris par les mêmes logiques évolutives à l’oeuvre chez les animaux (…) Le destin des caractéristiques humaines peut être compris de la même manière que celui des caractéristiques animales : la pression induite par la sélection élimine les caractéristiques les moins utiles
La question qui a le plus préoccupé les néolibéraux au cours des soixante-dix dernières années est l’équilibre entre démocratie et capitalisme. Le suffrage universel était synonyme de masses enhardies, toujours prêtes à faire dérailler l’économie de marché en utilisant le vote comme « levier de chantage » auprès des politiciens, afin d’obtenir des faveurs et vidant ainsi les caisses de l’État. De nombreux néolibéraux craignaient que la démocratie n’entraîne de manière inhérente un penchant en faveur du socialisme.
Les désaccords se manifestaient à propos des institutions qui protégeraient le capitalisme de la démocratie. D’aucuns défendaient un retour à l’étalon-or, tandis que d’autres ont soutenaient que les devises devraient fluctuer librement. D’aucuns se battaient pour des politiques anti-trust conséquentes, d’autres acceptaient l’existence de monopoles. D’aucuns pensaient que les idées devaient circuler librement, d’autres plaidaient en faveur de droits de propriété intellectuelle solides. D’aucuns estimaient que la religion était une condition nécessaire à une société libérale, d’autres la considéraient comme superflue.
La plupart considéraient la famille traditionnelle comme l’unité sociale et économique de base ; d’autres exprimaient leurs désaccords. Certains percevaient le néolibéralisme comme un moyen de concevoir la meilleure Constitution possible, tandis que d’autres considéraient une Constitution démocratique comme – dans une métaphore genrée mémorable – « une ceinture de chasteté dont la clé est toujours à portée de main de celui qui la porte. »
Cependant, par rapport à d’autres mouvements politiques et intellectuels, l’absence de sérieuses divisions sectaires au sein du mouvement néolibéral était remarquable. Des années 1940 aux années 1980, le centre de gravité a plus ou moins tenu.
Le seul conflit interne majeur est survenu au début des années 1960 avec la prise de distance de l’un des principaux penseurs du mouvement et soi-disant père intellectuel de l’économie sociale de marché, l’économiste allemand Wilhelm Röpke.
La rupture de Röpke avec les autres néolibéraux, qui s’est produite alors qu’il défendait avec force l’apartheid en Afrique du Sud et qu’il adoptait les théories du racisme biologique – postulant que la culture occidentale et un héritage génétique commun étaient les conditions préalables au bon fonctionnement d’une société capitaliste – était annonciatrice de conflits ultérieurs.
Si la défense revendiquée de la race blanche était une position marginale dans les années 1960, elle reviendrait pour diviser les néolibéraux dans les décennies à venir.
S’il peut sembler à première vue contradictoire d’associer la xénophobie et le sentiment anti-migrants au néolibéralisme – philosophie supposée de l’ouverture des frontières – ce n’était pas le cas dans l’un des premiers lieux de la percée néolibérale : la Grande-Bretagne de Thatcher.
En 1978, Hayek, qui avait obtenu la citoyenneté britannique en tant qu’émigré de l’Autriche fasciste, a écrit une série d’éditoriaux soutenant l’appel de Thatcher à « mettre fin à l’immigration » avant son élection au poste de Premier ministre.
Pour faire valoir son point de vue, Hayek s’est remémoré sa Vienne natale, où il est né en 1899, se rappelant les difficultés engendrées par l’arrivée d’« un grand nombre de Juifs galiciens et polonais » avant la Première Guerre mondiale, qui n’avaient pas réussi à s’intégrer.
Il est triste mais vrai, écrit Hayek, que « quelle que soit la mesure dans laquelle l’homme moderne accepte en principe l’idéal selon lequel les mêmes règles doivent s’appliquer à tous les hommes, il ne le concède en fait qu’à ceux qu’il considère comme semblables à lui, et n’apprend que lentement à étendre l’éventail de ceux qu’il accepte comme ses semblables. »
Bien que loin d’être absolue, la suggestion de Hayek, dans les années 1970, selon laquelle une culture ou une identité de groupe partagée était nécessaire au bon fonctionnement du marché, marquait un écart par rapport à ce qui avait été considéré jusque-là comme la feuille de route d’une société néolibérale – plutôt fondée sur une notion universaliste selon laquelle les mêmes lois devraient s’appliquer à tous les êtres humains.
Cette nouvelle attitude restrictive trouva un certain écho, notamment chez les néolibéraux britanniques qui, contrairement aux tendances libérales des Américains, ont toujours penché du côté des conservateurs. Rappelons que l’opposant à l’immigration non blanche Enoch Powell était membre de la Société du Mont Pelerin et a pris la parole à plusieurs de ses réunions.
L’une des nouveautés des années 1970 fut la combinaison des valeurs conservatrices de Hayek avec les influences d’une nouvelle philosophie – la sociobiologie. La sociobiologie est née en 1975 du titre d’un livre du biologiste de Harvard, E. O. Wilson. Il affirmait que le comportement humain pouvait être compris par les mêmes logiques évolutives à l’oeuvre chez les animaux. Nous cherchons tous à maximiser la reproduction de notre propre matériel génétique. Le destin des caractéristiques humaines pouvait être compris de la même manière que celui des caractéristiques animales : la pression induite par la sélection élimine les caractéristiques les moins utiles tandis que les plus utiles se multiplient.
La sociobiologie séduisit Hayek, mais l’Autrichien ne manqua pas de remettre en question l’importance accordée aux gènes dans cette discipline. Il soutint que les changements au niveau humain s’expliquaient mieux à travers les processus de ce qu’il appelait « l’évolution culturelle. » Alors que les conservateurs américains avaient promu une union fusionnelle entre le libéralisme de marché et le conservatisme culturel dans les années 1950 et 1960 – autour du magazine de William F. Buckley, National Review -, l’ouverture de Hayek à la science allait accoucher d’une nouvelle doctrine, qui offrirait un espace conceptuel pour des emprunts épars à la psychologie évolutionniste et à l’anthropologie culturelle. Au cours des décennies suivantes, néolibéralisme et néonaturalisme se combinèrent à maintes reprises.
Le principal ennemi des néolibéraux depuis les années 1930 n’était pas l’Union soviétique mais la social-démocratie occidentale (…) Le président de la Société du Mont-Pèlerin, James M. Buchanan, déclarait en 1990 : « le socialisme est mort mais le Léviathan vit. »
Au début des années 1980, Hayek commença à évoquer la tradition comme un ingrédient nécessaire à la « bonne société. » En 1982, devant un auditoire de la Heritage Foundation, il affirmait que « notre héritage moral » était le fondement de sociétés de marché saines. En 1984, il plaida pour le retour à « un monde dans lequel non seulement la raison, mais la raison et la morale, en tant que partenaires égaux, doivent gouverner nos vies ; où la vérité de la morale est simplement une tradition morale spécifique, celle de l’Occident chrétien, qui accoucha la morale de la civilisation moderne. »
La conclusion était évidente. Certaines sociétés avaient développé des traits culturels caractéristiques tels que la responsabilité personnelle, l’ingéniosité, l’action rationnelle et une préférence pour le temps court, tandis que d’autres ne l’avaient pas fait.
Ces caractéristiques n’étant pas faciles à acquérir ou à transplanter, ces sociétés culturellement moins évoluées – en d’autres termes, le monde « en développement » – devraient, selon Hayek, faire face à une longue période de diffusion avant de rattraper l’Occident (sans garantie de succès toutefois).
Ethnie et nation
En 1989, l’Histoire s’invita et le mur de Berlin tomba. Dans le sillage de cet événement imprévu, la question de savoir si les cultures du capitalisme pouvaient être transplantées ou devaient se développer de manière organique prit toute son importance. L’art de la transition devint un nouveau domaine dans lequel les chercheurs en sciences sociales s’attelèrent au problème de la conversion des pays ex-communistes au capitalisme.
En 1991, George H. W. Bush décerna à Hayek la médaille présidentielle de la liberté, le qualifiant de « visionnaire » dont les idées furent « validées aux yeux du monde. » On aurait pu penser que les néolibéraux passeraient le reste des années 1990 à se complaire, à polir les bustes de Mises (4) pour les exposer dans les universités et les bibliothèques d’Europe de l’Est.
Pourtant, ce fut exactement le contraire. Rappelons que le principal ennemi des néolibéraux depuis les années 1930 n’était pas l’Union soviétique mais la social-démocratie occidentale. La chute du communisme signifiait que le véritable ennemi disposait de nouveaux champs d’expansion potentiels. Comme l’a déclaré le président de la Société du Mont-Pèlerin, James M. Buchanan, en 1990, « le socialisme est mort mais le Léviathan vit. »
Pour les néolibéraux, les années 1990 ont apporté trois sujets d’interrogation majeurs. Premièrement, pouvait-on attendre du bloc communiste nouvellement libéré qu’il se convertisse du jour au lendemain à la doctrine du libre marché ? Deuxièmement, l’intégration européenne allait-elle accoucher d’un néolibéralisme continental ou d’un État-providence géant ? Enfin, que faire de l’évolution démographique – une population européenne vieillissante et une population non européenne croissante ? Était-il possible que certaines cultures – et même certaines ethnies – soient mieux disposées que d’autres à l’égard du marché ?
Les années 1990 ont inauguré un clivage dans le camp néolibéral, entre les partisans des institutions supranationales comme l’UE, l’OMC ou le droit international des investissements – on pourrait les appeler les mondialistes – et ceux qui estimaient que les desseins néolibéraux étaient mieux servis par le retour à la souveraineté nationale – voire par de plus petites unités sécessionnistes. Les populistes et les libertariens qui ont fait campagne en faveur du Brexit, bien des années plus tard, sont les héritiers de cette tradition.
Les crises post-2008 ont porté à leur paroxysme les tensions entre les deux camps néolibéraux. L’arrivée de plus d’un million de réfugiés en Europe au cours de l’année 2015 a créé les conditions d’une nouvelle hybridation politique, combinant xénophobie et libre marché. Mais il est important d’être lucide sur les éléments qui sont nouveaux, et ceux qui sont hérités d’un passé récent.
La campagne de droite pour le Brexit, par exemple, s’est construite sur des fondations posées par Margaret Thatcher elle-même. Dans un célèbre discours prononcé à Bruges en 1988, Thatcher protesta : « Nous n’avons pas fait reculer les frontières de l’État en Grande-Bretagne pour les voir réapparaître au niveau européen avec un super-État exerçant une nouvelle domination depuis Bruxelles ! »
Inspiré par ce discours (et la femme qui l’avait fait chevalier), l’ancien président de la Société du Mont-Pèlerin, Lord Ralph Harris de l’Institut des affaires économiques, forma le Groupe de Bruges l’année suivante. Aujourd’hui, le site Internet de ce groupe se targue d’avoir « été le fer de lance de la bataille intellectuelle pour remporter un vote de sortie de l’Union européenne ». Les soi-disant populistes, en l’occurrence, sont donc directement issus des rangs des néolibéraux.
Alors que les partisans du Brexit font l’éloge de la nation, la référence à la nature est plus évidente en Allemagne et en Autriche. L’aspect le plus saisissant de ce nouveau paradigme est peut-être la façon dont il combine les théories néolibérales du marché avec une psychologie sociale douteuse.
Le concept de « capital-peuple », implicitement mobilisé par ces néolibéraux, attribue des moyennes de capital humain aux pays, d’une manière qui naturalise ce concept. Leur discours est complété par des allusions aux valeurs et aux traditions, impossibles à saisir en termes statistiques et à travers lesquelles ils recréent un récit autour de l’essence nationale.
À l’inverse de ce que laisse entendre l’agitation médiatique autour du « populisme de droite », nous n’avons pas affaire à une grammaire foncièrement nouvelle. Exagérer la rupture, c’est passer à côté de cette continuité fondamentale.
Cette nouvelle fusion entre néolibéralisme et néo-naturalisme rejette l’universalisme pan-humaniste du marché au profit d’une vision du monde segmentée sur la base de la culture, voire de la biologie.
Les conséquences de cette nouvelle vision de la nature humaine s’étendent, au-delà des partis populistes, aux mouvements séparatistes, à l’identitarisme et au nationalisme blanc de l’alt-right.
Moins une rupture qu’une continuité
Tous les néolibéraux n’ont pas adhéré à ce tournant vers ces concepts culturalistes ou ethnicistes. Certains se mobilisent contre ce qu’ils perçoivent comme une instrumentalisation de l’héritage cosmopolite de Hayek et von Mises. La véhémence de leurs protestations n’occulterait-elle pas le fait que ces barbares populistes, massés aux portes, ont nourris à l’intérieur même de la forteresse ?
Un exemple frappant est celui de Václav Klaus, favori du mouvement néolibéral dans les années 1990 en raison des politiques qu’il a menées en tant que ministre des Finances, Premier ministre et président de la République tchèque postcommuniste. Klaus était un fervent défenseur de la thérapie de choc pendant la transition, un membre de la Société du Mont Pèlerin et un habitué de ses séminaires. Il a toujours considéré Hayek comme son maître à penser. En 2013, Klaus est devenu chercheur émérite au Cato Institute, un bastion du libéralisme libertarien et cosmopolite.
Mais considérons le parcours de Klaus. Il commença les années 1990 en combinant la demande d’un État fort au moment de la transition vers une économie libérale, avec une profession de foi hayékienne sur le caractère inconnaissable du marché. À la fin de la décennie, il se mit à cibler de plus en plus violemment les politiques environnementales de l’Union européenne. Au début des années 2000, il était devenu un climatosceptique accompli, écrivant en 2008 un livre intitulé Planète bleue en péril vert – Qu’est-ce qui est en danger aujourd’hui : le climat ou la liberté ?
Dans les années 2010, Klaus s’éprit du mouvement populiste et commença à réclamer la fin de l’Union européenne, le retour de l’État-nation et la fermeture des frontières à l’immigration. Mais son virage bancal à droite ne l’a pas conduit à rompre avec le mouvement néolibéral organisé.
Alors même que la Société Mont-Pèlerin organisait une conférence sur « La menace populiste pour la bonne société », elle invitait en parallèle Klaus, qui soutenait que l’immigration extra-européenne menaçait « de détruire la société européenne et de créer une nouvelle Europe, très différente de l’ancienne et des idées de la Société Mont-Pèlerin. » Avec les partis d’extrême droite avec lesquels il travaille au Parlement européen, Klaus épouse les théories du libre-échange et de la libre circulation des capitaux.
En résumé, les idéologues comme Klaus sont moins des populistes que des libertariens xénophobes. Ils sont moins les ennemis du néolibéralisme que ses propres enfants, nourris de décennies de débats sur le thème de la survie et de l’expansion du capitalisme.
Ainsi, cette nouvelle doctrine fondée sur l’ethnie et la culture est la souche la plus récente du courant néolibéral : une philosophie favorable au libre marché, qui ne repose pas sur l’idée universaliste que nous sommes tous similaires, mais que nous sommes tous, par essence, différents. À l’inverse de ce que laisse entendre l’agitation médiatique autour du « populisme de droite », nous n’avons pas affaire à une grammaire foncièrement nouvelle. Exagérer la rupture, c’est passer à côté de cette continuité fondamentale.
Notes :
[1] Note de la rédaction : Notion aux contours flous, le populisme est devenu dernièrement une catégorie élastique et stigmatisante dans laquelle journalistes, éditorialistes et politiciens tendent à ranger pêle-mêle toute opposition au libéralisme – quelle que soit ses origines, ses motifs et ses orientations.
[2] On désigne par « âge d’or » les deux décennies de prospérité économique mondiale au sortir de la Seconde Guerre, période s’étant traduite par des conditions favorables pour les travailleurs : sécurité de l’emploi, salaires décents, soins de santé et pension de retraite…
[3] Dans La Route de la Servitude (titre original : The Road to Serfdom) paru en 1944, l’économiste et philosophe Friedrich Hayek soutient que l’interventionnisme de l’État a tendance à toujours empiéter davantage sur les libertés individuelles et qu’il peut progressivement conduire au totalitarisme, c’est-à-dire, à la servitude des peuples.
[4] Ludwig von Mises (1881 – 1973), économiste austro-américain, est un auteur majeur de l’école autrichienne d’économie qui défend le capitalisme et le libéralisme classique. Son nom est également attaché à la critique du socialisme, que Mises considère voué irrémédiablement à l’échec en raison de l’absence des mécanismes de fixation des prix par le marché. Friedrich Hayek compte parmi ses élèves les plus influents.